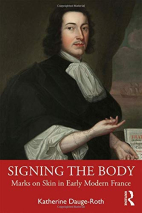
Déchiffrer les corps, inscrire l’identité : les signes cutanés à l’époque moderne
1En France, à partir de la fin du xvie siècle, s’accentue l’attention portée aux signes cutanés, qu’ils soient spontanés (marques de naissances, grains de beauté…) ou infligés par une force extérieure (cicatrices, tatouages…). La peau, déjà interprétée comme frontière entre l’individu et le monde qui l’entoure, s’avère dorénavant éminemment impressionnable. Marquée par les sentiments, par les souvenirs, ou encore par l’ordre du monde, elle est un support sur lequel il est possible d’écrire et de lire des vérités sur les individus. Dans un ouvrage foisonnant, Katherine Dauge‑Roth, associate professor en langues et littératures romanes au Bowdoin College, éclaire ce tournant corporel de l’époque moderne. Vaste chantier, ici ouvert au travers de cinq études indépendantes, minutieuses et stimulantes. La première est consacrée aux « marques du diable » dont la mention fleurit lors des procès en sorcellerie du tournant du xviie siècle (p. 27‑72). La seconde développe les stigmates laissés par les démons quittant le corps de Jeanne des Anges, lors de l’affaire des possédées de Loudun, dans les années 1630 (p. 73‑120). Une troisième concerne les pratiques du tatouage chez les populations amérindiennes de l’Amérique française, telles que documentées et parfois adoptées par des Européens dès le début du xvie siècle (p. 121‑169). La quatrième révèle l’étonnante fortune du tatouage chez les pèlerins européens à Jérusalem dès la fin du xvie siècle (p. 171‑215). Enfin, une dernière étude concerne l’étude des marques pénales tout au long de l’époque moderne (p. 217‑256).
2K. Dauge‑Roth s’inscrit dans l’historiographie foisonnante des marques corporelles, tout en œuvrant à étendre un champ jusque‑là surtout cantonné aux tatouages1 ou, de façon plus générale, peu enclin au croisement des types de signes cutanés. Son travail repose sur une idée simple : aux yeux de l’homme de l’époque moderne, il existe un lien d’inspiration ou de digression entre ces différents types d’inscriptions, malgré leur diversité apparente. Dès l’introduction, elle souligne ainsi comment la tradition française réunit sous le terme latin stigmata, au début de l’époque moderne, les cinq blessures du Christ, mais aussi les marques corporelles, distinctives ou punitives, choisies ou imposées, qu’elles soient au fer, tatouées, etc. Impressionnante variété des objets d’analyse, donc, qui trouve aussi son explication dans les contraintes inhérentes à l’étude des marques corporelles : tatouages, cicatrices et autres signes ont beau être perçus comme indélébiles, ils sont voués à disparaître avec la peau humaine elle-même. Les traces qui en subsistent ne sont donc qu’indirectes, poussant le chercheur à faire feu de tout bois. Chez Katherine Dauge‑Roth, la mobilisation de sources issues de domaines aussi variés que la jurisprudence, la démonologie, le mysticisme, le commerce, s’affirme comme une opportunité de démêler des imaginaires sociaux si variés qu’ils en semblent parfois — à tort — contradictoires. Ces coups de sonde foisonnants, répartis sur le temps long (les cinq chapitres courent du xvie siècle au xviiie siècle), sont également appuyés sur une riche bibliographie, à la fois francophone et anglophone. En conclusion de son ouvrage, l’autrice délimite trois grands axes d’analyses communs à ses études, qui viennent rétroactivement leur donner cohérence et lisibilité comme ensemble. Ils nous serviront ici de guides pour restituer la multitude de pistes d’analyse proposées.
La marque corporelle comme preuve
3Tout d’abord, K. Dauge‑Roth affirme que, dans une époque d’incertitudes et de remises en question des systèmes de pensée et de croyance (réforme protestante, guerres de religion), le corps occupe une place tout à fait singulière. Il est un signifiant stable et indéniable. Dès lors, le signe inscrit sur ce corps doit forcément signifier quelque chose. S’il est naturel, il peut entrer en résonance avec le cosmos, révéler des traits de caractère2. S’il est causé par une force extérieure, il témoigne d’un événement, qu’il s’agisse du diable laissant sur le corps d’une sorcière la signature insensible d’un pacte passé entre les deux ou d’un démon gravant les mots « Jésus, Marie, Joseph, François de Sales » en quittant le corps de Jeanne des Anges. Une marque sur le corps est la trace du moment où elle a été imprimée : elle exprime une vérité sur la vie d’un individu.
4En tant que telle, elle est aussi une preuve utilisable. En instituant la marque au fer des lettres V pour voleur, W pour voleur récidiviste, M pour mendiant, G pour gabelle et GAL pour galères, les législateurs de la loi du 4 mars 1724 entendent écrire à même le corps la preuve selon laquelle un individu a commis le crime correspondant. La marque comme preuve est aussi utilisable face à la justice, tout particulièrement dans le cadre de luttes contre des forces mystérieuses où son existence même est une affirmation de la légitimité de ces luttes. La trace laissée par le diable sur le corps de la sorcière atteste à la fois de la culpabilité de l’individu (elle autorise le passage à la torture qui aboutirait à un aveu, « reine des preuves », en confirmation) et de l’existence du diable. Par la même logique, le fait qu’il arrivait à cette marque de disparaître, qu’elle était difficilement détectable, ou qu’elle était parfois simplement inexistante, a conduit à sa remise en question au xviie siècle : elle n’était plus suffisamment tangible pour une époque attachée à l’empirisme scientifique et à l’objectivité.
5Car l’utilisation comme preuve nécessite également une certaine permanence, qu’elle soit réelle ou relative. Lorsque les pèlerins de Jérusalem se font tatouer les bras de symboles en lien avec cette expérience, ils entendent prouver qu’ils ont bien effectué ce voyage à l’aide d’un memento peu altéré par le temps. Certains entendent même repousser la fragilité du corps humain comme support pour de telles inscriptions en faisant représenter sur des portraits les dessins qui ornent leurs bras. La permanence de la marque renforce son utilisation à la fois comme témoin d’une expérience ou d’un événement, mais aussi d’une croyance ou d’une foi, d’une autorité sur son propre corps ou le corps d’un autre.
Un signe de modernité
6Cette utilisation de la marque comme preuve repose sur une tradition de l’inscription sur le corps. Elle ne provient pas de nulle part — elle est la réinterprétation et l’utilisation active de pratiques préalablement identifiées. La figure de Saint François d’Assise est ainsi étonnamment récurrente dans l’analyse. Et pour cause, les pèlerins de Jérusalem se font tatouer sous la houlette des Franciscains, ordre fondé par le saint. Jeanne des Anges, quant à elle, s’inscrit dans une longue tradition de stigmatisation instaurée dès la fin du Moyen Âge et dans une pratique de la religion qui, chez les femmes surtout, se fondait pour une large partie sur la contemplation des blessures du Christ. L’inscription de caractères ou de signes lisibles, tel qu’elle advient dans les tatouages des natifs de la Nouvelle-France ou dans la marque légale, est également le fruit d’héritages connus : à la fin du xviie siècle, la mention de la flétrissure dans les dictionnaires s’accompagne de l’évocation de la marque des esclaves à Rome et en Grèce ; et Lescarbot, observateur des tatouages amérindiens, fait référence aux Pictes et aux Pictons pour suggérer un lien direct entre tatouage de l’« Ancien Monde » et du « Nouveau Monde ».
7Mais ce renouveau de la marque du corps advient dans un univers métamorphosé par l’avènement de l’imprimerie et la circulation de documents officiels partiellement ou intégralement imprimés. La marque sur le corps est ainsi réactualisée et étroitement liée à cette nouvelle technologie. Les termes « marques », « caractères » ou « signes » désignent autant ce que l’on peut lire sur un morceau de papier que sur la peau d’un individu — une peau qui est, à cette occasion, assimilée à un parchemin. Le signe corporel est aussi reproductible grâce à des outils nouveaux. À propos des tatouages effectués à Jérusalem, l’autrice souligne qu’ils sont d’abord imprimés sur la peau grâce à des gravures proposées par le tatoueur, puis parfois réutilisés par leurs porteurs pour devenir des sceaux diffusables à grande échelle. Il est également fort probable que la personne qui fabriquait les fers destinés à marquer les condamnés était également celle qui fabriquait les caractères d’impression — d’autant plus que les fers reprenaient, par souci de lisibilité, les polices romaines mises à l’honneur en France depuis Claude Garamond.
8La marque corporelle est non seulement une forme d’impression sur la peau, mais elle partage aussi les mêmes fonctions que les documents imprimés. Authentificatrice, elle révèle le passage d’une autorité, qu’il s’agisse du diable sur la sorcière, de l’intermission de la famille divine pour libérer Jeanne des Anges, ou du roi de France et des personnes rendant justice en son nom sur le corps du condamné. Dans ce dernier cas, la marque est même un progrès par rapport aux documents officiels, puisqu’elle ne peut être perdue, détruite, ou dissociée du porteur. Loin d’être perçue comme un châtiment barbare (elle n’en était expressément pas un dans la mesure où, contrairement à d’anciens châtiments corporels, elle pouvait être dissimulée dans la vie de tous les jours), elle affirme et solidifie les mécanismes de contrôle développés par l’État. Elle s’adapte également à la nouvelle mobilité des individus. Marque-passeport, le tatouage du pèlerin évolue au fil des visites des lieux de dévotion et permet de s’affirmer comme chrétien pour trouver assistance ou se sauvegarder d’agressions potentielles. Par opposition, dans le cas des esclaves et des bagnards, l’individu, marqué comme une tête de bétail, était identifiable en cas de fuite et pouvait être ramené à son propriétaire.
Identités à fleur de peau
9Au cœur de la marque, quel que soit son type, se joue la question de l’identité. Celle‑ci peut être individuelle, sociale (la marque peut permettre de reconnaître un membre de la communauté des chrétiens, quand il s’agit de tatouages de pèlerins) ou culturelle (appartenance au monde amérindien en Nouvelle‑France). Elle est, en tout cas, lisible ou doit tendre à l’être : les chroniqueurs des tatouages amérindiens tentèrent ainsi d’établir des structures interprétatives qui leur permettraient de les décoder, à grand renfort de comparaisons avec les côtes d’armes bien connues des Européens. Derrière la marque, il y a ainsi l’idée selon laquelle elle indique quelque chose de son porteur, au-delà du simple signalement de son état (pèlerin, condamné, « sauvage », sorcière…). Elle peut ainsi signifier qu’il a été privé de sa capacité d’action (dans le cas des esclaves) ; elle peut aussi signifier qu’il a choisi de se livrer au diable lors du sabbat ; elle peut enfin signifier qu’un coureur de bois s’est « ensauvagé » au contact d’Amérindiens. Analogues à des badges ou des armoiries brodées, les marques tégumentaires sont à la fois des signes particuliers, en cela qu’elles permettent de reconnaître un individu, et un aveu du corps : elles sont destinées à être lues, que cela soit de façon positive (en signalant la sainteté, le statut, la dévotion) ou négative (en signalant le crime, l’esclavage, etc.).
10En effet, la coexistence de différents types de marques corporelles implique la possibilité d’adopter par leur biais différents rôles préexistants et de négocier des relations de pouvoir en s’inscrivant dans des traditions religieuses ou séculaires. Le cas de Jeanne des Anges est particulièrement parlant. Femme ayant vécu une situation de vulnérabilité profonde — la possession —, elle rédige un récit autobiographique, complément naturel des inscriptions sur sa peau, où elle se met en scène aux côtés de son ange gardien comme agent de sa propre libération et du choix de marques liées à des personnalités positives. Par ce choix d’un type d’inscription qui s’apparente fortement à la stigmatisation divine, Jeanne des Anges et son ordre deviennent les objets d’une attention positive. Les identités volontairement forgées peuvent aussi être inédites. Les coureurs de bois et autres Européens en contact étroit avec les populations amérindiennes choisissaient parfois de se faire tatouer, signe d’acculturation volontaire et moyen de bénéficier de contacts facilités avec leurs interlocuteurs. Mais, en choisissant des motifs européens ou catholiques, ils forgeaient surtout une identité culturelle qui leur était propre et fondamentalement nord-américaine. La marque corporelle, sa banalisation et la multiplication de ses occurrences et de ses significations possibles constituaient ainsi une opportunité pour des individus de devenir des agents de leur propre inscription corporelle.
***
11Foisonnant travail, donc, que celui de Katherine Dauge‑Roth, où les événements se croisent, coexistent ou se succèdent dans une juxtaposition qui interroge parfois et stimule souvent. Y apparaît, en germe, la richesse d’utilisation et d’interprétation que connaît le tatouage à partir du xixe siècle en France, plus que jamais utilisé comme signe d’identification dans un système de « bertillonnage » des corps et de fièvre classificatrice de l’anthropologie criminelle. Difficile de ne pas songer, par exemple, à l’œuvre d’Alexandre Lacassagne qui, avec des ouvrages tels que Les Tatouages. Étude anthropologique et médico‑légale, en 1881, entreprend de trouver un sens à ce qu’il appelle d’ailleurs des « cicatrices parlantes »3. Poursuite de la même quête de preuve, de modernité et d’identité, dans un ensemble de pratiques déjà anciennes et reconnues comme telles. À ce titre, l’ouvrage participe également à la réfutation d’un mythe tenace, selon lequel les tatouages et l’ensemble des marques qui y sont liés n’auraient été « découverts » qu’à la faveur des voyages du capitaine James Cook en Polynésie à la fin du xviiie siècle4.
12Le corps, objet changeant et périssable, apparaît ici analysable dans son individualité, en tant que surface où s’imprime une vie, grâce à la mobilisation de divers domaines des sciences humaines (le livre, classé comme étude littéraire, tient également de l’analyse historique, touche aux visual studies, etc.). Si Katherine Dauge‑Roth s’intéresse d’abord aux multiples imaginaires sociaux qui entourent l’inscription du corps, elle n’en écarte pas pour autant les trajectoires individuelles, qu’il s’agisse de celle de Jeanne des Anges, du pèlerin anonyme dont le portrait orne la couverture de l’ouvrage, ou des multiples individus, rarement nommables, qui utilisent ou subissent telle ou telle marque. Le travail de l’autrice, à terme, a des allures d’invitation à étudier l’objet‑corps dans toute sa complexité et comme partie intégrante de l’existence d’un individu.

