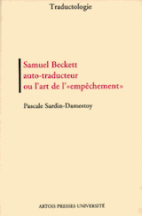
Beckett au travail
1Ce compte‑rendu est publié avec l’aimable autorisation de la revue de l’AILC Recherche Littéraire/Literary Research.
2L’œuvre de Beckett, célébrée en France depuis la première d’En attendant Godot, voici tout juste cinquante ans, reste pourtant, du moins dans son pays d’accueil, méconnue, partiellement occultée. S’il n’est pas question de nier ici le rôle tout à fait essentiel joué par Jérôme Lindon dans la diffusion de l’œuvre beckettienne, il faut cependant noter que les choix mêmes de sa maison d’édition (et, partiellement, de l’auteur lui‑même) n’ont pas toujours permis d’apprécier cette œuvre multiple et foisonnante dans toute son étendue et dans toutes ses variations. Rappelons simplement que nombre de textes, rédigés en anglais, n’ont jamais été publiés en France ou commencent seulement à l’être, comme More Pricks than Kicks (Bande et sarabande, 1994), Three Dialogues (Trois Dialogues, 1998) ou Echo’s Bones and other Precipitates (Les Os d’Écho et autres précipités, 2002), tous traduits par Édith Fournier après la mort de Beckett. Des ouvrages aussi importants que Dream of Fair to middling Women ou Disjecta. Miscellaneous Writings and a Dramatic Fragment, cités pourtant par tous les critiques, attendent encore leur publication en France, alors que ces textes ont souvent été traduits depuis plusieurs années en d’autres langues. Le fait qu’il manque aussi, pour la plupart des textes, une édition critique qui rende compte des changements effectués par l’auteur dans ses propres livres, parfois même après la première publication — tel est notamment le cas d’En attendant Godot, dont le premier tirage se distingue par endroits des tirages (et non des éditions !) subséquents — n’arrange pas les choses et ne permet que difficilement de comprendre que l’écrivain Beckett n’est pas simplement tombé du ciel pour s’établir, après la seconde guerre mondiale, comme l’un des plus grands écrivains français. Au portrait d’un écrivain en train de construire patiemment son œuvre, on a le plus souvent préféré substituer une image mythique, profondément atemporelle et passablement aseptisée, à laquelle la couverture sobre des éditions de Minuit semblait prédestinée.
3Depuis quelques années, on voit toutefois paraître des études visant à présenter les faces cachées non seulement de l’auteur lui‑même, mais de son œuvre. La plupart de ces travaux nous viennent du monde anglo‑saxon, où se trouvent la presque totalité des archives consacrées à l’écrivain : de Reading en Grande‑Bretagne, où Jim Knowlson, John Pilling et Mary Bryden ont patiemment construit, depuis 1971, la plus importante collection de manuscrits et d’études (cf. le catalogue Beckett at Reading, établi en 1998), mais aussi de l’Université de Texas à Austin (cf. le catalogue No symbols where none intended, 1984). Parmi les publications les plus importantes qui donnent accès aux manuscrits et, de façon générale, à l’œuvre de Beckett considérée sous l’angle d’un work in progress (ou regress), il faut mentionner au moins les magnifiques Theatrical Notebooks en 4 volumes, les éditions bilingues de Compagnie, Solo et Mal vu mal dit établies par Charles Krance, ainsi que les travaux fondamentaux d’Enoch Brater, Stan Gontarski, John Pilling et Rosemary Pountney. En France, signalons l’ouvrage de Pascale Casanova (1997), qui a permis, grâce à son approche sociologique, d’historiciser l’œuvre beckettienne, et à présent l’ouvrage que Pascale Sardin‑Damestoy vient de consacrer à Beckett auto‑traducteur.
4Aborder l’œuvre de Beckett sous l’angle de ce qu’on appelle son bilinguisme ne constitue pas en soi une nouveauté. Après l’essai de Ruby Cohn consacré dès 1961 à « Samuel Beckett Self‑Translator » et l’important volume collectif Beckett Translating/Translating Beckett paru en 1987, Brian T. Fitch (1988), Michael Edwards (1998) et Linda Collinge (2000) — ces deux derniers ne sont d’ailleurs pas mentionnés dans la bibliographie (trop) sommaire de Pascale Sardin‑Damestoy — se sont penchés sur le phénomène de l’auto‑traduction qui marque l’œuvre beckettienne de l’après‑guerre. L’originalité de l’ouvrage de Pascale Sardin‑Damestoy réside avant tout dans la décision de combiner l’approche traductologique, qui compare les versions française et anglaise des textes courts auto‑traduits, avec une analyse génétique des manuscrits, ce qui permet de considérer les textes à la fois dans leur dimension synchronique (comme des variantes existant simultanément) et dans leur évolution (comme des variantes successives). De plus, Sardin‑Damestoy a décidé d’aborder le problème de la coexistence de plusieurs variantes du texte non de façon chronologique, mais à travers une série de questions poétologiques, puisqu’elle voit avec raison dans l’activité d’auto‑traduction de Beckett non un simple souci d’être présent sur deux marchés littéraires, mais un véritable art qui participe pleinement à la création de cette « écriture de l’intermittence » pratiquée par Beckett. « Chez cet auteur, la réécriture est inscrite dans l’écriture même. L’auto‑traduction est un travail de (mal)‑citation de soi prolongeant le travail intra- et intertextuel déjà inscrit dans une œuvre qui n’a de cesse de se citer d’un texte à l’autre » (p. 217). Sardin‑Damestoy reprend alors à propos de Beckett auto‑traducteur la célèbre expression « art de l’empêchement » que Beckett avait forgée pour décrire le travail de ses amis peintres Bram et Geer van Velde :
La traduction est un art de l’empêchement voué à l’imperfection et à l’inachèvement ; l’auto‑traduction, un art insatisfaisant et frustrant qui a pourtant occupé toute la carrière littéraire de Samuel Beckett, pour s’imposer au fil des années comme principe évolutif de son œuvre » (Ibid.).
5L’étude de Pascale Sardin‑Damestoy se partage en trois parties suivies en annexes des dossiers génétiques élaborés dans le cadre d’un séjour de documentation à Reading.
6Dans la première partie, qui prolonge l’introduction et pose les bases du travail subséquent, le problème de l’auto‑traduction beckettienne est abordé de façon générale. Le critique y constate avec raison que l’écriture bilingue anglais‑français accompagne l’écrivain dès ses débuts, sans pourtant commenter le fait que le premier texte auto‑traduit est, curieusement, le poème « Cascando », traduit par Beckett dès 1936 de l’anglais en … allemand. On est également surpris de voir que l’intense activité de traducteur d’autrui ne se trouve mentionnée qu’en passant, alors que l’on connaît les célèbres traductions d’Éluard, de Rimbaud, d’Apollinaire et de Chamfort, et que dans une étude récente, quoique contestée, Beckett in Black and Red : Samuel Beckett’s Translations for Nancy Cunard’s « Negro » (1999), Alan Friedman a tenté de montrer que ces traductions ne sont pas dépourvues d’intérêt pour qui s’intéresse à l’évolution de la poétique beckettienne. Même si le choix du critique de se concentrer sur les textes courts datant de 1946 à 1980 paraît par ailleurs tout à fait raisonnable et pleinement suffisant, il aurait été souhaitable de confronter, pour mieux en comprendre les différences poétologiques, l’activité de Beckett auto‑traducteur à celle de Beckett traducteur d’autrui. La question de l’impossible fidélité semble bien être la même dans les deux cas, comme l’est aussi la stratégie de détournement ou de « perversion » qui marque l’attitude de Beckett par rapport au texte‑source. La disposition de Beckett face à ce travail « perdu d’avance » qu’est la traduction est en tout cas hautement ambivalente, comme le montre de façon très convaincante le chapitre II de l’étude consacré au mélange de compulsion et de répulsion avec lequel l’auteur s’attelle, toujours à nouveau, à sa tâche.
7La seconde partie de l’étude, placée sous le signe de la « parôdia », analyse l’art de Beckett successivement sous l’aspect syntagmatique (chapitre III) et paradigmatique (chapitre IV). « En s’auto‑traduisant, Beckett réorganise l’axe syntagmatique du discours : il s’en prend à la syntaxe, à l’ordre des mots et des groupes de mots. » Le passage vers la langue-cible produit une nouvelle combinaison, un nouveau rythme qui se souvient pourtant des idiosyncrasies de la langue‑source. Ainsi, à titre d’exemple, Beckett traduit la phrase française « il ne voulait pas qu’on le trouve » par une phrase anglaise parfaitement inhabituelle, « he usen’t to want to find him », produisant une syntaxe défamiliarisée. À d’autres endroits, Beckett choisit d’allonger ou au contraire de raccourcir le texte original, comme le montre son travail sur la nouvelle Premier Amour, un texte datant de fin 1946, mais que Beckett n’accepte de publier qu’en 1970 et de traduire en 1972. A côté de ce travail sur l’axe syntagmatique, on constate également une tendance à changer de ton en passant d’une langue à l’autre. Ici encore, Premier Amour livre quelques exemples particulièrement intéressants, comme ce passage où Beckett traduit l’expression familière « casser la croûte » par « to lunch lightly ». Le critique voit ici à l’œuvre un véritable « principe de la dissonance », qui vise à accroître les tensions entre les différents registres employés. À cela s’ajoute une tendance à l’assombrissement et une accentuation des sarcasmes du narrateur, comme quand il traduit l’expression « all the others » dans Eh Joe par « toute la chiennerie ».
8Dans la troisième et dernière partie de l’étude, ce travail de « décentrement langagier » est rapproché du décentrement du sujet beckettien, ce qui amène le critique à passer de l’analyse comparatiste à une interprétation de type psychologique. La traduction de soi est interprétée ici comme un élément constitutif de la poétique du décentrement, qui se manifeste par un travail sur la temporalité, sur l’espace et sur les lois de la logique. L’aliénation du sujet beckettien, déjà analysée par de nombreux critiques, se retrouve ainsi au niveau d’un travail sur les pronoms personnels, comme le montre la comparaison génétique d’un texte en prose intitulé Old Earth, où Beckett hésite entre les pronoms « it », « her » et « you » pour parler de la terre. L’aliénation peut même déboucher sur un état proche de la psychose, comme l’affirme Pascale Sardin‑Damestoy dans le dernier chapitre de son étude. « Les personnages beckettiens, d’un texte à l’autre, d’une langue à l’autre, nous parlent le langage délié de l’inconscient » (p. 191). On aurait cependant souhaité que le critique nous livre plus d’exemples où la comparaison des différentes versions du texte permette d’étayer ce type d’affirmation.
***
9L’analyse par « zones signifiantes » que propose l’étude de Pascale Sardin‑Damestoy permet de jeter une lumière précieuse sur le travail d’écrivain de Beckett, travail qui est effectivement inséparable de l’entreprise d’auto‑traduction. Lire les textes jumeaux en parallèle, comme le propose le critique, constitue une étape importante dans l’observation de l’écrivain au travail. Si l’analyse traductive et génétique paraît parfois instrumentalisée au profit d’une interprétation globale de l’œuvre, elle permet cependant, là où elle est menée de façon systématique et sans parti pris théorique, de nous livrer des informations indispensables sur la façon dont Beckett a élaboré ses textes.

