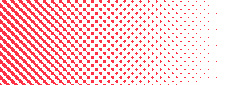« Une fois encore, la poésie m’obsède. » Bronisław Malinowski, poète polonais
« Malinowski ayant peur de la vie ». De la maladie infantile aux premiers voyages exotiques
Tu étais tellement comique avec ta concentration enragée,
à ton retour d’Afrique1
1Strach życia u Malinowskiego (« Malinowski ayant peur de la vie ») est le titre d’un portrait de Bronisław Malinowski (1884‑1942) à vingt ans à peine, peint par le dramaturge, peintre et philosophe Stanisłas Ignacy Witkiewicz (1885‑1939), son ami intime, qui nous donne en filigrane un indice sur le bouillonnant monde intérieur du futur anthropologue, avant leur départ commun pour les « Tropiques »2. Ces premières années du siècle sont une période au cours de laquelle Malinowski cherche, malgré une santé des plus fragiles, à assouvir ses pulsions littéraires et poétiques, tout en poursuivant avec ferveur des études philosophiques et scientifiques, et en entreprenant des voyages en Europe et des séjours en Afrique, accompagné par sa mère3. Ainsi sa fille Helena Malinowska4 évoque‑t‑elle son père et un passé polonais pour elle inatteignable : « Je me demande : pourquoi aussi peu de polonité dans la maison où nous avons grandi, mes sœurs et moi ? Nous savions si peu de choses de la jeunesse de notre père loin d’ici, mise à part une profonde dévotion pour une mère remarquable et un lieu mystique, Zakopane, au milieu des montagnes magiques qu’il avait aimées. »
2La « mère remarquable » est Józefa Eleonora Łącka (1848‑1918), trente‑six ans à la naissance du premier et dernier fils, Bronisław Kaspar dit familièrement Bronio ou Broniek, qui vécut son enfance et son adolescence entre Cracovie — résidence familiale —, Zakopane — le lieu montagneux évoqué par sa fille cadette —, et Varsovie — demeure de la prestigieuse famille maternelle. Appartenant à l’ancienne aristocratie terrienne, la szlachta5, la parentèle maternelle maintenait une certaine aisance matérielle si on la compare à d’autres maisonnées nobles et déclassées, comme celle des Malinowski. De sa mère, Malinowski hérita le goût des langues, un signe distinctif de la kultura szclachetna (« culture aristocrate ») d’une part, de l’autre l’expression d’une habileté linguistique hors du commun : le français, l’allemand, l’anglais, le russe, un peu d’italien et d’espagnol (appris durant les voyages en Istrie et Dalmatie, régions des Balkans alors italiennes, à Florence, à Pise et à Rome, et durant le séjour aux Iles Canaries avec son fils) constituaient les langues vivantes dans lesquelles mère et fils savaient s’exprimer.
3Dans le roman autobiographique 622 Upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta (Les 622 Chutes de Bungo ou la Femme démoniaque), que Witkiewicz6 écrivit en 1910 — et qui fut publié uniquement après sa mort en 1972, en raison de références trop explicites à des personnes vivantes7 — le personnage du duc de Nervermore incarne Malinowski. Ce dernier y est refiguré comme un polyglotte, voltigeant agilement entre les divers idiomes néo‑latins, slaves ou germaniques dans ses conversations ordinaires, et fredonnant une chanson en arabe. Outre sa capacité à maîtriser les langues anciennes — le grec et le latin8 —, enfant, Malinowski avait appris le gawra, le patois des montagnards des monts Tatras, en pâturant avec les petits bergers et en fréquentant leurs habitations en bois à Zakopane.
4On trouvait également cet intérêt pour les langues chez son père, Lucjan Felix Jan Malinowski (1839‑1898), devenu professeur de philologie slave au sein de la prestigieuse Université Jagellone de Cracovie, après avoir étudié en Allemagne et en Russie. Il avait effectué des recherches ethnographiques et dialectologiques en Silésie pour sa thèse soutenue en 1872 à Leipzig. Mort prématurément en 1888, sa monumentale collecte de folklore, chants et traditions montagnardes polonaises ne fut jamais entièrement publiée9.
5Après la disparition de son mari, comme quelques autres femmes dans une position sociale avantageuse au tournant des XIXe et XXe siècles, Józefa Malinowska put voyager vers les pays méditerranéens, maghrébins et africains, en compagnie de son fils, pour qu’il complète sa formation par des voyages d’instruction tout en soignant une santé fragile. Donné pour mort à quatorze mois, Malinowski avait en effet souffert de troubles de santé tout au long de son enfance et de son adolescence. À quatre ans, il avait de fréquentes douleurs au ventre et faisait des convulsions ; en 1892, à huit ans, lui est diagnostiqué un abcès intestinal. Il est opéré une première fois. La seconde fois, ce sera pour une péritonite et d’autres abcès intestinaux secondaires, à seize ans. En 1890, une inflammation des nerfs optiques se déclare et le plonge dans un état de semi‑aveuglement. En dépit de son infirmité, il parvient à terminer ses études grâce au soutien de sa mère qui l’aide à préparer son baccalauréat en lui faisant la lecture.
6Le « corps pathétique10 » du jeune poète Malinowski est un trait distinctif qui le singularise aux yeux de sa compagnie d’amis, et les passages de l’ouvrage de Witkiewicz dédiés à ses ennuis de santé sont récurrents : « Le duc souffrait d’une maladie chronique aux yeux, l’un des plus terribles spectres contre lesquels il luttait11 » ; ou encore :
Il dominait son astigmatisme en penchant légèrement la tête, et son visage empreint d’une terrible force de volonté exprimait la nostalgie d’assouvir tous les appétits vitaux, ce à quoi s’opposait une santé chancelante depuis trente‑six générations12.
7L’annotation méthodique dans son cahier des substances chimiques à usage médical qu’il s’auto‑administrait (arsenic, bromide, iode, calomel, quinine, cocaïne, morphine, aspirine, sel d’Epsom, calomel), les séances de gymnastique quotidienne, et jusqu’au fait d’épouser une infirmière13, Elsie Rosaline Masson (1890‑1935), constituent autant d’éléments qui indiquent une préoccupation constante pour son état de santé.
8Une telle inquiétude, unie à des périodes de réclusion dans l’obscurité d’une chambre qui soulageait ses yeux, lui firent vivre, d’après M. Young14, une jeunesse relativement à l’abri des excès de la « vie de Bohème » que vivait la jeunesse étudiante et artiste de Cracovie, en fréquentant des cabarets comme le Ziełony Balonik (« Petit ballon vert »). Des détails apparemment insignifiants de son apparence — il portait les cheveux coupés très courts à une époque où la mode masculine « alternative » allait dans le sens opposé — le distinguaient aussi des jeunes artistes. Enfin, la proximité fusionnelle avec une mère désormais veuve15, et qui était sa principale compagne de voyage, finissait de le situer à part.
9À partir de 1899, à seize ans, et justement pour raisons de santé, Malinowski put voyager en Méditerranée (Italie, France, Balkans), en Asie Mineure (Constantinople), au Maghreb (Tunisie et Algérie, en particulier à Biskra), au Machrek (Egypte pour six mois), en Afrique occidentale (dix‑huit mois aux Iles Canaries16), pour une période totale d’environ trois ans. Cette expérience de premiers voyages en pays « exotiques » fut suivie d’une année postdoctorale en Allemagne (1909‑1910)17 et de quatre ans en Angleterre (1910‑1914), ponctués par des séjours à Zakopane. Ainsi, le profil polyglotte s’était enrichi avec le temps, et avant le départ pour le Pacifique, de la figure d’un Malinowski cosmopolite.
10Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Breña Baja étaient par ailleurs considérées comme des destinations rares, lointaines et assez aventureuses pour des voyages destinés à rétablir la santé. Si d’un côté le choix d’une destination africaine peut être attribué à l’influence de l’écrivain polono‑anglais Joseph Conrad, dont il souhaitait devenir pour l’anthropologie britannique l’homologue de ce qu’avait été ce dernier pour la littérature anglaise18, il est également possible qu’il s’agisse d’une façon de mettre à l’épreuve l’enfant malade qu’il avait été, en défiant ses limites. Son amie Kazimiera Żulawska nous fournit des témoignages éclairants à cet égard, en nous décrivant la détermination du jeune Malinowski dans les efforts sportifs, tandis qu’il escaladait les montagnes des Tatras, aux alentours de Zakopane. Voulait‑il vaincre « la peur de la vie » qu’avait devinée en lui Witkciewicz dans le titre de son tableau ?
11Bien que le rayonnement international de sa carrière l’ait projeté loin de la Pologne, en Angleterre, puis aux États‑Unis jusqu’à sa mort prématurée à New Haven en 1942 et que ses voyages l’aient conduit en Afrique, puis en Mélanésie, Malinowski conserva une certaine fascination pour ce que nous pourrions appeler l’« exotique domestique » des petites communautés alpines, acquérant une maison dans le Sud‑Tyrol italien, à l’instar de son père qui, dans les années 1890, avait acheté une demeure à Zakopane dans les Carpates.
« Un lieu mystique, Zakopane, entre montagnes magiques »
Mia solitùdin a l’é ‘n cel
Cunà dai vent ch’a crijo ‘l nòrd
Andoa a rampio fra j’asard
Le nostalgìe d’un montagnard19
(Chanson piémontaise)
Un fort coup de vent m’a réveillé en pleine nuit. Vers le matin, j’ai revu en rêve mes figures idéales : Zenia, T., N.20, toutes endormies dans une même chambre […] cela se passait quelque part entre Zakopane et la Nouvelle Guinée21.
12Citée à plusieurs reprises dans les carnets de terrain à Mailu et aux Iles Trobriands, Zakopane, une ville d’eau des Carpates située à 40 km de Cracovie, était à l’époque de l’adolescence et de la première jeunesse de Malinowski une colonie d’artistes, d’écrivains et de patriotes du Sud polonais, sous domination austro‑hongroise. S’y rencontraient les intellectuels de la génération de son père, adhérant en grande partie à la Jeune Pologne (Młoda Polska), mouvement littéraire et artistique moderniste qui promouvait le néo‑romantisme, le symbolisme et l’art nouveau en réaction au positivisme, au scientisme et au réalisme qui avaient marqué la seconde partie du xixe siècle. Ses idéaux sont exprimés dans la revue Życie (« Vie »), organe officiel du mouvement, éditée par Kazimierz Tetmajer (1865‑1940) que Malinowski connut à Zakopane, avec d’autres, comme le poète, dramaturge et traducteur Jan Kasprowicz (1860‑1926), malgré la différence d’âge qui les séparait. Pénétrés de profonds sentiments patriotiques pour une nation qui avait perdu son intégrité territoriale et qui aspirait à la reconquérir, ils s’intéressaient au folklore et aux croyances populaires en un monde fantastique de feux follets et de démons.
13Alors que les élites polyglottes se formaient dans les universités qui les éduquaient à la culture des « vainqueurs », comme la philosophie allemande et autrichienne que Malinowski avait étudiée, les couches populaires — les paysans Chłopi et les montagnards dits Gorale22 — semblaient d’une certaine manière préservées et étaient idéalisées comme les dépositaires des traditions polonaises ancestrales. Célèbre fut le cas du barde des Gorale, Jan Krzeptowski Sabała, dont Malinowski fit la rencontre. Ce dernier était vénéré comme l’Homère23 de Zakopane et devint un habitué de la famille d’artistes à laquelle appartenait Stanisław Ignacy Witkiewicz. Cette fascination des élites pour les couches populaires avait atteint un tel degré qu’on l’avait qualifié en Galicie polonaise de chłopomania, littéralement la « paysanomanie », l’« amour fou » pour la paysannerie, ses coutumes et ses traditions. Ses adeptes étaient connus sous le nom de chłopomani : jeunes urbanisés d’excellente famille, ils rejetaient leur appartenance sociale, habitant, mangeant, s’habillant et parfois parlant24 comme des fermiers. Après l’échec de l’insurrection anti‑russe de 1863 dans la Pologne occupée, essentiellement dû à une défection populaire, il semblait maintenant prioritaire pour les patriotes polonais aisés de développer une fusion avec les classes laborieuses pour réussir leur lutte indépendantiste25.
14Un des poètes les plus connus de la Jeune Pologne fut Lucjan Rydel (1833‑1895) qui porta loin ses idéaux en épousant Jadwiga Mikołajczykówna (1883‑1936), une paysanne de dix‑sept ans dont la sœur, Anna, avait épousé Tetmajer. Si d’un côté un tel mariage fut immortalisé dans une des pièces les plus originales du théâtre polonais, Wesele (Les Noces)26, écrite par Wyspiański27, d’un autre côté Rydel et ses œuvres firent l’objet d’un boycott à Cracovie, sans parler de la dérision et des sarcasmes dont ils furent la cible. Cette atmosphère est décrite par un ami plus âgé de Malinowski, Tadeusz Boy‑Żeleński (1874‑1941)28, poète satiriste et chansonnier au cabaret Zielony Balonik, qui ridiculisait les difficultés de Rydel à s’adapter à la vie villageoise. Malinowski s’inscrit dans le mouvement de cette critique à l’encontre de la Jeune Pologne et de Rydel lorsqu’il décrit sa vie et celle de ces amis à Zakopane, loin des divertissements de Cracovie29 :
Ici, dans la retraite de nos bordels
où seulement la pluie nous importune comme les paysans.30
15On retrouve la même distance dans les vers suivants, qui laissent entendre l’appréciation de Malinowski en un dialogue imaginé avec un ami qui lui demande si les vers de Rydel et Tetmayer sont des exemples pour la jeune génération :
Quelque chose comme le vers de Rydel ou de Tetmajer ?
Non, un peu mieux, comme Poe.31
16Si Malinowski caricaturait les idéaux de la génération précédente, son attachement à la paysannerie et aux traditions ancestrales, il n’en était pas moins caustique envers les jeunes poètes ses amis et envers lui‑même, et assez lucide : « Il y a eu toujours quelque chose de tendu dans mes rapports avec Mère, avec Staś [Witkiewicz], avec tous mes amis. »32 Il se savait en peine d’écrire de la bonne poésie, comme en témoignent ces vers adressés à Tadeuz Nalepiński (1885‑1918), son camarade au lycée Sobieski de Cracovie, qui deviendrait poète et écrivain expressionniste33 :
Tu sais quelle sympathie sincère j’éprouve pour toi,
Et je sais pourquoi tu es aussi notoire au Parnasse
Au point que parfois une vaine jalousie me ravit
Pour les bons papiers qui t’ont réussi
Alors que je m’agite toujours autour du zéro.34
17Le regard ironique qu’il porte sur sa propre œuvre n’est pas moins sévère envers ses proches, comme dans ces vers où il critique une pièce de théâtre écrite par Nalepiński :
Ne sois pas méchant avec moi [après ce que je t’aurai dit] — ma volonté sincère
est que tu ne descendes pas plus en bas que l’un — jusqu’au zéro.35
18Il pouvait lui reprocher aussi un manque de profondeur théorique dans son œuvre dramaturgique, comme il l’explicite dans ces vers où il introduit des commentaires qui traduisent le jugement du philosophe et du scientifique36 :
Dans ce drame un peu me manquent les embrouillements de la profondeur,
La pensée est affirmative trop peu pondérée37.
19Parmi les autres amis qui gravitaient autour de Malinowski et de Witkiewicz, figure également Léon Chwistek (1884‑1944), alias le Baron Brummel de Buffadero‑Bluff des 622 Chutes de Bungo, et qui deviendra peintre, philosophe, mathématicien et logicien, s’attirant l’estime de Bertrand Russel grâce à l’intercession duquel il obtiendra une chaire à l’Université de Lwow en 192938. Un autre ami, gravitant à Zakopane à la charnière des deux siècles, cité dans la poésie malinowskienne, est Tadeusz Szymberski (1881‑1943), dit Tadzio, poète et dramaturge qui dans Les 622 Chutes de Bungo figure sous le nom de Tzimberski. Il épousa la peintre Zosia39 avec qui il vécut à Paris, dans la pauvreté, et Malinowski venu de Londres lui rendit visite dans le quartier de Montparnasse, à plusieurs reprises dans l’entre‑deux guerres. Dans les vers qui suivent, Malinowski le cite explicitement, lorsqu’il donne des conseils d’écriture poétique à Nalepiński, en mêlant à la poésie des commentaires plus analytiques :
Le courant principal des événements — un fleuve enflé,
Le spectateur doit être entraîné, sans comprendre
Et demeurer comme Szymberski en présence du visage du Seigneur
Par intermittence, j’ai l’obscure conviction,
que là nul n’advienne bien qu’il advienne.40
20Le cercle des amis de Malinowski à Zakopane comprenait également le premier écrivain polonais de science‑fiction, Jerzy Żuławski (1874‑1915), qui composa La Trilogie Lunaire et épousa une amie de Malinowski, Kazimiera Hanicka, qui tenait un salon littéraire dans leur villa Łada à Zakopane.
Le « gai savoir » du jeune Malinowski
21Si ce groupe d’amis comprenait des talents variés pour les arts et la littérature, l’héritage scientifique paternel de Malinowski et la détermination maternelle à le voir réussir ses études, ont sans doute fait qu’il s’investît dans les études universitaires avec une ferveur particulière. Inscrit à la faculté de philosophie en 1902, il suivit des enseignements de chimie, mathématiques et géométrie, pour ensuite s’intéresser en 1904 à la philosophie autrichienne du Cercle de Vienne, notamment au néo‑positivisme logique d’E. Mach (1838‑1916) et à l’empiro‑criticisme de R. Avenarius (1843‑1896). Cependant, sa poésie avait gardé les traces des enthousiasmes nietzschéens de sa première jeunesse41, dont on trouve ensuite des échos plus indirects. Une telle influence est transparente, par exemple, dans les vers suivants :
Que ta Muse engendre une fois de plus,
ou qu’elle avorte de nouveau des étoiles dansantes.42
22Dans Les 622 Chutes de Bungo, la célèbre référence nietzschéenne à l’accouchement d’une étoile dansante contenue dans le prologue de Ainsi parla Zarathoustra. Un livre pour tous et pour personne (1883) est explicitée par Bungo, pour clore un long échange avec le Duc de Nevermore sur la création artistique : « Nietzsche a dit: Pour donner naissance à une étoile dansante, il faut avoir en soi le chaos43 ».
23Les étoiles, très présentes chez Nietzsche44, faisaient l’objet de commentaires de la part des citadins passionnés de cieux nocturnes de montagne, tels Malinowski et Witkiewicz. Une lettre de terrain en Nouvelle‑Guinée, adressée à sa future épouse Elsie Rosaline, laisse transparaître cet intérêt dans un moment de nostalgie pour la Pologne et sa langue45 :
Les cieux sont merveilleux : Vénus à l’ouest, Jupiter qui sort après sept heures et Orion une heure après et tout cela produit le plus beau ciel de l’année. En Pologne, le plus beau est le ciel hivernal et je me souviens si bien d’Orion et Sirius hauts dans les cieux sur la neige qui couvrait les champs à Zakopane. Witkiewicz était un spécialiste des constellations et des noms d’étoiles et avait une bonne connaissance générale de l’astronomie et nous avions l’habitude de parler des étoiles et d’admirer le ciel.
24Les références nietzschéennes abondent également dans la production épistolaire et littéraire de la famille Witkiewicz, comme le montrent les lettres que le jeune ami de Malinowski recevait de son père, qui lui citait des aphorismes (« Il faut avoir besoin d'être fort : autrement, on ne le devient jamais »), ou le roman de Witkiewicz fils, Pozegnanie jesieni (« Adieu à l’automne », 1927), où le protagoniste Atanazy mentionne également le philosophe allemand46.
25Malinowski définit ainsi la première période de sa jeunesse comme une « période nietzschéenne » dans son carnet ainsi que dans une lettre adressée à son professeur Roman Pawlicki, dont il avait suivi en 1904‑1905 le cours sur Friedrich Nietzsche, qui lui inspirera son premier essai académique47 autour La Naissance de la Tragédie à partir de l’esprit de musique48 (1871). Ainsi, ce n’est pas seulement par les thèmes (le corps, la mort de Dieu, le dionysiaque, etc.) que Nietzsche avait visiblement influencé la production littéraire et scientifique, et pénétré la perception du monde de Malinowski et de ses amis. C’était d’abord par sa manière d’écrire des ouvrages où la philosophie se faisait provocatrice et expérimentale. Nietzsche écrivait en effet dans une prose poétique, riche d’aphorismes, où il intercalait des poèmes au milieu de la prose, en mettant sur le même plan écriture philosophique et écriture poétique, effet de son admiration pour les présocratiques, Héraclite et Empédocle spécialement. Par ailleurs, la relation entre l’art et la connaissance est un thème transversal à toute sa production, de La Naissance de la tragédie à Vérité et Mensonge au sens extra‑moral49, où il revendique l’art comme forme de connaissance et promeut la figure du « philosophe artiste », en invitant à abandonner le genre de vie théorique (qui prône une connaissance par le concept) et à lui substituer un genre de vie artistique (connaissance par les sensations).
26Nietzsche avait ainsi nourri Malinowski de l’esprit des présocratiques, et de la philosophie antique plus généralement sans doute. Certains de ses vers ont des accents démocritéens et pythagoriciens :
Au même moment Ananké vous a ouvert la porte
Indiquant la route des esprits vers une étendue de nébuleuses, dans l’au‑delà
Un abîme, où l’infinitude s’entrelace parallèlement50.Chaque homme porte en soi une mélodie secrète
Dont lui seul devine les sons ; parfois il perçoit les échos
Comme lentement ils imprègnent l’obscurité d’un silence intérieur
Alors que l’âme descend vers la nuit souterraine des nostalgies51.
27La fréquentation du cours de Pawlinski de 1905‑1906 dédié à la philosophie aristotélicienne avait également contribué à une certaine éducation philosophique. Mais, entre la fin du doctorat en philosophie obtenu en 1908 sub auspiciis imperatori et le séjour en Océanie (1914‑1918), la rupture dramatique de la relation fusionnelle avec le « philosophe artiste » Stanisław Ignacy Witkiewicz, ce que Malinowski appellera « La trahison de Staś »52, sera l’événement qui achèvera de clore la période de sa jeunesse, sur fond de l’éclatement de la Première Guerre mondiale.
« Zakopane sans Staś ! » ou l’Autre de la biographie : Stanisław Ignacy Witkiewicz
Le problème de Staś [Witkiewicz] me tourmente. En fait, sa conduite envers moi a été inacceptable. […] Finis amicitiae. Zakopane sans Staś ! Nietzsche rompant avec Wagner. Je respecte son art et admire son intelligence, et j’adore sa personnalité, mais je ne peux pas souffrir son caractère53.
28Ainsi Malinowski commente‑t‑il la rupture, advenue le 1er septembre 1914 à Toowoomba durant l’expédition commune en Australie, de l’amitié, fusionnelle et orageuse, avec son ami d’enfance Stanisłas Ignacy Witkiewicz.
29A l’origine de leur rupture, un autre drame : le suicide de la fiancée de Witkiewicz, Jadwiga Janczewska, le 21 février 1914, dont les circonstances ne sont pas claires. Se sentant responsable de sa mort, Witkiewicz demande par lettre à Malinowski, alors à Londres, de lui procurer du cyanure à travers ses connaissances au laboratoire de chimie de l’Université Jagelonne. Malinowski lui propose plutôt de se joindre, en tant que peintre et dessinateur, à la mission scientifique qu’il s’apprête à lancer en 1914. Son ami accepte. Partis en juin 201454, ils atteignent Colombo au Sri Lanka, puis Ceylan où Witkiewicz photographie les premiers rituels de magie auxquels Malinowski ait assisté (clichés qui ont tous été, malheureusement pour l’histoire de l’anthropologie, perdus)55. À l’éclatement de la Première Guerre Mondiale, Witkiewicz qui, né à Varsovie, était citoyen russe (contrairement à Malinowski, Cracovien et citoyen autrichien56), décide de rentrer en Europe pour s’enrôler dans les troupes tsaristes, alors que Malinowski, restera dans les îles jusqu’en 1918.
30La querelle entre les deux hommes vient ainsi de la volonté de Witkiewicz de s’enrôler en ligne avec le patriotisme familial57, tandis que Malinowski souhaitait poursuivre avec son ami et photographe sa mission aux Tropiques. Après la rupture à Toowoomba, au Queensland, le 1er septembre 1914, Malinowski écrira dans la première page de son Journal : « Le 1er septembre a marqué une nouvelle époque de ma vie : j’entreprends ma propre expédition en zone tropicale58. » La rupture avec Witkiewicz marqua une vraie bifurcation existentielle qui, avec la perte de sa mère en 1918, le mariage avec une Anglaise et le succès professionnel au Royaume Uni, l’éloigna définitivement de Zakopane et de la Pologne.
31La période succédant à la Première Guerre, coïncide pour Malinowski avec la rédaction de ses ouvrages d’ethnographie les plus célèbres et avec la consécration universitaire, couronnée par la création à son intention d’une chaire d’Anthropologie Sociale à la London School of Economics en 1927. Pour Witkiewicz, elle se caractérise par une production artistique, théâtrale, photographique et philosophique immense et fulgurante sous le pseudonyme de Witkacy: il écrit une trentaine de pièces théâtrales, une dizaine de romans, des essais philosophiques et esthétiques ainsi qu’une abondante correspondance59.
32Du point de vue artistique, Witkacy adhère à l’« anti‑callisme » moderniste, qui met en scène la déformation, la laideur, le monstrueux et le pervers, et s’oppose au mimétisme et au naturalisme prônés par son père et la précédente génération des peintres de la Jeune Pologne60. Au plan philosophique, il ne pouvait être plus éloigné de Malinowski. Son leitmotiv est la décadence de l’Europe et les visions apocalyptiques qui s’ensuivent : le « déclin de la métaphysique », la « fin de la religion », le « suicide de la philosophie » et la « chute de l’art ». Quant à son théâtre, il lui sert aussi de tribune pour la défense de ses idées et la critique de celles des autres, de Malinowski notamment dont il lit les ouvrages scientifiques. Il attaque sa théorie de la religion, la qualifiant de scientiste, par la voix d’Aparura, chef papou et protagoniste de la pièce Metafizyka dwugłowego cieleçcia (« La Métaphysique du vœu bicéphale », 1921) qui vitupère : « Ce n’est rien d’avoir été étudié par Malinowski, ce fichu rêveur anglomane indomptable. Les totems existent, c’est vrai, qu’importe ce que les savants écrivent sur eux61 ».
33Mêlant fiction littéraire et commentaires analytiques62, Witkiewicz procèdera de même dans le roman Niemyte dusze (« Les âmes lavées »)63, où il parle de sa fascination juvénile pour l’anthropologie et pour Sir James Frazer, ou encore dansLes 622 Chutes de Bungo. Puisqu’il y décrit un acte homosexuel entre Bungo (Witkiewitz) et le duc de Nevermore (Malinowski), certains, comme son biographe M. Young, se sont interrogés sur une éventuelle relation de ce type entre les deux amis. D’une manière ou d’une autre, que l’épisode décrit dans le roman soit vrai ou fictionnel, « Zakopane sans Staś » n’était plus pensable pour Malinowski.
34Les deux amis se reverront à l’occasion d’un premier retour en Pologne de Malinowski en 1922, avec son épouse et leur fille, pour vendre les biens familiaux. Initialement décidé à faire de Zakopane sa demeure estivale avec sa famille, il décide soudainement d’acquérir une propriété dans les Alpes italiennes64, proche de Bolzano et de la frontière autrichienne, peut‑être aussi pour éloigner sa respectable famille anglaise de Witkiewicz et de ses excentricités (orgies, expérimentations de drogues, etc.). Leur dernière rencontre date de 1930, lors d’un des rares voyages de Malinowski en Pologne, mais les échanges épistolaires se poursuivirent jusqu’au suicide de Witkiewicz en 1939, lors de l’invasion de la Pologne par les troupes nazies. Il avait d’ailleurs annoncé son geste dans l’avant‑dernière lettre qui nous est parvenue, de juillet 1938 (« Je ne te dirais pas que cela arrivera avec une totale certitude, mais c'est sûr à 98%65 »).
Des pulsions artistiques à l’anthropologie comme pratique créative
35La poésie fut sans conteste le seul art que Malinowski ait pratiqué durant une période étendue sur vingt années, quoiqu’il eût aussi la tentation d’écrire une pièce de théâtre en 1912 (ce qu’il ne fit pas, à l'en croire par manque de temps), et qu’il confessât le désir, dans son carnet intime, d’écrire son autobiographie : « Parfois, j’ai même envie d’écrire ma vie66 ». Malgré le filtre introduit par la fiction de Witkiewicz, la conception malinowskienne de la création artistique transparaît probablement dans les argumentations du duc de Nevermore. À la différence de Bungo qui considère l’art comme extérieur à la vie, le duc soutient avec ferveur leur entremêlement : l’art alimente et multiplie l’énergie vitale et la volonté humaine. Une telle conception permet de comprendre pourquoi Malinowski a maintenu une pratique poétique pendant tant d’années, malgré des résultats peu encourageants. Une insatisfaction identique quant aux résultats de ses efforts dans le domaine artistique se retrouve à propos de sa pratique photographique, ainsi qu'à propos du chant, auquel il aimait à s’adonner, ayant été formé à la musique et au violon dans son enfance : « Fredonnant des chansons, j’ai soudain envie d’en composer, sans originalité comme mes poèmes67. »
36S’il souligne le caractère insatisfaisant de ses créations, l’assouvissement de l’élan artistique, exceptionnellement puissant en lui, est néanmoins vigoureusement énoncé. Ses éclairs d’inspiration (terme utilisé par Malinowski lui‑même) sont décrits comme imprévisibles, suscitant une pulsion de composition urgente et inattendue. Le 14 janvier 1915, par exemple, il décrit une journée pluvieuse où il est en colère tant contre le gouverneur que contre les indigènes :
Ce matin, quand je me suis levé et que j’ai vu qu’il pleuvait à verse, j’ai eu brusquement une sauvage envie de tout planter là, et d’appareiller loin. J’exécute quelques exercices de gymnastique facile. Une fois encore, la poésie m’obsède et je voudrais écrire un poème, mais sur quoi, je l’ignore68.
37Un autre épisode du Journal porte la trace de cette fulgurance de l’inspiration qui, chez lui, surgit de manière fortuite :
Chez Dini où je discute paniers. Revenu assez tôt mortellement fatigué ; assis derrière un petit rocher près de l’ogodobada, je contemple le coucher du soleil. Défaillant. Trop bâfré à dîner. Et puis l’inspiration m’a saisi : j’ai écrit un poème69.
38Même si le plus souvent le résultat n’était pas du point de vue de Malinowski d’une grande originalité, le ravissement et le plaisir demeuraient dans la réception inattendue d’une inspiration, ce que confirme une pratique continue durant deux décennies. C'est que la poésie jouait un rôle moins comme processus aboutissant à un produit (le poème) que comme pratique produisant des effets sur l'individu Malinowski: elle modifiait ses dispositions, le relançait dans son travail, réorientait son énergie et sa réceptivité.
39Toutefois, il est, sur les îles Trobriand, une pratique artistique (et artisanale) qui semble donner à l’anthropologue des motifs de satisfaction. Il s’agit de la fabrication de peignes d’écailles de tortue. Pour lui qui n’a jamais pratiqué d’activités artistiques manuelles, le résultat est précieux et, en quelque sorte, compensatoire :
Hier soir et aujourd’hui, j’ai vécu dans l’émotion créatrice ; j’ai maîtrisé l’art de faire des peignes d’écailles et mon succès m’a grisé — un succès artistique ; c’est un peu comme écrire des vers.70
40Mais comment Malinowski s’explique‑t‑il une telle satisfaction, que ni la poésie ni la photographie ne lui ont offerte ? C’est qu’il y voit la « conjonction heureuse de [ses] intérêts scientifiques et artistiques ([sa] passion pour l’écaille de tortue)71 » ; mais aussi que sa double « curiosité, et artistique et scientifique, [était] comblée72. » Le plaisir est ainsi à son comble lorsque la pratique artistique se mêle harmonieusement à la pratique scientifique, comme lorsque dans ses poèmes il injecte quelque chose d’une analyse, d’un commentaire et d’une discussion qui relèvent habituellement de la science.
41P. Skalnik73 soutient que Malinowski était déterminé à exceller dans le domaine intellectuel, dans lequel ses amis ne pouvaient pas rivaliser, n’étant pas les « héritiers » du clan des professeurs de la renommée l’Université Jagellonne. L’investissement de Malinowski dans les sciences et dans une anthropologie à orientation positiviste relèveraient d’après M. Young d’une logique compensatoire74. Mais alors que ces auteurs insèrent la figure historique de Malinowski dans une dichotomie entre art insatisfaisant et une science qu’il aurait fini par privilégier, il nous semble au contraire que le rapport de Malinowski avec la science et l’art doit être considéré de façon plus nuancée. Il aspire en effet à l’interpénétration de l’un et l’autre, plutôt qu’à leur disjonction, s’inspirant en cela du modèle nietzschéen du « philosophe artiste » auquel ses amis Witkiewicz et Léon Chwistek restèrent également fidèles, l’art et la science étant toutes les deux des pratiques également créatives75.
42Ainsi, avec l’avancement en âge, l’anthropologie semble devenir la principale modalité de l’activité créatrice, comme cette phrase tirée du Journal semblerait l’annoncer :
J’analyse la nature de mon ambition. Une ambition qui prend sa source dans ma passion du travail : je suis grisé par mon propre travail, par ma croyance à l’importance de la science et de l’art — les yeux fixés sur l’œuvre ne voient pas l’artiste — l’ambition qui naît du regard que l’on porte constamment sur soi‑même — le roman de sa propre vie […]. Lorsque je pense à mon travail, ou à mes travaux, ou à la révolution que je veux opérer dans le domaine de l’anthropologie sociale — voilà une ambition qui a valeur véritablement créatrice76.
43Mort d’une attaque cardiaque à un âge relativement précoce, comme son père Lucjan, nous ne pouvons pas savoir si une fois encore la poésie l’aurait obsédé, si, avec le temps et à l'approche de la retraite, il n'aurait pas finalement publié ses poèmes ou écrit la pièce de théâtre qu’il avait en projet en 1912, à la faveur peut‑être d'un rapprochement avec son « ex‑ami » Witkiewicz — expression qu’il utilisera avec une ironie joviale pour clore la dernière lettre qu'il lui adresse en 1938.
Conclusion contrefactuelle
Je n’écris pas qu’avec la main,
Le pied veut sans cesse écrire aussi.
(F. Nietzsche, Écrire avec les pieds)
44Après avoir exposé les relations nouées par Malinowski avec le milieu littéraire et artistique polonais dont il faisait partie, on peut se demander quelle aurait été l’histoire de l’anthropologie si Witkiewicz, cet artiste polyvalent et volcanique, avait poursuivi son voyage aux Îles Trobriand et à Mailu en compagnie de Malinowski, alors que quelques‑uns des grands jalons méthodologiques de l’anthropologie contemporaine s’élaboraient77. On peut imaginer plusieurs scénarios, fondés sur différentes questions. Comment Witkiewicz aurait‑il influencé Malinowski par sa présence, son regard, sa perception ? Quels univers de sens sa pensée oblique longuement exercée et aiguisée aurait su saisir dans les atolls coralliens, que Malinowski n’aurait pas vus, en les lui communiquant par ses commentaires, ses dessins et ses photographies ? Une première hypothèse serait que l’artiste aurait travaillé de conserve avec le scientifique, en « multipliant » ses points de vue grâce à d’autres observations insoupçonnées78.
45Une autre hypothèse, plus hardie, serait que Witkiewicz, prodige dans les arts, en littérature mais aussi en philosophie, aurait pris la place de Malinowski à son retour des Tropiques, en poursuivant ses études à Londres et en devenant lui‑même le fondateur de l’anthropologie sociale britannique. Une telle supposition n’a rien d’extravagant dans la mesure où les cas d’artistes et d’écrivains qui se sont « convertis » à l’anthropologie ne sont pas si rares dans l’histoire des débuts de la discipline79. Alors, le nom de Witkiewicz aurait supplanté et effacé celui de Malinowski, lui retirant sa place dans l’histoire de la discipline. Qu’aurait été l’anthropologie si un adepte des Muses et de Schopenhauer, pour ainsi dire, avait pris la place d’un intellectuel, certes influencé par Nietzsche dans sa jeunesse, mais formé scientifiquement à l'école du néo‑positivisme logique du Cercle de Vienne ?
46Enfin, on peut imaginer que Witkiewicz, une fois retourné en Pologne après quatre ans passés dans les îles du Pacifique et en Australie, aurait utilisé les matériaux recueillis sur le terrain pour en faire des romans, des pièces de théâtre, des tableaux, en publiant ses photographies, continuant en somme dans le sens de l’art, sans ouvrir le dossier des « publications scientifiques ». Dans cette dernière hypothèse, qui rejoint les réflexions contenues dans ce volume sur la traductrice du Journal de Malinowski, Tina Jolas, l’artiste aurait renoncé sciemment à une carrière scientifique, en laissant la voie ouverte à son compagnon qui, lui, ne pouvait trouver l'accomplissement comme poète. Car, en effet, un artiste comme Witkiewicz aurait‑il pu concevoir l’anthropologie comme un horizon suffisamment vaste pour le déploiement de sa créativité, plus vaste que l’art même ?