
De la poésie des lieux à la poétique de l’album photographique dans les portraits de pays des Trente Glorieuses
1Des années 1920 à la fin des années 1970, le genre du portrait de pays a connu un développement majeur sous la forme d’albums photographiques, le plus souvent de grand format1. Alliant textes et photographies, ces ouvrages se donnent pour but de présenter les beautés et richesses de « pays » (nations ou régions) et de villes2, ainsi que de fournir une documentation relative à différents aspects de la contrée considérée. Durant les Trente Glorieuses tout spécialement, plusieurs collections de livres de ce type ont marqué le champ éditorial francophone, au point que cette période paraît constituer un âge d’or de la déclinaison photo-textuelle de ce genre encore largement méconnu3.
2Ces volumes décrivent et donnent à voir non seulement les territoires de ces pays, leur conformation géographique et certains éléments de leurs centres urbains, mais aussi leur histoire et éventuellement leur actualité, ainsi que leurs populations, leurs us et coutumes, sans omettre leur patrimoine, matériel et immatériel. Les représentations témoignant de ces trois ordres de réalité s’agencent au sein de ces albums selon des modalités diverses et des interactions texte-image qui revêtent des formes variées selon les ouvrages et les collections (certaines d’entre elles rassemblent dans un volume des clichés signés par un seul photographe, tandis que d’autres mobilisent des sources disparates).
3Productions mixtes, ces livres ne ressortissent de la littérature que sur le mode mineur. Si cette niche éditoriale fait la part belle aux écrivains, ce n’est cependant pas de façon généralisée4. La littérature y revêt essentiellement un rôle d’adjuvant. Certes, en plus des textes spécialement rédigés pour l’occasion, certains volumes accordent, par exemple sous forme d’anthologie5, une place notable à des textes issus du canon de la littérature, notamment à la poésie6. Cependant, ces recours à des échantillons d’œuvres n’inscrivent pas pour autant de façon nette au sein de la littérature ces volumes dont la forme, la teneur et les finalités se situent plutôt à la frontière du domaine littéraire.
4Susceptibles d’une grande diversité dans les sujets qu’ils abordent pour rendre compte des entités territoriales présentées, les portraits de pays participent simultanément de plusieurs domaines. De vocation documentaire et patrimoniale, ils appartiennent au domaine de la photographie et, par certains côtés, du livre d’art. En outre, ils touchent conjointement à la géographie, à l’histoire, ainsi qu’à la sociologie et à l’ethnologie, disciplines dont ils constituent, en les combinant, des formes de vulgarisation plaisantes. Enfin, ils entretiennent des relations marquées avec le développement de l’industrie du tourisme, selon une finalité que l’on pourrait qualifier non pas de publicitaire, mais plutôt de para-promotionnelle.
5Compte tenu de ces objectifs, le discours littéraire ne constitue qu’une composante parmi d’autres de ces ouvrages. Dès lors, comment comprendre que ces volumes, dont la visée semble être à la fois documentaire et de mise en valeur, dépeignent si souvent les territoires et nations comme « poétiques » ou recelant une forme de « poésie » ? Que vise le recours à un tel lexique pour désigner des réalités qui n’ont foncièrement rien de littéraire ? Quels sont les finalités et les bénéfices symboliques de cette opération au sein de l’économie icono-discursive particulière de ces albums ?
6Dans ce genre éditorial tel qu’il s’est décliné durant cette période, les systèmes de valeurs impliqués par la poétisation des lieux présentés usent de la poésie comme d’un principe d’unité de territoires intrinsèquement divers. Le poncif de la poésie apparaît comme un moyen commode de désigner l’essence des contrées représentées et, partant, leur valeur patrimoniale et leur intérêt sur le plan de l’attrait touristique. Établissant une continuité entre la poésie des lieux et celle des albums qui doivent en rendre compte, cette caractérisation textuelle en vient, en définitive, à porter sur les photographies qui sont reprises dans ces livres ainsi que sur la composition même de ces ouvrages.
La poésie comme principe d’unité
7De quoi au juste fait-on le portrait lorsque l’on propose une représentation de ce qui caractériserait en propre un « être culturel7 » tel qu’un pays, soit une « [d]ivision territoriale habitée par une collectivité, et constituant une entité géographique et humaine8 » ? Qu’il soit identifié à un État-nation ou non, un pays serait fondé sur la relation entre une collectivité humaine et l’espace qu’elle habite, ainsi que sur l’histoire de cette relation. Dès lors, les concepteurs de portraits de pays sont confrontés à la difficulté posée par l’ampleur et, surtout, la diversité d’une telle entité, sur les plans spatial, historique et social. Quelle que soit son étendue, tout pays est caractérisé par une considérable variété de composantes : des lieux de types différents (villes/campagnes, plaines/montagnes…) et une histoire ayant conduit à la coexistence de traces de différentes époques et différentes populations (classes sociales, groupes ethniques…).
8Tirer le portrait d’un pays suppose ainsi de se soumettre à une double orientation, contradictoire en apparence : apparaissant à la fois comme une entité homogène — en tous les cas, il demande à être présenté comme tel —, le pays est dans le même temps le lieu d’une diversité dont il s’agit aussi de rendre compte. Alors même qu’il apparaît comme un instrument de découverte (autres lieux, autres temps, autres mœurs), ce genre se révèle relativement homogène dans les stéréotypes (verbaux aussi bien qu’iconographiques) qu’il mobilise. En témoigne l’un de ses lieux communs les plus fréquents, qui consiste à souligner, souvent à l’entame de ces ouvrages, la difficulté que soulèvent« [c]e[s] pays […] d’une telle variété qu’il[s] défie[nt] l’unité9 », ainsi que l’écrit Giono à propos de la Provence. Ne craignant guère le paradoxe, certains n’hésitent d’ailleurs pas à faire de la diversité le ferment de l’unité du pays qu’ils dépeignent. Dans le volume qu’il consacre à la Suisse dans la collection « Petite planète », Dominique Fabre déclare ainsi :
Ce serait aller contre le bon sens que de vouloir tenter d’esquisser des généralités sur l’esprit suisse, car s’il y a une « unité morale », le caractère propre de la Suisse se révèle dans la variété et l’opposition10.
9Et d’ajouter que « c’est à sa diversité que la Suisse doit le caractère tout à fait particulier de son unité11 ».
-
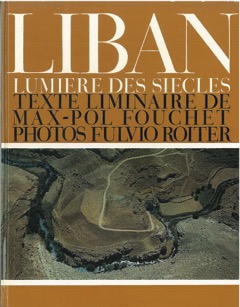
Fig 1 : Liban. Lumière des siècles, texte liminaire de Max-Pol Fouchet, photos Fulvio Roiter, Lausanne, La Guilde du livre, 1967, page de couverture. Coll. part. (D. R.)
10Point n’est besoin d’afficher une étendue conséquente. Les petites contrées paraissent aussi marquées que les plus grandes au coin de la diversité. Ainsi, dans le volume qu’il consacre à un autre pays de dimensions modestes, le Liban, Max-Pol Fouchet attire l’attention sur la même caractéristique. Aux yeux de ce grand médiateur culturel, « [l]a pluralité est la chair12 » du pays en ce qu’il constitue un point de rencontre entre Orient et Occident. Et comme nombre d’autres auteurs d’ouvrages de ce type — il est l’un des rares à avoir publié plusieurs portraits de pays, réalisant la plupart des photographies de deux d’entre eux13—, Fouchet pointe ce qui assure selon lui l’unité de cette diversité. La notion de poésie intervient précisément dans cette perspective :
Sa diversité, le Liban la doit à la nature, aux hommes, aux religions, à l’histoire. D’où vient pourtant que ce pays a un « climat » unique, une unité de charme ? Les éléments variés qui le composent n’ont-ils pas un dénominateur commun ? La réponse est simple et paraîtra trop simple, mais il faut la donner : le Liban est terre de poésie14.
11Fouchet explique ce qu’il présente comme une singularité par le fait que « les poètes », populaires pour l’essentiel, c’est-à-dire étrangers à l’institution littéraire et à ses codes, « sont exceptionnellement nombreux » dans le pays et seraient les porteurs d’une « sagesse poétique » qui témoignerait d’ « un art de comprendre la vie »15. Ces considérations s’écartent progressivement de la figure du poète en tant que tel pour pointer la façon dont la « poésie », au Liban, investirait « la vie » au sens large. Significativement, elles ne surviennent qu’au terme du texte de Fouchet, comme s’il s’agissait, à travers la mobilisation de la notion de poésie en cet endroit crucial, de répondre à l’horizon d’attente ouvert, à l’entame de cette préface, par l’invocation de la diversité constitutive du pays. Il en va de même d’un volume anonyme consacré à Paris publié par Flammarion, qui dépeint la « poésie de Paris » comme la résultante d’une unité dans la diversité :
La poésie de Paris, ce qui fait son charme, est déjà répandue dans tout ce que l’on a vu de Paris, dans ses monuments, ses œuvres d’art, son pittoresque. Chaque spectateur, il est vrai, en goûte plus volontiers tel ou tel aspect ; mais il est des traits généraux auxquels personne ne saurait être insensible : l’unité de la ville, son harmonie dans la diversité, sa mesure16.
12La poésie serait ici consubstantielle aux différents aspects de la ville présentés par les photographies que le lecteur de l’album a pu contempler. Mais elle se cristallise également à une échelle plus globale, celle de la ville dans son entièreté. En somme, la poésie se donnerait à appréhender à travers une multiplicité d’avatars, assurant ainsi l’unité du territoire dépeint, ainsi que le fondement de son charme, c’est-à-dire de la séduction qu’elle exerce. De façon notable, cette invocation à la poésie survient presque systématiquement dans les dernières sections de tel chapitre de ces livres. Ainsi, dans le même album, le titre du sixième et dernier chapitre n’est autre que « Paris poétique » — il suit « Paris, ville d’histoire », « Paris, capitale vivante », « Paris, ville d’art », « Paris, ville de science » et « Paris populaire ». La poésie semble ici un aboutissement naturel voire le cœur du propos de l’auteur. En terminant son livre sur le flou d’un « je ne sais quoi », il invite en effet le lecteur à investir librement ce terme qui vaut manifestement par ce qu’il conjoint de labilité et d’idéalisation potentielle.
-

Fig. 2 : Paris, Paris, Flammarion, 1961. Coll. part. (D. R.)
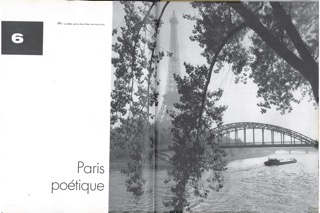
Fig. 3 : Paris, Paris, Flammarion, 1961. Coll. part. (D. R.)
13Au sein de ces albums, la notion de poésie semble l’un des truchements récurrents de l’opération de synthèse à laquelle se livrent volontiers ces portraits. Telle qu’elle se voit mise en œuvre, elle a pour finalité de garantir, à travers une notion délibérément indéfinie, une forme d’homogénéité à un portrait qui se montre par ailleurs relativement éclaté. En cela, l’usage de l’idée de poésie rencontre l’un des attendus du genre du portrait, qui a pour finalité ultime de rendre compte de l’identité singulière d’un territoire, de son « charme », de son « air », voire de son « essence ». La poésie désigne cette atmosphère insaisissable à travers un lieu commun conférant au territoire dépeint une valeur ajoutée. Si cette dernière est certes indexée sur un modèle culturel prestigieux, elle se trouve en réalité souvent détachée de toute idée de littérarité au profit d’une valeur esthétique plus générale et relevant pour une large part de l’ordre du patrimoine et de ce qu’il suppose en termes de permanence.
Essence et permanence
14Au sein de ces livres destinés à cerner l’identité d’un territoire, l’idée de poésie paraît être mobilisée de façon à constituer le point de cristallisation de l’être profond des lieux. Elle est l’un des vecteurs privilégiés de ce que Barthes, en évoquant les Guides Bleus dans ses Mythologies, a appelé, « le virus de l’essence17 ». Dans un volume de photographies de Paris de Willy Ronis dont il signe le texte, Marcel Brion, autre écrivain coutumier du genre, se livre ainsi à des considérations métadiscursives qui posent les enjeux de la notion de poésie en les situant sur le plan axiologique :
La véritable essence d’une ville (comme d’un paysage, comme d’un pays), c’est la poésie qui émane d’elle. La poésie de Paris ne se catalogue pas en formules scientifiques ; elle se situe au-delà de la logique et de la raison, et la plus sérieuse élucidation n’est encore qu’une lointaine approche, une timide esquisse18.
-

Fig. 4 : Paris, photographies en couleurs de Willy Ronis, photographies aériennes de Roger Henrard, douze gravures, texte de Marcel Brion, Grenoble, Arthaud, 1962. Coll. part. (D. R.).
15Ce clivage entre la « poésie de Paris » et le domaine de la science et de la raison, qui survient à nouveau en fin de texte, est récurrent dès lors qu’il s’agit de considérer la dimension « poétique » des lieux. Elle se fonde sur l’une des lignes de partage classiques de l’imaginaire moderne, qui fait de la poésie, en tant que manifestation de l’imagination, la folle du logis. Elle correspond notamment à l’opposition entre le « monde de l’inspiration » et le « monde industriel » identifiée par Luc Boltanski et Laurent Thévenot dans leur ouvrage portant sur les économies de la grandeur19.
16Dans ce cadre, la poésie n’est jamais véritablement définie, relevant d’une forme de pseudo-évidence. Elle tranche avec les transformations imprimées au monde contemporain par les réalisations anonymes issues du domaine des sciences et régies par les principes de la froide raison instrumentale. Ces ouvrages ayant vocation à faire connaître et à mettre en valeur un patrimoine souvent traditionnel, ils adoptent souvent un point de vue conservateur sur la modernité qu’ils présentent volontiers comme une menace pesant sur l’authenticité des pays et des villes dépeintes20.
17Dès lors qu’il s’agit pour les portraitistes de pays d’identifier l’essence d’un pays, régulièrement appelée « poésie », celle-ci semble reposer sur une résistance aux mutations induites par l’évolution historique. Par l’attribution d’une poésie particulière aux pays présentés, ces albums confèrent une épaisseur au présent en imprimant la teneur du passé aux lieux qu’ils permettent d’appréhender. L’essence est en effet de l’ordre de la permanence. Elle est ce qui du jadis se préserve dans le présent. En cela, elle constitue le socle, ou le cœur de l’identité qu’il s’agit de cerner21.
18Certaines de ces poches de résistance participent d’une sorte de retour à une enfance perdue, notamment en matière d’art de vivre. Ainsi de « [c]es fumeurs [qui] ressemblent à l’enfant qui tète. Le tuyau défie le temps, l’empêche de filer comme sur une autoroute22 », écrit Fouchet à propos de fumeur de narguilé à Beyrouth. Manière de fixer le temps, d’en suspendre l’écoulement inéluctable, en évoquant une activité — fumer — qui correspond précisément à un geste d’interruption du flux temporel23 aux antipodes des déplacements rapides permis par l’autoroute, environnement par excellence de la modernité et de ce qu’elle draine en termes de soumission aux impératifs de la vitesse. Ces lieux et pratiques préservent une supposée identité, une forme d’authenticité du Liban reposant sur l’otium, que Fouchet désigne à la fin du même texte en recourant au terme de poésie.
19Cette atteinte à l’identité propre des pays, due à une modernité uniformisante, se traduit notamment dans le traitement de leur patrimoine architectural, par exemple dans la volonté d’en conserver les formes les plus stéréotypées à l’intention des touristes étrangers. Ayant recours à l’idée de poésie sur un mode négatif relativement exceptionnel dans ces albums, Albert t’Serstevens en fait le constat désabusé dans l’ouvrage qu’il consacre au Mexique avec sa compagne Amandine Doré :
On commençait, pendant notre séjour au Mexique, à aligner des buildings sur le côté ouest de l’Alameda ; mais par un phénomène assez fréquent dans l’édification des cités modernes de l’Amérique espagnole, tout le côté nord, Hidalgo, a gardé sa physionomie ancienne […]. C’est là que s’est installé dans un couvent de l’époque coloniale l’hôtel Cortès où nous avons « tenu » huit jours entiers malgré les fêtes soi-disant populaires et les feux d’artifice que la direction offrait, dans le patio, à sa clientèle, avec mariachis, guitares, chanteurs larmoyants, danses du cru, tout le Mexique tel que le souhaitent — et le trouvent comme on voit — les touristes en mal de poésie exotique24.
-
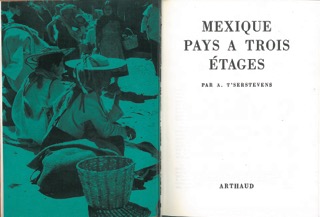
Fig. 5 : Mexique, pays à trois étages, par Albert t’Serstevens, 62 dessins au pinceau par Amandine Doré, 82 photographies de l’auteur, Grenoble, Arthaud, 1955. Coll. part. (D. R.)
20Selon un trait partagé par l’ensemble des genres qui relèvent de la littérature de voyage, dans ce portrait du Mexique, le touriste fait figure de repoussoir, et passe volontiers pour l’ « idiot du voyage ». Jean-Didier Urbain a pointé le paradoxe qui sous-tend l’être du touriste en soulignant combien il apparaît, jusque dans des publications qui lui sont expressément destinées25, non seulement comme inapte à saisir l’identité du pays qu’il visite, mais aussi, pire encore, comme un agent corrupteur affectant l’authenticité des lieux qu’il visite, en l’espèce leur poésie véritable, c’est-à-dire non « exotique », et qui est justement ce qu’il s’agit de discerner et de donner à appréhender au lecteur. À telle enseigne que la poésie, précisément, ne devrait pas fondamentalement participer de l’ailleurs, mais conduire à une redécouverte de quelque chose d’intime et de personnel à travers la rencontre de l’étranger. En témoigne par exemple le finale du livre qu’André Maurois consacre à Paris. L’auteur y donne la parole à l’une de ses étudiantes américaines :
-

Fig. 6 : André Maurois, Paris, Paris, Nathan, coll. « Pays et cités d’art », 1960. Coll. part. (D. R.)
[S]i d’autres villes ont leur poésie, nous avons été tellement nourris de livres français, qu’à Paris seulement nous avons l’impression, à chaque pas, de retrouver nos souvenirs personnels. Autrefois, des Romains comme Cicéron se sentaient chez eux à Athènes. Nous nous sentons chez nous à Paris26.
21Le parallèle formulé à propos des relations existant entre le monde romain et le monde grec et celles des Américains avec l’une des capitales culturelles de la vieille Europe repose sur l’intimité ressentie par les membres du premier groupe dans l’environnement du second. Il se fonde sur la familiarité avec un patrimoine culturel perçu comme commun. À Athènes, les Romains découvriraient, sous leurs yeux et sous leur pas, un souvenir incarné de leur propre identité culturelle. En l’occurrence, s’agissant de Paris, ce passé en lequel peuvent se retrouver des étrangers se voit explicitement lié au monde du livre (et, on peut le supposer, à la littérature). Mais dès lors que des Américains sont en mesure de percevoir la « poésie » de la capitale de la France, et d’entretenir à travers elle, avec la ville, une relation d’intimité, pourquoi un poète français comme Alain Bosquet, parlant du centre des États-Unis (le Middle West) ne retrouverait-il pas « quelque poésie » dans « quelques vocables » de sa langue, issus de colons francophones ayant jadis vécu en ces contrées ? Ces mots auraient été préservés dans l’Amérique contemporaine, mais métamorphosés par le développement des infrastructures modernes.
-

Fig. 7 : Alain Bosquet, Middle West, Lausanne, Rencontre, coll. « Atlas des voyages », 1967. Coll. part. (D. R.)
Je reviens au Michigan, à « cette place du détroit », comme l’appelait Antoine de La Mothe-Cadillac qui, en 1701, ne pouvait encore savoir qu’il serait à la fois l’ancêtre d’une automobile et celui d’une métropole [Détroit] où se concentrerait l’industrie des plus puissants chevaux-vapeurs du monde. Je n’irai pas à L’Anse, à Caseville, à Charlevoix […]. Je préfère visiter Bellefontaine, dans l’Ohio, en souvenir de je ne sais quel sonnet de Gérard de Nerval, car non loin de là je découvrirai encore Granville, Massillon, Lorrain, Napoléon. Et, pour finir, en me saoulant de résonances bizarres […], j’irai clamer tout haut ces noms de lieux qui voudraient faire du Wisconsin une terre de sortilèges : Eau Claire, Fond du Lac, Racine, Saint Germain […]. Des Français jadis ont coupé des roseaux, bâti des huttes. Quelques vocables, quand leurs ombres se sont dispersées, ont germé dans le sol uni et ennuyeux ; ils ont grandi, couverts bientôt de poutres, de rails et de béton. On ne les comprend plus, on les déforme en les craignant comme s’ils recelaient des mystères inavouables. Ils sont sur les cartes ; ils sont sur les enseignes lumineuses, entre les milk shakes et les stations de graissage ; ils sont sans être. Je suis coupable de leur trouver quelque poésie27.
22À travers la trivialité des commodités de la vie moderne, il ne s’agit pas seulement d’identifier nostalgiquement quelque survivance lexicale d’un passé qui persisterait au cœur du présent, mais aussi de toucher du doigt une dimension personnelle, pour Bosquet comme pour une large part de ses lecteurs, eux aussi francophones. L’auteur fait ainsi valoir, à travers la poésie, dans les ultimes lignes de son texte — il se termine sur le terme de « poésie » —, la découverte d’une intimité foncière, susceptible de se traduire dans l’ordre du langage, et qui constitue l’un des socles des identités nationales depuis le xixe siècle en particulier28. La poésie, fondée sur le poncif de l’ineffable, sur l’idée d’un charme indéfinissable, et qui semble en voie de disparition, consiste en une tentative de réenchantement du monde. Denrée rare, elle constitue une valeur refuge et, en ce sens, elle contribue à générer un effet de patrimonialisation, dans la mesure où le passé préservé au sein du présent, et qui en fait la poésie, se voit soustrait à son monde d’origine et transmis dans le présent par le livre, qui le donne à voir aux lecteurs29.
23Au sein de ces albums combinant textes et photographies, l’ordre de l’image n’est nullement laissé pour compte. Max-Pol Fouchet, d’autant plus sensible à cette donne qu’il a pris en charge le texte et la plupart des photographies de deux volumes publiés à La Guilde du livre30, écrit ainsi, dans les dernières lignes de sa préface aux photographies du Liban de Fulvio Roiter :
Oui, le Liban multiple a son unité dans la poésie. Je ferme les yeux… Je revois les arcades ommeyades d’Anjar, dans la Bekaa, dessinées sur les lointains sommets couvertes de neige. […] À quelque bruit soudain, cette neige bat des ailes, s’envole, remonte au ciel. Que la neige imite les colombes, que les colombes imitent la neige tous les aspects du monde se rassemblent. La poésie naît. Et j’aimais Beyrouth, ces modestes baraques où sont disposées en grappes et en figures des citrons, des oranges. […] L’orange était l’image. Et l’image conduisait à l’essence. Devant la mer, nous étaient offerts et l’image et l’essence31.
24Ces considérations rêveuses nouent à nouveau la poésie à l’essence du pays. Elles associent en outre le registre de l’essence et celui des images qui, dès la page figurant à la droite du texte, vont donner à voir les paysages et visages du Liban au lecteur. En se mettant en situation de contemplateur de l’être du pays qu’il dépeint en même temps que de ses images, et en les situant sur le même plan, Fouchet place ce lecteur dans une position analogue à celle qu’il présente comme la sienne. Cette contemplation censément plus profonde, indiquée par la fermeture des yeux, est une contemplation du souvenir, informée par un amour des lieux visités (« j’aimais Beyrouth »). En l’évoquant, Fouchet incite le lecteur à tourner les pages de l’album à sa suite, selon une invite qui se trouve souvent élargie au medium qui permet cette inscription du regard du lecteur dans celui que l’auteur et le photographe posent sur le pays ou la ville présentée. En effet, l’album et les photographies qu’il rassemble sont souvent, eux aussi, à la suite des pays qu’ils présentent, placés sous le signe de la poésie.
Poésie des albums
25Dans la préface qu’il signe pour Les Américains de Robert Frank, Jack Kerouac s’exclame : « What a poem this is ». Et d’avancer : « Anybody doesnt like these pitchers dont like potry, see?32 » À quoi peut bien tenir, dans le regard d’un écrivain, le caractère poétique de photographies telles que celles de Robert Frank ? Sans doute cette « poésie » est-elle pour partie unique, tenant à la fois des sujets représentés et de l’esthétique du photographe. Il n’en reste pas moins que cette caractérisation des photographies dans les portraits de pays se révèle particulièrement fréquente, comme s’il s’agissait de signifier au lecteur une manière d’appréhender ces recueils d’images par contraste avec les visées documentaires voire scientifiques de certains ouvrages accompagnés de photographie. Ces ensembles de clichés ont dès lors pour fonction de donner à voir l’identité des pays dont elles composent un portrait diffracté — se succèdent des photographies de différents types de réalités (paysages, portraits, monuments et bâtiments, anciens ou récents, scènes urbaines…) —, auquel il importe dans le même temps de conférer une homogénéité.
26Souvent ces caractérisations surviennent en des moments de transition des albums, notamment lorsqu’il s’agit de passer de la lecture du texte à la contemplation des clichés. Dans La France de profil de Paul Strand et Claude Roy, un texte du second se situe immédiatement sous le premier cliché à suivre le texte préfaciel de Roy, dont les interventions s’étendent tout au long du volume à travers une série de textes courts. Cette photographie montre une porte sur laquelle est fixée une affiche indiquant « Entrée de la photo ». Cette « entrée de la photo qui est une photo d’entrée33 » marque le début de la partie proprement photographique de cet album qui constitue l’un des chefs-d’œuvre du genre.
-

Fig. 8 : Claude Roy, Paul Strand, La France de profil, Lausanne, La Guilde du livre, 1952. Page de couverture. Coll. part. (D. R.)

Fig. 9 : Claude Roy, Paul Strand, La France de profil, op. cit., p. 15. Coll. part. (D. R.)
27À la faveur de ce seuil méta-discursivement et méta-iconographiquement surdéterminé, l’écrivain invite son lecteur à entrer dans ce qu’il tient pour une authentique poésie des images, qui procède de l’opération photographique à laquelle se serait livré Paul Strand :
Entrée de la photo… Entrez dans la photo !
Entrez, voyons, et faites comme chez vous. D’ailleurs, vous y êtes. Les hommes, les miroirs et les photographies ont chacun leur façon personnelle de réfléchir. Les photographies que voici, même quand les hommes en semblent absents, ne font jamais rien d’autre que réfléchir les hommes. Il est de la plus stricte politesse que les hommes le leur rendent. Réfléchissez un peu à ces photos qui vous réfléchissent […]. Entrez dans les photos, mélangez-vous à leur rêve tacite et à leur muette méditation […]. Mais surtout, ne laissez pas sortir le petit oiseau. Le photographe a eu bien du mal à attraper le petit oiseau de la poésie en posant sur sa queue un grain de sel d’hyposulfite, ce qu’on nomme en terme de laboratoire et de vérité : un révélateur34.
28Roy s’adresse en outre familièrement au lecteur en l’invitant à se sentir dans son intimité (« faites comme chez vous ») et en soulignant le caractère « humain » de ces photographies qui participent de la veine humaniste. Le caractère plaisant du texte repose sur un ressort simple, le redoublement, qui génère de séduisants effets poétiques. Tout commence par un polyptote, soit la dérivation homophonique d’une forme substantive (« Entrée ») et verbale, à l’impératif (« Entrez »), du même vocable. Vient ensuite une antanaclase qui joue de la double acception du verbe « réfléchir ». L’auteur va même jusqu’à convertir le registre de la rationalité technique (« en terme de laboratoire et de vérité ») en matière poétique et même, plus précisément, en instrument grâce auquel le photographe serait parvenu à « attraper le petit oiseau de la poésie » par le moyen d’un « révélateur ». Ce défigement ludique d’une expression lexicalisée, qui clôt ce texte attribuant aux images leur poésie, accomplit le geste par lequel ce texte, lui-même poétique si l’on en croit ses propres critères relatifs aux photographies de Strand, mobilise l’idée de poésie comme ferment d’unité.
29Comme de bien entendu, ces commentaires à propos des photographies revêtent, presque systématiquement, une fonction d’éloge. Le plus souvent, ils sont le fait de l’auteur. Cependant, ils peuvent parfois être dus à l’éditeur.
-

Fig. 10 : Benoist-Méchin, Arabie carrefour des siècles, Lausanne, La Guilde du livre, 1961. Page de couverture. Coll. part. (D. R.)
30Eu égard au caractère problématique de la photographie dans une culture musulmane qui s’oppose à la reproduction de la figure humaine, certains des clichés composant Arabie carrefour des siècles, publié à La Guilde du livre, incitent le directeur de la maison d’édition lausannoise, Albert Mermoud, à se fendre d’un « Avertissement des éditeurs ». Soucieux de la qualité discutable de certains clichés reproduits, l’éditeur tient à expliquer la nature particulière de certaines des photographies figurant dans cet album :
Que les amateurs de vues « piquées » — comme on dit dans le métier — nous pardonnent si certaines planches de cet album leur paraissent un peu floues. Ce n’en sont pas moins des images uniques et irremplaçables, captées parfois au téléobjectif, au prix de risques certains.
Nos lecteurs sauront apprécier leur valeur exceptionnelle, ainsi que l’intense « charge poétique » dont elles sont imprégnées.
A. M. Juin 196135
31Mermoud mobilise ici la valeur du flou, longtemps associée dans l’histoire de la photographie à la dimension artistique de ce medium dont l’appréhension oscille entre régimes documentaire et artistique36. Il retourne en argument de séduction ce qui pourrait passer pour un piètre témoignage du savoir-faire de la maison qu’il dirige, au regard de la qualité plastique habituelle et de la netteté des clichés qu’il a pour habitude de publier dans les albums de photographies qui ont fait une part de la réputation de La Guilde37.
32Reste que, pas plus chez Mermoud que chez Roy la « charge poétique » des clichés évoqués « en mention », selon une prise de distance reposant sur le recours au signe diacritique que constituent les guillemets, n’est définie ou même explicitée. À nouveau, le recours au lexique de la poésie semble supposer sa signification connue de tous, comme si elle allait de soi, et ce d’autant plus que l’auteur ne l’emploie qu’en prenant des pincettes, comme pour souligner qu’il a conscience du caractère quelque peu stéréotypé de ce vocabulaire. On peut s’en étonner, voire quelque peu rester sur sa faim. Toutefois, est-ce vraiment si surprenant à partir du moment où il s’agit de fonder la poésie en question sur une forme de familiarité, et de générer dans le même temps à travers la poésie un effet d’intimité ? En effet, le présupposé de connaissance instaure rhétoriquement une forme de connivence par postulation entre un auteur et un lecteur censés partager le même savoir, et en deuxième instance, entre ce lecteur et les clichés à travers lesquels il est invité à prendre connaissance de l’identité d’un pays.
33Sensiblement plus développées, les explications que Max-Pol Fouchet livre au sujet de son travail de photographe dans le cadre de l’album Terres indiennes fournissent quelques éléments suggestifs. Reprenant dans un texte conservé à l’IMEC l’un des poncifs de l’histoire de la photographie et de son impact sur les autres arts (l’idée qu’elle aurait permis à la peinture de se délester des impératifs de la représentation), Fouchet écrit ainsi :
Edgar Degas dit un jour à son ami Paul Valéry que l’invention de la photographie allait permettre aux peintres de ne plus se déranger pour aller voir, — je le cite, — « Si les petits ruisseaux ressemblaient aux petits ruisseaux ».
Sans doute, Degas voulait-il dire que la photographie libérait les peintres du souci de la représentation trop exacte de la nature.
Et sans doute avait-il raison : la photographie a été pour beaucoup dans la transformation des arts plastiques. […].
34Et d’étendre ses réflexions à la littérature, en faisant porter son questionnement sur les évolutions récentes de cette dernière, et plus particulièrement sur la description (pour le roman), et sur la comparaison (pour la poésie) :
Une telle transformation ne s’est-elle pas étendue jusqu’à la littérature ? Assurément.
Alors qu’un Balzac commençait presque toujours par décrire le décor de l’action romanesque, nos romanciers se méfient des descriptions […].
En poésie, […] on ne compare plus guère des choses qui se ressemblent. On compare, ou plutôt : on relie des choses dissemblables38.
35À en croire Fouchet, cette mutation de la poésie moderne — qui fait signe vers la fameuse « rencontre d’un parapluie et d’une machine à coudre sur une table de dissection » (Lautréamont) — l’ont incité à se livrer à une forme différente de poésie en pratiquant la photographie. À ses yeux, celle-ci serait en effet susceptible de « désencombrer la poésie de tous les éléments qui parfois l’entravent, la gênent, l’alourdissent ». Elle lui confère une certaine forme de pureté, c’est-à-dire lui permet de correspondre davantage à ce qui constituerait son essence. « Une image photographique », écrit-il encore, « n’a pas à craindre d’accumuler les détails. Elle n’a pas à craindre d’être simplement descriptive. / J’ai donc manié la caméra par amour de la poésie ». Pour autant, un tel point de vue ne revient pas à considérer que la photographie serait « dépourvu[e] de poésie ». Au contraire…
Les grands photographes que j’aime : Brassaï, Molinard, Pierre Verger, Robert Doisneau sont des poètes.
Mais la poésie de la photographie est particulière. Je ne crois pas qu’elle se confonde avec celle du poème.
L’objectif arrête, coagule les nuages. Le poème, lui, les met en marche vers des ciels infinis.
36Fouchet précise, au final, ce qu’il en est de sa démarche dans Terres indiennes, livre à l’occasion duquel il aurait « tenté de susciter un dialogue entre ces deux poésies », celle de l’écriture et celle qu’il prête à la photographie. Si, alors que le « poème les met en marche », l’ « objectif arrête » les nuages, eu égard à la dimension synthétique constamment conférée à la poésie de la photographie dans le cadre de ces portraits de pays, le « dialogue » que l’écrivain et photographe affirme s’être employé à susciter se veut, lui aussi, éminemment poétique, dans la mesure où Fouchet « relie », ce faisant, « des choses dissemblables ».
37Le caractère poétique des photographies n’est cependant pas uniquement fonction de leur dimension esthétique propre, au demeurant signifiée par les auteurs des textes. À ces deux poésies peut s’en adjoindre une troisième, qui tient à l’agencement particulier des images au sein de l’album. À cet égard, dans les dernières lignes de sa brève préface au volume de photographies d’Israël par Izis publié à La Guilde du livre (avec une très belle couverture ainsi qu’un frontispice de Chagall), André Malraux propose, avec l’emphase parfois mystérieuse qui caractérise sa prose, quelques réflexions à la faveur desquelles la photographie apparaît comme le matériau d’une opération de « métamorphose » du réel, et comme transcendant la stricte valeur documentaire qui lui a longtemps été assignée.
-

Fig. 11 : Israël, texte liminaire André Malraux, images Izis, couverture et frontispices Chagall, Lausanne, La Guilde du livre, 1955. Coll. part. (D. R.)
Les livres photographiques ont été d’abord des recueils de documents, des souvenirs de voyage, des reportages pittoresques. Puis ils ont échappé à l’album du touriste en retrouvant l’accent et la signification des films documentaires consacrés au Dnieprostroï ou à la Tennessee, à la lutte de l’homme contre les éléments. Et les meilleurs d’entre eux trouvent aujourd’hui leur art et leur autonomie en substituant à la prédication des épopées didactiques, une signification plus complexe et plus énigmatique, des images moins efficaces par ce qu’elles affirment que par ce que leur ensemble suggère ; cette technique, que l’on crut née pour saisir la réalité dans l’instant, devient art lorsqu’elle saisit l’instant où se reflètent les siècles, l’instant qui métamorphose le réel en le prolongeant dans l’interrogation du poème39.
38Si, cette fois, ce n’est pas tant la poésie ou le poétique que le poème, soit leur concrétion sous une forme littéraire, qui se trouve sollicité, le régime poétique apparaît à nouveau comme un opérateur de synthèse entre des réalités distinctes, voire opposées. À la faveur de considérations d’ordre historique, Malraux souligne le caractère humain et antitouristique acquis par l’album photographique au cours de son histoire et rapproche la « technique » mise en œuvre d’un « art » dont le poème semble une forme quintessenciée. Les photographies tiendraient leur caractère « poétique » de l’opération de montage dont elles font l’objet au sein du livre. Leur agencement permettrait de « saisi[r] l’instant où se reflètent les siècles », c’est-à-dire de façonner, par la captation d’une temporalité à très long terme (« les siècles »), la dimension patrimoniale de ces portraits de pays en l’assignant à la succession des images au fil de la lecture de l’album.
39Lorsqu’il signe ce texte, sa seule intervention dans le cadre d’un volume de ce type à notre connaissance, Malraux n’est pas seulement l’auteur à succès de L’Espoir et de La Condition humaine, pas plus que l’écrivain engagé auréolé du prestige de la Résistance. Il est également, après avoir été iconographe durant l’entre-deux-guerres, l’auteur du Musée imaginaire et des autres albums d’art qui ont suivi ce premier ouvrage marquant, paru en 1947 chez Albert Skira, à Genève. Les opérations de montage auxquelles il se livre dans ces volumes, le premier surtout, en juxtaposant des photographies soigneusement composées pour faire apparaître des connivences et une forme d’unité entre des productions artistiques séparées dans le temps et l’espace, sont ce qui retient son intérêt au seuil de ce volume40. Ses réflexions s’inscrivent dans le prolongement direct de celles auxquelles il se livre dans Le Musée imaginaire à propos de la révolution technique et éditoriale que permet l’album dans le regard qu’il invite à porter sur l’art et son histoire41.
40Le geste de montage que suggère Malraux se traduit en particulier par un topos iconographique des portraits de pays dont témoigne exemplairement L’Égypte face à face de Tristan Tzara et Étienne Sved42, paru un an avant l’Israël de La Guilde, et auquel peut-être Malraux songe en écrivant sa préface. Les doubles pages de l’ensemble du volume mettent en effet systématiquement en vis-à-vis deux photographies, l’une figurant des personnages ou activités (agricoles par exemple) anciens, à travers des photographies de détails de monuments de l’Égypte antique, et la seconde un cliché contemporain. Ainsi des pages 20 et 21 : la première photographie représente une statue de la « Reine Ti en granit noir » datée du xviiie siècle et conservée au Musée du Caire, la seconde une « Jeune fille du Caire »43. Alors que la texture de chacune des deux figures représentées suffit à les distinguer — l’une est de pierre, l’autre de chair — , en particulier en termes historiques, le cadrage de l’image, le demi profil, les traits du visage, l’éclairage de biais, corollaire de jeux d’ombres sur le côté droit des visages, et les yeux clos de ces deux figures génèrent un effet d’identification prégnant.
-
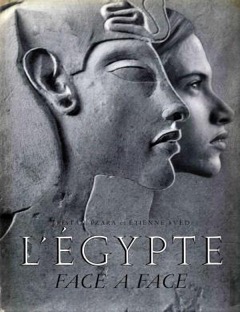
Fig. 12. Tristan Tzara, L’Égypte face à face, photographies d’Étienne Sved, Lausanne, La Guilde du Livre, 1954. Coll. part.

Fig. 13. Tristan Tzara, L’Égypte face à face, op. cit., p. 20-21. Ces images sont reproduites avec l’aimable autorisation des ayants droits de La Guilde du livre et d’Étienne Sved. (D. R.).
41Comme l’écrit Georges Didi-Huberman à propos des montages de Malraux, « les contrastes criants s’estompent ou s’harmonisent aux fins de révéler un air de famille dont l’album, nous le savons bien, est un modèle privilégié de présentation44 ». La fiction élaborée par ce trope iconographique, que l’on pourrait, sous réserve d’une réflexion théorique et analytique plus poussée, qualifier d’ « analogisation » ou d’ « analogisme », repose sur un procédé simple mais efficace : elle se fonde sur des traits formels convergents qui imposent l’idée d’une identité, incontestable car plastiquement fondée, entre une représentation du visage d’une statue égyptienne vieille de plusieurs siècles et une jeune femme des années 1950. Selon une métonymie implicite, cette juxtaposition d’images pose une parfaite identification entre l’Égypte d’hier et celle d’aujourd’hui, ce qui revient en somme à faire percevoir son « essence », à même chaque double page, mais aussi à l’échelle de leur succession. Sans être nommée comme telle dans cet album, et dans ceux qui ont recours ponctuellement à ce mode opératoire qui tend à neutraliser l’historicité des pays présentés45, la poésie du patrimoine trouve là une matérialisation formelle qui frappe en raison de son caractère à la fois soigné et systématique.
42L’invocation de la poésie apparaît comme un opérateur de patrimonialisation par excellence. Elle assigne en effet aux entités portraiturées une plus-value symbolique dans la mesure où elle inscrit fréquemment dans le présent le passé du pays, qu’il s’agisse de marquer une continuité entre des individus, des paysages ou des pratiques. Cette opération confère au pays représenté une forme d’authenticité, qui aurait été préservée des mutations imprimées par l’histoire. Selon Jean Davallon, la patrimonialisation repose sur « la création d’une relation » entre passé et présent, via un objet matériel, figuré par la photographie dans le cas qui nous occupe. Cet objet constitue un « opérateur » de la continuité entre passé et présent :
La linéarité du temps entre le passé et le présent est alors doublement travaillée : (i) par une « remontée » depuis le présent où nous sommes (nous et l’objet) vers le monde d’origine de l’objet ; (ii) par une présence du passé à travers l’objet. La boucle prend ainsi la forme d’un point arrière qui recoud le passé avec le présent ; ou plus exactement, qui va chercher le passé pour l’unir au présent.
Avec cette présence du passé comme passé dans le présent, le présent s’ouvre, se dédouble : passé et présent se superposent dans le présent […]46.
43Dans ces albums, la poésie se trouve mobilisée à la fois comme essence des entités qu’il s’agit de présenter, mais aussi, corollairement, comme idéal des ouvrages qui les dépeignent. En d’autres termes, l’opération consistant à faire des lieux portraiturés des réalités d’ordre poétique confère une dimension « poétique » à ces livres de photographie eux-mêmes. Ce qu’aspirent à mettre en œuvre nombre de portraits de pays, à travers leurs textes, et il s’agit bien là d’un topos de ce genre, c’est un dialogue entre la poésie des lieux et celle de la photographie, tel qu’il se cristallise au sein de l’album. En faisant de la poésie le cœur de l’identité du pays ou de la ville à présenter, il s’agit d’identifier le portrait au territoire qu’il dépeint à travers la poésie qu’ils auraient en commun, selon un trait générique en vertu duquel, idéalement, un portrait équivaut à ce dont il est le portrait, et dont il a pour fonction de pallier l’absence.
De la poésie des pays à celle de leurs portraits phototextuels
44Dans les portraits de pays publiés sous forme d’albums photographiques durant les Trente Glorieuses, la fonction assignée à l’idée de poésie ne s’explique pas seulement par un attrait socio-professionnel qui conduirait les écrivains sollicités à mettre en valeur les contrées qu’ils ont à présenter à travers le système de référence auquel ils appartiennent (et en raison duquel ils sont sollicités par les éditeurs), celui de la littérature. Ces livres élaborent une scénographie qui ne se borne nullement à capter une valeur littéraire. Plus fondamentalement, dans le cadre de l’économie icono-discursive de ces ouvrages, le stéréotype consistant à caractériser les pays dépeints et, dans un second temps, les albums eux-mêmes comme empreints de poésie permet de cristalliser un système de valeurs inhérent à ce genre éditorial et, plus largement, à ces volumes qui ont pour finalité la mise en valeur des pays et de leur patrimoine. Il s’agit en effet de nommer ce qui assure non seulement la cohérence des entités territoriales, historiques et sociales portraiturées, mais permet aussi de donner une dimension esthétique à une opération para-promotionnelle.
45Dès lors qu’ils ont pour finalité de donner à appréhender à leurs lecteurs une identité, celle du pays portraituré, la poésie est censée désigner l’être profond des pays, leur supposée essence. L’idée de poésie sert dans cette optique à faire de ces ouvrages des portraits en unifiant des entités présentées comme foncièrement disparates. La poésie fait prendre le portrait. Elle en est un opérateur. Dans l’analyse qu’il consacre à une publicité pour de célèbres pâtes italiennes, Barthes identifie l’être même d’une communauté nationale comme l’Italie sous le nom d’ « italianité47 ». Dans les portraits de pays, la poésie constituerait l’un des noms permettant de signifier au lecteur qu’il se trouve en face de ce qu’il recherche dans les portraits de pays, devant l’être même du pays qu’il s’agit de cerner dans son authenticité, essentielle à ces ouvrages dont le caractère documentaire est au service d’une entreprise patrimoniale et de valorisation. Elle est l’un des noms de l’être propre des pays (et des peuples) dépeints, ainsi que le baromètre de leur authenticité, parfois menacée par la modernité en marche et l’uniformisation à laquelle elle peut donner lieu, notamment à des fins touristiques.
46Dans ce contexte éditorial non spécifiquement littéraire, le recours à l’idée de poésie s’inscrit dans une dynamique communicationnelle à objectifs multiples. En l’occurrence, la documentation et la mise en valeur du patrimoine s’opèrent selon des finalités qui, si elles ne sont pas directement publicitaires, relèvent tout de même d’une mise en valeur à finalité touristique. Dans les termes proposés par Yves Jeanneret, la littérature et sa forme quintessenciée que constitue la poésie font dans ces livres l’objet d’une « instrumentalisation48 » en étant soumises à un impératif de mise en valeur para-promotionnelle, qu’elles ont pour finalité de contribuer à euphémiser. Cette logique participe pleinement du discours de promotion touristique et de l’impératif de dépublicitarisation49 qui le sous-tend : à travers la poésie, le tourisme, qui se veut un vecteur d’évasion du quotidien et de son emploi du temps éminemment régulé, trouve une forme idéalisée qui rompt avec les impératifs du monde industriel et qui relève d’une forme d’otium légitimé par une littérature encore parée à l’époque d’un considérable prestige culturel.
47Reste que le modèle de la poésie ne cesse de jouer sur deux tableaux, non sans ambiguïté. Ainsi, s’il s’agit indéniablement d’un stéréotype (qui au demeurant n’est pas propre au genre du portrait de pays et dont il serait intéressant d’historiciser l’approche en l’élargissant notamment aux littératures du voyage), la caractérisation d’un pays, d’une région ou d’une ville comme « poétique » constitue un topos destiné, précisément, à neutraliser son caractère stéréotypé. La poésie apparaît en ce sens comme un condensé paradoxal de littérarité : soit, d’un côté, le sommet de la littérature pour la période moderne ; soit, de l’autre, ce qui précisément échappe à la littérature, et donc la marque d’une forme d’adieu hautement valorisé à cette dernière50, comprise comme cloisonnée dans les formes et les mediums littéraires traditionnels. Ce pas de côté permet d’ouvrir un lecteur appelé à devenir lui-même poète à la découverte du vaste monde et des beautés qui sont les siennes et devant lesquelles, ainsi que le note André Siegfried, « le poète qui est en chacun de nous laissera toujours voir un “visage émerveillé”51 ».

