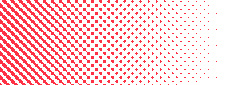1. Du tourisme en histoire
1En quoi le tourisme participerait-il du savoir et, à vrai dire, pourquoi convoquer le tourisme dans une réflexion sur les tombeaux qu’appellent les fins de la littérature ? Ces deux questions pourraient se réduire à une hypothèse de captatio : puisque le tourisme participe – au moins en théorie – du savoir historique, il peut être un véhicule par lequel on peut être ramené à la question de l’histoire littéraire.
2Il y a deux façons de connaître un ailleurs, temporel et spatial : à travers les documents qui y renvoient, ou bien en se rendant sur les lieux. Quelque temps qu’on s’octroie à approfondir, par une voie ou l’autre, la connaissance de ce double ailleurs, on se trouve démuni devant l’étendue immense à recouvrir et par la profondeur temporelle insondable : il faut inventer des voies d’accès au passé et à l’ailleurs. Les documents historiques, amassés au fil du temps, peuvent être intégrés à une histoire, mais ils présentent le désavantage d’offrir une suite de visions déjà toutes faites ; aussi faut-il s’en méfier. La visite sur place contourne cet obstacle, mais, en revanche, perd de vue la majorité des données que l’historien aura réunies en empruntant la première voie d’accès historique. En gros – et je souligne : en gros! –, on peut dire que l’histoire quantitative a emprunté, dans ses recherches, la première voie ; l’histoire littéraire ne s’y est pas ralliée sinon tout récemment, avec par exemple l’ouvrage de Franco Moretti, Graphs, Maps, Trees1,qui semble faire un sort meilleur aux données statistiques dans l’histoire de la littérature ; la seconde voie paraît s’être en revanche imposée davantage. Si l’historien tend à ne rien manquer des données qu’il ramène sur sa table, le chercheur qui agit en « touriste » s’en dispense pour se pencher sur un fait – écrit ou objet – apparemment dérisoire pour pratiquer sur celui-ci ce que l’on pourrait appeler une « herméneutique sociale » : il en traduit non pas l’esprit, il n’en fait pas la « pneumatologie »,ce qui l’exposerait au péché de vanité (car comment un être humain pourrait-il représenter l’irreprésentable ?), mais la position ou plutôt le positionnement ; les rapports qui y aboutissent, des fils qui lui semblent s’y rejoindre2.
3Le « tourisme » à valeur épistémique ne se pratique pas pour autant à vau l’eau ; nous allons voir pourquoi il peut être vu comme la méthode du savoir la plus adéquate à une époque qui met en doute plus que jamais les vérités livrées par les histoires, tout en sachant qu’il lui est impossible de s’en dispenser. On connaît cette opinion très répandue sur le tourisme : c’est un ersatz des voyages d’initiation d’antan3 : on s’embarque à bord d’un avion, on survole la distance qui sépare le point de départ de la destination, on y atterrit et on emprunte les trajets marqués pour visiter tel ou tel endroit, soigneusement quadrillés. Autrefois, on allait en Italie pour retrouver ce qu’on avait déjà découvert à l’aide des livres : une origine. Depuis que le monde ne cesse de se « globaliser », pour ne plus heurter trop violemment les habitudes des hommes « civilisés » que nous sommes, on sait que « l’origine » n’est plus qu’un agencement particulier d’un faisceau d’éléments et on s’efforce de suivre les fils noués et de refaire l’opération mystérieuse. Dotés de certaines connaissances historiques, les jeunes touristes partent de plus en plus à la chasse de l’imprévu, de l’inouï : ils découvrent un immeuble, une rue, un objet dont le positionnement, l’état et l’emploi qu’on en fait renvoient le scintillement d’une rencontre unique d’éléments : c’est une vérité « muette » qu’ils visent, pour reprendre le mot de Jacques Rancière4 et pour filer sa définition du poème sous l’angle de la pragmatique – « L’essence du poème, désormais, c’était d’être une parole qui dit autre chose que ce qu’elle dit, qui dit en figures l’essence de la parole5 ». L’affirmation du philosophe français n’est pas tout à fait exacte, elle peut être interprétée comme une hyperbole : le poème – et, à l’instar du poème, tout œuvre – manifeste, au-delà de ce qu’il veut dire, le propre d’un discours où, au fil d’une « archéologie » (c’est-à-dire d’une histoire), on décide de le ranger. Il s’agit donc d’une parole qui attend d’être découverte et intégrée à une histoire, par un auteur discret, « deus otiosus », qui laisse « parler » la vérité muette qu’il est censé découvrir et faire entendre. Le projet « archéologique » de l’histoire, tel qu’il est annoncé par Michel Foucault dans les années 19606, emprunte à la phénoménologie la méthode de l’épochè : l’auteur se retire tout en suivant de ses perceptions aiguës le fait à incorporer dans son histoire. C’est au long d’une observation à la fois minutieuse et discrète que les nœuds « discursifs » peuvent être mis en évidence pour tracer les contours d’un paradigme épistémique. Ce fait qui devient peu à peu, pour l’historien, objet est, comme le disait Robbe-Grillet, « là, tout simplement ». Mais lui aussi gardait l’ambiguïté sur le statut de ce « là » : « là », c’est dans le monde ; il a cette propriété de « faire partie », que seule une histoire peut démontrer.
4Ce n’est qu’en débordant les ornières touristiques que l’on arrive à en saisir, tant bien que mal, la présence de tant d’autres : des bribes d’une réalité culturelle, économique, vécue in vivo, qui sont là, prêtes à rentrer dans de nouvelles histoires. Ilarrive parfois qu’à l’intérieur même de trajets mille fois rebattus se cache un fait oublié « simplement là » qui attend d’être mû en objet par une narration qu’il rend possible. Le débordement que j’ai en vue ne signifie donc pas nécessairement éviter les parcours connus de tous, mais se libérer de la puissance contraignante des significations qui les accompagnent.
5Quelque spéculatif que le parallèle suivant puisse paraître, les voies de ce tourisme sous-jacent semblent recouper les voies méthodologiques des nouvelles approches épistémologiques de l’histoire, telles qu’elles ont été suggérées dans un article qui a fait date : « The Revival of Narrative : Reflections on a New Old History7 ». Je m’explique : la connaissance historique a longtemps visé la vérité intégrale du passé ; l’histoire des mentalités, dans sa première phase, braudelienne8, opérait des découpages larges, ramassait et essayait d’intégrer une large quantité de données matérielles ; le drame s’y trouvait remplacé par l’antienne ; ce n’en était pas moins une narration du passé, mais une dont la dynamique était mue par la répétition et dont le message était la dénonciation de l’illusion du renversement, là où, en deçà de l’apparente kyrielle des coups de théâtre, il y avait de la continuité. Lawrence Stone cite et remarque en marge du syntagme d’« histoire immobile » d’Emmanuel Le Roy Ladurie :
Le Roy Ladurie argued that nothing, absolutely nothing, changed over those five centuries, since the society remained obstinately imprisoned in its traditional and unaltered « éco-démographie ».
6Stone constate l’échec de ces initiatives à relever, par la statistique, les pourquoi de l’histoire européenne classique (surtout) et moderne. Plutôt que d’amasser et recycler des données sur l’Italie de la Renaissance, ou du moins à côté de ce travail quantitatif qui rend la vérification presque impossible, mieux vaut se rendre à Florence et y passer le plus de temps possible. On n’en arriverait certes pas à un dossier aussi touffu que celui préparé par l’historien des mentalités, mais au moins pourrait-on relever, par-ci par-là, des détails exemplaires d’une histoire pour l’essentiel à jamais enterrée. Le fait que les Medici aient déménagé du Palais Ancien pour habiter le Palais Pitti, sur la colline de Boboli, après 1548, peut être un signe de la nouvelle tournure prise par la vie privée des élites européennes depuis la Renaissance. Ce n’est qu’à la suite d’une visite rendue à Florence que ce détail prend forme d’argument, un argument plus fort peut-être, quoique les généralisations qu’il autorise soient contestables, que celui des données abstraites fournies par le traitement informatique de masses de données plus ou moins fiables. C’est ce que souligne Lawrence Stone dans deux passages dont on relèvera tout de suite l’importance pour notre étude :
One clear conclusion is surely that, whenever possible, sampling by hand is preferable and quicker than, and just as reliable as, running the whole universe through a machine. More and more of the « new historians » are now trying to discover what was inside people’s heads in the past, and what was like to live in the past, questions which inevitably lead back to the use of narrative9.
7Remarquons, au passage, l’implicite politique dela conclusion de Stone : les historiens « nouveaux » sont en train d’essayer de découvrir ce qui se passe dans les cerveaux des gens, ce qu’ils ont vécudans le passé. Soit. Mais de quelles gens parle-t-on ici ? Puisque, ou bien il s’agit, dans l’histoire quantitative, de sujets anonymes et dépourvus de voix, et alors rien de ce qui se passe dans leurs cerveaux n’a aucun intérêt, ou bien, de sujets passifs et en retrait dont on ne parle qu’à propos de la masse et des protagonistes dont les gestes nous sont connus et interprétés, il y a des détails qui nous avaient échappés : tels, le « massacre » des chats recensé par Robert Darnton, recueilli dans des archives qui, d’une part, n’avaient jamais intéressé ni l’histoire « romantique » des exploits, ni celle structurale et positive. La première ignorait un document insignifiant, la seconde le prenait en compte comme maille dans une chaîne, suivant la teneur d’informations qu’il avait pour l’intérêt de la série. Et, en effet, un massacre de chats, œuvre vindicative d’un groupe d’ouvriers affolés par d’incessants miaulements nocturnes, n’est pas un fait itératif dans la France des Lumières. À une lecture en profondeur, à une lecture herméneutique de l’événement domestique s’il en est, ce massacre est un des innombrables nœuds où se livre, en travesti, un trait de l’homme des Lumières, de la manière dont il « pensait » et, surtout, de son vécu, la catégorie épistémique la plus obscure qui soit.
8La question qu’il est temps de légitimement poser, à présent, c’est : quel peut être le profit d’un tel changement de méthode pour le domaine littéraire ?
9En premier lieu, l’histoire peut être littéraire. On déniche une première application de la tendance à privilégier les faits apparemment anodins mais par ailleurs exemplaires par rapport à l’ordonnancement des données dans la récente histoire de la littérature française parue chez Gallimard en 2007 sous la direction de Jean-Yves Tadié10. Dans une note liminaire au tout début du livre, on peut lire :
La littérature n’y est jamais présentée comme une catégorie qui pourrait être définie une fois pour toutes. Elle est partie prenante d’une histoire des pratiques culturelles. Aussi chaque chapitre s’ouvre-t-il par la description et le commentaire d’une peinture11.
10Aussi la présentation du xviiie siècle s’ouvre-t-elle par la description d’un tableau de Charles Gabriel Lemonnier qui remonte à 1812. On est transportés en arrière, en 1755, où l’on voit plusieurs personnages qui ont fait la gloire du siècle des Lumières, réunis pour la lecture de la dernière tragédie du maître Voltaire : « L’Orphelin de la Chine ». Et Michel Delon d’enchaîner :
Comme Lemmonier, nous choisissons de privilégier un certain nombre de figures, mais, plus que ne le peut une toile, nous essaierons de comprendre des mouvements d’idées et les fonctions de textes12.
11Notons aussi que, lorsqu’il articule « mouvements d’idées » et « fonctions de textes », Michel Delon semble bien viser une lecture en filigrane du texte comme révélateur des « mouvements d’idées ». C’est dire aussi que le texte n’est pas là pour illustrer une idée de l’histoire de la littérature (mais bien dans cette histoire). Ce qu’il « illustre » – mais le mot est mal choisi en l’occurrence – se trouve en deçà, et non au-delà de ce qu’il dit : une vérité « muette » donc, dont il faut surprendre le parler plus que les paroles. Là, l’historien se retire pour l’observer, il se garde (méthodo-logiquent) d’imprégner ce qu’il observe de ses propres idées sur le cadre dans lequel il faut intégrer le texte : pour laisser parler le texte, il faut, évidemment, se taire.
2. Du détail en histoire et en littérature
12Il semble que, entre 1979 et 2007, les littéraires ont tant soit peu rattrapé le retard de méthode – épistémologique s’il en est – pris par rapport aux historiens. D’une part, le constat du revirement de la narration en littérature française contemporaine appartient à la référence française la plus citée parmi les doctorants français sur le rapport entre littérature et postmodernisme : deux textes de Aron Kibédi Varga13, dont l’influence peut être mesurée au nombre de reprises par les chercheurs. En 1991, Sophie Bertho constate : « Le retour du sujet […] va automatiquement de pair avec le retour du récit. L’écriture semble redevenir le lieu d’une aventure humaine14 ». En 1997, dans un article de synthèse paru en anglais, Geert Lernout constate : « the new fiction writers have discovered the pleasure of story-telling, of tales of quest and adventure15 ». Le thème de la reviviscence du récit dans le roman contemporain est tel que Dominique Rabaté constate « que le “récit” y est presque devenu un mode concurrentiel avec le roman ou son ombre revendiqué16 » et il illustre son affirmation par l’œuvre de Pascal Quignard. D’autre part et de manière plus subtile, la « renarrativisation » qui caractérise le récit littéraire français depuis la fin des années 1980 ne signifie pas un simple retour en arrière. Si l’on narre de nouveau, ce n’est pas qu’on soit revenu à la littérature post-balzacienne : c’est désormais le détail qui joue le rôle premier comme sujet de la narration, un détail qui n’est autre chose que ce nœud dans lequel des fils invisibles font surface et sollicitent notre observation serrée et détachée dans le même temps. Comme exemple, nous pouvons nous reporter au livre de Naomi Schor, Reading in Detail, qui présente néanmoins le désavantage de ne pas s’intéresser trop à la littérature française. Reste que, dans le chapitre 8, intitulé « Fiction as interpretation/Interpretation as fiction », l’auteur renchérit sur l’idée que la fiction même peut être aussi un interprétant du langage :
Now, there is not such a very far way to go from the notion that fiction is self-conscious and reflects upon its representation of speech acts, to the notion – which seems to be gaining ground today – that novels also represent and reflect upon interpretation as performance17.
13Autrement dit, le romancier peut lui aussi se retrouver dans la position du touriste contemporain qui rive son attention à des détails exemplaires pour les mettre en exergue à titre d’« objets herméneutiques » : tel un quelconque ticket de métro dans Au piano18 de Jean Echenoz, rehaussé comme trace de la pratique quotidienne de la vie. La portée herméneutique du détail illustre bien, a priori, le principe de la parole muette énoncé par Jacques Rancière : le ticket de métro dit, certes, « autre chose que ce qu’il dit » ; tout autre est de savoir le remarquer et le faire signifier dans une histoire. Ce qui semble évident pour la pratique littéraire de la prose ne tarde pas à se manifester dans la pratique de l’histoire de la littérature. L’avancement récent des littéraires sur le tournant culturel paraît par ailleurs si décidé qu’on est en droit de se méfier d’un excès de zèle…
3. La constitution de l’objet du savoir chez Michel Foucault
14Cette conduite hétérogène, de l’historien en phénoménologue, qui débouche sur une herméneutique inédite ou, si l’on préfère, « archéologique », a été inaugurée par un penseur qui, en effet, avait une parfaite connaissance de la phénoménologie comme tous ses collègues19, mais qui était, en plus, un très bon connaisseur de Nietzsche. En 1966, Michel Foucault a choisi comme point de départ pour sa proposition d’une épistémologie de la modernité un autre tableau, « Les Ménines » de Vélasquez (1657). Les Mots et les choses étaient perçus, à l’époque, comme un ouvrage de théorie dont la thèse était « anti-humaniste » : la mort d’une idée de l’homme. Mais cette perception ne fut qu’un effet de surface : c’était, par-dessus tout, une nouvelle méthode historique, une nouvelle façon d’essayer de dire le vrai à partir d’exemples apparemment hétérogènes : une peinture, quelques phrases de Descartes, puis de Linné, puis de Ricardo – quant à la théorie, aucun maître à penser n’y est cité, quoique les clins d’œil abondent au fur et à mesure que le livre approche de son dénouement et que le système d’une théorie d’ensemble anthropologique prend contour. Et voici que, quarante ans plus tard, cette approche fait son entrée dans un ouvrage d’histoire de la littérature française. Donc : on commence par une peinture, puis c’est le contact « touristique » avec le chronotope.
15Mais cette peinture de Velasquez, tout comme les citations choisies par Foucault, ne sont pas évoquées pour la marque révolutionnaire qu’elles porteraient, dans le souci de tracer une histoire du progrès en peinture, dans l’économie ou dans l’histoire naturelle. Le perspective épistémologique de Foucault n’est pas, elle, intérieure à une métanarration de l’émancipation. Ce que l’auteur cherche par son choix d’archives, c’est plutôt à isoler une solution de continuité, entre des régimes de pensée uniques, irréductibles à une épopée de la connaissance. Foucault se contente d’y décrire des pratiques de pensée ; c’est exactement ce qui se passe avec la présentation du tableau de Lemmonier par Michel Delon :
La littérature n’y est jamais présentée comme une catégorie qui pourrait être définie une fois pour toutes. Elle est partie prenante d’une histoire des pratiques culturelles. Aussi chaque chapitre s’ouvre-t-il par la description et le commentaire d’une peinture20.
16Par conséquent, le point de vue de cette histoire n’est plus l’enregistrement des « révolutions », des « renouveaux » dans le langage littéraire – d’autant plus que la littérature « n’est pas une catégorie » – mais le propre d’une pratique d’écriture :
Si l’opposition entre le livre et le manuscrit est à relativiser, il en va de même de celle qui distingue selon nous la copie et la création, la reproduction et l’invention originale21.
4. L’« anthropologisation » de la théorie littéraire
17En quoi un tel thème d’histoire de la littérature est-il significatif pour la question de la théorie littéraire aujourd’hui ? À première vue, en rien. Et, pourtant, la théorie littéraire ne peut s’amorcer qu’à partir de quelques réponses sur ce que « littérature » veut dire, des réponses livrées à une nouvelle question : non plus quoi, mais comment. Et cette question ce n’est plus l’écriture qui y répond – acte individuel, effectué en retrait et sous le poids de l’impensé linguistique – mais une pratique sociale. La littérature est tout d’abord ce que les gens font et comprennent qu’ils font. La théorie littéraire est désormais le dessin d’une figure en mouvement à l’intérieur de la figure historique plus large, récupérées ensemble à l’intérieur d’une anthropologie. Quarante ans après Les Mots et les choses, on est enfin là, devant cet avertissement qui serait devenu une menace :
L’« anthropologisation » est de nos jours le grand danger intérieur du savoir. On croit facilement que l’homme s’est affranchi de lui-même depuis qu’il a découvert qu’il n’était ni au centre de la création, ni au milieu de l’espace, ni peut-être même au sommet ou à la fin dernière de la vie ; mais si l’homme n’est plus souverain au royaume du monde, s’il ne règne plus au mitan de l’être, les « sciences humaines » sont de dangereux intermédiaires dans l’espace du savoir. […] Ce qui explique […] leur précarité, leur incertitude comme sciences, leur dangereuse familiarité avec la philosophie, leur appui mal défini sur d’autres domaines du savoir, leur caractère toujours second et dérivé […]22.
18Il est significatif au plus haut degré que l’avertissement de Foucault apparaît à la suite d’un parcours – d’une histoire – et non pas d’une démonstration. Un des enjeux majeurs des Mots et les choses est peut-être – et ce, à la différence d’autres livres ayant marqué la vie intellectuelle en France après la fin de l’existentialisme – son caractère plus historique que théorique : ce n’est pas seulement les titres des ouvrages foucaldiens sur lesquels on peut s’appuyer pour soutenir cette remarque (Histoire de la folie à l’âge classique, par exemple ou bien Histoire de la sexualité), mais l’abandon par Foucault du registre prescriptif de ses écrits (dont il retrouve pourtant le goût vers la fin de livres tels que Les Mots et les choses). Le recours explicite aux philosophes contre l’abondance des références documentaires agit dans le même sens : dénoncer la théorie à l’aide de sa mise en histoire ; qui plus est, relativiser le statut des énoncés que le philosophe prend pour cible de ses analyses par le geste d’en insérer la portée à l’intérieur de séries discursives. Peu importe, à vrai dire la définition qu’il en donne et son caractère fonctionnel. Ce qui compte reste l’effet de dissémination qu’il arrive à engendrer par le positionnement énonciatif implicite qu’il occupe en tant qu’auteur. Car, si l’assignation des énoncés appartenant à différentes épistémès aux séries discursives n’est que le résultat d’une histoire, d’un « métarécit », alors les sciences humaines dont il se revendique et dont il signale la menace sous la forme d’une subtile auto-dénonciation représente un non-lieu discursif, un interstice, le seul d’où le geste critique soit encore possible pour autant qu’il est conscient et du caractère historique des vérités rhétoriques et du caractère toujours « théorique » de ces histoires : c’est, peut-être, le « constructionnisme » auquel d’aucuns rattachent le projet de pensée de Michel Foucault. Et c’est aussi, on peut dire, le propre du caractère « structuraliste » de cette pensée : l’idée que la vérité en langage n’existe qu’à titre de nœud rejoignant quelques-unes des ficelles discursives qui trament cette world wide web du savoir. Car, si les sciences humaines prétendent à l’universel, comme Michel Foucault croit reconnaître à la même page dont nous avons cité le fragment antérieur :
[c]e n’est pas, comme on le dit souvent ; [à cause de] l’extrême densité de leur objet ; ce n’est pas le statut métaphysique, ou l’ineffaçable transcendance de cet homme dont elles parlent, mais bien la complexité de la configuration épistémologique où elles se trouvent placées […]23.
19Ni métaphysique ni transcendance, mais advenue, hasard, origine négative ; la théorie n’en est, pour ce qui est de l’épistémologie, qu’un phénomène : commentaires autour d’une question formulée (par exemple : qu’est-ce que c’est la littérarité ?) dont la forme même ne peut être qu’attribuée à un nœud discursif. La vérité du savoir humain ne réside donc plus dans l’évidence logique, car elle n’est tout au plus qu’épochè, dénudation, schème – jamais phénomène. C’est toujours l’histoire qui en fournit des aperçus, l’histoire même des ficelles qui ont abouti au nœud et, en l’absence de la perspective absolue, il nous faut nous contenter de métaphores de ces nœuds, d’illustrations qui n’en sont pas l’application mais la visibilité en termes d’image de l’assemblage qui a noué le nœud24 : « Les Ménines » de Vélasquez sont, à ce titre, la même chose que la description de l’opéra Capriccio d’après la musique de Richard Strauss, scène avec laquelle s’ouvre le livre le plus fameux de William Marx, L’Adieu à la littérature. La vérité humaine – telle qu’elle se révèle dans le discours de la littérature – est une simple pose dont on a beau se demander quel en est le naturel ; les poses n’ont pas de dedans, ni d’origine, ni de début ni de fin ; les poses changent et tout ce qu’on peut mettre au service du savoir, c’est le changement d’une pose à l’autre et la réflexion sur le bien-fondé de l’histoire qui en résulte.
20Treize ans après Les Mots et les choses, Lawrence Stone explique la reviviscence de la narrativité en histoire, contre la feue prééminence de la statistique, du quantitatif, par l’avènement de l’épistémè anthropologique :
The first cause of the revival of narrative among some of the « new historians » has therefore been the replacement of sociology and economics by anthropology as the most influential of social sciences25.
21C’est ce que Christian Delcroix appelle le « moment réflexif » à la fin de son étude sur les « doutes et renouvellements » de l’histoire au cours des années 1980-1990 : « Ce moment – dans lequel nous sommes toujours – est aussi – et peut-être surtout – un moment réflexif pour l’histoire en France26. »
5. Le « moment réflexif » de la théorie. Deux « tombeaux » pour la littérature
22Ce moment réflexif ne doit donc surtout pas être pris pour un « moment théorique ». Les moments théoriques ont l’avantage remarquable de ne pas se poser de questions sur le pourquoi de leur objet. Certes, les approches en sont sujettes à caution. Les moments théoriques sont des moments de tournois, de croisades : il faut nommer, puis vaincre les ennemis et s’installer à leur place auprès de l’objet choisi comme le ferait un héros appelé à la rescousse d’une victime trop longtemps malmenée : c’est le cas de la théorie littéraire en France d’après les années 1960. On en a trop discuté ; n’en parlons plus.
23Il a fallu longtemps attendre jusqu’à ce que la suppression de la narration en littérature fût remplacée non pas tout d’abord par sa « réaction »27, mais par une remise en histoire de la théorie qui l’avait fièrement constatée. Les métarécits, discrédités selon Lyotard, ne pouvaient pas en finir avec la notion même de narration – on l’a souvent répété depuis 1979 – ne serait-ce parce qu’il y avait au moins une discipline qui se serait retrouvée subitement morte : l’histoire. Une fois le doute tout de même lancé, l’histoire en est venue à se re-penser elle-même et, dans ce but, à se remémorer sa biographie.
24Après la date-charnière des Mots et les choses, après que ses enseignements ont porté ses fruits, le moment réflexif s’empare peu à peu des sciences humaines en général – et par-dessus tout de leur dimension apparentée à la philosophie, à preuve l’étrange œuvre philosophique, faite d’aveux, de gestes herméneutiques et de scepticisme wittgensteinien de Stanley Cavell28 – et s’en va conquérir la théorielittéraire. Qui, du coup, arrête de parler, a honte de son pathos, cache désormais ses recherches formelles menées comme si de rien (d’aléatoire) n’était, et se laisse dissoudre dans deux directions. La première est celle que nous venons de remarquer : une réflexion historique qui évalue ses propos, tout en les mettant, ainsi, en récit, et qui sait se donner à la conscience comme autant de fils sous-jacents d’une pratique discursive par les figures des détails significatifs : un tableau, un fait, un texte d’archive que l’histoire de la littérature, accrochée à d’autres enjeux, aurait oublié. En ceci, histoire nouvelle, histoire littéraire et fiction contemporaine partagent un espace commun (qui, certes, n’en est pas le seul). De même que l’histoire ne peut plus avancer à toute allure en faisant défiler des bases de données, la théorie ne peut plus se dispenser de sa mise en abyme : c’est une raison, peut-être, de la rhétorique de la fin qui module des écrits contemporains – et notamment français – sur la littérature, et qui ne peut être contrecarrée peut-être qu’à l’aide de la rhétorique augurale de l’espace : Bernard Westphal, avec son Géocritique, en est un bon exemple29. Si une certaine idée de littérature s’épuise, il nous reste à en rechercher les formes diverses à travers le monde. La seconde direction de réflexion qui emporte la pratique de la théorie littéraire (à la rigueur, l’exercice de la théorie est une pratique…) est de repenser la question morale, le rapport longtemps oblitéré entre fiction et morale, à nouveaux frais, où au lieu de dire morale pour comprendre une normativité, on dit vécu pour comprendre des pensées et des conduites. Rainer Rochlitz l’avait déjà fait en 1998, dans L’Art au banc d’essai30. Jacques Bouveresse se pose, quant à lui, dans son dernier livre, La Connaissance de l’écrivain31, la vieille question de la formation par la littérature, cette question précisément que l’âge formaliste a dénoncée comme raison bourgeoise de la littérature, dont celle-ci devait se défaire au plus vite et sans reste.