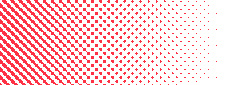1L’hypothèse de cet article est qu’un « écrivain-préféré » – expression que l’on pourrait figer, dont on pourrait faire une association signifiante – ne dit pas notre histoire, mais produit le dire de notre vivre1. Par vivre, j’entends ici, à la suite de Gérard Dessons, la vie historicisée, médiatisée par le langage : une pratique historique, par opposition à l’acception biologique, vitaliste, de la vie, qui fait la logique d’un certain discours sur la biographie2. L’écrivain-préféré inaugurerait ainsi le régime de discours par lequel on va pouvoir s’inscrire au monde exactement, et par là coïncider avec soi-même. Non qu’il réaliserait la somme des énoncés qui peuvent nous dire : il inaugurerait plus radicalement un paradigme discursif tel qu’il peut contenir – prédire, entériner – qui nous sommes et ce que nous vivons. Selon cette hypothèse, l’écrivain préféré contient en puissance, à l’état de potentialités, toutes nos phrases. Sa manière nous élit, bien plutôt que nous ne la choisissons, parce qu’elle engage toute notre historicité3: notre situation et notre façon de signifier dans l’histoire, voire de faire-histoire. Nous devenons par lui la référence d’un temps jusque-là étale et linéaire, et réciproquement ce temps se voit vectorisé, orienté par la position qu’il nous fait tenir dans le langage. C’est pourquoi, éventuellement, cet écrivain qui nous parle peut changer avec les époques de notre vie, mais fondamentalement, il n’y a qu’un écrivain-préféré, au sens où c’est un paradigme langagier spécifique qui, dans sa singularité, est apte à nous illimiter. En produisant un régime poétique qui nous reconnaît et dans lequel nous nous reconnaissons, l’écrivain-préféré inaugure notre vie comme vivre, c’est-à-dire qu’il en initie la dimension profondément historique – telle qu’elle peut s’historiciser par le langage, « définition même de l’homme4 », comme l’écrivait Benveniste.
2Par là, la problématique de l’écrivain-préféré est immédiatement éthique. Elle engage la question d’une articulation avec la réalité, par-delà tous les genres fictionnels ou non de l’œuvre concernée, car elle implique une humanisation de l’art à travers la figure d’un alter ego (fût-il profondément dissemblable). Celle-ci suggère que la subjectivité mise en œuvre dans l’écriture, si elle est autre chose et bien plus que l’expression d’une personne, est cependant le fruit d’un autre homme avant nous, a été portée par des affects humains, s’est extraite de l’histoire d’une vie qui a eu, comme la nôtre, ses peines et ses misères, et surtout a eu, comme nous-mêmes, l’obligation de faire face à cet exercice difficile, à cette entreprise périlleuse qu’est l’expérience de vivre.
3Posant l’hypothèse qu’il en va d’une poétique dans un questionnement qui implique une relation de nature éthique entre l’art et la vie, et, plus spécifiquement ici, entre l’écrire et le vivre, le lire et le vivre, je me propose de réfléchir sur ce sujet à partir du livre L’Art et la manière de Gérard Dessons5.
Une relation de langage
4L’écrivain préféré engage la question d’une relation, et si celle-ci a des répercussions dans la sphère de l’intellect comme dans celle des affects, elle a lieu dans, et par, le langage. D’abord parce que la littérature, sous les espèces particulières des écritures singulières, est le lieu d’exercice par excellence du langage, mais aussi parce qu’il n’existe pas de vie a-langagière, anté-discursive6. On veut poser que cette relation langagière entre un individu et un auteur est celle par laquelle s’engage la constitution d’un individu en sujet, autrement dit le travail ou l’opération d’une subjectivation, qui fait quitter au lecteur son statut individuel et contingent au profit d’un processus individuant, d’un devenir étendu, de l’accession à une conscience de soi liée à une coïncidence entre un vivre et le dire de ce vivre, et par là une appropriation et une sémantisation du monde. La qualité de l’écrivain, alors, qui nous est immédiatement familière, qui nous requiert et nous retient, est sa justesse, qu’on pourrait définir comme la qualité d’adéquation d’une signifiance, c’est-à-dire la pertinence des moyens engagés pour faire sens vis-à-vis d’une situation, d’un ressenti, de la nature d’une expérience ou d’un objet considéré, aussi bien que la capacité de ces moyens à faire naître en nous la conscience, l’idée, l’image ou le sentiment de ces situations ou objets. Cette justesse n’implique pas une adhésion morale, mais le sentiment que ce qui est dit ne pouvait l’être mieux. Aussi cette relation privilégiée entre lecteur et écrivain concerne-t-elle au moins autant l’activité d’une parole que les contenus de sens que celle-ci véhicule, ceux-ci lui étant cependant coextensifs. Cette maximalisation du langage, en outre, capable de nous atteindre dans notre existence même, c’est ce qu’on peut reconnaître comme le propre de la littérature.
5Plus exactement qu’entre un lecteur et un auteur, qui seraient posés tous deux comme des individus, c’est alors bien plutôt entre un sujet et une œuvre que cette relation s’établit. Plus précisément, cette relation qui est celle de l’art transforme l’individu lecteur en sujet comme elle a transformé l’individu auteur en sujet, l’œuvre les inventant par son inconnu même. Leur rencontre crée ce que Gérard Dessons appelle une « transsubjectivité7 », ainsi décrite :
Surprise de rencontrer la vérité, surprise que la vérité soit une rencontre de subjectivités, que la subjectivité se constitue dans cette rencontre, avec ce sentiment, double, de rencontrer ces phrases pour la première fois dans leur radicale nouveauté, et, dans le même temps, d’éprouver leur intime fréquentation8.
6« L’écrivain préféré » est ainsi le nom d’une relation privilégiée à la littérature, incarnée dans la figure, ou plutôt le travail, d’une œuvre particulière, élue pour la singularité qui lui est reconnue, et pour la singularisation qu’elle produit, réciproquement, de son lecteur. Gérard Dessons explique ainsi comment cette opération de reconnaissance est celle d’une connaissance à la fois inaugurale et, en quelque sorte, de toute éternité :
Il y a d’abord le sentiment que ce que vous lisez « vous concerne ». Quelque chose, là, que vous ignoriez jusqu’alors, a à voir intimement avec vous, avec votre personne, avec la conscience que vous avez de votre propre individualité. Vient ensuite l’analyse du processus : si ce poème vous concerne, c’est qu’en fait il « vous révèle ». […] Cette révélation n’est pas un éclairage braqué sur une zone obscure de vous-même, mais l’expérience de l’altérité : c’est en tant que vous devenez cette parole dans laquelle vous vous glissez que vous faites l’expérience de votre profonde identité9.
7« [F]aire que par la rencontre avec une œuvre je m’inscrive dans l’historicité de mon présent […] et que je ne le fasse jamais mieux que dans cette circonstance10 », c’est ce qui fait le spécifique de la relation à l’art, et vient justifier que la préférence d’un écrivain ait souvent à voir avec notre vie même, avec la façon dont nous pensons, conduisons, agissons ou encore rêvons notre vivre. Car cette relation, dans sa qualité mais surtout et d’abord dans sa spécificité, est inassimilable à toute autre, en ce qu’elle a cette vertu de « [m]e rendre à mon présent comme invention11 » :
L’important, dans cette expérience, n’est pas tant le sentiment d’une communauté d’intérêt – l’autre et moi pensons la même chose – mais le fait qu’une rencontre me rende capable de savoir que je suis capable de penser ce que sinon, peut-être, je n’aurais jamais pensé, ni même su que j’étais capable de le penser12.
8Bien plutôt qu’à un présent passif, même s’il peut aussi nous donner le sentiment de nous faire échapper à la réalité, c’est à nous-mêmes que nous rend l’écrivain préféré.
L’écrivain avec l’œuvre
9Il convient cependant pour la présente problématique de ne pas abandonner si vite le fait qu’une figure d’écrivain se cache effectivement derrière l’œuvre élue. Car elle lui donne comme l’incarnation d’une relation interpersonnelle, et ce qui se dit dans « l’écrivain préféré », c’est aussi ce sous-jacent que quelqu’un a vécu pour écrire cette œuvre, et que c’est ce quelqu’un, également, qui peut être rejoint à travers le temps, dans l’empiricité de son expérience, la justesse de sa situation. Ainsi lorsque Philippe Forest, dans L’Enfant éternel13, relit Mallarmé comme le poète qui a perdu son fils, cherche-t-il a rejoindre cette communauté d’expérience, non afin de relativiser sa peine, mais pour savoir qu’un autre que lui, mieux que lui sans doute parce qu’il est autre, a été capable de dire l’événement de la perte, l’événement de la mort, dans toute son incongruité, son illégitime occurrence. Et si dans la brièveté sèche des vers de Mallarmé – « père et mère se / promettant de / n’avoir pas d’autre / enfant / — fosse creusée par lui / vie cesse là14 », dans leur justesse poétique et rythmique impitoyable, l’écrivain reconnaît la mort de son enfant, le lieu de son dire et par là son tombeau, parce que « [f]aire l’expérience de l’art, c’est rencontrer ce moment où une œuvre, produite dans un contexte historique particulier, réalise, pour des sujets placés dans des situations différentes, l’expérience de leur propre historicité15 », c’est aussi dans la mêmeté de l’expérience, dans l’identification qu’elle permet, que va s’incarner pour lui la justesse de cette littérature, entre toutes celle lisible. L’interdiscursivité, qui est une intersubjectivité, entre son expérience et celle de Mallarmé, qu’un siècle pourtant sépare, la reprise donc, réitération et réénonciation, de ce poème et de son contexte réel, vont être les embrayeurs dignes de l’aider à dire sa propre expérience – sa singularité fondue dans sa pérennité, son éternité à travers le temps, son incessante actualité. Il faut donc ici, en d’autres termes, que Mallarmé ait vécu, et qu’il ait été un homme, mais aussi, qu’il ait écrit cent ans plus tôt, pour que se dise mieux que par toute syntaxe quelque chose du fond sans fin de la souffrance d’un père.
10La « préférence » accordée à l’écrivain n’est pas ici, on le voit, d’ordre esthétique. Elle est d’ordre éthique et inséparablement poétique, concernant la manière dont l’existence peut s’historiciser à travers le langage, et la nécessité de cette historicisation, qui est inscription subjective dans l’ordre indifférent du temps (il y a dans Tous les enfants sauf un de Philippe Forest de très belles phrases sur ce sujet16), à la fois pour/de celui qui a existé, et pour/de celui qui souffre sans fin possible sa perte. L’arrêt dans l’œuvre, l’arrêt de l’œuvre, que cette inscription parfois réalise, soit que le tombeau littéraire soit inachevable, soit qu’il ne puisse être suivi d’aucun texte, est une seconde historicisation, à une échelle à la fois symbolique et concrète, incarnée, de cette relation éthique entre le vivre et l’écrire, relation infinie dont les multiples formes trouvent en quelque sorte leur apogée, ou leur maximalisation, dans ce rapport aux seuils de vie, mort mais aussi parfois naissance.
11Ainsi de Pierre Michon récitant La Ballade des pendus17 lorsque les mots lui manquent – mais sont pourtant nécessaires – pour historiciser dans sa nudité sèche l’expérience de la perte, mais aussi celle, plus intrinsèque encore, plus radicale parce qu’elle est sans sujet, d’une vie terminée dont son acteur ne peut plus rendre compte. Il s’agit parfois d’écrire, mais il peut s’agir aussi de lire ou de réciter de mémoire un poème, comme encore le Booz endormi de Hugo à la naissance de sa fille, dont le contenu parfois ne s’accorde pas même, ou pas directement, avec la nature de l’événement, mais dont la teneur langagière, et plus exactement littéraire, est seule apte à rendre compte d’un moment réputé indicible. Car celui-ci au contraire, seul le dire, en ce qu’il est spécifiquement anthropologique, est apte à lui donner une dignité, c’est-à-dire ici une réalité qui s’empare des moyens qui sont proprement humains pour répondre à l’expérience de l’inconnu, ou, ainsi que Philippe Forest définit la mort, de l’inhumain.
12Si cette teneur est plus encore littéraire que simplement langagière, c’est que la littérature constitue un répertoire de discours, un patrimoine de dictions que la mémoire peut proposer lorsque l’imagination, la capacité d’invention sont suspendues face à la détresse suscitée par l’événement, et dont, produits de l’esprit humain, il y a tout lieu de penser qu’ils se sont construits avec l’empiricité d’une expérience réelle, comme chez Mallarmé.
13L’éthique peut alors être pensée comme l’ensemble des moyens par lesquels organiser le vivre et lui donner son sens18, et il n’est pas fortuit que la littérature, ou la fréquentation voire la cohabitation avec un « écrivain préféré », en soit l’un des premiers agents. Si historiciser sa vie en vivre est la dire par les moyens les plus appropriés, et si l’écrivain est ce langage en œuvre en avance sur notre propre savoir, alors sa coexistence va devenir une pratique, la pratique historique de notre propre existence, sa « révélation ».
14Si ce qu’on appelle l’écrivain n’est pas un individu, mais une œuvre, si le nom d’auteur, et exemplairement le pseudonyme, est le nom d’une activité dans le langage, bien plus que d’une personne, il peut aussi parfois être le nom de cette personne étendue, de ce sujet d’un vivre antérieur au nôtre, qui n’était pas seulement une plume, pas seulement l’auteur d’une esthétique, mais l’inventeur d’abord d’une relation d’ordre poético-éthique entre le tissu de son expérience et la toile de son œuvre, dont la nécessité, l’impératif, ont commandé l’écrire.
Lire et vivre
15Sortir de la conception individualiste de l’auteur n’empêche donc pas de considérer cet écrivain comme un compagnon de vie, n’empêche pas que le lecteur, lui, y pense comme à un individu, à une personne humaine avec l’ensemble de ses réalisations biographiques, qui sont parfois partie prenante de son devenir-écrivain (prises de position politiques, engagement sur tel ou tel sujet). D’où le fait que nous développions parfois des relations d’attachement qui vont au-delà d’un attachement littéraire, même si elles y ont pris naissance. Inversement, il est possible d’aimer une œuvre contre son auteur, malgré la personnalité de celui qui l’a faite. Ainsi, dans le plus clair des cas, un lecteur peut adhérer consciemment et délibérément à une œuvre parce qu’il en épouse les enjeux ouverts ou ceux de son auteur. Mais ce qui va réellement faire d’un écrivain cet élu entre tous qui, comment écrit bien Marielle Macé, « vaut la littérature19 », c’est l’activité notamment affective de son œuvre, non résumable à la somme de ses enjeux conscients. Cette activité langagière, on peut faire l’hypothèse que, transversale à ses multiples occurrences que sont les textes, elle pose un modèle de relation au monde, une médiation singulière qui est celle implicitement et sans doute inconsciemment adoptée avec le choix ou l’aveu de cette « préférence ». Celle-ci est un aimer mieux qu’on estime directement proportionnel à un dire mieux, dont l’étalon d’appréciation ne peut être qu’une relation spécifique à la réalité, un modèle de pensée et un système de valeurs déjà existants chez le lecteur, déjà éprouvés, même si inconnus, même si non conscients. En d’autres termes, je forme l’hypothèse que l’écrivain préféré vérifie, ou valide, une éthique du lecteur issue de sa propre expérience de vivre. Et que ce soit possiblement l’œuvre qui prodigue au lecteur cette éthique ne change rien à la nature de la relation, sinon en termes d’antériorité ou de postériorité, non pertinents, on l’a vu, dans l’ordre de cette réciprocité incessante engagée par la transsubjectivité de l’art. Si la relation est éthique, c’est non seulement qu’elle permet de « penser entièrement20 » la littérature, mais aussi qu’elle permet, réciproquement et par là même, de penser entièrement le vivre.
16Vivre qui est donc une configuration complexe, un réseau d’échanges et de circulations, que la rencontre d’une œuvre permet parfois d’historiciser en quelque sorte au maximum, par l’opération d’une coïncidence qui, loin d’être une simple co-occurrence, est en réalité une interpénétration – le vrai sens d’une rencontre. L’œuvre alors me dit pendant que je la redis, dans un mouvement d’énonciation ou de réénonciation réciproque. Mais ce me qu’elle récite et dans quoi je me reconnais alors que je m’y vois pour la première fois, parce que je m’y vois pour la première fois, ce n’est pas le complément ni même l’entièreté d’un objet, et ce n’est pas un individu : c’est un sujet, c’est du sujet ; c’est un vivre comme coïncidence au sens d’une exactitude, d’une justesse poétique qui réalise l’effectuation de ma valeur historique – de mon histoire comme valeur. Parce que le langage est le « grand interprétant », comme disait Benveniste, l’œuvre littéraire, dans sa diction du vivre, dans sa diction comme vivre, me fait advenir à ce que j’ignorais tout en le sachant. Fonction de l’art que ce travail de réinterprétation, de « remise en route de l’imaginaire de l’homme, de sa lecture créatrice de l’univers », ainsi que l’écrivait Duras21. L’œuvre alors, plus qu’un accompagnant, devient moi-même : la fonction même de moi, ipse chez Paul Ricœur22; cette distance nécessaire, et réflexive, qui me fait approcher toujours plus de ce que je suis, de ce que je deviens qu’elle m’aide à devenir, le sachant avant moi, étant, par définition, toujours en avance sur moi d’être collective, transsubjective, d’avoir éprouvé le détour d’un devenir-autre, d’une socialisation interne de sa singularité. Gérard Dessons écrit que « ce moment d’appropriation de l’œuvre de l’autre a ceci de singulier qu’il abolit la conception individualiste de l’individuation, dans la mesure où ce qui est reconnu comme le plus individualisé, étant le produit d’un acte subjectif (qu’il soit empiriquement le fait d’un individu ou de plusieurs), se trouve être en même temps ce qui concerne en propre d’autres individualités, qui y reconnaissent et y connaissent quelque chose d’elles-mêmes23 ». D’où vient sans doute que les écrivains qui s’intéressent à leurs prédécesseurs en viennent à fictionaliser leurs vies24, recherchant en dernière analyse moins ce qui a fait écrire, la clé d’une personnalité, que la façon dont écrire organise – sous-tend, transforme, altère ou grandit, et parfois justifie – le vivre.
17Car fictionaliser des vies, c’est mettre au jour des relations, et dans le cas de la biographie d’écrivain, ces relations se posent spécifiquement entre le vivre et l’écrire, ressortissent à une pratique de l’existence relative à cette activité d’écrire, qui est précisément autre chose et plus qu’une activité, qu’un pan des actions humaines dans l’économie d’une vie – mais peut-être bien l’économie même de cette vie comme vivre. C’est Duras écrivant : « Je peux écrire à la place de me conserver en vie, oublier de manger25 », où se distinguent une acception biologique de la vie et une acception historique de la vie, celle qui en passe par le langage et que j’appelle, à la suite de Gérard Dessons, un vivre.
18De façon analogue, on peut forger l’hypothèse que lire – lorsque la pratique en devient intensive, éthiquement signifiante comme avec l’écrivain préféré – sous-tend et organise le vivre, confère au sujet les moyens de s’approprier et de faire signifier son existence. Avec est sans doute, dans ce contexte, la préposition qui s’impose pour penser la relation entre un lecteur et son écrivain préféré. Si la création en tant que telle n’intervient plus dans le cas du lecteur en tant qu’individu, une créativité demeure dans le pouvoir qu’il se donne de la réénonciation, pouvoir de subjectivation qui revitalise cette historicité de l’écrire, la rejoue au présent et pour le propre compte de celui qui s’en empare, qui y met son vivre pour faire signifier l’œuvre à nouveau.
De la citation à la récitation : le rythme de l’écrivain
19Ce modèle intériorisé de l’écrivain préféré, ce n’est pas seulement, ou d’abord, un modèle philosophique ou intellectuel. C’est aussi, et premièrement, celui d’une rythmique de la parole : un modèle de phrase, ou plus exactement de phrasé26. La corporéité de son langage est ainsi une dimension active de l’écrivain préféré : on met son pas dans le sien, son rythme dans le sien, et sa rythmique devient la cadence de notre vivre, son écrire l’ouvrage de notre vie, son travail – ce ne sont pas tant sa voix ni son timbre, lorsqu’on les connaît, qui nous traversent, mais bien ce qui les tient, dans le parlé comme dans l’écrit : ce rythme du présent, ce déroulement du temps, par le langage, qui nous soutient dans l’entreprise de vivre; non pas seulement d’être animés de vie, mais d’activer historiquement – diciblement – le vivant en nous, l’humain anthropologique en nous.
20Lorsque Benveniste, dans son étude sur la subjectivité dans le langage, suggère que le seul moyen de concevoir « le temps où l’on est » est de le prendre comme « le temps où l’on parle27 », il induit une relation du sujet au présent qui est celle également en jeu avec l’écrivain-préféré. Car la « relation incarnée au présent » qu’évoque Marielle Macé28 est de l’ordre de cette contemporanéité qui n’est pas un effet du temps chronique, mais un effet du temps historique : par la réénonciation d’un autre-écrivain, d’une subjectivation littéraire, un je se met à coïncider avec son propre présent; une écriture, prise dans l’activité subjective et subjectivante de sa lecture comme réénonciation, devient la référence de ce temps où l’on est. Présent d’une coïncidence signifiante, donc, plus que d’un moment temporel même s’il en est également un, c’est cette lumière de la lecture évoquée par Duras, qui concurrence celle du jour : « On ne peut pas lire dans deux lumières à la fois, celle du jour et celle du livre29 ». L’activation d’une parole qui nous devient motrice, qui nous devient la nôtre d’inscrire ou d’inventer notre présent, c’est cela « l’écrivain préféré » : la justesse de dire ce que nous sommes, et plus encore, comment nous le sommes, la coïncidence de ce dire avec notre existence, l’exacte contemporanéité de ce dire avec sa nécessité dans l’instant – ce à l’échelle d’une vie.
21C’est ainsi sur le mode du récitatif que nous nous incorporons l’écrivain, qu’il s’incorpore à nous, à notre vivre : bientôt, même si nous continuons cependant de le faire, nous n’aurions plus besoin de le (re)lire : il parle en nous au point que nous le citons de mémoire, voire que nous le (re)formulons sans lui. Car nous pouvons l’interpréter, au sens exégétique comme au sens musical : nous le connaissons suffisamment bien, nous l’avons suffisamment compris, au double sens corporel et intellectuel, pour pouvoir le décliner, le varier, le faire rayonner en des variantes infinies; et les situations de notre vie sont des occasions de déclinaisons illimitées de son dire, qui est dorénavant le nôtre.
22Par là il ne vient pas simplement à notre secours, nous offrant l’occasion de placer un bon mot ; il nous offre littéralement les conditions pour penser une situation en train de se vivre, pour la nommer et la mettre en phrases. En ce sens sa poétique est toujours une préfiguration du vivre, de l’empirique, dans la mesure où sa justesse vient de ce qu’elle est en avance sur ce qui va susciter la nomination, ou requérir le dire. De ce point de vue l’écrivain est moderne30 : sa modernité est dans cette avance, dans cette prescience, dans sa capacité à nommer, ou à dire, ce que nous ignor(i)ons encore pouvoir vivre ; à nous le montrer, quand cela arrive. Elle agit comme une prédiction, au sens strict, de notre vivre comme coïncidence avec nous-mêmes, comme connaissance de notre historicité. En cela elle est éminemment puissante, d’abord surprenante, ensuite familière. Et c’est de sa familiarité même, qui est comme une accointance secrète avec ce que nous pensons sans pouvoir le dire – que l’écrivain offre, lui, les moyens de dire31 – que vient ce sentiment de vivre continûment avec l’écrivain, de le porter en soi, de l’avoir à nos côtés, de le sentir vibrer en nous comme une musique bien apprise. Son idiosyncrasie devient la nôtre, à moins que nous ne devenions la sienne.
23Avoir un « écrivain préféré », c’est faire de sa vie un vivre, de son individuation une transsubjectivation ; c’est sortir de tout solipsisme pour se donner une existence agrandie, un mode historique étendu; c’est grossir d’une autre subjectivité que la sienne, mais telle qu’elle étend la sienne propre : « L’évidence de l’art est une découverte de l’identité du sujet à travers un autre sujet. Elle se manifeste, par exemple, à la lecture d’un texte, dans ce sentiment que l’auteur a écrit exactement ce qu’on voulait dire32. » Mais ce n’est pas seulement, comme dans le registre de l’expression, la réalisation d’un possible qu’on était soi-même sur le point – ou dans la capacité – de réaliser. C’est une réalisation telle qu’on s’en découvre capable uniquement à passer par le détour de l’autre – qui n’est pas un autre individu, mais un autre sujet qui nous pose, réciproquement, en sujet33. « Le personnel et l’individuel, alors, ne coïncident plus. Quelque chose de moi, de mon goût ou de mon dégoût, est dans l’autre, est par l’autre, mais surtout n’est jamais aussi mien qu’en tant qu’il est autre, puisque, le découvrant, je m’y trouve […]. La particularité de l’individuation artistique réside en cela. Fonder l’identité sur une altérité radicale34. » De là vient peut-être la fortune croissante dans le domaine contemporain de ces fictions biographiques par lesquelles un écrivain réinvente le destin d’un de ses prédécesseurs.
De l’écrivain préféré à l’œuvre-écrivain
24Que cette articulation entre vivre, écrire et lire puisse devenir véritablement puissante est particulièrement visible lorsqu’elle agit sur la production même, ou une part de la production ou du principe, d’une œuvre. Ces fictions biographiques forment une part non négligeable du paysage contemporain mais ont toujours été, sans doute, une dimension de la relation des écrivains à leurs lectures : le désir d’incarner, de personnaliser ou de personnifier sa lecture d’une œuvre en recherchant l’homme ou la femme qui l’a composée. Ce, moins à travers la lecture même de l’œuvre qu’à travers, en un sens vraiment musical, artistique, son interprétation : une façon de la relire en en recomposant un volet énième, manquant, subsidiaire et parfois fantasque. Rêverie, songe, divagation ou improvisation, vision ou composition très personnelle – où il entre beaucoup de la manière de l’auteur interprétant – sur cet individu élargi, cet homme ou femme-œuvre qui devient dans son absence, dans sa disparition mythologisée, une part même de cette œuvre, de l’écriture encore. Ce sont les Beckett, Flaubert et autre Faulkner de Michon, les Mallarmé et Hugo de Forest, modèles aimés ou critiqués, longuement contemplés, intériorisés, compris, appréciés pour la condensation qu’ils offrent du tour qu’a pris une vie : cette façon, cette manière qui tient ensemble un regard, une attitude face à l’objectif ou à la mort, deux fixations du temps, deux arrêts irrémédiables, avec aussi un corps et sa tournure, une écriture et sa syntaxe, des actions et une psychologie, des gestes irréparables et leur destin tragique – ou parfois si banal. Cette interrelation, ce croisement de subjectivités, qui fait une « transsubjectivité », un sujet global qui est plus et autre chose que la synthèse des deux, c’est cela l’écrivain-préféré, à plus forte raison lorsqu’il aboutit en cette œuvre nouvelle, en quelque sorte tierce, qui en redit le tout signifiant pour un autre, et marque, pour celui-ci plus que pour celui-là encore, une historicité.
25Le sous-jacent de ces démarches littéraires, qui portent au rang de moteur voire d’éthique de l’écriture de réfléchir, au double sens du mot, la vie vécue d’un homme qui fût un écrivain, d’un écrivain qui fût un homme ; cette articulation du vivre avec le lire humanisé dans la rencontre d’un autre, de ce que l’on appelait autrefois « une sensibilité », et qu’il serait plus juste aujourd’hui de nommer une subjectivité, qui suscite à son tour l’écrire; leur sous-jacent donc est qu’on ne lit pas au hasard, qu’on ne lit pas pour rien, de même qu’on n’écrit pas au hasard ni pour rien. Mais que lire, comme écrire, dit qui nous sommes et peut-être ce que nous valons.
***
Le mot de la fin
26« L’écrivain préféré », alors, c’est cet ami qui nous devance en nous redoublant, qui nous précède pour nous convoquer mieux au moment de son impérieuse apparition; que nous convoquons pour qu’il nous rejoigne à la seconde où, le rendant plus vivant que de son vivant propre, nous le citons avec nos propres termes, pendant qu’avec les siens il invente notre devenir hommes. C’est peu dire alors qu’il est porteur d’un rapport au monde, d’ordre philosophique, affectif ou intellectuel, que nous favorisons. Il crée littéralement ce rapport, l’inaugure et en est la médiation même – sans laquelle, peut-être, le monde nous demeurerait éloigné, incertain, sans appartenance, nous refuserait son accès. C’est pourquoi découvrir par lui un langage contemporain de notre vie instaure cette vie comme vivre, et c’est pourquoi la relation que nous entretenons alors avec cet écrivain, loin d’être anodine, peut devenir jusqu’à un certain point vitale35.
27Produisant une image du vivre dans son entier ou dans sa signification, prodiguant une phraséologie et une rythmique à même d’en exprimer l’acuité et l’actualité, l’écrivain préféré est un compagnon de vie, un ami imaginaire qui a ce mérite d’avoir existé (ou d’exister encore), un homme qui vaut plus qu’un homme parce qu’il vaut le langage, et ne se dérobe jamais devant la difficile tâche d’interprétance qui est celle de l’humain vis-à-vis de son existence. Écrire, lire, vivre, sont des pratiques historiques, et s’il est vrai que « chaque roman désigne ce nœud de souffle et de sang par où l’individu naît à la vérité du temps36 », il est vraisemblable qu’elles forment ensemble l’activité d’une sémantisation nécessaire dont la portée et l’enjeu sont profondément éthiques.