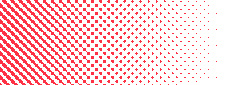1. On distingue les cœurs qui sont capables d’une hospitalité supérieure
S’accommoder des hommes comme ils viennent, tenir table ouverte dans son cœur, voilà qui est libéral, mais qui n’est que libéral. On distingue les cœurs qui sont capables d’une hospitalité supérieure au grand nombre de leurs fenêtres dont les rideaux sont tirés et les volets clos. Ils gardent vides leur meilleurs chambres. Pourquoi donc ? Parce qu’ils attendent des hôtes dont il ne suffit pas de « s’accommoder »1.
1C’est ainsi que Nietzsche parlait de la différence fondamentale entre deux types de rencontres qui portent certainement tous les signes de la prédilection. Des rencontres fortuites, d’une part, dont l’événement s’annule dans une économie libérale du cœur, qui la ramène à une qualité subjective préexistante pour alimenter l’amour propre. D’autre part, une rencontre dont l’événement est sauvegardé dans le tourbillon ombrageux de la lutte corps à corps, où le mérite personnel cède la place au mouvement éloquent d’une relation vivante.
2Les chambres vides et fermées de Nietzsche, comme dans le conte de La Barbe Bleue, sont l’endroit où la prédilection est testée et d’où peut naître la préférence pour quelqu’un. Cette chambre du test et du choix est le signe d’une hospitalité supérieure car elle n’est jamais le résultat d’un jugement porté sur soi-même, telle la libéralité ; ainsi restera-t-elle toujours à l’abri de la suffisance fatiguée du bon coeur. Elle devra être déchiffrée par celui qui sera choisi, ou par un tiers qui aura le plaisir de mesurer l’intensité d’une telle rencontre.
3L’accommodation difficile, presque guerrière, que la chambre vide prépare sera tantôt une prédilection pour autrui qui enseigne l’accomplissement de soi, tantôt une rencontre qui forcera l’individu à réagir à un problème de vie et de mort qui n’est pas donné d’avance. Dans cet article c’est dans ce sens que l’on parlera de ce qu’André Gide préfère ; l’on ira ouvrir quelques-unes des chambres vides de cet écrivain du début du siècle, en se concentrant tout particulièrement sur la lutte menée par André Gide pour accommoder Nietzsche et Dostoïevski dans l’espace de son œuvre littéraire. Avec Nietzsche Gide pensera aux formes, au sens et au temps de la prédilection et de l’amour pour la vie et l’ami ; avec Dostoïevski, il découvrira la rencontre qui transforme la vie et l’ami en problème romanesque et en personnage abyssal.
4Avant même de commencer, il faudra dire que Gide est un écrivain qui a gardé beaucoup de chambres vides pour accommoder ces écrivains préférés ; il suffit de mentionner peut-être que les plus longuement préparées et le plus tumultueusement habitées ont été les chambres de Nietzsche, de Dostoïevski, d’Oscar Wilde et de Mallarmé. Et il nous faudra aussi voir par la suite comment Nietzsche, qui n’est pas lui-même écrivain, le devient par l’exercice de la prédilection gidienne.
2. Nietzsche dans le Journal et les lettres de Gide.
5Dans son Journal Gide tient le compte des fenêtres fermées. Il s’agit d’abord de les dénombrer, et seulement en second lieu de les signaler aux autres. C’est l’occasion d’arpenter les façades de son esprit, de ses projets, de son parcours récent, tout seul, pour mesurer l’embrassure des fenêtres, leur espacement, pour admirer les arcades et l’étoffe sombre des rideaux ; on y mesure seulement ce qui pourrait provoquer le regard d’autrui de l’extérieur. Pour cette raison, le journal n’est pas encore le lieu d’où l’on puisse pleinement voir ce qui se passe dans les chambres que ces rideaux cachent. Il ne laisse voir aucune trace de Nietzsche avant 1902, la date de la publication de L’Immoraliste. En revanche, il y note avec minutie son voyage en Afrique, les livres qu’il est en train de lire ou d’achever, tout un tas de projets avec les circonstances et les dispositions qui les accompagnent. On y trouve souvent un souci éthique qui s’exprime à l’aide de nombreuses citations de la Bible, de Schopenhauer et des moralistes français. Il est pourtant étrange qu’un roman aussi nietzschéen que L’Immoraliste ne laisse dans le Journal aucune trace visible de la lecture du philosophe allemand. Plus tard, en 1918-1019, tout en se moquant d’une possible thèse écrite sur l’influence de Nietzsche sur son œuvre romanesque, Gide s’interroge :
Mais à quoi peut inviter ce travail ? À rechercher, dans mon Immoraliste par exemple, tout ce qui peut rappeler le Zarathoustra et à ne plus tenir compte de ce que m’enseigna la vie même. Le livre était tout composé dans la tête et j’avais commencé de l’écrire lorsque je fis la rencontre de Nietzsche, qui m’a d’abord beaucoup gêné. Je trouvais chez lui, non point une incitation, mais bien un empêchement tout au contraire. Si Nietzsche ici me servit, ce fut, par la suite, en purgeant mon livre de toute une part de théorie qui n’eût pas manqué de l’alourdir2.
6Le rejet du livresque d’une part et le besoin irrésistible d’autre part d’éclaircir sa pensée en lisant de la philosophie, énoncent tout le dilemme que soulève le nietzschéisme dans le Journal de Gide. Celui-ci ne reconnaît d’« influence » nietzschéenne sur son œuvre romanesque que dans la mesure où cette influence lui renvoie sa propre pensée (celle de Gide) comme dans un miroir plus « théorique ». Nietzsche est un préambule ou un concentré théorique de son œuvre romanesque, une sorte d’échafaudage intérieur qui pourrait être enlevé de l’édifice une fois terminé. On se souvient que dans le même sens, Gide parlait de la puissance de l’influence littéraire sur le processus créateur lui-même qui renforce l’originalité d’un écrivain. Dans son apologie de l’influence, Gide disait : « J’ai lu ce livre ; et après l’avoir lu je l’ai fermé ; je l’ai remis sur ce rayon de ma bibliothèque, – mais dans ce livre il y avait telle parole que je ne peux pas oublier. Elle est descendue en moi si avant, que je ne la distingue plus de moi-même […] Comment expliquer cette puissance ? Sa puissance vient de ceci qu’elle n’a fait que me révéler quelque partie de moi inconnue à moi-même ; […] les influences agissent par ressemblance. On les a comparées à des sortes de miroirs qui nous montreraient, non point ce que nous sommes déjà effectivement, mais ce que nous sommes d’une façon latente3 ».
7La lettre est pour Gide le complément du Journal, dans le sens où on y voit seulement ce qui se passe dans les chambres des luttes pour la reconnaissance, sans pouvoir deviner si elles sont des chambres réservées. Dans une lettre Gide dévoile son désir, mais pas vraiment ses choix. Il montre à quelqu’un ce qu’il cache aux autres, de même qu’il peut cacher à quelqu’un ce que tout le monde sait. C’est dans ce jeu double qu’il construit une confidence. « Nietzsche me rend fou ; - écrit-il à Drouin- pourquoi a-t-il eu lieu ; j’eusse follement voulu l’être ; je découvre avec jalousie une à une, toutes mes pensées secrètes […]. On m’accusera plus tard d’avoir été formé par Nietzsche4 ». Après cette première effusion, toute une démarche de légitimation sera mise en scène où l’on voit comment Nietzsche est petit à petit ramené à cette chambre longuement préparée pour la lutte de l’accommodation où Gide mesure son propre pouvoir créateur. « Oh ! Surtout ne crois pas que je cherche à me diminuer Nietzsche. Je lui fais mes dévotions particulières et l’ai canonisé. Mais je cherche à comprendre comment, en lui, mes plus secrètes et chères pensées se retrouvent chez elles, et partout toujours précédées5 ». Tout de suite après il se rebiffe et parle de l’influence de Nietzsche sur tout une génération : « toute œuvre de Nietzsche est une préface et n’est que cela […] S’étonner (soi artiste) d’avoir au fond de soi, presque insoupçonnées, les pensées que Nietzsche pousse au grand jour, c’est s’étonner d’avoir une vision artiste du monde […]. Je veux dire que, d’ordinaire, l’état nietzschéen n’est pas un résultat d’une évolution de pensée, mais d’une disposition physiologique et d’un encouragement du milieu, de sorte que l’on ne s’en aperçoit pas6 ». Ici, la généralité veut cacher l’événement de la lecture récente de Nietzsche.
8Un an plus tard, dans une lettre à Angèle, Gide reprend la question de l’influence, tout en lui donnant une tournure nouvelle : d’une action subie et en partie inconsciente, elle devient une vertu active, une sorte de congénialité qui n’est pas à la portée de tout de monde. Ainsi s’annonce une sorte de société des élus nietzschéens, « des cerveaux préparés », « préface d’œuvres admirables ». La rencontre avec Nietzsche est cette fois appelée « une fatalité charmante ». Le « nous » et le « je » s’y mêlent dans une participation heureuse au destin de l’œuvre de Nietzsche elle-même. Le philosophe est regardé comme ayant ce grand pouvoir de formulation et cette manifestation des pensées qui sont restées jusqu’à lui latentes et éparses.
9Dans les lettres la question de l’originalité, du travail d’élaboration et de l’inspiration se déplace vers la question de l’authenticité, du désir et de la rencontre. De ce fait, penser en termes nietzschéens, loin de nier l’individualité, l’affirme dans sa propre nature, à l’instar des personnages de Dostoïevski, qui, pour avoir été Nietzschéens, deviennent d’autant plus authentiques et puissants. L’œuvre d’art – dans le cas de Gide la prose lyrique, le récit de voyage et le roman – est la vraie chambre où l’œuvre philosophique se change d’une « éternelle préface » en une activité d’élection, de prédilection et à la fin en une préférence obtenue par un long travail d’accommodation.
3. L’accommodation romanesque.
10On pourrait lire l’œuvre romanesque de Gide comme le passage d’une chambre où l’on accommode les pensées et le style de Nietzsche à une chambre où l’on a longtemps attendu Dostoïevski. Ainsi, les grandes œuvres où Nietzsche est une marque certaine sont ses œuvres de jeunesse : Les Nourritures terrestres et L’Immoraliste. Immédiatement après la parution de celui-ci, une pléthore d’articles et de comptes rendus ont tracé la source de ce mot étrange d’immoraliste dans l’œuvre du philosophe allemand. N’eût été l’étrangeté de ce mot, le problème de l’influence de Nietzsche se serait posé avec moins d’insistance7.
La parole des livres brûlés ou l’élection lyrique
11La prose poétique de Gide que l’on trouve dans Les Nourritures terrestres explore le côté dithyrambique de l’écriture nietzschéenne. C’est la langue de celui qui se parle à lui-même en parlant à l’ami :
Quelle langue un tel esprit parle-t-il lorsqu’il se parle à soi seul ? La langue du dithyrambe. Je suis l’inventeur du dithyrambe …je prends par exemple, le chant nocturne – la plainte immortelle d’un être condamné, par surabondance de lumière et de puissance, par sa nature solaire, à ne pas aimer.
C’est nuit : maintenant toutes les fontaines jaillissantes parlent plus fort. Fontaine jaillissante, mon âme l’est aussi.
C’est nuit. Maintenant seulement s’éveillent tous les chants des amoureux. Et mon âme est aussi le chant d’un amoureux.
Quelque chose d’inassouvi, d’inassouvissable, est en moi, qui veut se faire entendre. Un désir d’amour est en moi, qui parle le langage de l’amour.
Je suis lumière : ah, que ne suis-je nuit ! Mais c’est ma solitude, qu’être de lumière encerclé. …
Mais je vis dans ma propre lumière, je ravale les flemmes qui s’échappent de moi.
Je ne connais pas le bonheur de prendre ; et j’ai souvent songé que voler, plus encore que prendre, est le vrai bonheur.
C’est là ma pauvreté, que ma main ne se passe de donner ; de là vient mon envie, de voir des yeux pleins d’attente et des nuits illuminés par le désir.
Oh, misère de ceux qui donnent ! Ténèbres jetées sur mon soleil ! Désir fou de convoiter ! Oh, fringale dans la satiété !
Ils acceptent mes dons : mais puis-je encor toucher leur âme ? Il est un gouffre entre prendre et donner : le gouffre le plus étroit est le plus impossible à franchir8.
12Le chant nocturne comme autant d’autres chants dans Ainsi parlait Zarathoustra jaillit de la source de tout don, la condition de possibilité de tout choix et la garantie de toute élection : la solitude lyrique. Le chant est la langue qui enseigne une attitude, une altitude, un état, une disposition de l’esprit et de la sensibilité qui se maintiennent et s’enrichissent par la profération lyrique. Celle-ci est la promesse d’une vocation du moment où elle se manifeste à travers l’élection de l’ami.
13C’est dans Les Nourritures terrestres que les chants nietzschéens peuvent éclore, et dans lesquels l’ami choisi et la nuit de solitude sont d’emblée donation, demande et accueil. Le poème ne porte pas seulement l’insigne de la vocation apprise dans la solitude, mais il est également adresse ; son énergie aussi bien que sa plénitude viennent de l’incantation du nom de l’être aimé, de l’élu:
Nathanaël, je ne peux commencer un seul vers, sans que ton nom délicieux y revienne.
Nathanaël, est-ce que tu comprends assez le pathétique de mes paroles ? Je voudrais m’approcher de toi plus encore.
Et comme, pour le ressusciter, Elisée, sur le fils de la Sunamite – « la bouche sur la bouche, les yeux sur ses yeux, les mains sur ses mains, s’étendit » - mon cœur rayonnant contre ton âme encore ténébreuse, m’étendre sur toi tout entier, ma bouche sur ta bouche, et mon front sur ton front, […] afin que dans la volupté tu t’éveilles, puis me laisses – pour une vie palpitante et déréglée.
Nathanaël, voici toute la chaleur de mon âme – emporte-la.
Nathanaël, je veux t’apprendre la ferveur9.
14L’élection lyrique n’est pas le résultat d’une décision (je te choisis parmi d’autres), encore moins est-elle le résultat d’un pacte. Elle est une élection sans alternative et sans histoire. Nathanaël est simplement là, le dédicataire de tous les poèmes et de tous les récits poétiques du livre, sans l’histoire d’une rencontre, sans accord conclu de longue date.
15La force de l’élection lyrique se mesure par le fait que le poème ne loue personne d’autre que Nathanaël, tandis qu’il exalte beaucoup de choses. « Voilà pourquoi, Nathanaël j’ai nommé Dieu tout ce que j’aime, et pourquoi j’ai voulu tout aimer. Ne crains pas que je t’énumère ; d’ailleurs je ne commencerais pas par toi ; j’ai préféré bien les choses aux hommes et ce ne sont pas eux que j’ai surtout aimés sur la terre10. » L’élection lyrique est lisible dans l’adresse du chant, et non pas dans son contenu, ni dans ses images ; le contenu comme on le verra scande l’impossibilité de tout choix, de toute élection. De ce fait, tout ce qui est offert par l’adresse doit être reçu avec une volupté égale, un désir toujours neuf, sans discrimination. Car ce qui est donné à l’être aimé et élu est ce que le livre appelle « la ferveur » et la « volupté » qui désigne précisément cette disponibilité totale devant toute chose pour laquelle « choisir m’apparaissait non tant élire, que repousser ce que je n’élisais pas11 » ; la disponibilité ressent l’étroitesse des heures qui enferme chaque sélection, la jalousie envers tout ce que l’on n’a pas fait, où le dépouillement que chaque possession particulière impose au sujet. Or le déploiement poétique comprend à la fois la sensation multiple et l’adresse élective ; elle scande la disponibilité envers les choses et l’élection de la personne. Le temps de la parole coïncide à proprement parler avec l’intensité de la sensation des choses, et l’urgence de l’invocation de l’aimé. Le temps du chant est ce que Gide appelle « l’instant séparé », où le chant confère une aura de plénitude à la sensation unique, en réitérant insatiablement le nom de l’aimé.
16Mais qu’est-ce que l’on doit apprendre du poème, et comment ? Et où passera le temps de l’apprentissage, dont la structure temporelle ne peut pas être l’instantané, mais plutôt une sollicitude de la durée dans l’ordre des étapes bien précises ? L’enseignement que le livre de Gide renferme est appelé par lui une « désinstruction » ; elle se déroule après avoir brûlé tous les livres et elle commence avec cette demande extrême : « quand tu m’auras lu jette ce livre – et sors ! ». Sur le modèle Nietzschéen d’une quête spirituelle non livresque décrite déjà si bien dans Ecce homo, Gide conçoit l’enseignement en tant que formation, connaissance et enrichissement de soi-même après avoir abandonné tous les livres. Ne pas pouvoir choisir parmi les choses qui s’offrent mesure le pouvoir qu’a sa propre vie de se choisir elle-même : « Attends tout ce qui vient à toi ; mais ne désire que ce qui vient à toi […] toute fatigue de tête vient, ô Nathanaël, de la diversité de tes biens. Tu ne sais même pas lequel entre tous tu préfères et tu ne comprends pas que l’unique bien c’est ta vie. Le plus petit instant de vie est plus fort que la mort. La mort, n’est que la permission d’autres vies, pour que tout soit sans cesse renouvelé12 ».
17La conception de la lecture est précisément liée, chez Gide comme chez Nietzsche, à un processus de mort et d’abandon de soi qui peut dans un mouvement dialectique se transformer en désir de soi. Tous les livres que l’on lit sont des concentrés d’autres vies que la nôtre ; ils désignent ainsi notre propre mort. Mais le livre est aussi chez Gide et Nietzsche l’ami qui développe le goût de la patience envers soi, et celui qui accompagne dans la solitude. Le livre peut acquérir les vertus de la patience et de la bonne compagnie seulement par amour : l’amour de la langue (la philologie) et amour de l’élu, qui est le lecteur choisi. Dans les deux cas, le livre en tant qu’écriture sur papier s’annule dans l’apprentissage par cœur et la récitation. En dehors de l’apprentissage rhétorique démocratique, Nietzsche nous propose comme Mallarmé l’action restreinte d’une lecture intensive et des lecteurs choisis (préférés) : « de tout ce qu’on écrit, je n’aime que cela qu’on écrit avec son sang. […] Il n’est guère possible de comprendre le sang d’autrui ; je hais tous ceux qui lisent en badauds. […] Celui qui écrit avec son sang et maximes ne veut pas être lu, mais appris par cœur13 ».
18Le temps de la lecture est la nuit de la solitude où le livre sera le seul ami possible : « Nathanaël, je voudrais arriver à cette heure de nuit où tu auras successivement ouvert puis fermé bien des livres cherchant dans chacun d’eux plus qu’il ne t’avait encore révélé ; où tu attends encore ; où ta ferveur va devenir tristesse, de ne pas se sentir soutenue. Je n’écris que pour toi ; je ne t’écris que pour ces heures. […] Je voudrais m’approcher de toi et que tu m’aimes14 ». L’instant fatal de la récitation scelle la contemporanéité absolue entre le lecteur, et l’auteur fictif du livre, et il est comme dirait Leibnitz « gros de l’avenir » et « gros du passé ». Il définit une temporalité monadique d’une écriture-lecture transmise par le sang, par le cœur, faite de la longue attente de ce qui nous est déjà arrivé (l’après-coup de la lecture), et de la mémoire d’une demande impérieuse (la promesse de l’écriture).
19L’écriture est à la fois abritée et défaite par l’élu ; la simultanéité absolue entre le lecteur et l’écrivain dans le « par cœur » est comparée par Gide à un festin des sens d’où l’unité du sujet à été bannie : « et chacun de mes sens a eu ses désirs. Quand j’ai voulu rentrer en moi, j’ai trouvé mes serviteurs et mes servantes à ma table ; je n’ai plus eu la petite place où m’asseoir ; quand j’ai voulu m’approcher de la table, ils se sont tous levés contre moi, ivres ; ils m’ont chassé de chez moi15 ». C’est de ce festin des cinq sens que toute préférence peut naître en tant que ce que Gide appelle « un rendez-vous de sensations16 ». L’écriture qui se donne à la lecture choisie consolide un état d’accueil et de disponibilité envers ce qui est présent ; elle transforme la mémoire en répétition à nouveau (le oui à la vie et la rédemption du passé, par l’éternel retour) de ce qui a été, et elle se maintient dans l’attente patiente de ce qui n’est pas encore (la création de l’avenir).
20Si d’autres noms apparaissent dans le livre, ce sont les noms des élections passées d’un professeur (l’amant) à son disciple (l’aimé). Ce rapport nous rappelle le schéma du Banquet, et la structure non symétrique de l’amour homosexuel qui forme la chaîne de la transmission du dialogue platonicien. Ménalque est le professeur qui a parlé dans le passé à celui qui parle maintenant dans Les Nourritures terrestres. Il donne une certaine épaisseur intensive au présent des instants séparés des dithyrambes et des poèmes en prose de ce livre. Le passé et l’avenir y sont liés par la vibration répétitive et brûlante du discours poétique. Le rapport de l’enseignement électif est le double rapport (dans le sens de Rousseau, constituant et constitué, commandement et obéissance) suivant : le discours du professeur amant précède toujours la sensation singulière de l’aimé, mais la sensation subie par l’aimé est la seule qui puisse sélectionner ce que dans ce discours sera transmis et qui constituera son enseignement: « Mais vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir, Angaire, Ydier, Tityre, dit Ménalque (et je te le redit à présent en mon nom, Nathanaël), la passion qui brûla ma jeunesse17 ». Ce qui fait brûler les livres est la passion, la ferveur, qui est aussi ce qui lie l’écrivain préféré au lecteur préféré dans une transmission foudroyante.
L’immoralisme ou l’élection épique
21La vocation lyrique et le don du poète comme « don de perpétuelle rencontre18 » s’enseignent à coups dithyrambiques, mais pour tirer une leçon de cet enseignement (qui dans le poème est attitude, état, disponibilité à l’état pur) la parole a besoin d’une certaine distance entre le locuteur et son adresse, une distance à la fois temporelle et de perspective. Relation fusionnelle et conflagration, l’amour de l’élection lyrique est une transmission sans reste (ce qui reste doit être brûlé, les livres) qui annule la possibilité d’avoir appris quelque chose en additionnant les savoirs, en exprimant le choix d’un mode de vie parmi d’autres, comme on le fait quand on tire une leçon. Toute leçon a besoin de l’horizon de la morale et du savoir pour naître en tant qu’apprentissage. Nietzsche, en parlant de Schopenhauer comme éducateur, caractérise cette transmission si rare de son temps, en termes de transmission honnête et sereine. « Schopenhauer, au contraire, se parle à lui-même : ou si l’on veut à toute force lui supposer un auditeur, qu’on pense à un fils instruit par son père. C’est un discours droit, rude, bienveillant devant un auditeur qui écoute avec amour. Nous manquons de tels écrivains […] un philosophe doit être très honnête pour n’avoir recours à aucun procédé de poésie ni de rhétorique […] Outre l’honnêteté, Schopenhauer a encore une autre qualité en commun avec Montaigne : une sérénité qui rend réellement serein19 ». Et ici, Nietzsche parle de deux types de sérénité, celle qui rend serein et celle qui au contraire a l’effet d’une gaîté qui afflige le lecteur. Dans ce nouvel horizon, celui de l’honnêteté et de la sérénité, l’enseignement et l’élection se fait à force d’exemple. Comme dans le poème, les livres ne sont pas suffisants pour que cette transmission ait lieu, mais à l’opposé du poème, ils ne doivent plus être brûlés. Ils enferment une leçon seulement dans l’horizon vécu de l’honnêteté et de la sérénité qui exprime la plus haute continuité qui puisse exister entre la vie de l’écrivain et ses œuvres.
22C’est dans cet horizon moral de l’honnêteté et de la sérénité que L’Immoraliste de Gide affirme son nietzschéisme. Comme dans Les Nourritures terrestres, le livre est une adresse aux amis, mais cette fois, ce sont les amis qui écrivent et transmettent, qui accueillent et gardent une leçon. L’expérience singulière du sujet nietzschéen s’exprime de vive voix par le narrateur de L’Immoraliste, Michel qui s’adresse à ses quatre amis dans un moment de détresse où il éprouve le besoin impérieux de parler. L’urgence de ce besoin de parler apparente périlleusement son récit au genre des confessions, cas dans lequel il se déroberait à toute exigence de sérénité, quand bien même il ferait preuve non pas d’honnêteté, mais de simple sincérité. Quelle est la différence entre sincérité et honnêteté ? Celle-là exige une transparence absolue et a-relationnelle du sujet qui parle, tandis que celle-ci colore la parole sincère du souci pour autrui, de ce qui pourrait servir à celui choisi comme interlocuteur. La parole est honnête envers celui auquel on parle. De cette façon, on pourrait dire que parler honnêtement à quelqu’un veut d’abord dire connaître et assumer tout ce qui est humain, pour pouvoir ensuite parler des vérités qui servent à la vie des autres. Or c’est dans l’horizon même de cette connaissance de tout ce qui est humain que l’immoralisme peut apparaître comme une présence spécifique de soi-même, et le choix de soi-même comme possible exemple pour les autres, les amis. Dans Humain trop humain, Nietzsche parle de la société élective des amis comme d’une société que l’on invente pour pouvoir assumer et donner à son expérience une valeur universelle de vérité. Ce n’est que par souci pour les amis choisis que l’esprit sentencieux de la morale, nommé par Nietzsche « esprit de lourdeur », peut devenir léger et serein, et que la sincérité reçoit quant à elle le poids de l’honnêteté :
j’ai pour mon usage intenté aussi les « esprits libres » à qui est dédié ce livre mélancolique, intitulé Humain trop humain : des « esprits libres » de ce genre il n’y en a pas, il n’y en a jamais eu, – mais j’avais alors, comme j’ai dit, besoin de leur société pour rester de bonne humeur parmi des humeurs mauvaises (maladie, isolement, exil, acedia, inactivité) : comme des vaillants compagnons et fantômes avec lesquels on cause et on rit – comme un substitut pour les amis manquants. Qu’il pourrait un jour y avoir des esprits libres de ce genre, que notre Europe aura parmi ses fils de demain et d’après-demain de pareils joyeux et hardis compagnons, corporels et palpables et non pas seulement comme dans mon cas, à titre de schèmes et de jeu d’ombres pour ermite : c’est ce dont je serais le dernier à douter20.
23À caractère fictif dans le présent, les compagnons-ombres sont les amis réels de l’avenir. D’autre part, le témoignage singulier du discours des aphorismes d’Humain trop humain, et des paraboles de Ainsi parlait Zarathoustra porte sur le passé qui a été dépassé. Ainsi, la leçon prend forme entre l’avenir de l’amitié universalisante et le passé du témoignage singulier.
24La forme narrative que ce dépassement didactique revête est le récit de voyage et le dialogue entre le sujet nietzschéen (Zarathoustra, le voyageur) et un personnage, que l’on pourrait nommer avec Deleuze un personnage conceptuel, dont le sens est entièrement symbolique et qui représente (incarne) un danger que le psychisme de l’esprit libre doit affronter, reconnaître et dépasser. De ce passé singulier, à l’entremise des amis, l’esprit libre atteint à sa vérité plus englobante qui rend visible une hiérarchie des perspectives. « Cet événement de ma vie – l’histoire d’une maladie et d’une guérison, car cela finit par une guérison – n’a-t-il été qu’un événement personnel ? Cela n’a-t-il été mon “humain, trop humain” ? Je suis tenté de croire aujourd’hui le contraire : je commence à penser et je pense toujours plus que mes livres de voyage n’ont pourtant pas été rédigés pour moi seul, comme il me semble parfois21 ».
25L’adresse est porteuse d’avenir, le récit de voyage, de passé. Ce sont les deux faces de la vérité, celle proposée par le voyageur et celle testée ensuite par les amis choisis. L’articulation entre une vie passée qui est racontée dans le récit de voyage et sa lecture (réception) par les amis marque un moment de crise que le sujet (ici Michel) conteur entrevoit comme « un tel point de ma vie que je ne peux plus dépasser. Pourtant ce n’est pas lassitude. J’ai besoin, j’ai besoin de parler, vous dis-je. Savoir se libérer n’est rien ; ardu c’est savoir être libre. Je vais vous raconter ma vie, simplement, sans modestie et sans orgueil, plus simplement que si je parlais à moi-même22 ». Ce que le récit doit dire est l’histoire d’une libération, mais ce que le récit ne peut pas raconter est l’expérience même de la liberté après la libération. Dans cette perspective on voit combien l’élection lyrique diffère de l’élection épique de « l’écrivain » : le sujet de l’histoire d’une libération, le conteur épique laisse à ses lecteurs choisis, à ses amis la tâche de l’aider et de s’aider eux-mêmes à trouver le sens et le goût de la liberté. À l’autre bout de la chaîne, le sujet lyrique, chassé de la table du festin des cinq sens, toujours hors-de-soi, offre à l’ami une liberté tout nue, sans l’histoire de la libération.
26L’Immoraliste suit un schéma narratif déjà proposé par Nietzsche comme récit de voyage. Le protagoniste de l’histoire est son conteur, Michel, qui réunit dans son destin beaucoup d’éléments déjà présents dans l’autobiographie du philosophe allemand. Comme le jeune Nietzsche, Michel est un spécialiste de philologie classique, héritant sa passion pour les livres de son père qui meurt relativement jeune et sa première morale, austère, de sa mère (ici il diffère de la « canaille » du côté maternel de Nietzsche). Le voyage vers le sud, l’Italie et les pays barbaresques, est lui aussi un motif nietzschéen. N’oublions pas que Nietzsche écrit son Zarathoustra à Gênes, et Humain trop humain à Sorrente, villes mentionnées dans L’Immoraliste. Un autre thème nietzschéen du livre serait celui de la maladie à travers laquelle le héros apprend le vrai sens et la valeur de la vie. La terre normande et les « singulières rencontres » avec ses habitants sournois, fripons et canailles nous rappelle de si près le domaine boisé de Zarathoustra et les hommes supérieurs à l’envers qu’il y croise. Mais je ne voudrais pas m’attarder plus longuement sur ces thèmes nietzschéens dans le livre qui ont fait déjà le sujet de beaucoup d’articles dès la publication du livre.À leur place, j’aimerais suivre les lieux où s’articulent les signes et les récits de la préférence.
27D’abord, dans le discours de la préface de l’auteur, on peut lire : « Je n’avais pas en vain orné de tant de vertus Marceline ; on ne pardonnait pas à Michel de ne pas la préférer à soi23 ». Ici la préférence n’est autre que la perspective morale dans laquelle l’auteur offre son récit au lecteur en lui demandant de s’abstenir de juger pour ou contre, de honnir ou de louer son héros ; à la place du jugement, il propose l’appréhension d’un problème, car « maints grands esprits (sic !) ont beaucoup répugné à… conclure – et que bien poser un problème n’est pas le supposer d’avance résolu ». Ne pas immédiatement juger afin d’obtenir une vision des problèmes moraux a été aussi le programme de Nietzsche. Il appelle cette vision de la valeur de la morale le problème de la hiérarchie, qui s’articule au moment de la prise de conscience d’un certain chemin et des malheurs nécessaires pour arriver à « tout degré “plus haut”, “relativement supérieur” qui s’appelle également “l’homme” […] Voici une longue échelle, dont nous avons nous-mêmes occupé et gravi les échelons – que nous même avons été à quelque moment !24 » Savoir raconter équivaut dans ce sens à savoir poser le problème de la hiérarchie des valeurs humaines. Ailleurs dans le texte, Nietzsche dévoile qu’une des méthodes pour poser le problème de la hiérarchie est le pouvoir de renverser les perspectives, qu’il décrit ainsi : « À partir d’une optique malade, considérer les notions et les valeurs plus saines puis, à l’inverse, à partir de la plénitude et de l’assurance tranquille de la vie riche, regarder, en contrebas, le travail secret de l’instinct de décadence25 ». Or, c’est exactement cela que l’immoralisme. L’immoralisme est ce pouvoir de renverser les perspectives et non pas simplement un manque de jugement moral par lequel on choisirait la mauvaise action, ou le mal aux dépens du bien.
28C’est exactement ce qui se passe dans le livre de Gide. Son schéma narratif montre les deux faces symétriques de la grande santé sous la décadence et de la décadence qui ronge tout esprit sain. De cette façon son livre est plus proche de la démonstration des premiers livres d’aphorismes de Nietzsche, Humain trop humain, et Aurore, que de Zarathoustra et de son schéma ascendant. Le renversement des perspectives que ce récit nous propose laisse aux amis le droit et la tâche de conclure et de prendre position, finalement de choisir leur vie en fonction de la leçon qu’ils tirent de la vie d’un autre. Cette logique était énoncée par Zarathoustra comme « voici mon chemin, quel est le tien propre ? ».L’écrivain préféré offre un exemple de vérité.
29Mais quelle est à proprement parler l’histoire de ce renversement des valeurs dans L’Immoraliste ? Il y a dans le livre deux voyages : le premier est un voyage de noces, mais qui se transforme graduellement en séjour de cure de santé. Michel tombe malade et sa femme Marceline lui prodigue par amour tous les soins et les distractions nécessaires à la guérison. Il guérit au fur et à mesure qu’il apprend la vraie valeur de la vie, et surtout le fait que la vie est soutenue d’abord par l’amour des petites choses (Nietzsche), qui doivent être exaltées plus encore que les idéaux qui s’éloignent de la vie. Ainsi apprend-il en bon nietzschéen à préférer un bon repas et une vie en plein air à la lecture de ses livres ; à préférer les jeunes garçons kabyles qui regorgent de santé et de liberté à un idéal de vie conjugale qui enferme l’élan vital. Mais les mêmes préférences changent de sens pendant le deuxième voyage dans le sud, où la situation sera inversée : maintenant c’est Marceline qui tombe malade et qui va graduellement vers la mort à cause des mêmes préférences pour les petites choses et la compagnie des mêmes jeunes garçons devenus entre temps plus clairement des chenapans assagis.
30Entre ces deux voyages il y a la prise en possession de la propriété terrienne de la Normandie, La Morinière, et la rencontre avec son collègue Ménalque à Paris. Les deux phases intermédiaires entre le premier et le deuxième voyage définissent les domaines d’une sérénité sans honnêteté, et celui d’une honnêteté sans sérénité, incarnés tour à tour par le mensonge insouciant des petits esprits de la Morinière en Normandie, et le simulacre du grand esprit qui ne se soucie pas de la valeur morale de son interlocuteur. Ménalquetransposé dans le récit de Michel n’est qu’un « célibataire de l’art », qui apprécie l’art ancien dans lequel la beauté et l’action ne faisait qu’un, mais qui n’arrive plus à écrire car « je ne veux pas me souvenir. Je croirais, ce faisant, empêcher d’arriver l’avenir et faire empiéter le passé. C’est du parfait oubli d’hier que je crée la nouvelleté de chaque heure. Jamais, d’avoir été heureux ne me suffit. Je ne crois pas aux choses mortes, et confonds n’être plus, avec n’avoir jamais été26 ». Sans aucun désir d’expression, Ménalque n’est qu’un simulacre de vertu supérieure. Il n’arrive à être qu’un pseudo-immoraliste. Il est la figure du cynique, définie par Nietzsche dans la seconde considération inactuelle par « sa faculté d’oublier ou bien, en termes plus savants, la faculté de sentir les choses, aussi longtemps que dure le bonheur, en dehors de toute perspective historique27 ». Mais pour Nietzsche, le cynique le plus accompli est l’animal. L’instant fatal vécu en permanence ce passe ici volontiers du « par cœur » de l’élection poétique et de la leçon rétrospective de l’élection épique, en sorte que sa vie reste en dehors de l’échelle humaine et ne touche jamais au problème de la hiérarchie des valeurs. Ménalque est incapable de comprendre son propre devenir. Ainsi n’est-il que très semblable au « singe de Zarathoustra », celui qui imite les valeurs supérieures par le dénigrement lourd et amer des misères et de l’asservissement de toutes les vertus. « Tes propos de fou – dit Zarathoustra – me portent préjudice, même quand tu as raison. Et même si Zarathoustra avait cent fois raison en paroles, toi, usant de mes propres paroles, toujours – tu réussirais à avoir tort28 ». L’esprit de lourdeur de Ménalque n’est que trop visible dans la façon dont il parle de sa joie comme un veuvage spirituel et comme une perpétuelle corruption de la manne céleste.29
31D’autre part, La Morinière se construit sur le modèle de la « nouvelle idole », ce petit état dans l’état, organisation de la propriété qui repose sur le mensonge et le vol.
32Après avoir vendu son domaine, en donnant une solution narrative au problème de la dépossession de soi de chaque propriété, le sujet nietzschéen répond à celui qui enseigne avec lourdeur que l’« on croit que l’on possède, et l’on est possédé30 », par le choix de sa famille et ses biens en continuant à aimer et en accompagnant sa femme jusqu’à sa mort. Ainsi, l’immoralisme de Michel n’est pas synonyme d’un crime. Si on lit attentivement, on s’aperçoit qu’il ne s’agit pas du remords (celui d’avoir laissé sa femme mourir), mais surtout et d’abord d’un récit qui ouvre la question de la hiérarchie des raisons et des valeurs : qu’est-ce qui vient d’abord, se demande ce récit, la vie et la valeur des petites choses que l’on peut observer et apprendre tout seul en cherchant son propre bien, ou bien l’idéal ancré dans une tradition dans lequel on cherche le bien d’autrui ? Dans le premier cas, est-ce vraiment la force de l’observation et le désir de l’emporter sur chaque coup de la maladie, ou bien les soins de l’amour conjugal qui ont guéri Michel ? Dans le deuxième cas, est-ce l’inobservation des petites choses de la vie ou bien le manque de soin de son mari qui a précipité la mort de Marceline? Et encore plus fondamentalement, quelle est la leçon que l’on tire de l’enchaînement même du premier et du deuxième voyage ? Michel a-t-il vraiment appris quelque chose sur la valeur de la vie ? Y a-t-il une leçon apprise entre le premier et le deuxième voyage ?
33L’enchaînement narratif comme leçon pour la vie a été traité par Nietzsche quand il parlait du sens de l’histoire. Michel est lui aussi historien, mais après sa guérison il s’aperçoit que l’histoire n’est que l’« immobilité de la mort » et que « tous les faits de l’histoire m’apparaissaient comme les pièces d’un musée31 ». Dans la seconde considération inactuelle, « De l’utilité et de l’inconvénient de l’histoire pour la vie », Nietzsche parle du choix du héros ou de l’événement préférés de l’histoire, comme relevant de la « force plastique de l’individu » définie comme « cette force qui permet à quelqu’un de se développer de manière originale et indépendante, de transformer et d’assimiler les choses passées ou étrangères, de guérir ses blessures, de réparer ses pertes, de reconstituer sur son propre fonds les formes brisées32 ».
34Michel arrive lui aussi à étudier et à comprendre l’histoire par le choix de ses héros préférés, et non pas par l’analyse froide de la lettre morte des archives :
À présent, si je pouvais me plaire encore dans l’histoire, c’était en l’imaginant au présent. Les grands faits politiques devaient donc m’émouvoir beaucoup moins que l’émotion renaissante en moi des poètes, ou de certains hommes d’action. À Syracuse je relus Théocrite, et je songeai que ses bergers au beau nom étaient ceux mêmes que j’avais aimés à Biskra. Mon érudition qui s’éveillait à chaque pas m’encombrait, empêchait ma joie […] J’en vins à fuir les ruines ; à préférer aux plus beaux monuments du passé ces jardins bas qu’on appelle les Latomies […]. J’en vins à mépriser en moi cette science qui d’abord faisait mon orgueil ; ces études qui d’abord étaient toute ma vie.
35Cette vision de l’histoire est le milieu par excellence de la préférence pour une personne, ou pour un mode de vie où cette personne montre sa force. Toute chose y devient un hiéroglyphe pour mieux comprendre et s’identifier avec ce mode de vie passée et l’assimiler au service de sa propre vie. Michel, depuis la découverte du sens de la vie comme volonté de guérir et comme force d’un « nouvel être », se défait de la méthode objective philologique pour découvrir le sens de l’histoire par une méthode entièrement empathique, à valeur de modèle et de miroir de sa situation présente. Il s’attache à la civilisation sans histoire des Goths, et il est surtout fasciné par la figure « du jeune roi Athalaric, qui se révolte contre sa mère et son éducation latine, qui rejette la culture, « préférant la société des Goths impolicés à celle du trop sage et vieux Cassidore33 », parce que lui-même préfère la compagnie des enfants arabes et kabyles à celles des philosophes, et des savants de Paris. Par cette identification et ce goût pour Athalaric Michel va découvrir le vrai mouvement et le vrai sens de l’art dans son histoire, qui est l’alternance de l’ascension des forces vitales et d’une période de décadence de la vie. Ni monumentale, ni traditionaliste, ni critique, l’histoire qui sert à la vie dépasse tous les « besoins » orientés vers l’objet historique, pour mieux affirmer la force de la vie présente du sujet. L’histoire apprend à bien poser le problème de la hiérarchie des valeurs dont on a déjà parlé : elle nous sensibilise à discerner la dégénérescence sous la santé et la santé qui naît de la décadence. Et c’est ici la leçon d’immoralisme que Michel offre à ses amis.
Le côté Nietzsche de Dostoïevki ou la rencontre romanesque
36Avec Les Faux Monnayeurs et encore plus avec Les Caves du Vatican, le modèle Nietzschéen s’étiole. Cet abandon d’un choix préférentiel nietzschéen est visible surtout dans la manière dont Gide construit le rapport entre le personnage écrivain et son entourage dans le roman.
37Dans Les Faux Monnayeurs, Édouard écrit son Journal qui se veut le porteur d’une nouvelle esthétique éthique imbue de nietzschéisme dans la préférence de la vie contre le livre mort. Le journal est l’écriture de soi, mais il ne montre que la porosité et la fragilité du sujet (celui d’Édouard) défini par sa fascination pour les autres. L’écriture n’est ici ni contemporaine (lyrique) ni postérieure (épique) à la vie, mais toujours en arrière de ses événements essentiels.
38On trouve aussi un décalage irréparable, une non-coïncidence essentielle entre celui qui lit et qui s’intéresse au Journal d’Édouard – Bernard, par exemple – et l’aimé autour duquel toute l’histoire du journal tourne – Olivier – qui ne lira jamais ce qu’Édouard est en train d’écrire. Le nouveau rapport de préférence qui se crée dans ces romans n’est plus nietzschéen. Dans les grands romans que Gide publie après L’Immoraliste, la règle sera toujours que l’écrivain préfère quelqu’un qui ne pourra pas le lire, et inversement, le lecteur préfère un écrivain qui ne l’a jamais choisi. Ceci a lieu parce qu’une nouvelle forme de rencontre est accommodée par l’univers romanesque gidien : il s’agit du modèle dostoïevskien avec ses nouveaux problèmes et ses nouvelles lignes de force. Aux yeux de Gide, la force de l’univers romanesque et de la vie de Dostoïevski vient de leur pouvoir d’humilité. L’amour des autres force l’être humain non pas à se dépasser vers une forme individuelle supérieure, mais à comprendre les lois de la société, de la tradition et de la nature humaine à la lumière de la bonté divine.
39L’exploitation du côté Nietzsche de Dostoïevski se trouve non pas au niveau du schéma narratif, mais au niveau de ses personnages majeurs, tels Raskolnikof qui incarnent un problème, comme le crime gratuit, ou le nihilisme politique et la transgression criminelle de la loi et de la vertu par Stavroguine et Verkhovenski. Mais ce côté Nietzsche se dissout toujours dans l’appel christique à l’humilité. La leçon et l’enseignement sont entièrement incarnés par la crise qu’un personnage central subit dans une situation de complication romanesque concrète : Raskolnikof découvre que le crime gratuit attire sa punition non pas sous la forme d’une morale officielle (des mœurs, aurait dit Nietzsche), mais sous la forme d’une morale intime, une nouvelle morale qui est celle de la découverte du christ rédempteur de toute forme de culpabilité. Le rêve de la vertu nietzschéenne par laquelle le héros croit pouvoir assouvir son désir de liberté, précipite celui-ci dans l’abyme de la conscience malheureuse où il entrevoit sa vérité dernière : celle d’être un être sans amour, un être abandonné par Dieu. Cette solitude sans issue est résolue de deux manières différentes par le personnage dostoïevskien : le suicide (Stavroghine, Kirilov) ou bien la soumission à l’impératif moral par empathie avec l’être aimé qui, lui, est fondamentalement croyant. Dans ses romans, Dostoïevski nous démontre le néant et la vanité de l’attitude nietzschéenne envers le sens de la vie et de la morale. Ce néant se révèle dans la faiblesse que l’individu éprouve suite à un crime commis ou seulement approuvé. L’acte criminel s’accompagne souvent des thèmes liés à la fausseté : la clandestinité, la conspiration, la contrebande, la contrefaçon, le bâtard. C’est celui qui est bâtard qui deviendra nietzschéen et c’est dans une conspiration,telle celle des démons, que les personnages les plus « nietzschéens » apparaissent. Chez Nietzsche la fausseté recouvre déjà un double sens : d’une part, elle représente la force de dissimulation comme pouvoir particulier d’affirmation de la vie ; d’autre part, elle désigne les faux-monnayeurs de l’esprit, enkystés dans un système de pensée déterministe ou bien adeptes d’une morale rigide qui nuit à la vie ; ceux-ci falsifient à leur insu les valeurs de la vie.
40Déjà dans L’Immoraliste on pouvait remarquer une certaine ambiguïté quant au sens du mensonge et de la dissimulation. On y trouvait d’une part le pouvoir destructeur du mensonge, du vol et de l’escroquerie de la Morinière, par lequel les ressources et les revenus du domaine s’épuisaient jusqu’à leur mise en faillite. D’autre part, il y avait la dissimulation de l’enfant vu comme un pouvoir inattendu de tester l’amour et de découvrir le désir de l’autre. Dans une très belle scène à Biskra qui nous semble une réécriture originale de l’enfant au miroir de Ainsi parlait Zarathoustra, l’enfant Moktir s’empare d’une paire de ciseaux au moment même où Michel épie son vol dans un miroir. Dans cette perspective, Michel entrevoit l’esprit malin de l’enfant, sans pourtant se rendre compte que l’enfant savait déjà qu’il était regardé dans le miroir. Ainsi, ce qui pouvait apparaître comme simple ruse enfantine, était en vérité une dissimulation plus subtile, l’intention d’observer la réaction de Michel. Celui-ci va-t-il se taire ou bien va-t-il le réprimander pour son acte ? Le voleur est celui qui a le pouvoir de tester l’amour de Michel, et ensuite de mesurer si cet amour va au-delà du jugement moral34.
41Rien de tel et aucune force positive de la dissimulation dans les romans dostoïevskiens de Gide. Dans Les Faux Monnayeurs, comme on le sait, on trouve une scène semblable, dans laquelle Georges, le petit frère d’Olivier et le neveu d’Édouard, veut voler un livre pendant qu’il se sait épié par Édouard. Le livre désiré est un livre de voyage sans auteur et sans grande valeur, l’intérêt tirant sa force à la fois du défi moral (le vol) et du fantasme de libération (le voyage). Plus tard, dans son Journal, Édouard va raconter cette scène, en changeant bien sûr les noms des protagonistes. Comme dans le théâtre dans le théâtre d’Hamlet, il offre son Journal à la lecture du jeune Georges pour observer sa réaction et pour forcer son aveu. Mais celui-ci ne laisse rien transparaître de ses réactions et regarde l’histoire avec indifférence. La vie seule, pense l’enfant a du sens ; une fois l’acte consommé, il n’y a rien à apprendre. Il refuse ainsi de tirer la leçon que l’écrivain (Édouard) lui propose, notamment que le vol étant blâmable, il expose son auteur à des soupçons peut-être injustes à l’avenir. L’enfant qui vit dans le présent de l’intensité et du risque ne se soumet pas à la jurisprudence qu’Édouard lui propose. Ce n’est pas la première fois que la vie ne se résigne pas à la leçon de l’écriture, et ce n’est pas la première fois non plus qu’un livre volé qui n’enferme qu’un fantasme (à la différence de L’Immoraliste où la voyage a une valeur de vérité, pour Georges il n’est que de l’ordre d’un fantasme enfantin) est préféré au seul livre qui dise la « vérité ».
42Un décalage encore plus grand entre l’écrivain, le sujet de son livre et son lecteur s’établit dans Les Caves de Vatican. Ici, la lutte d’accommodation a lieu entre Julius de Baraglioul, et son demi-frère bâtard Lafcadio, personnage entièrement nietzschéen qui commet un crime gratuit à l’instar de Raskolnikof. Julius se trouve au tournant de sa vie, quand il perd la reconnaissance de son public, et celle de son père qui lui a servi de « sujet » pour son dernier livre ; son père taxe ce livre d’immaturité. Au moment même de l’échec dans sa carrière d’écrivain, il découvre que Lafcadio est son demi-frère. La scène dont je parle a lieu le lendemain du crime, quand Lafcadio et Julius se retrouvent par hasard dans un hôtel à Rome ; Julius après avoir lu la petite annonce du crime projette un livre sur le crime sans motivation, comme preuve d’une grande liberté, sur le modèle nietzschéen. Il est en train d’imaginer dans son livre ce que Lafcadio avait fait dans sa vie. Mais ce projet de livre s’avère être un simple univers imaginaire entièrement séparé des vrais jugements que Julius porte sur la réalité : quand il découvre que la victime n’était autre que son beau-frèrequi lui avait confié auparavant le secret du faux pape et de la rocambolesque opération de laquelle il a été dupe et victime, Julius ne peut plus croire à un crime sans motivation. Il construit immédiatement la raison d’une conspiration de la Loge contre ceux qui cherchaient à rétablir le vrai pape dans ses fonctions au Vatican. L’hypothèse romanesque du crime sans motivation était donc l’effet de la connaissance imparfaite de la réalité (il ne savait qui était la victime quand il avait conçu le projet romanesque).
43D’autre part, celui qui a commis le crime ne peut pas l’avouer sans perdre son statut de lecteur préféré de ce livre. Car c’est pour Lafcadio, ce lecteur rétif qui déclare ne pas avoir envie de lire, que Julius amoureux de lui conçoit son dernier projet de livre. Au moment où Lafcadio avoue son crime, et devient de la sorte l’incarnation même de la morale rêvée par le livre de Julius, celui-ci perd tout amour pour lui : « dommage, j’ai commencé à t’aimer » dit-il. Par un renversement dostoïevskien de la situation, cette réplique déclanche en l’âme du jeune Lafcadio une prise de conscience aiguë de sa propre solitude morale. La fin du livre est presque une copie de la fin de Crime et châtiment : Lafcadio décide d’avouer son crime pour pouvoir soutenir et mériter l’amour de Geneviève, la fille si profondément catholique de Julius. Ainsi, dans Les Caves du Vatican le nietzschéisme du personnage principal Lafcadio ne donne vie à aucun livre, mais devient un des fils d’une intrigue compliquée, une des perspectives, la plus radicale bien sûr, mais pas la seule. Quant à l’amour chez Dostoïevski, à la différence de la prédilection nietzschéenne, on ne cherche pas, ni on ne doit inventer l’aimé. On le trouve tout simplement, car il est déjà là, et il (elle) attend. Comme Geneviève a toujours attendu en silence que l’amour de Lafcadio se réveille.
44C’est précisément ce nouveau rapport d’un amour affranchi du test d’une prédilection, et du poids d’un choix, un amour comme pure donne, que Gide découvre dans la force romanesque de Dostoïevski. Dostoïevski est l’auteur qui ne se donne pas directement à son lecteur avec lequel il pourrait établir un rapport de prédilection tel Zarathoustra avec ses amis. Dostoïevski se donne à ses personnages, et ce n’est que dans ses personnages qu’il se trouve :
Le véritable artiste reste toujours à demi inconscient de lui-même, lorsqu’il produit. Il ne sait pas au juste qui il est. Il n’arrive à se connaître qu’à travers son œuvre, que par son œuvre, qu’après son œuvre …. Dostoïevski ne s’est jamais cherché ; il s’est éperdument donné dans son œuvre. Il s’est perdu dans chacun des personnages de ses livres ; et c’est pourquoi dans chacun d’eux on le retrouve. Nous verrons tout à l’heure son excessive maladresse, dès qu’il parle en son propre nom ; son éloquence, tout au contraire, lorsque ses propres idées sont exprimées par ceux qu’il anime. C’est en leur prêtant vie qu’il trouve. Il vit en chacun d’eux, et cet abandon de soi dans leur diversité a pour premier effet de protéger ses propres inconséquences35.
45Dans l’univers de Dostoïevski ce qui devient futile est un rapport privilégié d’enseignement et de recherche de soi-même. Le rapport écrivain lecteur est toujours indirect, conditionné par le pouvoir d’abandon et d’identification avec la diversité idéale concrète de tous les personnages. Ce qui lie les personnages entre eux ce n’est pas d’abord un rapport de prédilection, mais un problème qui est au cœur et le moteur de l’intrigue. Car à la différence du thème du voyage de L’Immoraliste, ce qui caractérise les romans « dostoïevskiens » de Gide c’est précisément la richesse de l’intrigue. La seule façon de préférer les romans dostoïevskiens de Gide c’est de les lire d’un tenant, sans pouvoir s’arrêter, absorbés par l’intrigue d’où naissent et où se heurtent les problèmes concrets incarnés par des personnages compliqués.
46Le problème de Dostoïevski n’est plus le problème de la hiérarchie qui crée une histoire et un jeu de perspectives, mais le problème de la donne et de l’abandon à la diversité intensive des idées et des problèmes incarnés par les personnages : « Le prodige réalisé par Dostoïevski, c’est que chacun de ses personnages et il en a crée tout un peuple, existe d’abord en fonction de lui-même, et que chacun de ses êtres intimes, avec son secret particulier, se présente à nous dans toute sa complexité problématique ; le prodige, c’est que ce sont précisément ces problèmes que vivent chacun de ses personnages, et je devrais dire : qui vivent aux dépens de chacun de ses personnages – ces problèmes qui se heurtent, se combattent et s’humanisent pour agoniser ou triompher devant nous36 ».
47Ainsi, le côté Nietzsche de Dostoïevski n’est qu’un problème parmi d’autres, il pose la question : quel est le sens de la recherche de soi sous la forme de la liberté absolue, manifestée comme action insensée, autodétermination transgressive, crime gratuit. Le problème est posé par les personnages entièrement pris dans des situations concrètes qui forment l’intrigue. Car l’action et la situation d’où elle naît sont construites de sorte qu’elles intriguent le lecteur. Le rapport d’élection est presque toujours manqué dans ces romans, étant remplacé, comme l’a si bien remarqué Deleuze dans « Qu’est-ce que l’acte de la création ? », par un état d’urgence, qui est le choix d’une action (plutôt réaction) dans une certaine situation pressante.
48Je voudrais prendre un exemple : dans Les Caves du Vatican, la confrontation entre Lafcadio (après avoir commis le crime), et le savant d’apparence ridicule Monsieur Defouqueblize pourrait être un exemple illustre de la façon dont le roman de type dostoïevskien transforme une relation de prédilection, l’amitié, en réaction à une situation de crise qui la réclame d’urgence. Car…. surprise ? Le ridicule savant qui ne boit que de l’eau quand Lafcadio préfère le champagne n’est autre que l’ancien ami nietzschéen Protos, déguisé, qui a suivi en cachette son ami d’enfance pour corriger ses éventuelles erreurs d’homme supérieur qui ne fait pas attention aux détails quand il commet un crime gratuit. Au début du roman, on retrouve le nom de Protos dans le carnet (une sorte de journal improvisé) de Lafcadio, lu en cachette par son demi-frère écrivain Julius. On le retrouve aussi dans l’histoire rétrospective de la vie que Lafcadio fait au même demi- frère dans un geste de sincérité gratuit. Dans cette histoire on apprend que le rapport entre Protos et Lafcadio est que « je me tournais vers lui comme s’il avait dû m’apporter la délivrance37 ». Mais ce rapport nietzschéen entre les « amis » qui s’entre-inventent ne résiste pas jusqu’à la fin, car il précède sans en faire partie le roman entendu comme intrigue. L’amitié est le passé du roman, ce dont l’un des personnages se souvient. Le portrait de Protos composé par Lafcadio pour attiser la curiosité de son demi-frère est entièrement nietzschéen : une force vitale qui repousse instinctivement toute contrainte de l’éducation, tout en faisant preuve d’une excellence force intellectuelle si sa volonté y consent. Dans la scène que j’invoquais tout à l’heure et qui est une réécriture originale de la confrontation entre Raskolnikof et le détective Porphyre (le nom de Protos y est un clin d’œil d’ailleurs), Protos est déguisé en savant maladroit pour mieux observer les réactions de Lafcadio, son contentement de soi, et pour bien lui aménager la surprise du dévoilement auquel il doit réagir. Ce que Protos mime est une conversion nietzschéenne du savant contraint et limité en un être intéressant, libéré par le champagne, maître de lui-même, qui rejette la vérité de la science pour la vérité de la vie. Cette pantomime agile réussit à leurrer le jeune nietzschéen Lafcadio qui se croit encore le seul possesseur de la vérité du crime commis dans le train. Mais Protos ne se déguise qu’afin de mieux se montrer par la suite, en tant que « subtil », c’est-à-dire « homme qui, pour quelque raison que ce fût, ne présentait pas à tous et en tous lieux même visage38 ». Lafcadio découvre qu’il a été surveillé pendant toute la durée de son acte criminel. Protos quant à lui, de même qu’il réussissait une composition parfaite en latin pendant son enfance, réussit à présent un crime parfait en corrigeant les erreurs que Lafcadio a laissé lui échapper pendant sa fébrile exécution. Mais, si on se souvient bien, Lafcadio n’aimait pas lire précisément parce que, selon lui, dans les livres on était toujours capable de « corriger » et de « retoucher » les erreurs de la vie, tandis que la vie avait cela de particulier qu’elle ne laissait pas cette possibilité. L’opposition entre vie et écriture (livre écrit), est nietzschéenne, mais elle ne tient pas debout dans le cas de la réorganisation du monde par le roman dostoïevskien, en tant que « heurt de problèmes ». Le livre est celui qui recrée cette fois la vie comme symphonie de problèmes. C’est dans le roman que l’individu avec toute la force de son intimité, tous ses secrets et les aléas de sa volonté, est appelé à réagir à un certain événement, à découvrir dans l’ami son ennemi rusé, dans sa liberté une savante mise en scène par autrui, dans son crime le chemin vers le salut, la découverte de Dieu et de l’amour.
49Préférer un écrivain comme Dostoïevski revient ainsi à reprendre dans ses romans, ou dans sa vie des situations dans lesquels les personnages participent à des problèmes. C’est au niveau de l’intrigue et de certaines situations qui posent un certain problème que l’on retrouve Dostoïevski chez Gide. Ainsi par exemple dans la scène de la lutte de Bernard avec l’ange, pure irruption du fantastique et de l’hallucination dans un univers réel où l’on retrouve la scène de la rencontre hallucinée entre Ivan et le diable qui n’est qu’un ange déchu dans LesFrères Karamazov.
50La scène de la lutte avec l’ange (comme celle de Jacob) incarne le problème de la recherche de soi sous un mode qui n’est plus celui de l’élection et de la hiérarchie des perspectives, mais celui de la réaction à une situation problématique donnée. Bernard résume la rencontre avec l’ange, une rencontre qui n’est plus celle de la prédilection, mais celle de la lutte ; il déclare à Édouard : « J’ai débattu cela toute la nuit. A quoi faire servir cette force que je sens en moi ? Comment tirer le meilleur parti de moi-même ? Est-ce en me dirigeant vers un but ? Mais ce but comment le choisir ? Comment le connaître, aussi longtemps qu’il n’est pas atteint39 ? » Car dans l’univers dostoïevskien le problème du choix de soi-même est résolu par la réponse que le personnage arrive à donner à une rencontre qui impose son problème, et non pas à une affinité élective.
51Ainsi, en revenant aux chambres vides que Nietzsche proposait, selon lesquelles on pouvait reconnaître le grand homme qui sait réserver un espace pour des accommodations significatives et difficiles, on finit par les chambres de Dostoïevski qu’un diable-ange hante pour échapper à toute attente, à tout calcul, à toute prévision de l’interlocuteur. C’est ainsi que parlait le diable dans la chambre nocturne de Ivan Féodorovitch, avec beaucoup d’ironie, sinon de malice :