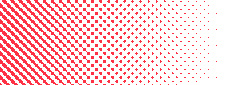L’ethnologue préféré : Le Lévi-Strauss de Tristes tropiques
« De la musique encore et toujours ! »
Verlaine, Art poétique
1L’écrivain préféré ? À cet intitulé, on s’attend à voir associer le nom d’un romancier ou d’un poète. Mais est-ce que celui d’un ethnologue pourrait figurer sur la liste ? Si cet ethnologue s’appelle Lévi-Strauss, et que dans ses écrits il nous fait entendre de la musique, j’ai envie de répondre : oui – ce qui implique nécessairement un questionnement des frontières de la littérature et de l’ethnologie. On peut aussi se demander pourquoi lui plutôt qu’un autre. Qu’est-ce qui fait qu’il apparaît soudain comme un ami ? D’un destin à l’autre, le lecteur s’identifie naturellement à l’auteur. Le mot « vocation » vient aussitôt à l’esprit. Mais si, loin de toute nécessité, tout n’était que hasard…
Un chant familier
2L’ethnographie, support empirique de l’ethnologie, est au carrefour de l’art et de la science. Tout en rendant compte de vérités objectives, elle exige un véritable travail d’écriture par lequel un auteur peut éventuellement exprimer sa singularité. Néanmoins ce souci du bien-écrire ne garantit en rien son rattachement à la littérature. Comme l’écrivit Vincent Debaene : « Les logiques de qualification d’un texte comme scientifique ou comme littéraire sont tout simplement hétérogènes puisque, dans un cas, on évalue une pertinence et, dans l’autre, on désigne une appartenance1. » De ce point de vue, science et littérature ne sont pas à mettre sur le même plan. Néanmoins l’intrusion du « je » dans les textes de sciences sociales2, souvent présentée comme une « révolution épistémologique3 », est venue semer le trouble dans la division des genres. L’inflation du je « méthodologique » a rendu caduc le positivisme des pères fondateurs, pour qui le langage devait se cantonner à sa fonction instrumentale : transmettre des informations. Aujourd’hui le « divorce de nature entre l’objectivité du savant et la subjectivité de l’écrivain » n’est plus d’actualité : il est possible de « faire d’un sarcasme la condition de la vérité4 ». Plus personne n’est dupe de « la ruse de l’ethnographie, ce faire semblant qu’il n’y a pas d’ego5 ». Faire passer des interprétations pour des descriptions, des jugements pour des théories, une neutralité de ton pour une garantie d’objectivité : ces astuces ne marchent plus. Malgré tous les apparats d’objectivité, une étude ethnographique sera toujours « le tableau de quelque chose vu par quelqu’un6 ».
3La présence de ce « quelqu’un », aussi doué soit-il pour peindre la réalité, suffit-elle à faire basculer un texte du côté de la littérature ? Assurément non. La singularité seule ne suffit pas. Elle doit s’étoffer d’une dimension esthétique. L’usage de la langue doit être suffisamment stylé pour que l’on puisse parler de « littérarité ». Autrement dit, de ce quelqu’un doit jaillir une voix, reconnaissable entre toutes. Plus précisément un chant. C’est ce fameux « grain de la voix7 » dont parle Barthes, lorsque celle-ci est au croisement de la langue et de la musique. Ce chant, dans le cas de Lévi-Strauss, semble être à la fois un « phéno-chant » et un « géno-chant », pour reprendre l’opposition théorique de Barthes qui transpose celle de Kristeva entre phéno-texte et géno-texte. Le phéno-chant couvre « tout ce qui, dans l’exécution, est au service de la communication, de la représentation, de l’expression : ce dont on parle ordinairement, ce qui forme le tissu des valeurs culturelles » : c’est ici l’examen lucide d’un parcours intellectuel atypique, une confession critique. À l’inverse, le géno-chant renvoie à « cette pointe (ou ce fond) de la production où la mélodie travaille vraiment la langue », autrement dit à la « diction » de Genette avant Genette8 : c’est le lyrisme auquel il succombe par endroits, lorsqu’il s’abandonne à la musique des mots indépendamment du discours initial. On retrouverait donc ces deux types de chants dans Tristes tropiques, et il serait intéressant d’en étudier les proportions. Mais, pour le moment, ne nous embarrassons ni du « phéno » ni du « géno », boulets terminologiques qui risquent de faire couler le propos présent. Retenons juste l’idée de chant tout court.
4Le glissement métaphorique de la peinture à la musique se justifie tout d’abord par les aspects formels de Tristes tropiques, qui le rapprocheraient de la symphonie : « Le livre, écrit Pierre Campion, adopte visiblement une composition musicale : les deux premières parties, dans un désordre savant, constituent le prélude de cette nouvelle Symphonie du Nouveau Monde. Composant les thèmes du départ, des débuts dans la vie, de l’exclusion et des effets du pouvoir, ce prélude conduit au morceau du coucher de soleil-opéra9. » Ce glissement s’appuie ensuite sur la distinction faite par Frédéric Keck entre deux modes opératoires de la fiction au sein de l’œuvre de Lévi-Strauss : une « fiction picturale » qui tend vers le « tableau taxinomique », et une « fiction musicale » où le cognitif se mêle au sensitif10. Une telle distinction est tout à fait pertinente, mais l’auteur fait rentrer, semble-t-il, plusieurs ouvrages dans sa catégorie « fiction musicale ». Pour ma part, je n’y ferais figurer que son récit autobiographique. Car, en définitive, Lévi-Strauss n’aura vraiment fait entendre son « grain » – écrit avec son corps – que du 12 octobre 1954 au 5 mars 1955, la période d’écriture de Tristes tropiques.
5C’est le seul ouvrage qui me vienne à l’esprit quand j’entends ou vois le nom de Lévi-Strauss. Comme Gracq l’a très bien remarqué, « il arrive couramment qu’on transfère à un nom, sans y réfléchir, l’attachement qu’on a en réalité pour un seul ouvrage11 ». Pour d’autres ethnologues, ce sera plutôt Les Structures élémentaires de la parenté ou Anthropologie structurale. Mais peut-on, pour ces deux derniers livres, parler d’« écrivain » ? Il n’y a vraisemblablement que dans Tristes tropiques que Lévi-Strauss sort de la peau de l’« écrivant12 », que l’on sent la présence de quelqu’un, dont la voix résonne comme la musique d’un être familier. À mes yeux, ce récit autobiographique prend toute la lumière. Et tout le reste n’est que littérature grise. Il peut arriver que mon œil, balayant furtivement une rangée de la bibliothèque, s’arrête un instant sur La Potière jalouse, titre qui laisse rêveur. Mais si un feu malencontreux venait à se déclarer, cet opus ne serait pas sur la liste des premiers à sauver. Ni les autres, puisque c’est toute la production théorique en tant qu’œuvre qui fait peur. Trop magistrale. Alignés au garde-à-vous comme des soldats sur la rangée principale de la bibliothèque, les volumes semblent vouloir faire plier la réalité à leur « structure ». C’est pourquoi Tristes tropiques n’est pas rangé à côté d’eux. Il est classé plus haut, dans la lignée des grands romans.
Appartenir à la littérature
6Dans quelle mesure Tristes tropiques relève-t-il de la « littérature » ? La question a été posée dès sa sortie en 1955 par le jury du prix Goncourt qui voulait l’honorer de ses lauriers. On peut mieux comprendre la réponse donnée au travers de la distinction faite par Gérard Genette entre deux régimes littéraires complémentaires : le régime « constitutif » et le régime « conditionnel »13. Le jury n’assuma pas sa préférence sous prétexte que l’œuvre n’était pas une « fiction ». S’il avait opté pour le point de vue de la « diction » et le critère « rhématique »14 – s’il avait écouté la musique –, sa décision aurait été tout autre. Dans sa délimitation du littéraire, il se cantonnait au régime constitutif, conception fermée s’appuyant sur des conventions bien établies. Respectant à la lettre les dernières volontés d’Edmond de Goncourt, dont le prestige devait retomber uniquement sur « un ouvrage d’imagination en prose », il se rabattit sur un vrai roman : Les Racines du Ciel de Romain Gary15. Le libre-arbitre du jury étant circonscrit par des clauses juridiques, c’est du côté des critiques littéraires, des journalistes, des écrivains et des universitaires, que le débat aura lieu. Se situant dans le régime conditionnel, où l’appartenance d’une œuvre à la littérature est plus aléatoire, c’est la puissance de leurs arguments et l’état du marché littéraire qui décideront du destin du livre16.
7À sa sortie, la dimension hybride de Tristes tropiques fera couler beaucoup d’encre, de Raymond Aron à Claude Roy en passant par Madeleine Chapsal. Seul Barthes restera froid à cet engouement esthétique, davantage sensible à la production théorique de l’auteur. Dans la presse grand-public, nombreux furent les articles qui s’évertuèrent à faire rentrer Tristes tropiques dans la littérature. Analysant « l’idée de littérature dans les années 1950 », Vincent Debaene et Jean-Louis Jeannelle17 ont fait ressortir les deux principaux arguments qui étaient à l’époque avancés par les admirateurs du livre. Le premier portait sur le « style », et faisait de Lévi-Strauss un descendant de Chateaubriand. Le second relevait de ce que les auteurs appellent « le dialogue des phares » : dans Tristes tropiques Lévi-Strauss converse d’égal à égal avec les plus grands noms de la littérature (Montesquieu, Montaigne, Rousseau). Autre référence lumineuse que l’on retrouve chez la plupart des commentateurs : Proust. En effet, si Tristes tropiques est bien un récit de voyage, c’est moins l’ethnologue en personne que sa mémoire que l’on voit crapahuter.
8Ainsi, les filiations ne manquent-elles pas pour rattacher Lévi-Strauss à la littérature. Derrière cette démarche, il y a nécessairement une certaine idée de la littérature. Pour ne pas dire une idéologie, voire une mythologie. Celle-ci est encore plus accentuée dans les écrits des critiques d’avant-garde comme Bataille ou Blanchot. Pour Bataille, Tristes tropiques est l’exemple parfait montrant que le salut des sciences humaines est dans la littérature. Il ne retient que « l’ouverture poétique », et passe complètement à côté de son structuralisme latent. Blanchot, lui, l’ancre profondément dans la métaphysique : l’ethnologue, comme l’écrivain, est « l’homme au point zéro ». Alors que, comme le notent Vincent Debaene et Jean-Louis Jeannelle, Lévi-Strauss à la fin de son aventure littéraire dénie à l’art et à la métaphysique (ainsi qu’à la psychologie) leur pouvoir de consolation.
9Cette neuvième et dernière partie intitulée « Le retour » pourrait être rebaptisée : « Triste ethnologue » ou « Le non-retour ». L’homme, le savant et sa discipline semblent être arrivés au bout de la nuit d’un voyage à la fois intime et historique, éreintés d’avoir fait le tour de la condition humaine – en un mot : entropologisés18. Et l’on pourrait presque faire dire à l’ethnologue ces vers du poète :
Je ris de l’Art, je ris de l’Homme aussi, des chants,
Des vers, des temples grecs et des tours en spirales
Qu’étirent dans le ciel vide les cathédrales,
Et je vois du même œil les bons et les méchants19.
10Ce cynisme ferait ainsi écho à son fameux « Je hais les voyages et les explorateurs », phrase d’accroche qui ouvre le bal du récit de manière insolite. Et si l’on va plus avant dans ce rapprochement, ne pourrions-nous pas comparer la mélancolie qui transpire dans les dernières pages de Tristes tropiques avec la « langueur verlainienne » en tant qu’elle incarne « le lieu d’un changement, d’une sorte de conversion intérieure, le passage du moi personnel à un moi impersonnel où ne subsiste plus rien de la sensibilité ancienne20 » ? Que décrivent, en effet, les dernières phrases du livre si ce n’est le louvoiement du moi de l’ethnologue qui, non content de se haïr, cherche à faire son trou « entre un nous et un rien21 » ? Au final, il fait le choix du nous, mais sans grande conviction.
11Lévi-Strauss affirme dans un premier temps qu’il « assume sans réserve [sa] condition d’homme22 ». Cela passera pour lui par une objectivation rigoureuse de l’expérience sensible, travail colossal que l’on retrouvera dans La Pensée sauvage ou Mythologiques. Mais au moment même où il dit adieu à la littérature23, le voilà qui se laisse emporter par une insoutenable légèreté lyrique. Il se lance dans une phrase interminable qui semble vouloir essouffler le lecteur, comme pour lui faire ressentir le caractère éprouvant du voyage philosophique accompli. Phrase-fleuve rythmée de tirets et de points-virgules qui s’achève sur une note tragi-comique. À « la contemplation d’un minéral plus beau que toutes nos œuvres » et au « parfum, plus savant que nos livres, respiré au creux d’un lis », succède curieusement « le clin d’œil alourdi de patience, de sérénité et de pardon réciproque, qu’une entente involontaire permet parfois d’échanger avec un chat24 ». Faut-il rire ou pleurer ? Applaudir ou désespérer ? Serait-il exagéré de parler de « langueur lévistraussienne » ? De lui faire dire malgré lui – pastiche de la troisième « ariette oubliée25 » : « Il pleure dans mon cœur / Comme il pleut sur la jungle » ?
12L’hypothèse pourrait se défendre. Mais les postures philosophiques du poète et de l’ethnologue sont bien éloignées : le premier veut se fondre dans la poésie des éléments, quand le second n’aspire qu’à saisir l’« essence » des choses (et des mots). Pour ce dernier, l’intelligible prime sur l’émotion. Si l’ethnologue n’est pas à l’abri du sublime, l’événement esthétique n’aura été qu’un accident. Il convient donc de ne pas trop extrapoler sur un éventuel « air de famille » entre Verlaine et Lévi-Strauss. Toutefois cette parenthèse aura permis de souligner l’idée suivante : entre le regret du je ancien et le pari du nous nouveau, le moi de Lévi-Strauss aura été bien ballotté. Il est vrai que l’ethnologue a tranché, et plus jamais après Tristes tropiques, l’anthropologue ne s’égarera dans la « littérature » ni ne jouera à l’« écrivain ». Mais l’on se plaît à imaginer que quelque part au fond d’un de ses tiroirs, se cache un vieux manuscrit qui, épuré de tout « système » ou « structure », est pure littérature. Ce serait par exemple l’épisode raté du « coucher de soleil », qu’il aurait travaillé et retravaillé pour en faire quelque chose de « vaguement conradien26 » et serait l’« apothéose » de son talent littéraire. Ou bien une nouvelle « nouvelle version de Cinna27 ». Ou enfin, fin du fin, la partition d’un opéra aux accents wagnériens. Ce serait une belle ironie.
13Ce détour par Verlaine est révélateur de l’inclination de cet article : le désir d’a/encrer Tristes tropiques toujours plus profondément dans la littérature (et consacrer un ethnologue comme « écrivain préféré »). Et pour ce faire, ce détour me conduit à examiner la langue, la littérarité du texte. Je néglige ainsi un point essentiel souligné par Antoine Compagnon : « La littérarité, comme toute définition de la littérature, engage en fait une préférence extra-littéraire28. » Ma vision du livre en tant qu’œuvre littéraire est forcément influencée par l’évolution du marché littéraire français, en particulier par la notoriété de la collection « Terre Humaine » des éditions Plon. Chaque ouvrage publié dans cette collection est naturellement considéré par le public comme « littéraire », quelle que soit sa valeur esthétique. Cette dimension littéraire fait le bonheur du lecteur amateur. Mais elle est loin de faire l’unanimité chez les spécialistes, qui ne manquent pas d’égratigner tous les scientifiques dérivant vers des horizons artistiques29. Charles Dantzig a d’ailleurs noté non sans humour – citations à l’appui –, à quel point l’adjectif « littéraire » ou le substantif « littérature » sont malmenés par les universitaires et les artistes : « Je me demande s’il existe d’autre activité humaine aussi injuriée que la littérature30 ? » Est-ce une injure de dire que Lévi-Strauss c’est « Mallarmé en Amérique du Sud31 » ? Si tel est le cas, quel graphomane n’aimerait pas être injurié de la sorte ?
14Toujours est-il que ce n’est pas sans mauvaise conscience que Lévi-Strauss écrivit son récit autobiographique. Commande de Jean Malaurie qui voulait lancer l’aventure de sa collection, Tristes tropiques fut rédigé en six mois, comme un péché qu’il fallait commettre le plus vite possible, pour revenir au plus tôt à la raison scientifique. Quel autre chef d’œuvre aurait-il pu écrire s’il avait prolongé son aventure littéraire ? Qu’il n’y ait eu qu’un seul écart dans le parcours rectiligne de Lévi-Strauss donne à son récit autobiographique cette aura des œuvres miraculées. Le doit-on au « hasard », à la « chance » ou à la « destinée », pour reprendre les termes de Thibaudet32 ? Que représente Tristes tropiques dans la « ligne de vie » de Lévi-Strauss ? Un moment de faiblesse ? Ou, au contraire, l’œuvre qui paradoxalement fait le lien entre toutes ses séquences biographiques ?
L’espace de la chance
15D’une ligne de vie à l’autre, le livre croise mon chemin d’étudiant incertain. Comment devient-on ethnologue ? Par hasard et/ou par nécessité. Le hasard d’une rencontre, d’une université, d’une procédure administrative ; la nécessité d’un environnement, d’une époque, d’un tempérament. À la jonction des deux logiques, un coup de cœur pour un livre. Or il arrive souvent qu’on lise un livre pour de mauvaises raisons. Et, forcément, on le lit mal. Lu bien avant de commencer un cursus d’ethnologie – pour le plaisir –, Tristes tropiques m’apparaissait avant tout comme un récit de voyage et d’aventure (et non pas comme un « livre sur le voyage » comme le précise la quatrième de couverture). Relu pour la réalisation d’un exercice de recherche – pour le plaisir et l’instruction33 –, ce fut l’occasion de mettre des mots sur un texte adoré, plus précisément de montrer en quoi l’ethnologue peut parfois être aussi un écrivain, un artiste. Re-relu au cours des années de « terrain » – pour l’autorité –, je pensais que c’était le modèle d’enquête ethnographique par excellence.
16À cette période charnière de l’apprentissage intellectuel, le Lévi-Strauss de Tristes tropiques représentait pour moi ce qu’il y a de plus beau dans l’ethnologie. Leiris aurait pu lui voler la vedette avec L’Âge d’homme, mais cette « auto-ethnographie34 » était trop éloignée de l’ethnologie académique. Face à ces deux chefs d’œuvres, Les Argonautes du Pacifique occidental de Malinowski ne faisait pas tellement le poids35. Pourtant, dans la pratique, je donnais raison à ce dernier, en cherchant à connaître le point de vue des « indigènes » et en optant pour l’« observation participante36 ». J’aimais le style du premier, mais l’épistémologie du second avait le dernier mot. La frontière entre esthétique et vérité n’était pas clairement délimitée. L’objectif premier était bel et bien scientifique. Cependant il était frustrant de se résigner à une fonction instrumentale du langage – de devenir un « bureaucrate de l’évasion37 ».
17Même s’il est vrai que « l’ethnologue n’est pas en principe un auteur qu’on écoute pour lui-même38 », je n’arrivais pas à faire taire ma subjectivité, laquelle venait régulièrement parasiter l’inventaire des faits plus ou moins objectifs. Je voulais relever le défi d’« écrire un texte qui puisse être en même temps un sentiment intime et un compte rendu distancié39 ». Pour masquer la présence de l’ego et feindre une mise à distance de la littérarité, l’idéal aurait été sans doute une écriture « blanche ». Mais c’est une écriture chatoyante – à l’image des reflets de la réalité – qui s’est imposée. Cette écriture me semblait pleinement ethnographique dans la mesure où « elle ne fix[ait] pas la vision dans un savoir » mais « introdui[sai]t le trouble dans ce qui [était] regardé40 ». En faisant le choix d’une certaine polyphonie contre un méta-langage quelque peu tyrannique, je pensais rendre service au réel. Je ne réalisais pas que la manière d’écrire n’allait en rien influer sur le caractère scientifique du travail final. « Les choix stylistiques, écrit Jean-Pierre Olivier de Sardan, sont en fait largement “neutres” du point de vue de la qualité scientifique : c’est une des grandes différences entre l’œuvre littéraire, où contenu et forme sont indissociables, et le texte sociologique, qui admet un tel découplage41. »
18Je mesure aujourd’hui toute la fragilité de ma posture stylistique, de ce refus de renoncer au plaisir des mots, d’avoir été trop complaisant vis-à-vis des fantasmes littéraires, alors que j’exécutais un travail relevant des sciences sociales. Si l’on en croit Vincent Debaene, malgré toute la force de conviction de Barthes la fusion entre littérature et science serait un vœu pieux : « Réconcilier un mode de discours qui se reconnaît d’abord à sa transitivité et à son dédain du style avec un autre, défini par son intransitivité et son exigence formelle, n’est pas seulement un non-sens historique, c’est une impossibilité logique42. » Quelques années plus tôt, Jean-Claude Passeron avait déjà bien fustigé le sociologue qui, jaloux du romancier dont les écrits trouvaient plus facilement un lectorat, se laissait séduire par les muses de la littérature. Mais le combat est inégal, car selon lui, « on a souvent vu faire de la bonne littérature avec de la mauvaise sociologie, parfois même avec de la bonne, jamais de la bonne sociologie avec de la littérature, bonne ou mauvaise43 ».
19Faut-il parler de Tristes tropiques en termes de bonne littérature ou de mauvaise sociologie ? En ce qui me concerne, j’avais associé indifféremment l’adjectif « bonne » aux deux substantifs. Dans mes trois lectures du livre, étalées sur une période de dix ans environ, la première était celle d’un amateur (comme pour un roman d’été), la seconde répondait à un objectif scolaire (rédiger un mémoire), et la troisième s’inscrivait dans une perspective « professionnelle » (s’inspirer d’un modèle). En reprenant les réflexions de Thibaudet dans son article « Le liseur de romans », on pourrait reformuler ce constat de la manière suivante. Ma première lecture était celle d’un « lecteur de romans » qui, sans aucune conscience littéraire, « lit n’importe quoi, au hasard, sans être guidé par aucun des éléments, intérieurs ou extérieurs, qui tiennent et circulent dans ce mot : le goût44 ». Je voulais du dépaysement, de l’aventure, des sensations ; je lui demandais – honte à moi – « une distraction, un rafraîchissement, un repos de la vie courante45 ». La seconde lecture était celle d’un « liseur de romans », c’est-à-dire un lecteur qui croit à « un ordre où la littérature existe, non comme un divertissement accidentel, mais comme une fin essentielle46 ». Enfin la troisième lecture se serait rapprochée de celle d’un « viveur de romans », fondée sur la suggestion vraie et dont l’archétype extrême – caricaturale – serait Don Quichotte vis-à-vis des romans de chevalerie. La vie vécue par Lévi-Strauss était une vie idéale, et il fallait essayer de suivre ses pas à mon propre niveau. Peu importait le résultat, seule comptait la démarche.
20Ces trois attentes de lecture peuvent-elle être rassemblées autour d’une même « ligne de vie »? Dans une perspective romanesque, cela serait tout à fait envisageable. Mais si l’on veut être réaliste, il faut reconnaître que c’est le « hasard » qui a tout fait. Ou presque. Si l’on m’avait dit, à l’occasion de la première lecture, que j’allais devenir ethnologue, j’aurais sûrement lâché une onomatopée amusée. Au fil du temps, cependant, un certain nombre de coïncidences s’accumulant, il est tentant, comme le note Pierre Bourdieu, de « se faire l’idéologue de sa propre vie en sélectionnant, en fonction d’une intention globale, certains événements significatifs et en établissant entre eux des connexions propres à les justifier d’avoir existé et à leur donner cohérence47 ». C’est la métaphore de vie comme chemin, avec la fausse évidence d’une linéarité qui fait sens. On oublie ainsi que la réalité penche plutôt du côté de la discontinuité.
21Si l’on veut toutefois rendre au libre-arbitre ce qui lui revient de droit, il faudrait se tourner vers la notion intermédiaire de « chance ». Le « hasard », selon Thibaudet48, « procède par points discontinus ». Puis vient la « chance », laquelle « implique une suite de points ». Un semblant de cohérence voit le jour. L’unité atteint son apogée avec la « destinée », qui serait orchestrée d’en haut. C’est « l’illusion biographique » dénoncée par Bourdieu. Entre le chaos du hasard et l’ordre trop parfait de la destinée, il semble que l’aléa encadré de la chance – mélange de volonté individuelle et de déterminismes sociaux – soit au plus près du réel. Entre hasard et nécessité, ce serait donc la chance qui crée le fil linéaire d’une vie. Et non pas une « ligne », sans doute trop épaisse et trop dense pour caractériser la singularité d’une existence. Ce qui s’est développé de manière plus ou moins continue dans l’espace de la chance entre la première et la dernière lecture, c’est sans doute un certain sens critique, une ébauche de maturité – une métamorphose progressive de « lecteur » à « viveur » de littérature. L’enchantement originel a-t-il résisté à l’éthique scientifique ? Est-il encore possible de fermer les yeux sur les passages structuralistes, pour ne voir que les anecdotes humoristiques, les descriptions sublimes, l’ombre de Chateaubriand ou le fantôme de Proust ? Une fois devenu ethnologue, est-il toujours légitime de lire Tristes tropiques comme un livre d’écrivain ?
22Quand je rouvre Tristes tropiques aujourd’hui, deux lecteurs se chamaillent pour tirer la page à soi : celui qui veut éprouver (le lecteur), et celui qui veut comprendre (le liseur ou le viveur) ; celui qui admire l’écrivain, et celui qui a du respect pour l’écrivant. Malgré leurs aspirations différentes, ces deux types de lecteur ne s’opposent pas de front. D’ailleurs Barthes a très bien expliqué que l’écrivain et l’écrivant ne font souvent qu’un, alternant les rôles selon l’humeur ou les circonstances. Quoi qu’il en soit, si l’on se place du côté de la réception, il semble difficile d’éprouver sans comprendre et vice-versa. Si l’on me demande : « Qui est votre ethnologue préféré ? », faut-il pour y répondre prendre en compte la voix des deux lecteurs, ou n’écouter que celle du cœur ?
Narcissisme distancié
23Loin d’aborder cette dimension schizophrénique, mon propos consiste juste à voir dans quelle mesure un livre peut influer sur le cours d’une vie, en l’occurrence la mienne. Comment une biographie couchée sur papier peut-elle agir sur l’orientation d’un jeune individu en quête de destin ? Un tel narcissisme peut bien entendu être considéré comme déplacé dans un cadre universitaire. Malgré tout, je tiens à faire le pari de l’auto-analyse, en référence à Bourdieu. Dans son Esquisse pour une auto-analyse (2004), ce dernier commence par une phrase d’avertissement : « Ceci n’est pas une autobiographie », clin d’œil au « Ceci n’est pas une pipe » de Magritte. Malgré les apparences, l’auteur ne va pas se raconter, mais exploiter une expérience personnelle à des fins sociologiques. « À chaque fois, commente Bernard Lahire, la personne de Pierre Bourdieu s’efforce de ne pas être le centre psychologique, sensible et émotif du “problème” et de l’“attention”, mais un point particulier situé (et se situant) dans des espaces structurés (et structurants)49. » Dans le même esprit, par un travail auto-réflexif, j’essaie ici de me servir de mon expérience de lecteur pour mettre au jour quelques éléments de compréhension relatifs au goût littéraire. Par une mystérieuse alchimie, l’objectif est de transformer une tare épistémologique en vertu heuristique. De faire d’un vécu des plus banals un matériau exploitable par l’analyse scientifique.
24Avec un peu de recul, il semble que ce qui m’a plu dans le Lévi-Strauss de Tristes tropiques, c’est son ironie – immédiatement perceptible puisque « les artifices sont placés au premier plan, désignés, exhibés même50 ». Au départ il y a un fond de méchanceté, dont la fonction première serait de décaper le sens commun – une logique caustique ou sarcastique qui s’inscrit dans un projet de démystification. Commencer son livre en proclamant tout de go sa haine pour les voyages et les explorateurs, alors qu’il s’apprête à raconter ses propres aventures, ne manque pas de panache. On est a priori aux antipodes de l’empathie que le lecteur occidental est en droit d’attendre d’un anthropologue respectable. À moins de lire ce récit comme une parodie du genre et de lui-même.
25Ce brin de scepticisme paraît faire corps avec le destin des sciences humaines depuis que « la perte de confiance dans l’univers a fait prendre conscience de l’ironie de la condition humaine51 », vers la fin du xviiie et le début du xixe siècle, époque où l’ironie de situation, l’ironie dramatique et la parabase, procédés traditionnellement rattachés à la peripeteia des Anciens, entrent dans la catégorie de l’ironie. Cette nouvelle acception n’a pu s’imposer que parce qu’elle fait désormais partie de la réalité existentielle des individus. Tout au bout de l’ironie il y aurait l’absurde, mélange d’existentialisme et de désillusion historique.
26Cependant l’ironie de Lévi-Strauss aurait sonné comme une grinçante condescendance si elle n’avait recouvert que l’objet d’étude proprement dit. Or les illusions du moi n’ont pas été épargnées. L’ironie vaut aussi pour lui. Au plus fort des envolées sarcastiques, l’empathie ne fait jamais faux bond. Tant qu’elle ne sombre pas dans l’autodérision systématique ou la pose mondaine, l’ironie purifie autant qu’elle salit. On pourrait ainsi parler d’une empathie au second degré. Celle-ci renvoie à un bon usage des émotions dans la description ethnographique, l’objectif étant de passer de la « contemplation éblouie » à la « contemplation inquiète52 », pour faire émerger un texte vivant qui rende compte d’une certaine angoisse relative aux enjeux de la modernité. Ainsi, les variations de ton renvoient moins à un défi esthétique, qu’à une éthique propre à tout récit, qu’il soit scientifique ou littéraire.
27Entre sarcasme, lyrisme et neutralité, le texte ethnographique tente de cerner au mieux le réel. Et c’est dans une empathie contrôlée – savant dosage de sens critique, d’humanisme et d’auto-réflexivité – que ses vertus heuristiques sont les plus manifestes. Tristes tropiques incarnait pour moi ce juste ton, soutenu par une forme incroyablement originale qui défie la loi des genres (récit de voyage, ethnographie classique, essai philosophique, pamphlet, texte symboliste). Le texte ethnographique se parait avec Lévi-Strauss de la grâce du Livre.
D’un quiproquo à l’autre
28Le titre d’« ethnologue préféré » paraît se justifier par la dimension éthico-esthétique de Tristes tropiques. Il faut toutefois essayer de savoir si derrière cette explication intellectuellement correct il n’y a pas d’autres motifs, moins respectables, autrement dit s’attaquer au mythe de la vocation (moderne), dont l’histoire date de la fin du xviiie siècle et qui est devenue aujourd’hui une « conviction culturelle générale53 ».
29Au commencement de ma carrière d’ethnologue, il pourrait bien y avoir une série de quiproquos. Tout d’abord, c’est un coup de cœur littéraire qui m’a fait entrer dans le monde de la science54. Je pense alors à une nouvelle de Tabucchi55. Un groupe de jeunes amis se retrouve à un café pour se projeter dans leur imminente vie d’étudiants, quand l’un d’eux arrive bouleversé. Il a été victime d’une erreur administrative. Lui qui ne jurait que par les Lettres classiques, on l’a inscrit en Droit. Sacrilège. Il se rend aussitôt au secrétariat pour tirer au clair cette affaire. L’employé lui répond qu’il s’agit d’une « petite équivoque sans solution ». L’amoureux des Lettres s’affole. L’employé le rassure : sa langue a fourché. Il voulait dire une « petite équivoque sans importance ». Il arrive qu’un destin bascule sur un lapsus. Dans mon cas, il n’y a pas eu d’erreur administrative ou de lapsus. Mais il y a bel et bien eu une petite équivoque, ne serait-ce que sur le terme même d’« ethnologue ». Je ne savais pas très bien à quoi cela renvoyait exactement, mais le mot en soi sonnait bien. Et puis derrière lui on entendait des échos d’humanisme, des murmures d’aventure, sur fond d’érudites litanies. Il contenait tout l’imaginaire d’un gai savoir où l’heure et la sueur n’ont pas de prix. C’était bien plus chic que journaliste, avocat, médecin, chef d’entreprise ou directeur de cabinet… Il fallait se jeter à l’eau, et se laisser porter par le courant sémantique du mot.
30C’est ce qu’explique parfaitement Judith Schlanger lorsqu’elle écrit que « d’une certaine façon, le terme en sait plus que moi et c’est pourquoi je m’en réclame56 ». Pour elle, il existe plusieurs catégories de vocations, lesquelles se caractérisent par leur approximation, et qui renvoient à des positions plus ou moins valorisées dans la société. C’est donc par rapport à un stéréotype assez flou que l’individu incertain s’oriente, et c’est à lui qu’il incombe ensuite de préciser le sens de sa vocation. La catégorie ne vaut rien en soi, c’est l’individu qui l’habite qui fait tout. Peintre, écrivain, architecte, professeur, policier, boulanger : derrière ces métiers se cachent autant de réalités à inventer selon qui l’on est ou ce que l’on veut être. Pour ce qui est de l’ethnologue, le flou est d’autant plus grand que les querelles internes entre les « anciens » et les « modernes » (et maintenant les « post-modernes »), sont assez virulentes, et que désormais le sociologue lui emprunte sa méthode fétiche : l’enquête ethnographique. Qu’est-ce que l’ethnologie aujourd’hui ? Bienheureux celui qui pourrait donner une définition qui fasse l’unanimité. Dans cet imbroglio idéologico-politique, l’étudiant un tantinet éclectique, à moins de suivre d’emblée les grandes lignes tracées par un mandarin, ne peut que tâtonner. Pour asseoir une argumentation, au petit bonheur la chance il avance un auteur qui lui paraît pertinent, priant pour que l’interlocuteur – proche ou lointain – qui évalue sa compétence soit du même camp que le courant convoqué. Sinon il n’a plus qu’à changer de vocation. Voilà donc une première source d’équivoques. Quant à savoir si elle est sans importance ou sans solution, seul l’avenir peut le dire.
31La deuxième hypothèse renvoie aux illusions de « l’âge lyrique » (Kundera). La première fois où la couverture de Tristes tropiques m’apparut en format poche, c’était dans les mains d’une jeune et jolie étudiante recroquevillée dans un coin d’escalier menant à l’amphithéâtre principal. Nous étions en première année de sciences politiques, l’ouvrage n’était recommandé par aucun professeur. Que faisait-elle avec ce livre cinq minutes avant un cours de droit constitutionnel ? Malgré la foule d’étudiants qui montaient et descendaient les marches dans un grouillement bruyant, elle ne démordait pas de sa lecture. Ses doigts s’accrochaient à la couverture, coupant en deux le visage du jeune Indien qui servait d’illustration. De ce dernier on ne voyait plus que le regard mélancolique. Cette photographie mentale, toujours vivace, participe-t-elle de mon amour de Lévi-Strauss ? Et si, à la place de Tristes tropiques, elle avait eu entre les mains L’Alchimiste de Paulo Coehlo, serais-je allé sur-le-champ à la recherche de ma « légende personnelle » ? Fort heureusement le hasard m’a épargné cette lubie. Ce fut Lévi-Strauss, et ce fut bien ainsi. Enfin on en revient toujours à cette idée du quiproquo. Au fait qu’une vocation ne tienne parfois qu’à une photo.
32Pour Lévi-Strauss, tout s’est joué sur un coup de téléphone. C’est moins l’appel de l’ethnologie57 que celui de Célestin Bouglé qui fut déterminant. Automne 1934. Neuf heures du matin. Un dimanche comme les autres. Le téléphone sonne. Le directeur de l’École normale supérieure est à l’autre bout du fil. Cet appel est d’autant plus curieux que l’ancien élève n’a jamais vraiment fait partie de « l’écurie » du directeur. Peu importe, la proposition tombe : « Avez-vous toujours le désir de faire de l’ethnographie ? » Un poste de professeur en sociologie à l’Université de Sao Paulo n’attend plus que sa science. Les faubourgs de la mégalopole regorgent d’Indiens, paraît-il. Pourquoi ne pas leur rendre visite le week-end ? Lévi-Strauss doit donner sa réponse avant midi. Trois heures de réflexion, c’est beaucoup trop quand il s’agit d’une vocation. Soudain la carte postale du Brésil occupe tout l’écran de son imaginaire : les gerbes de palmiers sont bercées par une brise aux senteurs de cassolette58. Le « parfum brûlé » du Brésil nourrit ses rêves d’ailleurs ; cette « distillation patiente et fractionnée » lui donne un avant-goût du caractère équivoque de toute situation humaine. Il n’a pas dit oui qu’il est déjà là-bas. Le voici dans la peau d’un explorateur, à l’affût d’un bout de paysage, d’un mot insolite, d’une vision poétique, qui l’air de rien éclairent un aspect particulier de la condition humaine.
33Mais il a un doute. Aussitôt la divine odeur envolée, la proposition du directeur lui semble avoir été faite à la légère. Bouglé ne confond-il pas Sao Paulo et Mexico ? Y a-t-il vraiment des Indiens là-bas ? Leur absence condamnerait les week-ends de l’ethnographe à se transformer en longues séances de bronzage sur les plages brésiliennes. Le futur professeur de sociologie a de bonnes raisons de remettre en cause les propos du directeur. Philosophe ayant écrit un ouvrage sur le régime des castes en Inde, Bouglé n’y a curieusement jamais mis les pieds, pensant avec une condescendante naïveté que « dans le flux des événements ce sont les institutions qui surnagent59 ». Mais Lévi-Strauss est trop enthousiaste pour compromettre son voyage. Il dit oui. Quelques jours plus tard, invité à la table de l’ambassadeur du Brésil à Paris, il apprend de la bouche de ce dernier que tous les Indiens ont disparu depuis longtemps, massacrés par les colons portugais au xvie siècle. Il reçoit toutefois la garantie que, malgré l’absence des Indiens, le pays reste un merveilleux objet d’étude : « Vous allez, comme sociologue, découvrir au Brésil des choses passionnantes, mais les Indiens, n’y songez plus, vous n’en trouverez plus un seul60… » En réalité, les Indiens dont il rêve sont à trois mille kilomètres plus avant dans les terres.
34Finalement, Tristes tropiques est un récit de quiproquos : sur le métier d’ethnographe, sur les bons sauvages, sur le temps qui passe, sur les mirages du destin. Et sa contribution à la promotion de Lévi-Strauss comme « ethnologue préféré » (au mépris de sa production théorique) s’inscrit dans le même esprit d’équivoque, renforcé par les contingences affectives. Mais ce titre est remis en jeu à chaque relecture. Ce qui m’enchantait hier peut demain m’agacer. Par ailleurs, dans un coin de la bibliothèque, il y a Les Argonautes du Pacifique qui me fait de l’œil, et je me surprends à rougir de lui avoir refusé la tendresse qu’il mérite. Juste à côté, il y a aussi la Chronique des Indiens Guayaki qui réclame toute mon empathie. Je ne sais plus où donner de la tête tellement il y a de livres et d’auteurs à aimer. En cas d’incendie, pour ne pas faire de jaloux, je pourrais être tenté de laisser les flammes préférer à ma place. Ne plus faire confiance même à la chance. S’en remettre au pur hasard, loin de toute idée de destinée. Et écouter tout simplement la musique des flammes.