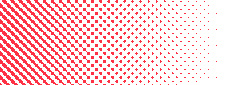La fabrique de l’épuisement : oppression affective et déracinement dans le Journal d’usine de Simone Weil
L’espace, l’espace tue.
(Kaplan, 1982, p. 40)
1Leslie Kaplan, établie dans une usine de 1968 à 1972, a écrit L’Excès-l’Usine, œuvre poétique publiée en 1982 dans laquelle elle décrit l’espace de l’usine qui s’étend bien au-delà des frontières physiques de cette dernière, semblant contaminer les ouvrières et ne jamais les abandonner, modifiant leurs corps et leurs gestes1. L’établissement est une pratique politique et philosophique principalement post-mai 1968 décrivant « une mobilité sociale descendante pour des raisons politiques » (Dressen, 1999, p. 10). Des « centaines de militants étudiants », « issus de diverses organisations de la gauche extraparlementaire » (Zancarini-Fournel, 2001, p. 148) et provenant de diverses classes sociales, ont décidé d’abandonner leur statut pour devenir ouvriers. Plusieurs d’entre eux ont ensuite narré leur expérience dans des récits, comme Robert Linhart dans L’Établi (1981) ou, plus récemment, l’autrice-compositrice-interprète Dominique Grange, accompagnée du dessinateur Tardi, dans la bande-dessinée Élise et les nouveaux partisans (2021). Si l’établissement est un phénomène daté, marquant plutôt les années 1970, les récits et témoignages personnels décrivant les expériences d’usine se sont multipliés ces dernières années, avec la mise en lumière d’À la ligne (2019) de Joseph Ponthus, ou encore le remarqué En salle (2022) de Claire Baglin. Bien avant cela, Simone Weil, illustre « devancière » (Grenouillet, 2014, p. 29), a volontairement adopté un déclassement et décrit son expérience, ayant travaillé dans les « usines Alsthom, J. J. Carnot, et Forges de Basse-Indre puis Renault » (Wahl, 2005) en tant que manœuvre entre 1934 et 1935. Affaiblie par cette expérience et par sa santé fragile, elle a par la suite quitté le travail ouvrier pour reprendre son métier d’enseignante. Malgré son pacifisme, elle s’est engagée successivement pendant la guerre civile espagnole – un bref engagement dans la colonne anarchiste Durruti – et la Seconde Guerre mondiale – à travers des actions de résistance à Marseille, puis son rôle de rédactrice à Londres, pour la France Libre de de Gaulle. Elle décède à 34 ans en 1943, malade et épuisée.
2Pour Weil, « le travail est l’activité par laquelle s’exprime au mieux la condition humaine » car « travailler, […] c’est mettre en forme, tenir le monde à distance en éprouvant sa nécessité. » (Taïbi, 2009, p. 17) Elle dénonce les philosophes – notamment marxistes – qui écrivent sur l’usine sans s’y « être exposé[s] » (Weil, [1935] 2002, p. 11), et se complaisent dans une « perception imaginaire » (Taïbi, 2009, p. 15) de la condition ouvrière sans y avoir réellement prêté attention. L’un des concepts fondamentaux de la philosophie de Weil est justement cette attention, sans laquelle l’action « ne serait pas action, mais mouvement du corps dans le sommeil » (Weil, 1988, p. 316). Comme l’écrit Joël Janiaud :
Les guerres, les oppressions politiques, les relations humaines en général sont remplies de ces actes dans lesquels, soumis à l’imagination, on ne croit pas à la réalité de l’autre. Le remède à cette inconscience tiendrait selon Simone Weil en un seul mot : l’attention. (Janiaud, 2002, p. 8)
3Ouverture morale à autrui qui implique la mise à l’écart temporaire de soi-même, l’attention est au cœur de la praxis philosophique de Weil et l’a donc poussée à travailler en usine, afin de vivre l’oppression et de s’y exposer. De cette expérience, elle a tiré un journal ainsi que plusieurs essais prenant appui sur ce dernier, rassemblés dans La Condition ouvrière ([1935] 2002). Si la plupart de ses essais ont été produits a posteriori, rationalisant l’expérience ouvrière, le Journal d’usine a été écrit au jour le jour, à fleur d’expérience. Alors que Weil est réputée « froide [unsentimental] » (Nelson, 2017, cette traduction et toutes les suivantes sont les miennes) à la fois dans son style et dans ses idées, son journal en offre une tout autre image.
4Le Journal d’usine est composé d’entrées quotidiennes s’égrenant au fil des semaines. Il est formé de passages prosaïques où se suivent – et souvent se ressemblent – des détails techniques concernant les machines sur lesquelles travaille Weil, ainsi que des chiffres en grande quantité, qu’ils désignent des sommes d’argent, des heures travaillées ou des pièces à fournir. Contrainte de respecter le bon comme tous les autres ouvriers de son usine – une commande d’un certain nombre de pièces à fournir en un certain nombre d’heures sans quoi le bon est « coulé » –, Weil illustre le rythme de son quotidien par une litanie technique et numérique. Parallèlement à cela, plusieurs passages du journal abondent en vocabulaire traitant des affects de la philosophe par rapport à ses tâches et à son environnement matériel. Les affects présents dans l’œuvre sont constitutifs de l’usine en tant qu’espace d’oppression totale, à la fois physique et émotionnelle. Selon Weil, à l’usine « les choses jouent le rôle des hommes, les hommes jouent le rôle des choses ; c’est la racine du mal. » (Weil, 1991, p. 295) Les ouvriers ont perdu leur autonomie et leur liberté, ils ne sont plus que des rouages accomplissant des gestes sans idée, obéissant à une hiérarchie bureaucratique qui modifie les objectifs et les salaires à l’envi. L’usine tisse alors une toile de relations sociales et politiques qui fait écho à un totalitarisme poussant les individus à renier une quelconque forme de jugement dans leurs actions et à suivre les ordres aveuglément. Cette toile repose en grande partie sur des affects, qui permettent d’isoler et d’immobiliser les ouvriers, empêchant, nous le verrons, l’attention de s’exercer.
5S’il est difficile de définir la notion d’affect tant elle est sujette à débat et difficile à distinguer de ses deux proches parents, le sentiment et l’émotion, je rassemble sous cette catégorie ce qui est exprimé par Weil, car je l’analyse dans sa relation avec la matérialité et la sociabilité de l’usine, qui affectent violemment son corps. Suivant l’avertissement de Frédéric Lordon dans La Société des affects (2013), je souhaite m’écarter d’un « individualisme sentimental » qui pourrait menacer le « tournant émotionnel » des sciences humaines, pour toujours considérer les « structures, institutions [et] rapports sociaux » dans leur matérialité (p. 9-10). Seule une analyse duelle, prenant en compte à la fois les réalités corporelles/matérielles et sentimentales/émotionnelles peut nous permettre de nous éloigner de cet individualisme, et c’est sous la notion d’affect que je la range. Il convient toutefois de noter que les frontières entre « affect », « sentiment » et « émotion » restent poreuses, comme le témoigne l’usage plus ou moins différencié de ces termes par de nombreux théoriciens.
6La douleur corporelle décrite dans le Journal d’usine a déjà été analysée par plusieurs critiques comme Anne Roche dans la préface de l’œuvre (Weil, 1991), Nadia Taïbi dans La Philosophie au travail (2009), ou encore Corinne Grenouillet dans Usines en textes, écritures au travail (2014). Si toutes trois insistent sur la douleur physique et même parfois psycho-affective – comme l’analyse de l’ennui par Grenouillet (2014, p. 131) –, il me semble qu’une approche littéraire relevant de la théorie de l’affect manque aux nombreuses études de ce journal. Elle autorise une compréhension plus aiguë de cet espace d’oppression protéiforme et de la souffrance de la diariste, précisant par-là plusieurs notions philosophiques définies par Weil comme l’attention et le déracinement. Je prendrai appui sur les chercheuses de l’affect Sara Ahmed et Hannah Freed-Thall afin de contredire deux idées reçues sur les affects : leur pure subjectivité et leur caractère uniquement psychologique. Je me concentrerai ensuite sur ce que j’appelle l’oppression affective de l’usine, à savoir les affects produits par les conditions de travail en usine qui isolent les ouvriers les uns des autres. La soumission à cet espace entraîne deux affects principaux : la fatigue et l’épuisement, que j’étudierai à l’aune de l’essai que Gilles Deleuze a dédié au théâtre de Samuel Beckett, L’Épuisé (1992). Alors que la fatigue – souvent accompagnée de la colère chez Weil – implique un sentiment d’impuissance face à la réification du corps ouvrier, ainsi qu’un isolement affectif, l’épuisement suppose une perte totale des possibles et une coupure complète avec le réel. L’ouvrier devient alors, au sens de Weil, un « déraciné ». Je lierai cette analyse à la matière textuelle du journal grâce à l’étude que Morgane Cadieu a consacrée à Georges Perec dans Marcher au hasard (2019), où elle se concentre sur l’utilisation des répétitions et des listes comme signifiants de la fatigue ou de l’épuisement. La critique de l’usine comme espace d’oppression affective me conduira par la suite à discerner les possibles stratégies de résistance mobilisées par la diariste. Les relations entre ouvriers forment une première tentative de résistance au sein de l’usine, relations que Weil signe typographiquement dans son journal et que j’étudierai sous l’angle des « liens faibles » mis en lumière dans Le Pouvoir des liens faibles (2020), dirigé par Alexandre Gefen et Sandra Laugier. Enfin, les notions de dégoût et d’écœurement théorisées par Hannah Freed-Thall dans son article « Écœurement : la langue du dégoût français [Heartsick : The Language of French Disgust] » (2018), représentent, malgré leur statut d’affects négatifs, une dernière possibilité de lutte et de remise en cause de l’ordre établi.
De la fatigue à l’épuisement : l’usine comme espace d’oppression affective
7Il est important dans un premier temps de dissiper deux idées à propos des affects. Si la peur et la fatigue paraissent purement subjectives et personnelles, nous verrons qu’elles se placent dans une relation de coproduction avec le tissu social dans lequel elles se trouvent. Comme l’écrit Hannah Freed-Thall :
[…] les sentiments enregistrent les répartitions inégales de pouvoir ; ils ne peuvent être pensés en dehors des cadres sociaux dynamiques qui les rendent lisibles (et qu’ils façonnent)2. (Freed-Thall, 2018, p. 426)
8Alors que les sentiments sont le plus souvent pensés comme des signes réactifs dans un environnement social donné, ils sont de fait des acteurs dans la formation de cet espace de liens et de relations. Il en est de même pour l’espace social et matériel de l’usine, qui impose un ensemble d’affects, et qui en retour est façonné par ces derniers. Il faut également rappeler que les émotions ne sont pas de purs produits psychologiques, mais ont des effets physiques et matériels, devenant par là des affects. C’est par ce constat que Sara Ahmed ouvre son essai The Cultural Politics of Emotions :
Les émotions façonnent la surface même des corps, qui prend forme à travers la répétition d’actions dans le temps, ainsi que d’orientations de rapprochement et d’éloignement vis-à-vis des autres. […] C’est ce qui nous permet d’associer l’expérience d’une émotion à l’affect même d’une surface sur l’autre, affect qui laisse sa marque ou sa trace3. (Ahmed, 2014, p. 4 et 6)
9Si les affects sont à fleur de peau, à la surface des corps, ils sont donc aussi marqués par la répétition des gestes dans le temps et par les relations aux autres, deux aspects capitaux du travail en usine. Weil avait elle-même déjà noté ces relations de coproduction façonnant les corps et les gestes lorsqu’elle écrivait dans son « Expérience de la vie d’usine » :
Il est difficile d’être cru quand on ne décrit que des impressions. Pourtant on ne peut décrire autrement le malheur d’une condition humaine. Le malheur n’est fait que d’impressions. […] Ce sont les sentiments attachés aux circonstances d’une vie qui rendent heureux et malheureux, mais ces sentiments ne sont pas arbitraires, ils ne sont pas imposés ou effacés par suggestion, ils ne peuvent être changés que par une transformation radicale des circonstances elles-mêmes. (Weil, [1935] 2002, p. 341)
10Les « circonstances » de l’usine, prise comme espace social construit par un ensemble de relations à la fois horizontales – entre collègues – et verticales – avec la hiérarchie –, produisent donc des affects à plus d’un titre : elles contrôlent les gestes, le temps et les interactions sociales. Si l’usine a la mainmise sur toutes ces composantes par lesquelles les affects se créent et se renouvellent sans cesse, je pense qu’il est possible de la qualifier d’espace d’oppression affective, s’actualisant à travers la fatigue, puis l’épuisement.
11La fatigue et la colère sont les deux versants d’un même sentiment d’impuissance face à la réification du corps ouvrier transformé en machine. Weil écrit par exemple :
Je voudrais bien ne pas couler le bon. […] La fatigue et le désir d’aller vite m’énervent un peu. Je mets une bande, en commençant, pas assez loin, ce qui m’oblige à recommencer le 1er coup de pédale et loupe une pièce (1 loupée sur 5.000, c’est peu, mais si cela se produisait à toutes les bandes, cela ferait beaucoup). Cela m’arrive plusieurs fois. Enfin, énervée, je remets alors la bande trop loin, elle passe par-dessus la butée et au lieu d’une rondelle il tombe un cône. […]. L’outil est cassé. (Weil, [1935] 2002, p. 116)
12La deuxième phrase met en relief l’entremêlement de la fatigue et de la colère visible tout au long du texte. Ce vase clos affectif qui empêche l’attention à autrui est en outre souligné par les sujets de la colère, ici du verbe « énervent », qui sont deux autres sentiments : la « fatigue » et le « désir d’aller vite ». Le fait que les affects semblent submerger le sujet, qui n’est exprimé dans cette phrase que par une seule lettre, ce « m’ », transmet très bien la primauté de ces derniers sur la constitution du sujet, comme élidé par ses émotions, et ne se retrouvant que dans les gestes mécaniques de l’usine qui suivent. La description technique des gestes du travail recouvre la majeure partie de l’extrait, illustrant le lien théorisé par Ahmed entre le corps, les gestes et les affects. Enfin, on remarquera l’adjectif « énervée », noyé dans les gestes techniques, qui ne supporte ni sujet ni verbe, et qui témoigne de l’isolement et de l’immobilité affective du sujet, enfermé dans sa tâche difficile et répétitive, et incapable d’exercer la capacité d’attention si chère à la philosophie de Weil. La fatigue et la colère de cette dernière sont des symptômes affectifs de sa réification, de la transformation de son corps en machine. Créés par l’espace à la fois matériel – visible à travers les tâches à effectuer – et social – marqué par la peur de couler le bon dans la phrase d’ouverture – de l’usine, ces deux affects isolent le sujet dans sa réification, le poussant à se concentrer uniquement sur ses tâches, comme un simple outil. Toutefois, ils ne ferment pas les possibilités d’espoir et de révolte. Weil écrit par la suite qu’elle est « horriblement énervée à l’idée de recommencer » (Weil [1935] 2002, p. 117) cette même tâche, signalant mais aussi rejetant sa position mécanique répétitive et automatique. Romain Huët, anthropologue travaillant sur la fatigue dans un cadre contemporain, a très bien décrit les possibilités ouvertes par de tels affects :
Il [le fatigué] prévient les devenirs. […] Sur les côtés de la société, il l’altère en raison de sa non-adhésion au présent. […] [Il est] un appel ferme à ce que la société se réfléchisse dans ce qui lui manque, dans ce qu’elle a de brutal et dans les conséquences que son organisation produit dans de nombreuses vies. (Huët, 2021, p. 10-12)
13La fatigue et la colère sont des affects négatifs mais porteurs de possibles, signes d’une remise en cause d’une condition. Toutefois, c’est le regard extérieur, comme celui du chercheur comme Huët ou celui de la philosophe comme Weil, qui peut s’extraire de l’usine et décrypter ces possibles. À l’intérieur de l’usine, ces affects sont synonymes d’immobilité et d’isolement social, puisque la colère et la fatigue coupent toute envie de socialisation. Affectant les corps et les gestes, ils forment la première étape d’une oppression affective qui a pour but de supprimer toute pensée chez l’ouvrier. La seconde est l’épuisement.
14Au contraire de la fatigue, l’épuisement signifie la fin des possibles. Comme l’écrit Gilles Deleuze dans son essai sur les pièces de Samuel Beckett intitulé « L’Épuisé » : « Le fatigué a seulement épuisé la réalisation, tandis que l’épuisé épuise tout le possible. Le fatigué ne peut plus réaliser, mais l’épuisé ne peut plus possibiliser. » (Deleuze, 1992, p. 57) Il n’y a rien à tirer de cet affect, ni espoir, ni révolte, ni possibilité. Weil écrit alors :
L’épuisement finit par me faire oublier les raisons véritables de mon séjour en usine, rend presque invincible pour moi la tentation la plus forte que comporte cette vie : celle de ne plus penser, seul et unique moyen de ne pas en souffrir. […] Effroi qui me saisit en constatant la dépendance où je me trouve à l’égard des circonstances extérieures : il suffirait qu’elles me contraignent un jour à un travail sans repos hebdomadaire – ce qui après tout est toujours possible – et je deviendrais une bête de somme, docile et résignée (au moins pour moi). (Weil, [1935] 2002, p. 103-104)
15L’affect qu’est l’épuisement est placé en tête de phrase et en est le sujet, reléguant Weil à un statut d’objet. La tentative de réclamer une agentivité à travers les différents pronoms nominaux « me » ou « moi » et le déterminant possessif « mon », symbolisant la volonté passée de la philosophe avant d’arriver à l’usine, s’écrase contre la seconde section de la phrase ouverte par les deux points. Cette dernière introduit la conséquence finale de l’épuisement, « ne plus penser ». L’épuisement de toute possibilité façonné par l’usine a fait de l’absence de pensée le seul rempart contre la souffrance engendrée par la réification du corps. L’usine en tant qu’ensemble de relations sociales hiérarchiques trouve là sa forme parfaite d’espace d’oppression totale : en utilisant les affects à son avantage pour isoler les ouvriers les uns des autres et les arrimer à leur tâche, elle finit par supprimer toute pensée en dehors des tâches mécaniques, répétitives et réifiantes qu’elle leur impose. Cette oppression totale, c’est aussi l’absence de choix, soulignée dans l’extrait par l’isotopie de la contrainte et de la passivité, avec des termes comme « me faire », « me saisit », « la dépendance » et « me contraignent ».
16 Sans faire de l’espace de l’usine un espace proprement totalitaire, il est tout de même intéressant de se pencher sur la définition du totalitarisme d’Hannah Arendt pour en voir les similitudes et en comprendre les effets. Pour Arendt ([1990] 2018), le totalitarisme est en partie une « fiction politique exclusive » qui « tente de dessaisir l’homme de sa nature sous prétexte de changer celle-ci. » (p. 12 et 53) Arendt théorise alors le concept de « désolation », pris dans le sens étymologique de « dé-solation », à savoir la privation du sol (Bornand, 2004, p. 35). L’usine en tant qu’espace d’oppression totale s’est dotée du taylorisme comme « fiction politique exclusive ». Si, comme l’écrit Henry Le Chatelier dans sa préface à l’ouvrage de Taylor ([1912] 1927), le taylorisme permet un « accroissement de rendement » sans augmenter « la fatigue » (p. 2), la réalité est tout autre. Georges Vigarello rappelle ainsi que la théorie de Taylor se concentre uniquement sur le chiffre et sur « l’instauration de “cadres”, administrateurs et “calculateurs”, tous chargés d’étudier les meilleures formules de gestes, d’outils, de comportements, de dispositifs, dont les rôles convergent pour améliorer le travail au moindre coup. » (2022, p. 223) Dès que l’ouvrier ne peut plus se soumettre à cette religion du chiffre sans cesse prêchée par une caste de ce que l’on désignerait aujourd’hui par « managers », Taylor « congédie ou rétrograde » (Taylor, [1912] 1927, p. 47), « avec une indifférence à tout versant émotionnel » (Vigarello, 2022, p. 224). L’ouvrier se retrouve dans une version industrielle du darwinisme social, où « seuls résisteraient les plus solides et les plus déterminés. Seuls serviraient d’exemple les plus “adaptés”. » (Vigarello, 2022, p. 224) Le taylorisme est donc une doctrine officiellement mise en avant pour maximiser le potentiel de l’ouvrier, mais modifiant en réalité sa nature, imposant certains affects et transformant son corps en machine dont les gestes et les rendements sont chiffrés, à la seconde et au gramme près. Cette réification, c’est la « désolation » mentionnée par Arendt, le dessaisissement de l’être de sa nature. C’est aussi ce que Simone Weil met en avant lorsqu’elle se compare à une « bête de somme, docile et résignée » ([1935] 2002, p. 104), image traditionnelle du travail abrutissant, mais aussi utilisation d’une autre forme de vie pour montrer un changement de nature.
17 Comment cet épuisement des possibles induit par le taylorisme est-il signifié dans le texte, dans la texture du quotidien de Weil ? Morgane Cadieu, dans son analyse de l’œuvre de Georges Perec, caractérise son utilisation des listes et des énumérations par deux aspects principaux : elles sont « une pratique de l’espace, une déambulation », mais aussi « un rempart contre le hasard ». S’appuyant sur l’essai de Deleuze mentionné plus haut, elle conclut qu’« à l’inverse de Beckett, Perec est […] du côté de la fatigue et non de l’épuisement » parce qu’il échoue dans sa Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, « se [fatiguant] avant d’avoir épuisé l’espace » (Cadieu, 2019, p. 133-134, 145 et 151). Cette fatigue ne ferme pas les possibles parce qu’il s’agit pour Perec de « transmettre une boîte à outils littéraire permettant à d’autres auteurs de continuer à épuiser la littérature, projet sans fin puisqu’épuiser une liste consiste à l’augmenter toujours. » (p. 151) Face à la figure de l’énumération, limitée par la fatigue mais sans cesse reprise, d’auteur en auteur, la répétition représente un excès, car elle semble se dérouler ad vitam eternam, dépassant le cadre du texte pour s’épandre infiniment à l’identique. La répétition est aussi « une pratique de l’espace », mais n’a pas de caractère déambulatoire ; au contraire, elle utilise le même segment spatial encore et encore. En cela, elle est également une pratique temporelle : alors que l’énumération et la liste s’accordent avec le temps linéaire et chronologique, autorisant cette transmission, la répétition impose un temps cyclique, fermé sur lui-même. Elle est aussi un « rempart contre le hasard » dans le sens où cette cyclicité ne semble supporter aucun clinamen – notion de « physique atomiste » que Cadieu définit comme « la déviation d’un atome hors de sa chute nécessaire et linéaire » (Cadieu, 2019, p. 136). Weil illustre bien cette cyclicité :
Mercredi 9 [janv.]. 7h-1h½ cambrage à la machine à boutons. […] 1h½ - 3h½ trous percés à la presse. […] 3h¾ - 5h¼ rivetage avec Léon : capots d’acier […] Jeudi 10 [janv.]. 7h – 10h40 : continué […] 10h45 à 11h25 : recuit dans four à Léon […] 11h½ à 5h trous dans gros et lourd écran […]. (Weil, [1935] 2002, p. 96-97)
18La répétition des jours et des horaires qui scandent le texte à un rythme régulier souligne une cyclicité artificielle, créée de toutes pièces par l’usine. Il en va de même pour la répétition des nombres de pièces à travailler, et des montants des salaires perçus. Cette marée répétitive de chiffres qui rend la lecture de l’œuvre difficile est le résultat du taylorisme : la logique chiffrée du rendement poussé à l’extrême force les ouvriers à effectuer des bons, à savoir un nombre de pièces à travailler en un temps précis, sans quoi leur paie est diminuée. Ces répétitions numériques ad nauseam ont une puissance d’abstraction importante. Comme le souligne Christy Wampole, les valeurs monétaires sont déjà totalement abstraites pour Weil :
La critique de l’argent faite par Weil est dirigée contre son statut de produit de l’imagination. Elle partage avec Marx une compréhension sémiotique de l’argent comme inverseur de signes. Son idée selon laquelle “la relation du signe à la chose signifiée est détruite” par l’argent est cohérente avec la détresse que Marx ressentait à la vue d’un riche homme bourgeois qui pouvait acheter toutes les quantités de ce qu’il ne possédait pas naturellement, renversant la nature et corrompant le système de signes dans son ensemble. (Wampole, 2016, p. 135)4
19De même, la cyclicité temporelle transforme les notations de durée comme « matin » et « après-midi » en coquilles vides et abstraites : il n’y a plus de jour, ni de nuit, seulement des chiffres, qui n’indiquent plus de moment dans la journée, mais une succession d’heures inchangées. Le mélange des nombres désignant les trois valeurs – pièces, temps, argent – s’opère inévitablement, symbolisant l’indistinction qui se forme dans l’expérience ouvrière vécue par Weil. Tous les nombres se ressemblent et ce qu’ils sont censés représenter devient abstrait également. Cette abstraction, à savoir « le remplacement des choses par les chiffres de ces choses [things are replaced by figures of those things] » (Wampole, 2016, p. 128) où « le rapport de signe à signifié périt » (Weil, 1948, p. 153), est la cause principale de ce que Weil a nommé le « déracinement ». Cette coupure fondamentale entre les choses et ce qui les signifie, c’est le réel épuisé que le langage n’arrive plus à rattraper, et qui affecte les corps et les gestes des ouvriers. Déracinement pour Weil ou désolation pour Arendt, la répétition dans le Journal d’usine est donc bel et bien du côté de l’épuisement, témoignant de l’oppression totale de l’usine. En tant qu’espace dans lequel se tisse un ensemble de relations aux êtres et aux choses, l’usine contraint les ouvriers à s’isoler sur leur ouvrage à tel point que leurs affects ne sont causés que par ce dernier. Leurs tâches étant répétitives et machinales, ces affects ne deviennent que des symptômes d’une réalité réifiante, qu’ils renouvellent sans cesse dans cette relation de co-production exprimée par Ahmed. L’épuisement, ultime étape de cette oppression, sinon totalitaire, au moins totale, isole et prévient toute tentative de penser, comme en témoignent ces répétitions abstraites qui dé-solent et déracinent les ouvriers, coupant toute capacité d’attention envers autrui.
Des stratégies d’attention envisageables ?
20 Dans ces conditions, la capacité d’attention semble impossible. Néanmoins, les relations sociales ne sont pas toutes abolies au sein de l’usine, et, à quelques rares occasions, des liens se tissent encore. La vague submergeante de nombres et d’affects comme la fatigue et l’épuisement constituant la vaste majorité du Journal d’usine, il est certain que la diariste est largement isolée du reste de ses collègues. Enfermée dans ses propres souffrances et tâches, elle semble n’avoir le plus souvent aucun lien avec les autres ouvriers. Quelques passages viennent toutefois contredire cette apparence :
Four. Coin tout différent, bien qu’à côté de notre atelier. Les chefs n’y vont jamais. Atmosphère libre et fraternelle, sans plus rien de servile ni de mesquin. Le chic petit gars qui sert de régleur… Le soudeur… Le jeune Italien aux cheveux blonds… mon « fiancé »… son frangin… l’Italienne… le gars costaud au maillet… Enfin un atelier joyeux. Travail en équipe. (Weil, [1935] 2002, p. 93)
21Lors de sa cinquième semaine de travail, Weil est envoyée travailler au four pour une journée. Là, le tissu social de l’usine se transforme et les relations verticales isolantes s’horizontalisent et créent une communauté de collègues. Ces entrelacements affectifs et sociaux sont extrêmement courts puisqu’ils ne sont en place qu’une journée, mais ils n’en demeurent pas moins essentiels. Ils font partie de ce que Sandra Laugier et Alexandre Gefen appellent des « liens faibles » dans l’introduction de l’essai qu’ils ont codirigé (2020). Les deux auteurs soulignent, sinon la force, au moins cette « nouvelle source de résistance contre l’individualisme néolibéral et le pur rapport de force », qui se trouve « au cœur de nos formes contemporaines d’attachement et de soin aux autres » (p. 11 et 17). Dans le Journal d’usine, les liens entre ouvriers peuvent être qualifiés de « liens faibles » tant les relations sont réduites à peau de chagrin à cause de cette oppression affective. Ces liens faibles sont signifiés dans l’extrait à travers l’énumération des collègues de Weil et les points de suspension les reliant autour du four. Ce signe de ponctuation renforce l’idée que ces liens sont fragiles et soumis à l’usine et à son écrasement de la pensée. Mais les caractéristiques attribuées à chacun de ces collègues soulignent bien les prémisses d’une capacité d’attention renaissante. Ce sentiment de fraternité ne s’arrête pas à cet extrait, puisque quelques pages plus loin, un autre passage signifie le retour de ces liens faibles :
Je suis épuisée. Avec cela je ne me suis pas rattrapée car j’aurais dû faire les 10.000 pièces (45 F) en 15 h, et j’y ai mis 16 h 3/4. À 5 h 3/4, arrête ma machine dans l’état d’âme morne et sans espoir qui accompagne l’épuisement complet. Cependant il me suffit de me heurter au gars chanteur du four qui a un bon sourire — de rencontrer le magasinier — d’entendre au vestiaire un échange de plaisanteries plus joyeux qu’à l’ordinaire — ce peu de fraternité me met l’âme en joie au point que pendant quelque temps je ne sens plus la fatigue. Mais chez moi, maux de tête… (Weil, [1935] 2002, p. 102)
22Si l’épuisement marque l’ouverture de l’extrait, faisant tomber le couperet sur les possibles, si la nouvelle répétition numérique déracine l’ouvrière-philosophe, la dernière phrase semble bousculer ces dynamiques. L’énumération de rencontres fraternelles renverse encore une fois le tissu social de l’usine, à la différence qu’elle est cette fois marquée par des tirets cadratins, beaucoup plus solides que les points de suspension. Ces relations demeurent des liens faibles mais elles montrent toutefois cette résistance mentionnée par Gefen et Laugier, qui semble s’accroître avec le temps passé dans l’usine. Les liens faibles deviendront peut-être des liens forts, qui pourront pulvériser l’isolement affectif dans lequel plonge l’usine et autoriser le jaillissement de l’attention.
23 Si les liens faibles et les relations avec autrui semblent être une voie de sortie de l’oppression affective de l’usine, il est également possible de la combattre seul, en restant dans le champ de l’affect. Comme nous avons pu le constater avec la fatigue et la colère, qui, même si elles sont finalement les symptômes d’une réification, sont également porteuses d’espoir et de devenirs politiques, le dégoût et l’écœurement recréent du possible et s’opposent à l’abstraction déracinante. Le dégoût est toujours lié à une remise en cause des tâches effectuées par la diariste. Ainsi, elle parle d’un « profond dégoût, qui me fait ralentir » (Weil, [1935] 2002, p. 125) ou « d’un dégoût que je refoule pour aller plus vite » (p. 148). La faisant revenir sur la nature de sa tâche, le dégoût autorise un questionnement et favorise le retour de l’attention, ou comme l’écrit Hannah Freed-Thall :
Il attire notre attention sur les marges, les restes, les anomalies des systèmes de production de valeur. En tant que caractéristique des textes littéraires, le dégoût à une force performative : il nous attire près du texte, demande notre attention, intensifie notre sentiment d’être des individus mortels et incarnés5. (Freed-Thall, 2018, p. 422)
24Répétée par deux fois par Freed-Thall, la capacité d’attention est en effet favorisée par le dégoût, qui est un affect forçant à se rapprocher de son objet – ici, la tâche – et à le questionner. Cette tâche, devenue un non-sujet sous la fiction politique du taylorisme – effacée par l’efficacité, le rendement et les objectifs –, est remise en lumière, ce qui permet à Weil de réfléchir à sa nature réifiante. Dans un autre passage, alors qu’elle est « saisie par le dégoût », Weil se questionne : « On dirait que, par convention, la fatigue n’existe pas… Comme le danger à la guerre, sans doute. » ([1935] 2002, p. 151) La puissance performative du dégoût autorise Weil à remettre en question la normalité de la fatigue, constamment produite par l’usine. La comparaison avec « le danger à la guerre » invoque une image en-dehors de l’usine et de son influence sur la vie quotidienne des ouvriers, ce qui témoigne de l’ouverture des possibles autorisée par cet affect et de sa capacité à engendrer de l’attention. De même, l’écœurement chez Weil a été analysé par Freed-Thall comme un
état paradoxal : c’est à la fois le résultat du travail monotone de l’usine et de l’immobilité qui empêche le sujet de travailler, bloquant son instrumentalisation, suspendant sa subsomption dans le flot régulier de la production6. (Freed-Thall, 2018, p. 432)
25Comme le dégoût, l’écœurement autorise le ralentissement et la pause dans le travail, tout en étant un produit de l’usine. Encore une fois, la relation de co-production entre l’affect et son environnement théorisée par Ahmed se confirme. Je rajouterai à cette explication que l’écœurement est un possible levier communautaire. Si Freed-Thall ne pense pas au texte de Weil lorsqu’elle écrit que l’écœurement « enregistre la vulnérabilité partagée […] qui caractérise la vie dans le présent [registers the shared vulnerability […] that characterize life in the present] » (Freed-Thall, 2018, p. 422), je pense que l’idée est tout à fait applicable au Journal d’usine. Ainsi, une des mentions de l’écœurement par Weil se fait à la suite d’un « manque de sympathie » entre ouvrières après le refus de l’une d’entre elle, une tuberculeuse, d’effectuer un travail ingrat qui est de toute façon donné à une autre :
Pas un mot de sympathie des ouvrières, qui connaissent pourtant cet écœurement devant une besogne où l’on s’épuise en sachant qu’on gagnera 2F ou moins et qu’on sera engueulé pour avoir coulé le bon – écœurement que la maladie doit décupler. (Weil, [1935] 2002, p. 85)
26Si à première vue, l’absence de sympathie ne joue pas en la faveur d’un sentiment de communauté, l’écœurement demeure le dénominateur commun entre toutes les ouvrières, qui selon Weil connaissent toutes ce dernier, connaissance exprimée par le pronom personnel « on ». L’écœurement est la seule raison pour laquelle les ouvrières auraient pu avoir de la sympathie pour la femme tuberculeuse et demeure un possible, une possibilité d’enracinement.
27L’usine, en tant qu’espace social et producteur d’affects, se rapproche d’un espace totalitaire sous la plume de Simone Weil. Imposant des affects qui eux-mêmes entretiennent sa production sous l’égide de la fiction politique qu’est le taylorisme, l’usine déracine, dé-sole les ouvriers et détruit leurs possibles. Alors que la fatigue et la colère les isolent, les enfermant dans leurs tâches réifiantes, l’épuisement les coupe de tout possible, de tout sens de la réalité, comme le symbolisent les répétitions abstraites perceptibles dans la majeure partie de l’œuvre. Par contraste, les liens faibles, qui autorisent un renouvellement de l’attention, ainsi que l’écœurement et le dégoût, qui permettent une prémisse d’enracinement en autorisant Weil à se questionner sur ses tâches et à esquisser un sens de la communauté, semblent bien fragiles. Weil n’a pas supporté son expérience en usine. À cause des conditions de travail et de sa santé fragile, elle n’a pu y rester « que » 150 jours, là où elle voulait pourtant travailler le plus longtemps possible au plus près des ouvriers. Cette sortie prématurée lui a toutefois permis de prendre du recul sur cette expérience et ce Journal d’usine, afin d’écrire les autres essais qui composent en partie La Condition ouvrière. Si cet échec est le privilège d’une déclassée volontaire qui a pu quitter l’usine quand elle l’a souhaité, il a beaucoup marqué le parcours de cette philosophe qui a toujours œuvré pour la « transformation radicale des circonstances », contre ce « malheur [qui] n’est fait que d’impressions » (Weil, [1935] 2002, p. 341).