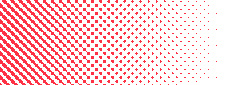Souffrance intime et corps politique : variations sur le thème scatologique dans l’œuvre de Richard Millet
1En 2019, Richard Millet publie un court texte intitulé Étude pour un homme seul dans lequel il relate la liaison entretenue par Pascal Bugeaud, son double littéraire, avec sa femme de ménage, Yelitzeveta, l’année de sa maladie. Comme Millet, Bugeaud souffre alors d’un cancer à cause duquel on lui a retiré un poumon et le côlon, et le récit décrit la renaissance du désir de ce corps souffrant et humilié par les maux de ventre qui le travaillent. L’écrivain livre ici une version dégradée de lui-même, Bugeaud se trouvant contraint de recourir à YouPorn et à la prostitution pour atteindre une jouissance plus que précaire tandis que ses diarrhées incontrôlables le classent définitivement dans « la confrérie des déféquants » (Millet, 2019b, p. 29), sorte de catégorie la plus misérable de l’humanité. Or, Bugeaud prête à cette déchéance physique une valeur symbolique, puisqu’il voit dans son cancer la manifestation physique d’une relégation sociale : la « maladie succédant à mon bannissement du milieu littéraire, ou en étant la conséquence, la réponse de mon corps au scandale suscité en mon nom » (p. 11).
2Ce scandale qu’évoque l’auteur par le biais de la fiction, c’est l’« affaire Millet », dont nous pouvons rappeler les grandes lignes. En 2012, le romancier corrézien, également éditeur chez Gallimard, faisait paraître chez Pierre-Guillaume de Roux un opuscule intitulé Langue fantôme, suivi d’un Éloge littéraire d’Anders Breivik, suscitant la stupeur et l’indignation. Quoique condamnant les actes du tueur norvégien qui avait causé un an plus tôt la mort de 77 personnes à Oslo et sur l’île d’Utøya où étaient réunis de jeunes militants travaillistes, Richard Millet présentait avant tout le terroriste comme une victime de l’effondrement civilisationnel que traverseraient nos sociétés. Perturbé par le divorce de ses parents, et donc par la décomposition de la famille en Occident, confronté à une immigration extra-européenne remettant en question les fondements chrétiens de son identité, Breivik ne devrait pas, selon Millet, être considéré comme un raciste ou un « facho » mais bien plutôt comme une figure « sacrificiel[le] du mal qui ronge nos sociétés » (2012a, p. 115).
3En faisant du bourreau une victime, en vantant la « perfection formelle » de ses attentats (p. 103), mais aussi en validant au passage la plupart des thèses xénophobes développées par Breivik dans son manifeste de mille cinq cents pages, Millet provoquait donc un scandale dont l’apogée fut la publication dans Le Monde d’une tribune rédigée par Annie Ernaux, intitulée « Le pamphlet fasciste de Richard Millet déshonore la littérature » (2012) et signée par une centaine d’écrivains. Quelques jours plus tard, Millet était évincé du comité de lecture de Gallimard, l’écrivain n’ayant plus le droit d’officier en tant qu’éditeur que de chez lui, avant le bannissement définitif en 2016, consécutif à la publication d’un article intitulé « Pourquoi la littérature de langue française est nulle », principalement attaché à tourner en dérision un texte de Maylis de Kerangal, autrice phare de la maison.
Le corps politique de Richard Millet
4Dans un texte de réponse qu’il rédige quelques années après, Millet décrit la tribune d’Annie Ernaux comme une attaque à son « corps lui-même » (Millet, 2016c, p. 68). Pour lui, nulle distinction de l’homme et de l’œuvre, mais au contraire une identification totale de l’écrivain à ses textes. Il est vrai que l’article, qui visait son livre, a signé le début d’un effacement progressif de Millet de l’espace public, au point qu’il est devenu aujourd’hui parfaitement invisible, à l’image de ses œuvres qui ont quasiment disparu des librairies. Le corps de Richard Millet, tel qu’il le perçoit mais aussi tel qu’il le représente, est donc politique, puisqu’il est le réceptacle de débats idéologiques qui le dépassent. L’écrivain en fait un corps de martyr de la démocratie et de ses valeurs « bien-pensantes », qui s’accorde tout à fait à la situation de marginalité et de vulnérabilité dans laquelle il estimait déjà se trouver le 7 février 2012, sur le plateau de Ce soir ou jamais, l’émission de Frédéric Taddéi : « Qu’est-ce que je suis, moi ? Je suis un Français de souche – quelle horreur ! catholique – quelle horreur ! hétérosexuel – quelle horreur ! J’ai tout contre moi ».
5Quoiqu’il eût en réalité « tout pour lui », comme le lui faisait remarquer une intervenante présente sur le plateau, ou qu’il se situât en tout cas par ces caractéristiques dans une majorité dominante aujourd’hui en France, l’écrivain s’inscrivait alors dans une minorité qu’il jugeait menacée par l’immigration et la « théorie du genre ». Il insistait sur le besoin qu’il éprouvait d’exprimer sa « douleur », celle qu’il ressentait en étant « le seul Blanc » sur le quai du RER, à la station Châtelet-Les Halles à six heures du soir, et se disait « hanté par la question de l’identité, non seulement [s]on identité, mais aussi l’identité nationale » (Millet, 2012d, deux premières minutes). Ce dernier glissement, du personnel vers le collectif, relève de nouveau d’une forme d’identification de l’écrivain, non plus à ses textes, mais à tout un territoire, selon un mouvement de projection des sentiments intimes sur le monde alentour. On le voit, chez Millet, les contours du moi sont flottants, et le corps personnel trouve un miroir dans le corps social.
6On retrouve ainsi dans les œuvres de Millet une représentation allégorique de la nation sous la forme d’un corps malade. Le personnage de Louise Bugeaud l’affirme dans Ma vie parmi les ombres (2003) : « le monde entier [est] entré […] dans une longue, une irrémissible maladie » (p. 380). C’est pourquoi elle ne s’étonne pas que des troubles intestinaux affectent sans cesse son petit-fils Pascal ; ce dernier exprime simplement par son corps le mal-être de toute une nation. La mise en scène de l’effondrement de la France, et même de l’Europe entière, se développe tout particulièrement dans l’œuvre polémique de l’écrivain qui prend véritablement son essor à partir de 2005, avec la publication du Dernier écrivain. Ce texte que Millet a écrit en 2000 constitue, plus encore que l’Éloge littéraire d’Anders Breivik, un point de bascule dans la trajectoire de l’auteur. Refusé par Paul Otchakovsky-Laurens, le premier éditeur de Millet avec lequel il avait eu jusqu’alors une relation très privilégiée, le texte introduit les grandes lignes de sa vision politique, qu’il déclinera ensuite à l’envi dans une série d’essais ou d’opuscules (une quinzaine en dix-sept ans). Pour Millet, la France est entrée dans une ère de « décadence » (2005, p. 19)1, d’« effondrement » (2007, p. 45)2, depuis que les valeurs héritées des Lumières – la « gnose des droits de l’homme » (2003b, p. 227)3 – se sont imposées, en particulier l’« égalitarisme » (2012c, p. 17).
7Cette pensée décliniste et anti-Lumières n’a rien d’original : elle s’inspire des discours contre-révolutionnaires de Joseph de Maistre ou de Louis de Bonald, largement réactualisés par l’extrême droite contemporaine. De ces réactionnaires, Millet hérite aussi une vision organiciste, selon laquelle le corps social est comparable à un être vivant dont les différents membres constitueraient les organes. Sous sa plume, la France n’est plus qu’un « grand corps épuisé » (2011, p. 42), un « réel devenu cadavre » (p. 11). Paris aussi apparaît souvent comme un organisme dont les intestins seraient les tunnels souterrains, selon une représentation qui n’est pas sans rappeler la façon dont Céline décrivait New-York dans le Voyage au bout de la nuit. Dans Paris bas-ventre : le RER comme principe évacuateur du peuple français (2021), le réseau express régional devient ainsi « réseau d’évacuation rapide » (p. 70), tandis que le peuple français, mêlé aux populations immigrées, ne fait que transiter à travers la capitale jusqu’à la nausée, réduit à l’état de déjection.
8Car telle est bien la grande maladie qui frappe la France et l’Europe selon l’écrivain : l’immigration extra-européenne, et en particulier l’immigration arabo-musulmane qui conduit au « métissage » (2008, p. 148), à la « créolisation » (p. 87)4, à « l’enfer de l’indifférenciation » (2012c, p. 75). On est proche, ici, de la théorie du « grand remplacement » élaborée par Renaud Camus, rencontré chez P.O.L et qui fut un des rares soutiens publics de Millet lors de « l’affaire », en 2012. Si le RER est un « égout civilisationnel » pour Millet (2015), c’est parce que des Français de toutes origines, et même des non-Français s’y croisent, diluant ce qui fait à ses yeux l’identité française, qu’il pense fondée sur une couleur de peau, une langue et une religion : la religion chrétienne. L’indifférenciation, ce serait aussi le queer, l’abolition des genres, dénoncée notamment dans Français langue morte – autre thème cher à l’extrême droite. Pour Millet, l’humanité s’énonce donc désormais
dans les modalités d’un perpétuel transit intestinal de soi à soi, sous couvert de transe tantrique, d’altruisme de surface, de glisse « gender fluid », ce qui glisse-là n’étant rien d’autre que le même qui s’oublie, une valeur liquide, diarrhée existentielle, dysenterie littéraire et liquidation des « anciennes » valeurs… (2020a, p. 159)
Hantise et éloge de l’excrétion
9On retrouve ici la métaphore intestinale, qui permet de traduire de façon polémique et concrète l’angoisse d’un changement sociétal vécu comme un processus de décomposition, de liquéfaction, de fusion. On peut percevoir, dans le vocabulaire employé, l’influence de la lecture de Zygmunt Bauman et de son concept de « société liquide » (Bauman, 2013), forgé pour qualifier l’extrême flexibilité des individus et le perpétuel mouvement auquel ils sont contraints à l’ère de la mondialisation, de l’ouverture des frontières, mais aussi des réseaux sociaux. Les conclusions que tire Millet sont toutefois bien éloignées des analyses teintées de marxisme de Bauman. C’est pourquoi en le lisant, on pense aussi à la hantise des flux, de la boue, en somme de l’élément liquide qu’exprime Léon Degrelle, fondateur dans les années trente du mouvement fasciste belge Rex, dans son journal de guerre intitulé La Campagne de Russie (1949). Le monde, dans l’imaginaire de Degrelle, se structure selon deux catégories distinctes que Jonathan Littell a mises en lumière dans un essai consacré à l’étude de ce texte : Le Sec et l’Humide (2008).
10Or, cette perception sensible du monde, la crainte d’une liquéfaction des éléments et des corps qui préfigurerait une décomposition sociale et morale, n’a rien de singulier ; il s’agirait même d’un topos de la littérature fasciste, si l’on en croit les analyses de Klaus Theweleit dans son essai Fantasmâlgories, paru en Allemagne en 1977. Ce théoricien de la littérature a consulté de nombreux écrits intimes des soldats des corps francs, ces bataillons civils volontaires qui se forment en Allemagne au lendemain de la Première Guerre mondiale dans le but d’étouffer la révolution socialiste et de favoriser l’accession d’Hitler au pouvoir. Tous décrivent à peu près la même menace : il s’agit de faire face à la marée océanique du bolchévisme ou de la « putain prolétarienne » (Theweleit, [1977-1978] 2016, p. 54) en se forgeant une « cuirasse » (p. 165), une « carapace corporelle endurcie, indissoluble » (Theweleit, 2008, p. 122) capable de garantir l’intégrité physique et morale du soldat. N’est-ce pas cette tentation de fixer son corps dans une identité clairement définie qui conduit Millet à se présenter de façon si rigide comme un écrivain « blanc, mâle, “Français de souche”, catholique, hétérosexuel » (Millet, 2005, p. 28) ?
11Cependant, l’imaginaire corporel de Richard Millet est loin d’être aussi clivé que ceux décrits par Klaus Theweleit ou Jonathan Littell. Par un phénomène de réversibilité, il arrive même souvent que la souffrance, la souillure et la maladie deviennent des gages d’authenticité et de spiritualité, tandis que la santé et le plaisir apparaissent comme les valeurs trompeuses de nos sociétés contemporaines. Ainsi, tout en déplorant l’amollissement des nations occidentales, Millet s’insurge contre les impératifs hygiénistes qu’elles profèrent et qu’il juge héritées de l’Amérique protestante. La promotion des corps standardisés des sportifs ou des acteurs pornographiques va pour lui de pair avec les nouvelles valeurs de santé, d’hédonisme et de transparence qu’il oppose en tous points à la culture catholique sur laquelle s’est fondée la France, cette dernière supposant d’affronter, et non d’évacuer la saleté, le mal et la mort :
Il faudrait également examiner l’influence du sport et, plus largement, de l’hygiénisme contemporain sur la forme même du roman : minceur formelle et maigreur stylistique vont de pair avec l’obésité morale. Quant à la portée intellectuelle, elle est si proche de l’anorexie qu’on est tenté d’y voir le triomphe de ce que l’alibi sportif tentait de faire prendre pour une valeur : l’indigence spirituelle. (Millet, 2010a, p. 169)
12Contre la santé, la transparence, « les langages faméliques » et les « styles anorexiques » (Millet, 2021, p. 66), contre « l’écriture maigrelette, et souvent fautive, des éditions de Minuit et de chez P.O.L. » (2020b, p. 146), à l’opposé de leurs « prosailleurs étiques » ([1992] 1993, p. 158) ou de la simplicité de Patrick Modiano, qu’il dépeint comme un « mélancolique constipé » (2019a, p. 129), Millet fait donc paradoxalement l’éloge de l’obscurité, de la maladie et même de la flatulence, comme dans son essai Le Corps politique de Gérard Depardieu (2014). L’acteur incarne pour lui l’excès, de par son talent, son physique, sa vulgarité, mais aussi de par ses choix politiques, en particulier son exil en Russie, décrit comme un pied-de-nez aux conventions et aux normes. Millet s’enthousiasme devant le pet que « lâche Depardieu à l’establishment », car :
La bouche d’en bas parle avec plus d’éloquence que la vertu sociale-démocrate, ou que les techniciens de surface du culturel. Seul Depardieu est capable de péter en barytonnant, comme dit Rabelais. (2014, p. 91)
13La mise en scène des coliques de l’écrivain dans Étude pour un homme seul participe de cette démarche : explorer la marge, intégrer le « reste de terre », cet Erdenrest dont parlait Freud dans la préface des Rites scatologiques de l’ethnographe américain Jean Grégory Bourke – les déjections, la sexualité que l’homme civilisé a refoulés et qu’il cherche à cacher, tandis qu’ils constituent l’essence de l’humanité (Freud, [1913] 1981, p. 32). Millet n’hésite pas non plus à puiser dans le répertoire des insultes scatologiques, inscrivant certains textes dans une veine pamphlétaire héritée de Céline aussi bien que de Léon Bloy et qui prend le plus souvent pour cibles les journalistes et les écrivains – sa principale victime étant, bien entendu, Annie Ernaux, qu’il a un temps affublée de l’infâmant surnom d’« Anus Ernie » dans ses chroniques de blog parues en ligne de 2014 à 2018, avant d’être retirées par leur auteur (voir notamment Millet, 2016d).
14À l’irruption récurrente des réalités triviales s’ajoute un autre trait stylistique nourrissant cette impression d’excès : c’est l’emploi d’une phrase complexe, fondée sur l’imbrication savante de nombreuses subordonnées, par laquelle Millet entend subvertir les normes de simplicité de l’écriture contemporaine, en particulier l’emploi du présent et de la phrase courte. Cette phrase méandreuse, loin d’être clairement circonscrite, s’écoule, déborde, tout comme sa production logorrhéique : Millet, écrivain graphomane, publie plusieurs livres chaque année. On pourrait presque parler de style scatologique, et d’ailleurs Millet lui-même décrit souvent la création littéraire comme un processus de digestion fondé sur l’ingestion d’une matière réelle ou autobiographique que s’approprie l’écrivain, qu’il rumine au plus profond de lui-même, avant de l’excréter sous forme d’écriture. « [I]l est vrai qu’écrire n’est souvent pas autre chose qu’une forme d’excrétion et l’écrivain un sujet déféquant, selles ou textes, sang, sanies, encre, et même le sperme, trouvant dans l’écriture une transmutation en élixir », écrivait-il récemment dans Étude pour un homme seul (2019b, p. 46).
15Il apparaît donc clairement que l’obsession scatologique dépasse le seul champ de la politique chez Richard Millet pour recouvrir une vision totale du monde et de l’écriture. Les corps souffrants et excrétants qu’il met en scène – ceux de ses doubles, ou de ses ennemis – contribuent certes à véhiculer une pensée réactionnaire, nourrie par les idées de l’extrême droite. Cependant, ils disent aussi un mal-être personnel, une obsession de la mort, qui alimentent ces positions politiques.
La scatologie, thème milletien
16Il faut d’ailleurs constater que la mise en scène de corps souffrants et excrétants, loin d’accompagner la radicalisation du discours politique de Millet au tournant des années 2000, se trouve au cœur de l’œuvre fictionnelle de l’écrivain dès ses débuts, endossant des significations multiples. D’une certaine manière, le premier roman de Millet, L’Invention du corps de saint Marc (1983), n’est pas très éloigné de son Étude pour un homme seul. Il retrace le parcours spirituel d’un jeune homme malade, mourant. Affligé d’une maladie dont on ignore la nature véritable, Marc est parti au Liban rejoindre son amie Marie et son frère, le narrateur. Dès les premières pages, Marc est comme marqué du sceau de l’infamie, car le narrateur se souvient l’avoir rencontré lorsqu’ils étaient en France, Marc se tenant seul, « être chétif et taciturne […], debout près des lieux d’aisance » (1983, p. 12). Le roman fait le récit de ses derniers mois, marqués par une souffrance physique intense. Éprouvant une passion quasi-christique, Marc est parfois pris de nausées, de vomissements ; ses fièvres s’accompagnent de sueurs sanguinolentes et de démangeaisons. Il pleure, gémit et se vide dans un épisode où la diarrhée n’est encore décrite qu’à mots couverts. Un soir de pluie, il s’est installé pour dormir sur la terrasse et le narrateur qui l’a accueilli chez lui à Beyrouth constate que Marc ne fait « rien pour dissimuler les immondices qui coulaient le long de ses jambes » (p. 66). Deux ans plus tard, Duparc, le personnage principal de L’Innocence (1984), agonise lui aussi au milieu des livres qu’il a passé des années à rassembler. Il finit par ne garder « à peu près rien de ce qu’il mangeait », « se soulag[eant] n’importe où dans l’entrepôt » qui se trouve rempli de « petits tas d’excréments liquides et sanguinolents » (p. 131). Quant au narrateur de La Chambre d’ivoire ([1989] 2001), il semble souffrir de dépression et doit « apaiser [s]es entrailles qui [l]e faisaient souffrir » (p. 151) au point de le contraindre à pénétrer à Barcelone dans des latrines souterraines.
17Dans ces premiers récits, la douleur qu’éprouvent les personnages jusque dans leurs entrailles renvoie d’abord à une difficulté à être au monde qui semble être celle du jeune Millet lui-même. Le titre de son premier roman, qui détourne celui d’un célèbre tableau du Tintoret, La Découverte du corps de saint Marc, invite d’ailleurs le lecteur à prendre le mot « invention » au sens religieux de « découverte ». Millet propose dans ce texte inaugural et les suivants de révéler au lecteur son corps littéraire, image de son propre corps, mais aussi réceptacle de son imagination et de sa vision du monde, dans une sorte de confusion du réel et de la fiction qui présidera à son existence, Millet se lamentant souvent dans son journal de n’avoir su vivre qu’à travers la littérature, et non véritablement. Les maux de ventre dont souffrent Marc et le narrateur de La Chambre d’ivoire s’inspirent de ceux de Millet lui-même, qui se dit affligé de coliques depuis l’enfance, évoquant les longues heures passées à lire aux cabinets, mais aussi les verrues qui recouvraient sa main gauche (2004, p. 143), et donc les humiliations et les angoisses liées à ce corps malade. Ils rendent aussi palpables les angoisses de la dépression, celle que Millet nomme justement « [s]a maladie » (2018a, p. 16-17 ou 65), et qui l’a conduit en 1978, mais aussi en 1989, à faire plusieurs tentatives de suicide.
18Dans La Gloire des Pythre (1995), premier grand roman du cycle corrézien, l’exhibition du corps déféquant prend des accents beaucoup plus métaphysiques. Le thème scatologique y acquiert une importance de premier plan, notamment à travers la description des rituels défécatoires d’André Pythre, qui impose à ses trois enfants de passer chaque matin après lui dans la cabane qu’il a installée dans le champ. Quant aux scènes d’agonie, elles sont toutes étroitement liées aux fonctions basses : Aimée, la compagne d’André, s’éteint d’abord dans une « exsudation totale d’elle-même » (p. 122). Puis, André et son fils Médée meurent accidentellement alors qu’ils étaient en train d’uriner, le premier succombant à une ruade de vache, le deuxième finissant sous les décombres d’un mur effondré. La dernière partie du livre est consacrée au dernier des enfants d’André Pythre, Jean, un idiot qui souffre à la fin de sa vie de diarrhées terribles. Il meurt dans un taxi qui l’emmenait à l’hôpital et on l’enterre avec son pantalon souillé. Sa tombe, carrée, rappelle le carré où il faisait ses besoins, sur le côté de l’église, mais aussi la forme d’une fosse d’aisance qu’il avait vidée.
19La souffrance corporelle continue dans ce texte d’être une expérience de l’humiliation, elle confirme notamment le mal-être lié au manque d’amour du père, dont Millet dira toute la dureté dans plusieurs textes autobiographiques, le décrivant comme un maître de musique intransigeant dans Musique secrète, toujours prêt à rabaisser ses fils, corrigeant sans cesse leurs fautes de langue et recourant souvent au martinet dans La Forteresse (2022), un « père monstrueux » comparable aux « divinités ténébreuses, Mars, Hadès, Barbe-Bleue, Dracula, [aux] scélérats de Sade » (Millet, 2010c, p. 135 et 26). Cependant, l’excrétion devient aussi une expérience métaphysique, un rappel de notre essence misérable et de notre finitude : elle apparaît comme une répétition de la mort.
20C’est avec Lauve le pur, en 2000, que le corps littéraire de Richard Millet devient véritablement un corps politique. Dans l’incipit de ce roman, Thomas Lauve, un jeune homme de vingt-six ans sort d’un restaurant parisien et se trouve pris de terribles maux de ventre. Il se vide de ses intestins dans une rame de R.E.R. qu’il est contraint de quitter. Il entreprend alors de parcourir à pied le chemin qui le mènera des Halles à Nogent-sur-Marne où il réside. Fabrice Thumerel a montré la portée symbolique de l’itinéraire décrit par Millet dans les cinquante premières pages de son roman. Parti du jardin du Luxembourg, près duquel il a dîné et qui servit de prison sous la Révolution, il passe ensuite devant le petit Eros doré de la colonne de Juillet, sur la place de la Bastille, dans lequel le critique voit l’emblème « d’un monde postrévolutionnaire dominé par un plaisir indécent » (Thumerel, 2010, p. 54), pour arriver au donjon de Vincennes où fut « jugé et fusillé le duc d’Enghien, une nuit de mars, à trois heures, dans les fossés » (Millet, 2000, p. 48), et pour lequel Thomas Lauve éprouve une « vive pitié » (p. 48).
21Ces références appuyées à la Révolution française et aux Lumières contribuent à ancrer la souffrance physique et morale de Thomas Lauve dans des racines toutes politiques. Certes, Lauve est présenté d’emblée comme un jeune homme hanté par l’abandon de sa mère, partie lorsqu’il était encore enfant, et jamais revue. Il a quitté la Corrèze pour s’installer en tant que professeur de français dans la région parisienne, et erre sans but dans les rues de Paris dans l’espoir de la recroiser un jour par hasard. Cette souffrance psychologique ne suffit pas, toutefois, à justifier le véritable chemin de croix que Lauve effectue au début du roman, ni les autres scènes d’humiliation scatologique qui viendront ponctuer le roman. Le corps de Lauve est aussi celui du Corrézien incapable de s’adapter à une vie parisienne marquée par la décadence et, plus encore, le corps du professeur de banlieue confronté dans son collège, et dans les transports en commun, à une jeunesse immigrée qu’il ne comprend pas. Il est un corps allégorique, politique, qui vit dans sa chair ce que Millet perçoit comme une décomposition identitaire et sociale de la France, et qu’il décrira par la suite dans ses essais.
22Tout se passe comme si la souffrance intime, une fois passée par le filtre de la littérature et des doubles successifs qu’elle offre à l’écrivain, trouvait des correspondances dans l’univers tout entier dans lequel elle se projetait. C’est par la représentation répétée des corps déféquants que l’idéologie réactionnaire de Richard Millet peut apparaître finalement comme une variation sur le thème de la souffrance physique et morale. Car la scatologie est bien un thème, au sens où l’entend la critique thématique :
un signifié individuel, implicite et concret ; il exprime la relation affective d’un sujet au monde sensible ; il se manifeste dans les textes par une récurrence assortie de variations ; il s’associe à d’autres thèmes pour structurer l’économie sémantique et formelle d’une œuvre. (Collot, 1988, p. 81)
23Le thème, pris dans cette acception, permet de reconstituer le « paysage » intérieur de l’écrivain, révélant ses goûts et ses dégoûts, mais aussi son rapport au monde. Il rend visible « l’ensemble des choix existentiels d’un écrivain mais aussi ses options idéologiques, esthétiques, stylistiques » (p. 84). Il permet ainsi de comprendre que les idées politiques de Richard Millet, mais aussi son statut littéraire et social, sont en lien direct avec certains épisodes biographiques, en particulier les conflits avec le père, le voyage au Liban ou encore l’expérience de la dépression. Dans cette perspective, il convient aussi, et peut-être surtout, de rattacher la vision politique de Richard Millet d’une pensée religieuse imprégnée de mystique et d’une mythologie littéraire héritée de Maurice Blanchot reposant sur l’effacement, la disparition de l’écrivain.
Abaissement mystique et fantasme d’effacement
24Les souffrances des corps humiliés de Pascal Bugeaud, de Marc Fournier, de Jean Pythre ou de Thomas Lauve ont toutes une dimension sacrificielle, pour ne pas dire christique, que l’on retrouve dans l’itinéraire spirituel décrit par Millet dans L’Orient désert (2007), récit d’un voyage au Liban et en Syrie fortement imprégné de théologie négative, des mystiques rhénans ou arabes, que Millet cite abondamment. Dans ce texte, la souillure devient le signe d’une plus grande pureté, la maladie apparaît comme une expérience plus authentique de la vie, et l’abaissement le plus sûr chemin vers l’élévation spirituelle. L’écrivain martèle qu’il faut faire jouer « [l]a propreté contre la pureté : l’hygiène, la transparence, l’absence de secret » ([2007] 2009, p. 209) contre l’expérience de la déréliction physique, de l’obscurité et du mystère. L’accès à Dieu suppose donc d’« accepter d’être malade contre l’hygiénisme » (2018b, p. 74). Le texte est traversé de fusées gnostiques, comme lorsque l’écrivain observe une boule de savon d’Alep laissée dans sa douche, qu’il prend d’abord pour un étron, et note : « pense que tu es à peu près semblable à ça » ([2007] 2009, p. 202).
25S’il envisage l’humanité comme un tas d’excrément, Millet propose toutefois dans ce livre un itinéraire plus proche de la mystique. Traversant les vestiges des premiers siècles du catholicisme en Syrie, en particulier à travers les « villes mortes », situées au nord d’Alep, où se trouvent le monastère de saint Siméon et la basilique de Qalb Lozé, il relate une « expérience intérieure », au sens où l’entendait Bataille, fondée sur le dénuement : nudité, saleté, abstinence sexuelle, jeûne, dérèglements digestifs. À la fin de son périple, Millet tombe malade et son ventre « se vide dans la douleur et dans la joie » (p. 181). L’auteur se livre alors à un éloge paradoxal de « la diarrhée en pays lointain », qui semble pouvoir conduire à l’extase :
Le mal de ventre, l’écoulement, l’humiliant accroupissement, le sordide, la détresse, tout ça nous rapproche de Dieu. Sans trop jouer sur les mots, on pourrait dire que le relâchement fait partie d’une méthode : violence de l’humiliation comme condition d’un prélude à l’extase, l’extase étant cela même qui, me détachant de la possibilité de l’union avec Dieu, me laisse la fruition d’un espoir infiniment déçu. (p. 183)
26L’excrétion, en ce qu’elle est évidement de soi, apparaît bien comme un chemin vers l’extase, qui permet de « sortir de soi » pour aller vers Dieu.
27Cette vision paradoxale, selon laquelle c’est par l’abaissement que l’on s’élève vers Dieu, Millet l’hérite certes de Bataille, mais plus encore peut-être de Simone Weil, pour laquelle il a de nombreuses fois témoigné son admiration. Comme l’a montré Christine Hof, la philosophe accordait une attention toute particulière à l’épître de saint Paul aux Philippiens, dans lequel l’apôtre suggère d’imiter l’abaissement de Jésus qui a accepté de mourir comme un homme, et même comme un esclave sur la croix, en nous rabaissant à notre tour, en endurant des souffrances physiques pour mieux nous élever vers Dieu. C’est le concept de kénose, terme dérivant du verbe grec kénoô, employé par saint Paul dans cette épître, et qui signifie « se vider, se dépouiller de soi-même ». Il permet de mieux comprendre la place de l’excrémentiel chez Richard Millet, élément réversible, paradoxal en ce qu’il peut apparaître tantôt comme un symbole d’humiliation, le signe d’un avilissement ou d’une décomposition, tantôt comme une marque distinctive, voire un gage de sainteté.
28Ainsi, l’on peut trouver dans Le Sommeil des objets (2016), sorte d’inventaire pongien d’objets voués au rebut, l’évocation d’une scène de RER dans laquelle Millet raconte avoir vu un musicien rom s’accroupir au bout du quai pour déféquer, laissant un étron dont l’écrivain décrit la lente décomposition dans des fragments successifs intitulés « Immondices ». Or, loin d’aboutir à son habituelle critique de l’immigration, l’écrivain voit cette fois-ci dans l’excrément une mise en abîme de la condition de l’immigré, lui-même réduit au statut de déchet, et par cela digne de pitié. L’étron devient alors « rebut du rebut » (2016b, p. 19), mais aussi image de la « misère de notre condition, que nous prétendons la plus haute de la Création, et par quoi nous serons néanmoins sauvés, pour peu que nous ayons le cœur pur » (p. 18). L’imaginaire mystique vient donc à la fois alimenter et complexifier le discours politique.
29Par ailleurs, cette mystique négative se trouve renforcée par une sorte de mythologie romantique de l’artiste solitaire, vivant en marge de la société, et dont le silence révèlerait l’authenticité. Richard Millet se dit fasciné par ces artistes qui se sont retirés de la vie publique ou qui se sont tus, abandonnant subitement la création. Rimbaud en est le premier modèle, bien sûr, mais Millet est aussi très marqué par la figure de Sibelius, compositeur finlandais auquel il a consacré un essai et qui a cessé d’écrire de la musique trente ans avant sa mort, laissant sa huitième symphonie inachevée. Plus encore, ce sont les modèles de Maurice Blanchot ou de Louis-René des Forêts qui l’ont influencé. Aussi Millet se méfie-t-il du carriérisme et de la réussite, qui ne peuvent couronner selon lui que « la fausse monnaie », les écrivains à succès étant voués à jouer le jeu du « Spectacle », de la médiatisation et de la standardisation. De par ses origines, Millet s’est toujours senti et voulu en marge : né en Corrèze, ayant passé plusieurs années à Toulouse, puis au Liban, il apparaît, à son arrivée au lycée de Vincennes, comme un Français en marge, parlant une langue teintée d’intonations et d’expressions qui le distingue des autres Parisiens. Après son premier mariage, il s’est installé à Nogent-sur-Marne où il vit depuis plus de quarante ans et se met toujours en scène comme provincial ou banlieusard. Revendiquant une langue riche et complexe, baroque, aux antipodes des voix blanches et des phrases courtes de nombre de ses contemporains, il brandit la scatologie comme une matière tirée de ses origines rurales, mais aussi comme une subversion bien plus sûre que le trash pornographique de Houellebecq ou Despentes.
30Dans cette perspective, la mise au ban de l’écrivain était nécessaire, peut-être même voulue, tant Millet semble avoir élaboré, au fil des ans, une véritable stratégie de l’échec. La relecture du programmatique incipit de L’Innocence (1984) est à ce titre édifiante : « Je finirai sans doute dans l’opprobre » (p. 9), écrivait-il déjà en 1984 ! Aujourd’hui, rejeté du monde littéraire parisien, diminué physiquement par son cancer, Millet est tombé dans l’abjection et a en quelque sorte accédé au statut de rebut, de déchet, dans une ultime identification à l’excrément. Admirateur de Léon Bloy, il est devenu un véritable « scatologue » (Bloy, [1893] 1999, p. 66) : « INVENDABLE à perpétuité, l’Invendable, dans tes livres aussi bien que dans ta personne » (Bloy, [1909] 1999, p. 536). Il a publié ses derniers textes politiques à la Nouvelle Librairie, et son autobiographie La Forteresse chez Les Provinciales, deux éditeurs marqués à l’extrême droite, bénéficiant d’une faible diffusion et d’une médiatisation inexistante. L’esthétique littéraire s’est muée en un style de vie (Macé, 2016) fondé sur le paradoxe : c’est en exhibant des corps souffrants que l’écrivain provoque sa propre disparition, c’est en disparaissant du monde littéraire que l’artiste peut advenir, c’est en devenant paria qu’il s’élève, c’est par le silence que la singularité de sa voix peut se faire entendre.
31À ce titre, Nada, l’héroïne du court récit fantastique Le Sommeil sur les cendres qui se veut une réécriture de la célèbre nouvelle « Le Tour d’écrou » d’Henry James, apparaît comme un double bien plus significatif que Pascal Bugeaud lui-même. Cette jeune femme à l’existence si fantomatique que l’on pourrait se demander si elle existe vraiment, est une Libanaise venue se réfugier en Corrèze avec ses neveux pendant la guerre d’août 2006. Nada, dont le nom renvoie au « rien », en espagnol, pousse des hurlements silencieux, passe ses après-midis à dormir et reporte sans cesse son projet de se rendre au village voisin. Seuls ses maux de ventre lui donnent corps, la contraignant à s’accroupir dans le jardin du domaine ou même à vomir, et l’amenant toujours plus à se vider de son être. À la fin du récit, elle voit les enfants qui l’entouraient disparaître à leur tour, puisqu’ils sont emportés dans des draps blancs, sans que l’on sache si cette vision ne renvoie pas à une mort antérieure, qui serait survenue au Liban, ou s’ils ont été tués par la mystérieuse gouvernante de la maison, Mme Razel. Dans les dernières lignes, Nada se désintègre pour n’être plus qu’une voix perdue dans
ce qu’on ne saurait entendre vraiment mais que la littérature, dit-on, exorcise, et qui m’avait toujours rendue si sensible, en les lisant, à la voix des écrivains, laquelle ouvre en moi un abîme où je ne cesse de choir, devenue non pas tant un personnage que la dimension spectrale de cette voix qui n’est, après tout, qu’une excroissance de l’écrit, ou quelque chose de plus monstrueux, encore, une existence entre les lignes, l’enfer de la marge, ou des métaphores, ou des interprétations réductrices, et désormais seule à mener cette existence-là, dans les siècles des siècles […] définitivement seule et condamnée à errer dans ce qui est à présent et pour l’éternité une langue morte. (Millet, 2010b, p. 155)
32Tel serait donc le destin de l’auteur : s’effacer dans les marges de son texte, n’être plus qu’une voix inaudible se perdant dans un état de la langue française qui semble voué à disparaître, la marge étant présentée comme un « enfer », mais l’enfer seul menant pour Millet à l’espoir d’une rédemption.
33La mise en scène de corps souffrants traduit donc bien la volonté de Millet de dénoncer un ordre social et moral qu’il juge perverti, à la fois par la propagation de la culture populaire américaine, nourrie d’éthique protestante, et par l’immigration arabo-musulmane. Si les doubles de Millet sont pris de crises de diarrhée, c’est qu’ils éprouvent jusque dans leur chair ce que l’écrivain perçoit comme la décomposition de la nation française. Ces corps politiques ont une fonction polémique en ce qu’ils sont chargés de véhiculer un discours identitaire et décliniste. Cependant, ils endossent bien d’autres symboliques et sont le réceptacle de toutes les obsessions de l’écrivain ; plus que des allégories, on peut considérer qu’ils constituent un thème central dans l’œuvre de Millet, au sens fort que lui donne la critique thématique.
34Aussi la pensée politique de l’écrivain corrézien n’est-elle pas nourrie exclusivement de lectures anti-révolutionnaires, anti-modernes ou, plus récemment, des représentants de la Nouvelle Droite ou de l’extrême droite. Elle tire d’abord ses origines d’une souffrance intime liée à la violence du père et à l’expérience du déracinement qui ont nourri tout à la fois un sentiment de marginalité et une profonde angoisse existentielle. Puis, elle découle d’une vision religieuse imprégnée de gnosticisme et surtout de mystique dans laquelle la maladie, la souffrance, l’abaissement sont non seulement intrinsèques à l’homme, mais constituent aussi une voie privilégiée vers la rédemption tant souhaitée. La pourriture est dénoncée, mais elle est aussi recherchée en tant qu’expérience de vérité. La liquéfaction des corps est redoutée, mais elle est aussi la voie la plus sûre vers l’effacement, la disparition de l’écrivain, qui permet à l’œuvre d’advenir.