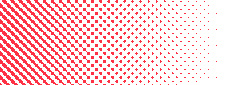L’après-guerre comme terrain d’exploration des rapports entre souffrance et politique dans Le Nazi et le Barbier (1971) d’Edgar Hilsenrath et Les Exclus (1980) d’Elfriede Jelinek
1Le personnage de Madame Holle, dans Le Nazi et le Barbier (19711) d’Edgar Hilsenrath, comme le personnage d’Otto Witkowski dans Les Exclus (1980) d’Elfriede Jelinek, sortent de la période nazie avec une jambe amputée. Pour ces deux personnages, la perte de leur jambe et de leur intégrité physique est une image de l’état politique de leur pays : pour Madame Holle, femme d’un SS tué par les partisans, dont la gangrène a attaqué la jambe le jour de l’arrivée au pouvoir d’Hitler, ce sont « les juifs qui [lui] ont jeté un sort2 » (Hilsenrath, [1971] 2018, p 102 ; ouvrage désormais abrégé NB). Pour Otto Witkowki, ancien SS autrichien, sa jambe amputée est le reflet des « mesquines limites assignées à l’Allemagne3 » (Jelinek, [1980] 2008, p. 239 ; ouvrage désormais abrégé E) d’après-guerre. Ces personnages, dans une conception pseudo-biologique de la société divisée entre pur et impur portée par l’idéologie nationale-socialiste, font de leur corps souffrant un corps politique. Ce raccourci vitaliste et raciste est l’objet d’une critique dans les deux œuvres : le comique lié à la coïncidence de l’apparition de la gangrène le jour de l’arrivée au pouvoir d’Hitler produit une satire de l’antisémitisme forcené du personnage de Madame Holle dans Le Nazi et le Barbier. Dans Les Exclus, l’évacuation de la responsabilité d’Otto Witkowski du fait de son amputation expose une société autrichienne d’après-guerre dont la dénazification n’est qu’affichée. Ces deux personnages amputés permettent d’emblée d’apercevoir l’ambivalence du sens politique de la souffrance du corps dans ces textes, notamment de la souffrance des bourreaux.
2Le Nazi et le Barbier est un roman écrit par Edgar Hilsenrath, juif allemand né à Leipzig en 1926 et qui a passé son enfance à Halle. La famille d’Hilsenrath fuit l’Allemagne en 1938 pour se réfugier en Roumanie. En 1941, Hilsenrath et sa famille sont chassées et enfermées dans un ghetto d’Ukraine. Survivant du ghetto, il émigre à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Palestine mandataire, puis à Lyon, où une partie de sa famille a trouvé refuge, et enfin à New York en 1951. L’histoire éditoriale du roman est significative de la difficulté que le texte a suscitée en Allemagne de l’Ouest : le roman est écrit en allemand, mais il sera d’abord publié en traduction anglaise en 1971 (The Nazi and the Barber. A Tale of Vengeance). Ce n’est qu’en 1977 – après avoir été entre autres publié en traduction française (Le Nazi et le Barbier, 1974) – qu’il est enfin publié en Allemagne, chez un petit éditeur à Cologne sous le titre Der Nazi und der Friseur, après avoir essuyé plus de soixante refus de la part de maisons d’édition allemandes4. La difficulté que ce texte a suscitée s’explique par le ton grotesque du roman mais aussi par l’inversion de la forme privilégiée du récit sur la Shoah, du « témoignage du témoin [testimony of the witness] » (McGlothlin, 2017, p. 226, ma trad. et idem ensuite) : le roman est constitué du témoignage fictif d’un ancien SS usurpant après la guerre l’identité de son ami juif Itzig Finkelstein qu’il a lui-même tué dans le camp d’extermination fictif de Laubwalde, avant d’immigrer en Palestine mandataire sous cette fausse identité. Le motif choquant de la métamorphose obscène du bourreau en victime est renforcé par le registre grotesque duquel est empreint le roman, dans un récit fait de nombreuses péripéties romanesques qui couvrent les dernières années de la République de Weimar, l’arrivée au pouvoir d’Hitler, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah et les premières années de l’État juif.
3L’importance de la souffrance, notamment enfantine, dans la trajectoire du personnage principal, pose également problème dans une double perspective. D’une part, la description de la souffrance semble prise dans une rhétorique de l’excuse qui entre en résonance avec les stratégies de défense mises en œuvre par les inculpés nazis dans les procès d’après-guerre. D’autre part, le récit de la souffrance du bourreau est faite à la victime dans une perspective d’autojustification. L’exposition des tourments d’un bourreau interroge ainsi les limites discursives élaborées dans l’après-guerre autour de la Shoah, ce qu’Erin McGlothlin appelle une « rhétorique des limites [rhetoric of limits] » (McGlothlin, 2007, p. 226) construisant la Shoah comme objet marqué par l’indicible et l’ineffable5. Hilsenrath pousse cette rhétorique des limites du dicible jusqu’à son extrémité : Mira, survivante de la Shoah, est marquée par un mutisme clinique. À sa place et à la place d’Itzig, c’est leur bourreau, Max Schulz, qui fait le récit de ses propres souffrances, depuis les violences infligées par son beau-père dans l’enfance jusqu’aux souffrances endurées pour échapper à l’Armée rouge dans la forêt polonaise.
4Les Exclus (Die Ausgesperrten) est un roman d’Elfriede Jelinek, écrivaine autrichienne connue pour ses positions antifascistes et féministes. Dans Les Exclus, paru en 1980 et dont l’histoire se situe au début des années cinquante à Vienne, l’amnésie volontaire du rôle de l’Autriche sous la période nazie est placée au centre névralgique du roman qui fait la description d’une société d’après-guerre où « criminels innocentés et victimes coupables continuent de sévir » (Hoffmann, 2005, p. 98). C’est, entre autres, Les Exclus et sa description acerbe de la société autrichienne d’après-guerre qui vaudra à Elfriede Jelinek la réputation durable de « souilleuse de nid [Nestbeschmutzerin] »6. Ce roman, dont le point de départ est un fait divers (le triple meurtre des membres de sa famille par un adolescent de la petite bourgeoisie viennoise) est le récit d’une bande de jeunes viennois s’essayant à la violence comme seule possibilité d’« acte gratuit », fruit d’un cocktail idéologique et politique fait de capitalisme et d’existentialisme. Il constitue une tentative de généalogie politique7 de la violence, dans une République d’Autriche qui tente de camoufler les continuités avec la période nationale-socialiste, pourtant bien visibles dans le personnel politique notamment. L’amnésie autour de la responsabilité de l’Autriche et l’absence d’un processus de dénazification produisent la transmission à la génération suivante d’une souffrance et d’une violence inintelligibles, qui se cristallisent dans le triple meurtre que commet Rainer à la fin du roman. Dans ce texte, nous nous intéresserons à la souffrance de ces personnages d’apprentis bourreaux et au lien tissé par la voix narratoriale entre une souffrance générationnelle tue et sa conversion en violence gratuite et apolitique. La violence inouïe de la période de guerre est en effet passée sous silence et incarnée par le personnage du père, ancien SS, tortionnaire reconduisant dans l’espace privé après la guerre une violence institutionnalisée pendant celle-ci.
5Dans Les Exclus et Le Nazi et le Barbier, les personnages qui souffrent sont souvent des personnages de bourreaux, ou des personnages de victimes aveugles aux causes de leur souffrance. Dans les deux cas, il y a une perturbation de l’empathie habituellement associée à la souffrance. La souffrance corporelle est ainsi au centre d’un spectre d’interrogations : comment comprendre le jeu de miroir entre volubilité des bourreaux8 et silence des victimes ? La conversion presque systématique de la souffrance en violence conduit-elle à une interchangeabilité des bourreaux et des victimes ? Ou bien la mise à distance parodique ou ironique de la souffrance, dans le contexte d’après-guerre commun à ces deux textes, constitue-t-elle des tentatives d’historicisation et de politisation de la souffrance des corps ?
6Dans ces textes où tous les personnages souffrent, apparaît en premier lieu un règne de la souffrance, vidé de signification politique ou historique, dans une forme de relativisme des rôles et des situations. On verra ensuite que ces romans procèdent à une contextualisation de la souffrance par la parodie de discours audibles dans l’après-guerre. C’est enfin en traitant de marques plus ténues de la souffrance que sont les symptômes que ces textes réinsèrent de manière différente la souffrance dans des réseaux de sens à la fois historiques et politiques.
Le règne de la souffrance dans Le Nazi et le Barbier et Les Exclus
7Dans les dernières pages du Nazi et le Barbier, Max Schulz, établi en Israël sous l’identité de sa victime Itzig Finkelstein, cherche désespérément à être jugé par le juge juif allemand à la retraite Wolfgang La Schüsstiss pour les crimes contre l’humanité commis lorsqu’il était SS. Cette perspective testimoniale fait apparaître la question de l’autojustification : en faisant le récit de sa propre vie, Max Schulz pose la question de la part de responsabilité qu’il a eue dans son destin de « génocidaire » (NB, p. 12). Le récit de ses souffrances semble ainsi avoir pour but d’expliquer la trajectoire du personnage « moi, Max Schulz, sept semaines tout juste, futur massacreur mais pour l’heure innocent9 » (NB, p. 24). À la fin des Exclus, la perspective est inversée, le roman se termine par une chute spectaculaire que le lecteur ne peut pas anticiper : Rainer massacre dans les dernières pages du roman sa sœur, son père et sa mère. Il est ensuite interrogé par la police. La dernière phrase du roman constitue l’aveu de culpabilité de Rainer, mais aussi une invitation à la relecture du roman comme clé d’explication du crime : « Maintenant vous savez tout et pouvez donc disposer de moi10. » (NB, p. 416). Si les perspectives narratives sont différentes, un des points communs majeurs de ces œuvres est d’exposer la souffrance des protagonistes, et notamment la souffrance corporelle représentée comme moteur de leurs actions violentes, en posant la question de sa valeur : la souffrance corporelle est-elle un moyen d’expliquer la violence des bourreaux ?
8L’importance donnée dans Le Nazi et le Barbier à la description de la maltraitance dont est victime le protagoniste Max Schulz, même représentée grotesquement, est une source de vives interrogations au sein de la littérature critique sur Hilsenrath. Les souffrances de l’enfant Max Schulz sont en effet parfois présentées comme une explication de sa violence ultérieure, de son devenir « génocidaire ». Le viol subi par le bébé de sept semaines (NB, p. 18) a une dimension hyperbolique et symbolique :
Moi, Max Schulz, futur massacreur mais pour l’instant innocent, je poussai un cri déchirant, me cabrai, m’agrippai à la laine de bois du fauteuil éventré, relevai ma petite tête devenue toute rouge, pissai une nouvelle fois sans faire exprès, voulus aussi péter. Impossible, orifice obstrué. Je fus pris de convulsions, entendis chanter les petits anges, entendis leurs alléluias, vis voler des harpes et des flûtes de pan, vis des gammes de petites croches montantes, toutes sortes de clés, la clé de sol et d’autres, vis la grande clé en fer de mon ancêtre Hagen le porteur de clé, l’entendis grincer et crisser, aperçus son entrejambe, entendis ricaner, chuchoter, vis toute la gamme des péchés et de la débauche, mais pas le moindre petit ange en vue, plus de harpe ni de flûte de pan, j’entendis le bon Dieu éclater de rire, je voulus encore prier… mais c’était trop tard.
Je sais ce que vous allez dire : Max Schulz a un grain ! Un cauchemar ! Voilà tout !
Mais pourquoi dites-vous ça ? Le bon Dieu n’a-t-il pas inventé l’innocence pour qu’elle se fasse piétiner, écraser ici-bas… sur cette terre ? Les faibles désarmés ne se font-ils pas bousculer par les forts ? Matraquer, humilier, enculer ? Voire à certaines époques exterminer ? Vrai ou faux ? et si c’est vrai… pourquoi dites-vous que c’est Max Schulz qui a un grain11 ? (NB, p. 24-25)
9Le grain est convoqué à de nombreuses reprises ensuite pour expliquer le comportement de Max Schulz et cette scène de viol souligne la réversibilité de tout un imaginaire lié à la civilisation allemande - la clé de sol de la musique se transformant en clé en fer du personnage sanguinaire des légendes germaniques. La culture, en particulier ici la religion et la musique, est écartée au profit d’une anthropologie du mal, sous le regard amusé d’un Dieu mauvais. Le dernier paragraphe théorise cette loi du plus fort camouflée derrière un voile de civilisation. La déclinaison des souffrances que les « faibles désarmés » doivent subir est corporelle, d’où la description grotesque du viol de l’enfant comme scène initiale du mal qui se réverbère dans la suite du roman, annoncée dans la répétition obsessionnelle de l’identité du narrateur » futur massacreur mais pour l’instant innocent12 » (NB, p. 24). La pulsion de vengeance habite ensuite l’enfant qui veut retourner la souffrance contre celui qui l’exerce :
Je rêvais aussi de la canne jaune et de la canne noire, je les voyais toutes les deux dans mes mains. Dans ces rêves je ne voyais pas Slavitzki, mais je l’entendais hurler13 (NB, p. 34).
10Cette volonté de faire souffrir en retour se détache de la figure de Slavitzki et prend une dimension aveugle, notamment lorsque, quelques années plus tard, Max Schulz est devenu apprenti coiffeur :
Pour ma part, le métier de coiffeur m’avait toujours intéressé. Après tout, qu’y a-t-il de plus noble que le crâne d’un homme ? Et n’est-il pas jouissif de façonner cette belle chose, de lui donner une forme, de l’embellir ? Justement parce qu’on sent qu’il serait tout aussi jouissif de l’écrabouiller ? On la tient. Entre les mains. Alors parfois ça vous démange… bizarrement, vous savez. Voilà une tête ! À la merci de vos mains14 ! (NB, p. 39-40).
11On retrouve ici la parodie de l’idéal humaniste d’une tête bien faite, dans une première littéralisation d’ordre esthétique, mais c’est surtout l’idée de la formation et de la culture comme obstacles à la férocité qui est fragilisée. De même que les anges et les notes de musique, l’éducation, la culture, le polissage spirituel ou physique ne semblent être que l’envers d’une volonté d’être en position d’ « écrabouiller » l’autre. La souffrance du corps de l’enfant se métamorphose en une pulsion de faire mal qui tire elle aussi son origine du corps : le terme « démanger [jucken] » marque bien la dimension physique, en deçà de la rationalité de ce retournement de la souffrance physique en pulsion destructrice.
12C’est cette représentation de la souffrance dans Le Nazi et le Barbier qui pousse Cilliers van den Berg à mobiliser la notion de traumatisme dans son analyse du roman :
La question est de savoir s’il est question ici de la représentation d’un traumatisme historique, concret, ou si une telle manipulation de la représentation du traumatisme ne doit pas plutôt être comprise comme un moyen heuristique pour représenter sa dimension ontologique15 (van den Berg, 2011, p. 15 ; je traduis).
13Pour van den Berg, le traumatisme historique de l’avènement du nazisme semble être un moyen de représenter un traumatisme « ontologique », dans une lecture psychanalytique du roman mais également dans une forme de relativisation de l’événement en question, dont l’historicité passe au deuxième plan. Le fait que le traumatisme représenté soit celui du bourreau fait entrer la souffrance dans une forme d’incertitude : le traumatisme, habituellement associé à une figure de victime est ici le lieu d’un doute pour la personne qui lit puisque la souffrance subie est retournée en violence dans le devenir-bourreau du personnage. L’empathie face à la souffrance enfantine, même représentée de façon grotesque, relativise-t-elle la culpabilité du « génocidaire » et de l’usurpateur Max Schulz ? L’image récurrente du bâton sans mains avec lequel on est frappé puis on frappe aveuglément vide la souffrance et la violence de toute signification politique et idéologique, rendant difficile l’établissement d’une responsabilité.
14On retrouve ce même mouvement de balancier dans Les Exclus. Anna et Rainer, les jumeaux d’Otto Witkowski (ancien SS qui réoriente la violence qu’il a déployée pendant la guerre dans la sphère privée contre sa femme et ses enfants), sont mus à l’adolescence par une volonté de faire souffrir qui prend la forme d’agressions, de vols, de mutilations et enfin à la fin du roman, du triple meurtre commis par Rainer. À des échelles évidemment différentes, les jumeaux, comme Max Schulz, transforment la souffrance subie en violence. Un mécanisme inexorable allant de la souffrance à la violence traversant les générations semble être à l’œuvre :
Parfois la journée est tout à fait normale, et le père pique au hasard l’un des enfants et le rosse en gueulant. […] L’enfant rampe impuissamment en l’air, cependant que le contenu de l’enfant s’élève au-dessus du corps et grimpe d’un cran plus haut d’où il domine l’effroyable événement. […] Dans leurs têtes s’est noué quelque chose qui donnera plus tard une explosion de lumière orange16. (E, p. 251)
15Dans la description de la violence paternelle exercée sur les jumeaux, le traumatisme est représenté par l’image du « contenu de l’enfant [Kindesinhalt] » s’extrayant du corps et observant du dessus la violence subie par le corps. Cette expression surprenante fait signe vers une abolition des limites du supportable, dans une expérience qui ne peut être prise en charge par la conscience. Ce traumatisme est d’emblée liée à « l’explosion de lumière orange », qu’on peut rapprocher des agressions ou des meurtres qu’ils commettront – la couleur orange évoquant également la couleur du pyjama ensanglanté de Rainer après son triple meurtre. Le caractère inexorable de ces retournements du traumatisme, prenant la forme dans ces deux textes d’une maltraitance des enfants par des pères tortionnaires, met en place un règne de la violence aveugle et incompréhensible qui s’incarne dans l’image d’un bâton qui passe dans la main de celui qui a été battu. Dans ce mouvement de balancier ou de ronde infernale n’existe apparemment ni pure victime ni pur bourreau puisque ceux qui font souffrir ont eux-mêmes souffert.
16Mais ce règne de la violence et de la souffrance apparaît dans les deux romans dans un contexte historique précis : celui de l’après-guerre et de ses procès, dans lesquels la souffrance peut prendre une fonction de justification. Dans Le Nazi et le Barbier, l’exagération comique, le grotesque et l’interchangeabilité semblent alors interroger le sens de la souffrance en prenant en compte le contexte historique des procès d’après-guerre et des discours qui s’y élaborent. Dans Les Exclus, c’est également contre les pièges d’une empathie mal placée que l’ironie de la voix narratoriale semble orienter la lecture, dans un même mouvement de ré-historicisation de la souffrance.
Des tentatives de décorrélation entre souffrance et empathie ?
17La représentation de la souffrance des corps dans Le Nazi et le Barbier et dans Les Exclus est marquée par une complexification de l’empathie par rapport au personnage souffrant, puisque la représentation de la souffrance dans ces textes est en grande partie celle de tortionnaires nazis. Au-delà du règne de la violence, un certain nombre de manipulations d’un discours sur la souffrance du corps comme moyen d’annuler la question de la responsabilité individuelle et collective peuvent être décelées. Cette logique de dédouanement est notamment poussée à son comble dans la description fictive de l’avènement au pouvoir d’Hitler, représenté dans Le Nazi et le Barbier par un discours prononcé à Wieshalle en 1933 auquel Max Schulz assiste, et où l’on retrouve les bâtons qui l’ont marqué enfant :
Et le Führer dit : « Maudit soit le bâton dans la main du faux maître. […] Béni soit le bâton dans la main du vrai maître, le bâton deviendra glaive et la main règnera pour toute l’éternité. Amen. » […] Peut-être que les autres ont eu droit à d’autres bâtons, pas forcément jaunes et noirs ? Vert peut-être, ou bleus, ou rouges, ou violets ? Il y avait sûrement plein d’autres bâtons, il y en avait sûrement de toutes les couleurs17. (NB, p. 58-69).
18Cette ronde de bâtons de toutes les couleurs mais sans identités vide le discours de toute idéologie et pose de manière aiguë la question de la responsabilité : la main sans identité qui tient le bâton permet in fine de « faire porter le chapeau » à un coupable originel et non identifiable :
Vous croyez probablement que je me paie votre tête. Ou bien vous ne me croyez pas et vous vous dites :
Max Schulz a un grain ! […] À quoi joue Max Schulz ? Qu’est-ce qu’il veut me faire croire ? À qui est-ce qu’il veut faire porter le chapeau ? À sa mère ? Aux juifs ? Au bon dieu18 ? (NB, p. 16)
19Cette interrogation sur la responsabilité, attribuée au lecteur sur un mode comique, est en réalité une question centrale de ces deux romans :
La plupart des génocidaires courent toujours. […] Ils se portent à merveille, les génocidaires19 ! (NB, p. 458).
Toutefois à l’heure actuelle les coupables innocents restent nombreux. Depuis des rebords de fenêtres fleuris, ils regardent le public, aimables, riches de souvenirs de guerre, font des signes de la main, ou revêtent des fonctions importantes. Derrière des géraniums. Il serait temps que tout soit pardonné, oublié, afin de pouvoir recommencer de zéro20. (E, p. 233)
20Cette idée des coupables innocents met en lumière toute une rhétorique de l’excuse, parodiée dans ces textes et dans laquelle le corps souffrant a une place centrale : ce seraient des « derches ensanglantés21 » (NB, p. 60) qui ont porté Hitler au pouvoir et le viol subi dans l’enfance serait à l’origine de la trajectoire de Max Schulz.
21La souffrance du corps est ici mobilisée pour donner une image apolitique de l’avènement du national-socialisme, évacuant l’idéologie nazie et la question de la responsabilité politique collective et individuelle. C’est dans la lettre d’explication qu’écrit Max Schulz à Itzig, son ami d’enfance dont il usurpe l’identité après l’avoir tué dans le camp d’extermination fictif de Laubwalde, que cette rhétorique de l’excuse apparaît véritablement comme une parodie :
Sauf que je n’aurais jamais pu manier le bâton avec autant de violence et de démesure s’il n’y avait pas eu d’ordre. L’ordre : vas-y, frappe. […] Car moi, Itzig Finkelstein à l’époque encore Max Schulz, je n’étais qu’un petit poisson de rien du tout, anxieux et frétillant, un petit poisson qui ne frappait que parce que c’était permis. […] Mais tu peux me croire, Itzig. Je n’étais pas antisémite. J’ai suivi le mouvement, c’est tout22. (NB, p. 246-247)
22Andrée Lerousseau (2017, p. 32) note des similitudes avec ce que rapporte Hannah Arendt dans Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal (1966, p. 41) à propos de la réfutation par Eichmann de tout antisémitisme de sa part23. De manière générale, les éléments de langage du petit poisson ou du suivisme sont des lieux communs de cette rhétorique de la justification. La souffrance corporelle du personnage principal est prise d’un point de vue de la réception entre empathie et reconnaissance d’un discours parodié et c’est cette reconnaissance de la parodie qui perturbe la liaison entre empathie et souffrance. On observe également cet effet de perturbation du rapport entre souffrance et empathie dans le chapitre où Max Schulz décrit les sévices que lui a fait subir le personnage fantastique de Véronia, une « sorcière » qui le cache après qu’il a échappé de justesse à l’Armée rouge en évacuant le camp de Laubwalde. Ce passage du roman, comme le remarque également Andrée Lerousseau, est construit comme un épisode de conte. La souffrance est présentée par le personnage comme une étape de sa rédemption : « J’étais là pour être torturé, c’est tout. Véronia essayait de me faire passer un message24. » (NB, p. 161). Mais ce châtiment permettant de passer outre la justice humaine par une souffrance corporelle hyperbolique et fantasmatique est-il adapté à un génocidaire bien humain ? Passé au moulin du grotesque, ce motif de la souffrance rédemptrice pose la question des formes et des contours que peut prendre la responsabilité. De même, la jambe amputée d’Otto Witskowski, perçue comme châtiment corporel, lui permet de n’être pas confronté à la question de sa responsabilité dans les meurtres de masse auxquels il a participé :
Depuis que l’histoire lui a pardonné, il est resté honnête, et ça fait une paye. Après 1945, l’histoire s’est décidée à tout reprendre de zéro ; décision à laquelle l’innocence coupable s’est aussi résolue. Witkowski recommence en toute innocence tout en bas de l’échelle, où ne commencent habituellement que des jeunes qui ont la vie devant eux ; remonter la pente avec une seule jambe est plus difficile, du reste avec une seule jambe tout est plus difficile25. (E, p. 298-299)
23L’« innocence coupable » souligne la réversibilité de ces termes dans l’Autriche d’après-guerre mais également la réversibilité de la souffrance physique, en particulier celle d’Otto Witkowski qui lui permet de gagner une empathie problématique :
Il tourne sur son axe et tente de se mettre sur pied, ce qui ne réussit qu’avec le coup de main breveté maison [sa femme, Gretl], oh hisse ! Le revoilà debout. Les béquilles aussitôt coincées sous ses aisselles – il a cru pouvoir s’en passer pour violer Gretl, autrefois il se passait bien de tels expédients. […] Et au lieu de prendre la Gretl, maintenant qu’elle est juste à côté de lui, il cache sa tête chenue contre sa poitrine et ne peut s’empêcher de pleurer. Ce qui l’émeut beaucoup, car elle en ignore la raison et pense, à tort, que c’est à cause d’elle. Pauvre petit bonhomme, ça va s’arranger, console-t-elle doucement, sans pourtant le consoler26. (E, p. 301-302)
24La réaction émue de Gretl face à ce mari souffrant est mise à distance par le discours indirect libre, qui fait entendre à plusieurs reprises la volonté d’Otto de violer sa femme. La manipulation de la souffrance dans le but d’obtenir une empathie mal placée est ici mise en valeur par la narration – créant chez la personne qui lit une indignation directement liée également à l’ambivalence et aux manipulations de la souffrance du corps.
25La décorrélation entre souffrance et empathie, notamment quand il s’agit de personnages bourreaux, permet d’appréhender la question de la souffrance des corps d’un point de vue historique et politique. Par le grotesque, l’ironie et l’humour noir, c’est la monosémie du corps souffrant qui est remise en doute : la souffrance du corps n’échappe pas à de multiples manipulations et peut être le lieu de déploiement d’une rhétorique de l’excuse ou le lieu d’un châtiment corporel rédempteur (les sévices de la sorcière, l’amputation d’Otto ou de Mme Holle) se substituant à une justice humaine. Dans Le Nazi et le Barbier, la parodie d’une rhétorique de l’excuse que l’on décèle dans le discours de ce « narrateur non fiable »27 qu’est Max Schulz fait apercevoir l’auteur impliqué jouant contre son personnage narrant en réintroduisant une dimension historique et contextuelle dans le sens à donner à la souffrance des corps. Ce jeu est également présent dans Les Exclus au niveau de la relation entre la voix narratoriale et les personnages : elle resitue également la souffrance ses symptômes physiques dans des réseaux de sens historiques et politiques.
Historicisation et politisation de la souffrance : le cas des symptômes
26Si les corps souffrants des bourreaux et les discours tenus par ces personnages sur leurs souffrances semblent être le lieu d’une problématisation politique et historique de la valeur de la souffrance des corps et de l’empathie à laquelle cette souffrance peut être associée, il y a également dans ces deux textes une attention à des marqueurs infralangagiers de la souffrance : les symptômes. On croise dans ces deux œuvres des personnages travaillés par une souffrance qui ne s’exprime pas mais donne lieu à des troubles de la parole et de l’alimentation. Dans Les Exclus, la logorrhée incontrôlable de Rainer s’oppose au mutisme d’Anna. Dans Le Nazi et le Barbier, deux femmes survivantes de la Shoah sont touchées par des troubles de la parole : Hannah Lewisohn qui n’émet plus que des cris ininterrompus et Mira, la femme avec qui se marie Max Schulz, qui est mutique jusqu’à la proclamation de la création de l’État d’Israël. Ces troubles de la parole, qui touchent des victimes de violence intrafamiliale ou de violence de masse, s’articulent également dans ces deux textes à des troubles alimentaires : Anna rejette les aliments en bloc et Mira absorbe de manière boulimique tout type de denrées. En nous concentrant sur cette conjugaison de troubles de la parole et de l’alimentation chez ces deux personnages féminins en particulier, nous tenterons de voir comment ces romans permettent de réinsérer les symptômes d’une souffrance inintelligible dans des réseaux de sens à la fois historiques et politiques.
27Le mutisme d’Anna est lié à un blocage générationnel :
Anna a tant de rage en elle – un effet sans doute du conflit de générations – qu’à s’écouter elle casserait en plus les vitrines éclairées de cette avenue commerçante, la fierté de Vienne28. (E, p. 235)
28Ce « conflit » fait d’abord référence, dans une formulation euphémisée par la modalisation, à l’adolescence comme période typique de rébellion, mais fait également référence au conflit qui se joue entre la génération de la guerre et celle des enfants d’après-guerre du fait de l’impossible transmission. Ce nœud de silence autour de la souffrance et de la violence de la guerre passe de manière inintelligible à la génération suivante sous forme de symptômes :
Anna est sans cesse obsédée par des choses désagréables qui accèdent à son cerveau par une voie à sens unique. La barrière mobile se lève toujours dans la même direction. Ça entre mais ça ne ressort jamais, toutes ces choses désagréables se bousculent dedans, et la sortie de secours est barricadée. […] À cette époque commencèrent chez Anna les premières difficultés d’élocution, la langue disait de plus en plus souvent non, aujourd’hui je ne travaille pas29. (E, p. 244)
29Le silence d’Anna est le signe d’un inassimilable, exprimé par le motif métaphorique mécanique récurrent d’une « barrière mobile » dysfonctionnelle et d’une « sortie de secours barricadée ». La voix narratoriale met en lien ces symptômes avec les traumatismes vécus dans l’enfance, eux-mêmes le résultat d’un transfert dans la sphère privée d’une violence institutionnalisée sous la période nazie. À plusieurs reprises, il est souligné que la guerre et sa violence impriment leurs marques sur les jumeaux, par l’intermédiaire du père :
Trop souvent l’enfant a vu sa mère, comme le squelette d’un vieux cheval, se casser en deux et former un V sous les coups du père. Qui la plupart du temps utilise à cet effet de vieilles charentaises, bonnes à jeter après usage. Les rossées commençaient, paraît-il, le jour même où la guerre fut perdue, car si auparavant le père rossait des étrangers de corps et de formes divers, à présent il ne dispose plus que des corps de sa femme et de ses enfants30. (E, p. 250)
30Le père dispose également de la « boîte d’aquarelle des enfants » dont il veut se servir pour faire des « entailles, des éraflures et des petits trous dans la peau » sur les photos de la mère, pour reproduire les « blessures corporelles » que « son métier lui a appris31 » (E, p. 252). Cette image de la boîte d’aquarelle, obscène parce qu’elle mêle activité enfantine et violence insoutenable, souligne le passage insidieux de la violence et de la souffrance à la génération suivante. Cette continuité, invisible aux adolescents, est soulignée à de nombreuses reprises par la voix narratoriale dans une forme d’ironie tragique vis-à-vis des personnages : la souffrance qu’ils ressentent et la violence qu’ils veulent faire subir sous la forme d’un « crime gratuit » n’ont pas pour eux d’origine historique, sociale ou genrée. Ainsi, la souffrance des personnages, au niveau individuel et collectif, faute de pouvoir être intégrée dans un réseau de sens, est retournée en violence contre soi ou autrui, dans les troubles de la parole, de l’alimentation, les automutilations, les agressions ou les meurtres.
31Dans Le Nazi et le Barbier, la boulimie et le mutisme de Mira sont liés au traitement subi pendant la guerre : l’assimilation de son propre corps comme abject semble être le point central de la caractérisation d’une souffrance qui ne disparaît pas à la fin des sévices mais subsiste sous forme de symptômes. Mira aime en effet en particulier les
croûtes de pain dur, millet, boulettes composées d’ersatz de farine et de sciure de bois, une spécialité des camps qui continue d’attiser chaque fois l’appétit de Mira, […] les restes de repas, de la nourriture pour chiens […] des restes de nos tartines pour la collation du matin, et plein d’autres choses encore : épluchures ou trognons de pommes, miettes de gâteaux, noyaux de pêches ou de prunes s‘il y reste un peu de chair. Nous les posons n’importe où, comme par négligence, la plupart du temps à même le sol32 (NB, p. 383).
32Les symptômes de Mira - le mutisme et un rapport à la nourriture bloqué en deçà des modes humains d’alimentation – renvoient à la perception de son corps comme abject, c’est-à-dire marqué, comme Michaela Marzano l’exprime dans La Philosophie du corps, par l’impur, la souillure, le déchet33.
33Cette perception de son propre corps comme taché, souillé, sale est également au fondement de la souffrance du personnage d’Anna :
Après avoir englouti son demi-sandwich, Anna file aux cabinets et se met un doigt dans la gorge. Et les voilà qui ressortent, mais en ordre inverse, harengs, oignons, berk. […] Elle a le sentiment de n’être rien d’autre qu’un bloc de crasse34 (E, p. 244).
34Depuis les travaux de Julia Kristeva (1980), l’abject est une notion mobilisée dans la perspective spécifique du corps féminin. Dans Le Jeu de l’abjection (2011), Suzanne Böhmisch prolonge cette réflexion sur les liens entre féminité et abjection en prenant appui sur des textes d’Elfriede Jelinek : « Elles [les œuvres d’E. Jelinek et E. Czurda] font voir le glissement sémantique entre féminité, altérité et abjection » (p. 27). Elle se fonde notamment sur les réflexions de Judith Butler dans Trouble dans le genre (1990) qui défend que la liaison entre abjection et féminin permet de définir la limite entre ce qui est intelligible et inintelligible, faisant la critique d’une « assimilation tendancielle du féminin à l’impensable, l’inintelligible, l’abject » (Böhmisch, p. 34). La voix narrative met en valeur dans Les Exclus ce lien entre féminin et abjection :
Un jour, elle était encore enfant, elle a observé maman dans la baignoire. Contrairement à son habitude, la mère avait gardé un vieux slip blanc qui s’enflait dans l’eau comme une voile. Il y avait du rouge dessus. Répugnant. Un tel corps n’est qu’un appendice légèrement périssable et non l’essentiel de l’être humain35. (E, p. 244)
35Le souvenir de sa mère marquée par le sang menstruel souligne le lien entre les différents symptômes de la souffrance d’Anna et l’assimilation du corps féminin à de l’abject. Le dégoût provoqué par le sang se transmet de la mère (qui cherche à camoufler le sang menstruel en gardant un vêtement dans la baignoire lors de ses règles) à Anna et se répercute sur la perception de son propre corps, indélébilement marqué par « la crasse ». Ce lien entre corps féminin et abjection n’est pas circonscrit à la mère et la fille, ce sont des normes de visibilité imposées qui renvoient le sang des règles et, par là, le corps féminin à de l’abject :
Anna et maman se voient interdire sous peine de mort de laisser traîner aux yeux du monde entier ouate ou serviettes hygiéniques tachées de sang. De tels indices doivent être détruits ou disparaître sans laisser de trace. Anna le ferait d’elle-même de toute façon, n’efface-t-elle pas illico toute trace de son corps. […] Tantôt elle cesse de parler et tantôt de manger, rien ne franchit ses lèvres, même pas de la soupe, et si ça se produit, elle se met les doigts dans la gorge et restitue en un jet puissant cette soupe qui ne lui a pourtant rien fait. Ces misérables restes dans la cuvette sont aussitôt chassés, tout comme la ouate sanguinolente qui témoigne, elle aussi, d’un processus vital plutôt désagréable. Du balai, ni vu ni connu36. (E, p. 374)
36Dans la violence qu’elle exerce contre son corps, Anna semble aspirer à l’effacement. Mira, dans Le Nazi et le Barbier, aspire au contraire à l’engloutissement du monde extérieur. La perspective grotesque et extravagante de la narration du Nazi et le Barbier met en lumière les marques corporelles et physiques d’une souffrance liée à l’expérience concentrationnaire, non spécifiquement décrite comme féminine, mais incarnée dans des personnages de femmes. La conjugaison des troubles de la parole et de l’alimentation dans ces deux romans permet de mettre au jour les effets d’une relégation de certains types de corps aux limites de l’humain : le corps féminin pour Anna dans Les Exclus et le corps juif – et de ce fait racialisé et animalisé dans l’idéologie nationale-socialiste –, et en l’occurrence également féminin pour Mira dans Le Nazi et le Barbier où l’assimilation d’une abjection liée au féminin et à l’extermination de masse semblent se conjuguer. En présentant ces symptômes corporels comme liés à une perception abjecte de soi, ces deux romans opèrent une réinsertion de ces souffrances apparemment de l’ordre de l’inexprimable et de l’inintelligible dans des réseaux de sens historiques et politiques.
Manipulations empathiques des souffrances corporelles : interroger les valeurs de la souffrance
37Dans ces deux romans, la souffrance semble d’abord constituer un règne duquel on ne peut s’extraire, une anthropologie du mal faisant se bousculer violence et souffrance dans une ronde sans fin. Pourtant, dans le traitement de la souffrance des bourreaux comme dans celle des victimes, on trouve un travail de réinsertion dans un contexte historique et politique précis. Les expressions volubiles de Max Schulz dans Le Nazi ou le Barbier ou d’Otto Witkowski dans Les Exclus ont une teinte parodique, par la référence sous-jacente aux discours de justification ou d’excuse qui s’élaborent dans l’après-guerre. La description des marques que la souffrance laisse sur le corps, sous forme de symptômes, est également le lieu d’une ré-historicisation de celle-ci : le mutisme de Mira est, en miroir de la volubilité des bourreaux, une image grossissante d’années d’après-guerre où la parole des victimes est à la fois rare et inaudible. À cette ré-historicisation de la souffrance s’ajoute dans Les Exclus une perspective genrée, par le lien explicité entre féminin et abject.
38On pourrait alors opposer schématiquement la souffrance des bourreaux, volubiles et encombrantes, aux marques ténues de la souffrance des victimes que sont les symptômes. Mais le point de fuite du silence comme horizon d’un discours de la souffrance ne semble pas constituer le fin mot de ces récits sur la souffrance. Dans Le Nazi et le Barbier, l’extravagance, l’outrance avec lesquels le récit dépasse les normes discursives dans son traitement de la Shoah sont une manière de remettre en cause cette partition entre parole des bourreaux et silence des victimes. Dans Les Exclus, le lien entre souffrance et silence est avant tout articulé, par le sarcasme et l’ironie de la voix narratoriale, à l’amnésie mise en place autour de la Seconde Guerre mondiale dans l’Autriche d’après-guerre. Ces deux romans posent ainsi, par le détour de la description de souffrances corporelles ou de symptômes corporels de souffrance psychique, la question du devenir de la souffrance dans des sociétés dans lesquelles celle-ci est en apparence résorbée, refoulée ou re-canalisée.
39Dans cette perspective, ces deux romans proposent une mise à distance critique de la réaction d’empathie que les souffrances suscitent, en produisant une historicisation par la parodie, l’ironie ou le grotesque. La perturbation du lien entre souffrance et empathie oblige à interroger la valeur du corps souffrant. La souffrance corporelle est soumise à un questionnement sur les manipulations auxquelles les manifestations et expressions de celle-ci peuvent se prêter. Dans la comparaison de ces deux romans apparaît ainsi un discours radical et inconfortable sur la souffrance : les corps en souffrance ne sont pas signifiants en soi et la valeur de la souffrance ne prend sens qu’au sein de discours romanesques qui réintroduisent de l’histoire et politisent ce qui apparaissait d’abord comme un règne indéterminé de la violence.