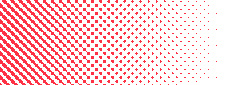Souffrir : du for intérieur au dire collectif
1Au lendemain des attentats de Paris du 13 novembre 2015, dessinateurs de presse, écrivains et individus sur les réseaux sociaux convergent pour dire leur souffrance, mais aussi celle d’une nation blessée. Aux corps assassinés que la pudeur et la décence défendent de représenter dans leur violence immédiate se substituent les larmes d’une Marianne, la Tour Eiffel ensanglantée et couverte d’un linceul bleu blanc rouge, les visages des victimes, poèmes et dessins qui exhibent la souffrance d’une communauté cherchant à élaborer un discours de consolation1. Plusieurs siècles auparavant, au cœur des guerres de religion, Agrippa d’Aubigné s’exclame, dans Les Tragiques : « Je veux peindre la France une mère affligée » (1616, v. 97). Là aussi, c’est un être souffrant que l’on représente pour dire le tourment d’une société, en l’occurrence soumise à une violence fratricide et politique. Si la France est déchirée – l’image des deux enfants lui dévorant le sein est devenue topique –, c’est pour mieux dire les déchirements causés par la guerre civile. Autre événement notable : le 8 novembre 1686, à 7 heures du matin, l’issue de l’opération de Louis XIV est favorable et sa guérison est l’occasion de réjouissances nationales. La souffrance du monarque devait passer pour celle de son peuple – et son état celui de son État (voir Perez, 2007). En plusieurs occasions, corps humain singulier et corps politique (du peuple dans son ensemble au représentant du pouvoir) semblent se répondre, voire se superposer.
2Ce numéro de Fabula-LhT interroge en diachronie les relations qu’entretiennent les individus avec le corps social et politique, dès lors qu’il est question de souffrance. Quelle place et quelle valeur sont accordées à celle-ci dans les récits qui entendent la retranscrire, dans la littérature du xvie siècle à nos jours, lorsque le corps souffrant est investi d’une valeur collective et politique ? Car bien qu’éprouvée de manière intime dans le corps d’un sujet, la souffrance est aussi affaire de toutes et de tous. Les corps revêtent une dimension symbolique en fonction de leur appartenance politique et sociale : ils témoignent souvent de la santé d’une nation ou de la légitimité d’un régime. Ils sont même parfois pourvus de pouvoirs surnaturels et miraculeux, à l’instar des rois thaumaturges auxquels on prêtait le pouvoir de guérir les écrouelles, ou servir une stratégie de propagande efficace, à l’image du corps sain et viril promu notamment dans les États autoritaires du xxe siècle. Mais qu’en est-il lorsque de tels corps défaillent ? Les questionnements actuels sur le genre, sur le handicap ou sur les situations de crise sanitaire invitent à reconsidérer les textes portant sur la violence physique, la douleur, la blessure et la maladie. Sur le plan littéraire, quels genres et quels registres – pathétique, tragique ou ironique – se trouvent associés à de telles scènes de souffrance ? À travers celles-ci, par quels moyens littéraires les auteurs et autrices envisagent-ils de débusquer les mécanismes du pouvoir, voire de construire une histoire politique des corps ?
3Récits fictionnels et factuels – récits de guerre, d’esclavage, d’attentats, d’épidémies, littérature concentrationnaire –, textes poétiques et théâtraux abondent en corps souffrants. Ils mettent en scène un certain nombre de figures emblématiques, à l’instar de la femme battue, du bouc émissaire, du martyr chrétien, de la gueule cassée ou du résistant torturé. Corps sanglants et agonisants, macabres, guillotinés, violés, mutilés : tous apparaissent traversés par le politique et posent la question philosophique du mal, du désir et de la mort.
Champs de savoir
4Tout en prenant en considération la variété des formes littéraires et des options stylistiques choisies pour dire la manière dont le sujet « fait connaissance avec sa douleur » (selon le titre d’une nouvelle de Le Clézio2) et ce faisant interroge la communauté à laquelle il appartient, il s’agit d’identifier les différents champs de savoir dans lesquels s’inscrivent les écritures de la souffrance.
5Celles-ci entrent en premier lieu en résonance avec la poétique du récit de guerre, telle que Jean Kaempfer, dans son essai fondateur (1998), en a posé les jalons. La pertinente partition qu’il effectue entre le récit de guerre impérial et le récit de guerre moderne, entre une appréhension rationnelle des événements et leur restitution délibérément inintelligible3, a aussi pour effet d’interroger l’une des continuités fondamentales du genre qu’est l’omniprésence du corps souffrant.
6Ce dernier constitue en second lieu un thème privilégié des écritures de soi, sous la forme plus précise du récit de maladie – depuis les douleurs suscitées par la gravelle qu’évoque Montaigne dans son Journal de voyage en Italie jusqu’aux témoignages sur les maladies auto-immunes, le cancer, le sida, que Stéphane Grisi (1996) subsume sous le terme d’« autopathographie ». Véronique Leroux-Hugon et Véronique Montémont (2017) soulignent l’apparition relativement tardive du récit entièrement consacré à la maladie, lequel prend son véritable essor au xxe siècle, notamment par le biais du journal personnel ou du texte autobiographique. Parmi ces récits formant un « lieu d’incarnation d’une représentation de soi, et du soi souffrant » (p. 664), depuis La Doulou d’Alphonse Daudet (1929) jusqu’à L’Usage de la photo d’Annie Ernaux (2005), on en trouve un grand nombre qui dépasse la simple narration d’une affection pour défendre une plus large prise en compte et une meilleure acceptation des malades dans la société. Le corps souffrant se fait alors corps politique, au sens où il met en question les normes et les impensés d’une époque.
7Ces différents types de récits sont volontiers mobilisés dans le champ des humanités médicales, au croisement de la médecine, des sciences humaines et des sciences sociales. Le texte littéraire y est généralement appréhendé comme un modèle offrant un ensemble d’énoncés originaux sur l’expérience de la douleur. Dans une perspective thérapeutique, il incite le sujet souffrant à une prise de conscience, une prise de parole, voire une prise de plume libératrices, permettant de mettre à distance et de sublimer l’expérience de la maladie. Telle est la perspective sur laquelle se fonde en particulier l’approche de Rita Charon dans Médecine narrative. Rendre hommage aux histoires de maladie (2006). Son approche vise à prendre le contrepied d’une culture médicale où le patient est plus souvent considéré comme un objet (celui d’un diagnostic) que comme un sujet (celui d’une nouvelle expérience de vie), et où le médecin est davantage appelé à délivrer un savoir technique qu’à développer un discours d’empathie authentiquement capable d’aider le malade. Dans cette optique, la littérature fournit toutes les armes pour affronter le caractère parfois inouï de la souffrance, pour dépasser le lien coutumier entre « le défaut de mots et l’excès de maux », pour restituer la complexité du « rapport des hommes à la réalité fuyante de la douleur » (Poulin, 2007, p. 34-35). Cet enjeu vaut d’être éclairé par nombre de récits littéraires faisant de la maladie une expérience fondatrice, soit du point de vue du souffrant – de Fritz Zorn à Hervé Guibert –, soit du point de vue du soignant – de Georges Duhamel à Jean Reverzy ou Martin Winckler. Ces textes ont pour mérite de faire apparaître à quel point la douleur se situe « au croisement du biologique et du culturel ou du social », comme le précise Roselyne Reynaud au seuil de son Histoire de la douleur (1993, p. 6).
8Le présent numéro entend prolonger les réflexions initiées dans les études littéraires par des monographies, depuis celle d’Isabelle Poulin (2007) jusqu’à celle Christoph Groß (2021), comme par des volumes collectifs, à l’instar de ceux dirigés par Florence Fix (2018), par Mireille Naturel (2018) ou par Bruno Pétey-Girard et Pascal Séverac (2018). Toutefois, notre ligne critique vise à faire ressortir davantage la portée politique de la mise en récit de la souffrance, tant il est vrai que la représentation de la douleur est toujours une construction collective, comme le mettent bien en lumière les collectifs dirigés par Marilina Gianico (2018), et par Ariane Bayle et Brigitte Gauvin (2019). Afin de saisir de quelle manière la littérature interroge la gamme des souffrances endurées, leur géométrie variable qui est fonction des états de l’individu comme des évolutions de la communauté où il évolue, nous proposons de développer la réflexion en quatre parties.
Témoigner de la souffrance de soi et des autres
9La première regroupe trois études dont les corpus non fictionnels ont pour point commun de livrer un regard sensible et critique sur la souffrance. Examinant la représentation des corps souffrants dans Le Passe-temps (1595) de François Le Poulchre, qui tient à la fois du recueil de nouvelles, des essais et des Mémoires, Lou-Andréa Piana montre de quelle manière le récit tire sa force, sa cohérence et sa continuité d’un discours moral et politique sur la souffrance. Celle-ci peut être infligée lors des guerres civiles (dont l’auteur est le témoin direct) ou subie dans l’intimité du corps (à commencer par la goutte dont souffre l’auteur). L’expérience de la maladie, tout en permettant à Le Poulchre d’adopter une certaine posture littéraire, élève le discours d’un observateur aiguisé de son temps au rang d’une leçon de sagesse humaniste. Celle-ci se présente comme un réquisitoire contre les passions politiques et leurs inévitables dérives, dont le corps de l’individu constitue la première cible.
10Consubstantielle à la pratique de la guerre comme à l’épreuve de la maladie, la souffrance s’immisce également au sein du monde professionnel. Julien Néel analyse à cet égard le « Journal d’usine » de Simone Weil (contenu dans La Condition ouvrière, 1951). La philosophe, bien avant Leslie Kaplan, Robert Linhart ou Joseph Ponthus4, s’immerge dans l’univers ouvrier : elle y travaille par solidarité, par conviction, mais aussi pour mieux en démonter la mécanique. Parce que l’usine conduit au déracinement, voire à la désolation – désignant étymologiquement la « privation de sol » –, elle est analysée comme un espace et un dispositif d’oppression. Julien Néel propose de lire le journal de Simone Weil à l’aune de la « fabrique de l’épuisement » (2024) qu’il rend visible, notamment par l’usage de la répétition, tout à la fois figure littéraire de l’excès et indice d’une temporalité cyclique.
11La dimension collective du corps souffrant peut également se faire jour dans des textes plus intimes, moins spontanément tournés vers le monde social. Tel est ce qu’entend montrer Anne Strasser dans son article consacré à la réception, par des lecteurs ordinaires, de deux récits de deuil publiés par Simone de Beauvoir, Une mort très douce (1964) et La Cérémonie des adieux (1981) – l’un portant sur le décès de la figure maternelle, l’autre sur le lent déclin de Jean-Paul Sartre. La chercheuse identifie la portée politique des deux textes dans la capacité qu’ils ont à susciter l’empathie et à programmer « le passage d’une expérience singulière à une expérience partagée » (2024, § 24). Les réactions des lecteurs, aux sensibilités divergentes, soulignent la « réflexion nourrie de valeurs morales, éthiques, politiques » (2024, § 5) que toute œuvre dédiée à la dégradation du corps semble susciter.
Fictions de la souffrance : de l’individu au collectif
12Essais, journaux, récits factuels ne sont pas les seuls à révéler la porosité de la frontière séparant la souffrance singulière et la souffrance collective : la fiction permet elle aussi d’imbriquer étroitement ces deux dimensions. Prenant pour point de départ le motif de la jambe amputée, attribut commun à plusieurs personnages des romans Le Nazi et le Barbier (1971) d’Edgar Hilsenrath et Les Exclus (1980) d’Elfriede Jelinek, Clara Metzger observe de quelle manière « la perte de […] leur intégrité physique est une image de l’état politique de leur pays » (2024, § 1). L’analyse met en lumière la « politisation de la souffrance » (2024, § 5) à laquelle s’emploient les deux romans, le premier par l’emploi du grotesque et de la parodie, le second par l’écart constamment ménagé entre la voix narrative et celle des personnages. La mise en scène de la souffrance des bourreaux aboutit à une satire acerbe de la société allemande, qu’elle ait trait à la montée de l’antisémitisme ou à l’amnésie coupable caractérisant l’après-guerre.
13La signification politique du corps souffrant n’est pas toujours immédiate et exige parfois de l’herméneute un travail de décryptage. En témoigne celui que fournit Mathieu Roger-Lacan pour lire Germinie Lacerteux (1865) au-delà de l’interprétation sociale ou médicale à laquelle donne généralement prise la figuration de la souffrance dans le roman naturaliste. C’est ainsi qu’une série d’indices, d’ordre « infra-politiqu[e] » (2024, § 32), font apparaître la corrélation entre le corps de l’héroïne et l’expérience historique. Afin de dégager la « réflexivité politique que le geste esthétique des Goncourt contient en puissance », l’auteur de l’article identifie le vaste système de références et d’échos qui « fait de la violence intime l’envers symbolique de l’événement politique » (2024, § 33 et 17).
Violences scéniques, souffrances publiques
14Le théâtre est un lieu topique de la représentation de la souffrance d’une part, de la politique d’autre part. Les origines lointaines du théâtre occidental en font des moments importants de la vie de la cité. La tragédie autant que le vaudeville, la comédie-ballet comme la pièce de circonstance investissent les souffrances de personnages illustres ou médiocres, les instituent comme moteurs d’une machine éminemment politique et les insèrent dans un moule générique propre à en interroger la portée au gré d’effets divers – le rire, la pitié, etc. Prenant pour objet d’étude les œuvres de théoriciens du théâtre importants, Clara Filippe montre comment et pourquoi Mercier et Diderot, au xviiie siècle, ont remis en jeu la représentation du corps souffrant, que la tradition théâtrale avait, au nom de la bienséance comme de la vraisemblance, bannie des scènes françaises.
15Par-delà le xviie siècle régulier, et remontant à la scène médiévale, Marielle Devlaeminck interroge la manière dont se configurent les pièces politiques du tournant des xve et xvie siècles. On trouve là, comme à rebours, une illustration nette des réflexions postérieures qui feront du corps souffrant un paradigme esthétique autant que politique. Les perspectives genrées et sociales se donnent à voir avec acuité au sein d’un vaste corpus théâtral, où le genre littéraire lui-même repose sur une appréciation sociopolitique du personnel engagé. Le théâtre, lieu régulier des démonstrations violentes (du théâtre humaniste aux performances les plus actuelles), n’est pas sans construire un double mouvement de fascination et de répulsion, de mise à distance et d’adhésion parfois voyeuriste.
Souffrir aux marges : société et subversion
16Dans cette perspective, le corps souffrant est l’objet de gestes et de regards que l’on peut situer aux marges d’un idéal de société. Sadisme, masochisme, voyeurisme, scarifications, automutilations : autant de pratiques à la frontière du supportable et de l’acceptable, questionnant les normes établies.
17Ainsi Caroline Minard montre-t-elle comment le corps souffrant permet à Richard Millet de « traduire de façon concrète l’angoisse de l’effondrement d’un monde chrétien occidental qu’il juge menacé par l’immigration » (2024, résumé). Le corps est allégorisé dans ses dysfonctionnements – intestinaux, notamment, au gré d’une écriture scatologique – pour représenter une société que l’écrivain présente comme parvenue à son terme, au prisme d’une pensée réactionnaire.
18Azélie Fayolle étudie quant à elle les écrits féministes des saint-simoniennes professant un discours sur le corps pour faire advenir une société « Nouvelle ». Condition féminine et corps féminin souffrant s’articulent afin de « développe[r] une poétique du corps » (2024, résumé) résolument progressiste. L’analyse de la presse féministe qui se développe autour de ce groupe montre comment le corps particulier peut être collectivisé – et par conséquent politisé – afin de défendre une cause politique. Le corps est saisi consciemment, dans ces écrits, par des sociétés ou des individus qui font de leur corps marginal – leur corps physique singulier comme leur corps social collectif – la condition de possibilité d’une réappropriation du pouvoir politique et médiatique.
19Enfin, Willem Hardouin-Zanardi se penche sur une autre « revalorisation du corps » (2024, résumé), située dans un contexte différent, en s’intéressant à la « société du fouet » et aux jouissances qu’engendre la souffrance. À contre-courant des discours moraux traditionnels, voire traditionnalistes, souvent portés par une morale spécifiquement chrétienne ou à tout le moins religieuse, on voit comment Christiane Rochefort et Vanessa Duriès articulent corps souffrant et émancipation politique. La mise en scène d’un corps exhibé, torturé et éminemment sexualisé permet d’investir le corps politique comme un corps asymétrique. Patriarcale, la société qui promeut la « liberté sexuelle » est en fait au service d’un assujettissement paradoxal : les corps se libèrent en jouissant de la souffrance qu’ils subissent.
*
20Parce qu’elle se situe au croisement de genres littéraires multiples, parce qu’elle apparaît comme une expérience foncièrement intersubjective, parce que les enjeux sociaux et philosophiques qu’elle soulève sont rejoués dans l’actualité la plus récente, l’écriture de la souffrance – vécue, recomposée, parfois sublimée – méritait à nouveau d’être interrogée. Les articles rassemblés dans ce numéro, ainsi que dans le dossier d’Acta fabula qui lui est lié, rendent compte de la fécondité d’un sujet qui invite à réfléchir de manière diachronique aux pouvoirs et aux effets de la littérature sur les consciences.