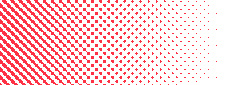Jouir de souffrir, ou la société du fouet
1L’arrivée du « sex-shop » et du « cinéma X », avec certains succès comme celui de Deep Throat (1972) de Gerard Damiano1, font des années 1960 et 1970 un moment charnière de la pornographie. Celle-ci quitte la clandestinité, l’artisanat et la persécution : elle « participe du Big business » (Bertrand et Baron-Carvais, 2001, p. 89). La puissance du cinéma se fait décisive, ce qui influence les textes littéraires. Ceux-ci quittent le domaine du conte philosophique pour s’avancer sur la production de masse, comme le remarquent, dès le début du siècle, certains auteurs :
Nous n’en sommes plus aux contes grivois dont se délectaient les fermiers généraux […]. La pornographie contemporaine est d’une autre essence, elle s’est démocratisée, elle s’est industrialisée (Lavollée, 1909, p. 97-98).
2Renouant avec ses racines philosophiques, en partie héritées de Sade, une certaine littérature pornographique prend alors pour personnages des opprimés : des femmes, des homosexuels, de jeunes adultes ou des vieillards interviennent comme personnages actifs, dont les scènes érotiques font émerger des propos assumés ou perçus comme libérateurs, de plus en plus explicites.
3Le contexte des années 1970-1980 permet aussi une prise en compte de certains domaines auparavant très marginaux :
[…] au cours du xxe siècle, des clubs, des associations, des bars ont permis à des individus ayant des pratiques sexuelles minoritaires de constituer des espaces pour vivre leur désir, lutter contre les stigmatisations, défendre des valeurs ou du moins une certaine tolérance vis-à-vis de sexualités tenues pour déviantes. (Trachman et Bérard, 2018, p. 170)
4C’est ainsi qu’émerge, assez rapidement, une littérature s’intéressant aux plaisirs sadomasochistes, qui fait figure de minorité parmi les minorités : « Hommes homo-maso, femmes homo-maso – ou hommes hétéro-maso ? Qu’est-ce qui fait le plus d’oppression, maso, ou homo ? Il faudrait un ordinateur. » (Rochefort, 1982, p. 173) Par ailleurs, ces domaines marginaux permettent de révéler l’ambivalence de la « liberté sexuelle », voire sa restriction à certaines classes sociales privilégiées. En 1993, Vanessa Duriès constate :
Vivre pleinement sa sexualité, si l’on sort tant soit peu des sentiers battus et sillonnés par les autres, est un luxe qui n’est pas accordé à tous. La liberté sexuelle est davantage un concept médiatique qu’une réalité dans la France profonde (Duriès, 1993, p. 53).
5La récupération bourgeoise de la libération sexuelle, et sa transformation en privilège d’oppresseur, pose problème, et il semblerait donc intéressant de chercher à comprendre comment la littérature pornographique sadomasochiste parvient à devenir « irrécupérable », c’est-à-dire à empêcher sa récupération bourgeoise. Pour cela, nous étudierons deux romans représentatifs de ce genre, qui ont fait scandale à leur parution : Quand tu vas chez les femmes (1982) de Christiane Rochefort et Le Lien (1993) de Vanessa Duriès.
6Le premier roman a pour narrateur un homme blanc, mature, bien installé dans la société, « professeur de psychanalyse » : un dominant. Il possède une double vie : esclave lors de séances tarifées, il assure, le reste du temps, son rôle d’oppresseur, comme tous ses « compagnons de galère » qui sont éditeurs, P.-D.G. ou journalistes reconnus. Tous viennent en effet chercher leur plaisir auprès des mêmes prostituées, qu’ils appellent « Maîtresses ». Or, le narrateur rencontre, en dehors de ses séances, celle qu’il appelle « l’Ange », dont il tombe éperdument passionné. Il cherche à l’entraîner dans son plaisir, à faire d’elle une prostituée, une Maîtresse accomplie, c’est-à-dire soumise à son argent à lui, à son contrôle, à son corps (selon une dialectique bien connue). Mais l’Ange contrecarre tous les mécanismes d’oppression et resémantise les codes de l’univers masochiste à son avantage, ce qui lui permet de prendre le contrôle de ceux qui prétendent l’asservir, les défenseurs de l’ordre bourgeois2.
7Le second roman se présente comme le témoignage authentique d’une esclave majeure, consentante et éperdument amoureuse de son Maître. Le scandale qu’a provoqué ce livre, dont la couverture montre l’auteure en tenue de soumise, vient aussi du fait que le masochisme y est présenté de façon très spirituelle, presque mystique, et aussi comme l’occasion d’une véritable émancipation de la société patriarcale. La narratrice, en se faisant l’esclave d’un homme, déclare se libérer de l’oppression masculine : un tel paradoxe ne peut que provoquer un choc. Tout comme le personnage de l’Ange, la narratrice lutte contre les clichés patriarcaux et cherche à donner une vision plus honnête de la relation sadomasochiste : elle se montre en « perverse », dont le plaisir n’est pas indexé sur la grammaire bourgeoise. Cependant, bien que le texte ait été médiatisé comme une autobiographie, la présentation du masochisme et l’organisation non-chronologique des chapitres autorise à parler d’autofiction.
8Il s’agit donc de nous demander comment est mise en place, dans ces deux romans, la critique de l’assujettissement de la chair à l’ordre social. En d’autres termes, nous aimerions montrer que l’écriture du corps, dans ses souffrances et ses jouissances, mais aussi l’écriture du plaisir, dans ses dimensions triviale et mystique, participe à la redéfinition de l’oppression et de l’émancipation.
Jouissance du corps souffrant : inversion des valeurs
9Romans du plaisir sadomasochistes, Quand tu vas chez les femmes et Le Lien montrent des corps souffrants, mais dont la souffrance se traduit en jouissance. Les codes traditionnels de la pornographie, qui privilégient une sensualité d’abord génitale et, moins prioritairement, de la caresse, sont renversés : le recours à d’autres pratiques que la pénétration pénienne est majoritaire dans la littérature sadomasochiste. Bien sûr, l’« érotisation des punitions corporelles n’est pas nouvelle » :
La flagellation dans un contexte religieux a été soupçonnée d’avoir des connotations érotiques dès le xviie siècle […]. On trouve dans la littérature érotique et pornographique de nombreuses scènes de punitions dans des contextes judiciaires ou scolaires (Trachman et Bérard, p. 173).
10Dans les romans de Rochefort et Duriès, il ne s’agit toutefois pas de fessées, mais bien de tortures, dont certaines sont décrites avec un luxe de détail. Bien que les scènes soient violentes, on y trouve le lexique du plaisir, de façon particulièrement abondante. Dans Le Lien, la narratrice décrit le moment où des poids sont suspendus à ses lèvres vaginales :
La douleur devenait intolérable, mais je devenais la spectatrice de cette souffrance : le plaisir qui naissait insidieusement en moi la dépassait, la stigmatisait. […] Quelque chose d’indéfinissable […] commandait à mon corps de jouir de cette souffrance fulgurante magnifiée par mon obéissance servile […] et à jouir de la douleur […]. Je me livrais au châtiment avec une joie quasi mystique [ :] cette succession de peurs, de douleurs et de plaisirs entremêlés, je ne pouvais plus faire la différence entre les uns et les autres. (p. 22)
11Si le terme premier est « douleur », la seconde partie de la première phrase y ajoute le « plaisir », et la suite du texte montre une alliance de termes entre le verbe « jouir » et ses compléments, puis une antithèse, terminant sur l’aveu d’une indistinction entre la douleur et le plaisir. L’intensité des sensations permet à la narratrice de transcender l’opposition habituelle entre la souffrance et la jouissance, pour atteindre la conciliation des contraires. Ce « quelque chose d’indéfinissable » dessine la limite à partir de laquelle les pratiques sexuelles deviennent « perverses », en soustrayant le plaisir aux codes de la morale reproductive hétérosexuelle.
12Cette échappée hors des codes traditionnels est encore plus marquée dans Quand tu vas chez les femmes : « le fouet tombe sur mes fesses actionné de main de Maîtresse et l’injure de ses lèvres, maladroit idiot chien stupide, tout est bien, je suis rentré chez moi. » (p. 11) Le cliché linguistique « de main de maître » est détourné pour prendre un sens plus concret. Le zeugme allie le geste à la parole, celle-ci étant citée en discours indirect libre, ce qui crée un contraste intense avec la conclusion du narrateur : les deux dernières propositions semblent contredire la première. Mais il n’en est rien : il s’agit d’une seule et même phrase, affirmant nettement la jouissance de la position humiliée.
13Au-delà de l’alliance du plaisir et de la souffrance, les deux romans se font écho dans l’utilisation d’un vocabulaire religieux. Vanessa Duriès et Christiane Rochefort se montrent sensibles au caractère ritualisé des moments sadomasochistes. Le plaisir des esclaves est rapproché très explicitement du plaisir saint, malgré le malaise possible des lecteurs. Cette association donne aux deux romans un sens allégorique net. Lorsque la narratrice du Lien déclare qu’elle accomplit « cette fellation avec un recueillement mystique » (p. 32), le lecteur est appelé à comprendre que le masochisme a une portée spirituelle et que le roman possède un fonds philosophique. L’envoûtement de la narratrice du Lien en porte le témoignage :
On ouvrit une porte de chêne, et je découvris avec stupéfaction le décor solennel d’un lieu mystique.
La beauté de cet endroit me frappa. C’était une cave voûtée magnifique aux murs de pierre apparentes. Des cierges ornaient chacun des angles et les flammes des longues bougies blanches tremblaient sur l’or des pierres centenaires en faisant surgir des ombres sinueuses et menaçantes. C’était si beau !
J’étais comme fascinée par la noblesse et la prédestination évidente de ce lieu : cette cave semblait avoir été conçue depuis la nuit des temps pour le plaisir et la souffrance, pour les rites les plus secrets, et j’évoquai en frissonnant les messes noires et autres rituels prodigieux. La lumière mordorée teintait ma peau, mon corps semblait s’imprégner de poudre d’or, je me sentais irrésistiblement belle… (p. 45)
14Au-delà de l’éloge inattendu du « donjon bdsm », on remarque la progression à thèmes dérivés. La porte qui mène à une cave éclairée par des flammes étroites évoque une descente aussi obscure que solennelle. La descente dans une cave sadomasochiste est mimétique de l’introspection ; le plaisir recherché par la narratrice n’est pas éloigné des plaisirs religieux. La mortification, dans les deux cas, donne accès à une transcendance : l’esprit dépasse la matérialité du corps.
15Il en va de même dans Quand tu vas chez les femmes, même si le narrateur perçoit les choses avec une légère différence. En effet, celui-ci reste un oppresseur, et sa recherche de l’humiliation lui permet d’assouvir un fantasme de toute-puissance, de façon contre-intuitive. En effet, au plus fort de sa jouissance, il se considère comme l’égal de Dieu, avec qui il engage même un dialogue :
Je n’étais pas certain de désirer d’être sur ce pied-là avec Dieu. Notre affrontement se situait dans des zones plus abyssales […] Je péchais la journée entière, sans une minute de creux, qui dit mieux ? Je vous lance un sacré défi Seigneur, voyons si Vous allez le relever.
— Et si je t’abandonnais ? Te laissais choir une bonne fois, en ayant marre à la fin des grands airs que tu te donnes et de tes prétendus défis et de ton théâtre et toutes tes insanités ?
Non, vous ne pouvez pas me faire ça, s’il Vous plaît, ayez pitié, Seigneur Vous connaissez ma misère ! Ne me laissez pas ! (p. 161)
16L’évocation d’un « affrontement », répété sous la forme d’un « sacré défi » passerait pour une provocation vaine, si Dieu ne prenait pas la parole par la suite. Au plus fort de sa jouissance, le narrateur dialogue avec le Seigneur, en se moquant de sa miséricorde infinie. Ce nouveau personnage, qui peut être une projection délirante du narrateur, dans sa quête d’une Maîtresse toujours plus divine, met au jour la vantardise du narrateur, souligne sa faiblesse et le double sens de son discours. Les mises en scène qu’il fait jouer aux prostituées sont un « théâtre », l’humiliation qu’il recherche n’est que de « grands airs », qui occultent la réalité : la peur de l’abandon. La crainte la plus profonde du narrateur est qu’on ne s’occupe pas de lui, qu’on ne lui accorde pas les égards qui lui sont dus :
[…] elles sont assises sur le lit tranquilles, fumant et papotant. Ne me regardant même pas en train de me tortiller devant elles, ne m’insultant même pas, ne m’infligeant même pas leur mépris – quoi, m’auraient-elles oublié pour de bon ? Et mon temps ? C’est à moi ce temps. Je l’ai acheté. (p. 21)
17La transcendance à laquelle le narrateur dit accéder se retourne contre lui : il ne s’agit pas d’accéder aux Mystères antiques, mais plutôt à un besoin primitif de domination. Quand tu vas chez les femmes, bien que pornographique de prime abord, sonde aussi l’âme humaine, et ce besoin d’acheter le temps, c’est-à-dire de le dominer, de le contrôler. Si le narrateur emploie des prostituées, c’est pour marquer sa capacité à tout acheter, à tout contrôler. Il règle le monde à son usage : il décide du temps pour travailler et du temps pour jouir, il décide de sa souffrance comme de sa jouissance.
18Par ce biais, Christiane Rochefort montre la fragilité du statut d’oppresseur. Faisant écho au discours de La Boétie, elle souligne qu’il suffit de cesser d’obéir pour que l’oppression disparaisse : la panique du narrateur lorsqu’il soupçonne ses Maîtresses de l’avoir oublié, de même que sa réponse effrayée à la menace divine d’abandon, montrent bien son besoin d’être au centre des regards, de l’attention.
19Cette « réalité paradoxale », explicitement affirmée dans Le Lien (p. 16) et implicitement exposée dans Quand tu vas chez les femmes, est le point de départ d’une réflexion ambivalente. Tandis que, dans Le Lien, la narratrice fait de son statut d’esclave un levier de son émancipation, dans Quand tu vas chez les femmes Christiane Rochefort expose la violence réelle du narrateur et son esprit oppresseur dans les moindres détails. Celui-ci voit la société comme un champ de bataille où chacun est soumis à la loi du plus fort (ou du plus riche). Cette « société du fouet » se révèle d’une horreur supérieure aux mises en scènes violentes inventées par le narrateur.
Le chien dans la société du fouet
20Christiane Rochefort a su choquer son public en inventant des mises en scènes particulièrement cruelles dans Quand tu vas chez les femmes. Le narrateur, à l’occasion d’une séance, se retrouve avec un fouet introduit dans son anus. Il revient voir ses Maîtresses le lendemain :
— Alors c’est pour une extraction ? dit Élise. On va jouer au docteur ?
— Il nous faudra des instruments dit Macha, est-ce que quelqu’un a un rasoir dans le coin ?
J’avoue que mes cheveux se dressèrent. Ben quoi, c’est ce que les médecins font pour l’accouchement, me dit ma tortionnaire, on recoud après, ils disent que c’est rien du tout.
— Tant que c’est pas dans eux qu’on taille, dit une collègue, moi je suis défigurée de là, c’est un préjudice dans le travail mais ils veulent pas le reconnaître à la Sécu, le rasoir arriva porté par la rumeur. Il dépassait tout de même mes espérances […]. Elle leva le rasoir. Je me couvris de sueur. Sa main s’abaissa, disparut de mon champ, […] je serrai les dents, la douleur aiguë glacée me transperça, je me permis de gémir, là tout de même j’avais le droit. (p. 118-119)
21En associant la torture à la pratique de la césarienne, le narrateur dénonce (malgré lui) une société qui banalise certaines souffrances : la phrase « ils disent que c’est rien du tout » fait écho aux discours qui normalisent les douleurs ressenties par les femmes.
22Malgré l’horreur que peut susciter la scène du rasoir, force est de constater que les moments où le narrateur affirme son statut d’oppresseur sont encore plus violents. Une fois le fouet retiré de son anus, le narrateur continue l’association avec l’enfantement, et s’imagine comprendre pleinement le plaisir féminin :
Telle une femme dont l’amant est parti, je me sentais vacant. In-occupé. Dés-occupé. Je me mis à comprendre les femmes, du dedans : le vide, après la délivrance. Leur attachement névrotique à ce qui est sorti d’elles, et n’y rentrera plus jamais. Ce morceau de leur corps intime perdu pour toujours, qu’il leur faut perdre encore en le sevrant de leur sein ; puis de caresses ; et pour finir, en le rejetant. Comment supportent-elles cette castration ? Elles ne la supportent pas c’est tout, et voilà la source de leur misère immémoriale. (p. 130)
23Le vocabulaire rappelle la théorie freudienne d’« envie du pénis », à laquelle le narrateur souscrit complètement. En effet, l’infériorité des femmes est ici expliquée par l’idée selon laquelle elles se sentiraient castrées ; cette idéologie, loin d’être présentée dans le roman comme un frein à l’ascension sociale, semble au contraire parfaitement compatible avec l’accession aux chaires universitaires de psychanalyse, comme c’est le cas pour le narrateur. Pourtant, il est lui-même le contre-exemple total des théories freudiennes, du moins si l’on en croit les confessions qu’il distille au fil des pages.
24Le narrateur se dit l’auteur d’une « thèse fameuse » : « Un Œdipe dans une société matriarcale ». Le principe de l’Œdipe désigne, chez Freud, un désir sexuel orienté vers la mère, et un désir de mort orienté vers le père. Mais le désir de mort, pour le narrateur de Quand tu vas chez les femmes, est orienté vers la mère : « Mais c’est fini maintenant Mère chérie, nous allons nous retrouver tous les deux. Aux enfers » (p. 16), tandis que le père, dans sa seule évocation, est investi d’une charge libidinale à ce point violente que le vocabulaire lui-même devient agressif :
Autour de mes dix ans j’eus le fantasme que mon père m’enculait. Il me rentrait dedans par-derrière bien à fond, et nous jouissions ensemble en beuglant. Quand il me reprochait ma mollesse je le regardais l’imageant en train de m’enculer, dans la salle à manger Empire, debout, toute sa grosse bite dans mon cul si tendre et donné, lui appartenant, […] ma mère entrait et voyait ça, ne disait rien, c’était son droit naturel puisqu’il m’avait fait de disposer de moi […] (p. 253)
25Au contraire du passage où le narrateur croit comprendre le désir féminin, exprimé par un vocabulaire très abstrait, ce qui chez Rochefort symbolise l’incompréhension (« attachement névrotique », « morceau de leur corps intime », « misère immémoriale »), c’est ici un vocabulaire très cru qui montre l’incapacité du narrateur à comprendre l’infondé de la théorie freudienne. Alors même qu’il aurait eu, dans son expérience de vie, l’occasion de comprendre que la psychanalyse est l’opposé de la vie libidinale réelle, le narrateur se montre aveugle, accepte ce qu’il perçoit comme l’ordre du monde, l’ordre « patrisexuel » accordant à un patriarche le droit « naturel » de disposer de sa progéniture, y compris sexuellement, et conclut son souvenir par cet aveu d’oppresseur : « je veux que la loi sévisse dans sa rigueur, c’est la loi que je désire, parce qu’elle est » (p. 253).
26Ce désir de la loi configure toute la vision que le narrateur a de la société. Et cette vision s’avère bien plus violente que les mises en scène qu’il choisit de subir. Par exemple, lors d’une soirée mondaine à laquelle il a fait venir l’Ange, celle-ci décide de rentrer chez elle. Un autre masochiste lui propose sa voiture et son conducteur ; elle accepte. Immédiatement, le narrateur imagine un viol :
Ce travailleur travaillé par la faim sexuelle n’allait pas manquer une occasion de cette qualité, et Pétra est tout de même une femme, d’ailleurs serait-elle partie seule avec lui… Je la voyais saisie, l’auto garée sur une de ces petites routes de forêt connues sûrement d’Eziz, bousculée, investie, se rendant à la fin et d’avance consentante… » (p. 199)
27Cette scène révèle la violence politique du narrateur. L’Ange étant « tout de même » une femme, elle ne peut que se « rendre » ; Eziz étant un « morceau superbe et splendidement normal », il ne peut que l’agresser, entendu qu’il vient d’un pays « sous-développé » et ne peut donc être qu’un étranger libidineux aux yeux du narrateur. Cette banalisation du viol, raconté dans des termes tout aussi banals, a pour effet de choquer le lecteur. Car l’écran des termes psychanalytiques ne protège pas de cette image révoltante. Le simple fait qu’elle puisse être racontée de façon aussi badine prouve que la société patriarcale, jusque dans son langage, accepte le viol comme allant de soi, lorsqu’il respecte les stéréotypes bourgeois.
28Rappelons que le narrateur est un représentant de l’ordre bourgeois. Qu’il ne soit pas choqué par ces images, relevant du pénal, laisse deviner que sa vision est oppressive. La progéniture à disposition du patriarche, la femme à disposition de n’importe quel homme, étant « naturels » pour l’ordre bourgeois, sont tout simplement acceptés par le narrateur.
29C’est un tout autre genre de violence qui est dénoncé dans Le Lien, mais il ne s’agit pas de la vision de la narratrice. Dans le dernier chapitre du roman, elle évoque l’oubli de son sac à main dans la voiture de sa mère. Dans ce sac se trouve un cahier, qui recueille plusieurs « tirages en couleurs me présentant au mieux nue, mais le plus souvent attachée, écartelée, prise par un ou plusieurs mâles. Les gros plans de fellation et de sodomie alternaient avec des scènes de saphisme, d’urolagnie, sans oublier les clichés de mon infibulation » (Lien, p. 79). La narratrice voit sa vie privée d’adulte violée par ses parents, qui ouvrent son sac et en examinent le contenu.
La découverte de ces photos pornographiques provoqua un véritable scandale familial. Chacun se crut autorisé à me faire la morale, à me menacer – même de mort ! – ou à me couvrir d’injures.
J’étais définitivement répudiée. Depuis ce jour je ne reçus plus jamais de nouvelles de ma famille. Les semaines qui suivirent furent les plus dures à vivre de toute ma vie. Je sombrai dans une profonde dépression d’où seul Pierre put me sortir par la force de son amour. (p. 80)
30À la tyrannie familiale, qui reconduit « la cause de mon père, la cause de l’hypocrisie » (p. 80), s’oppose l’amour du Maître, qui est une force de vie. Bien que les clichés pornographiques soient choquants pour les parents, leur réaction témoigne d’une violence non consentie, organisée et destinée à effacer la « déviance ». En fouillant le sac de leur fille, d’une part, en divulguant le contenu, d’autre part, et en accablant la narratrice, ses parents structurent une répression violente et efficace. Sous prétexte de la protection surgit la menace de mort, tandis qu’à travers le jeu de la domination sourd la promesse de la vie. Cette opposition cachée fait écho au prologue du roman où la narratrice expose le fait qu’elle était une petite fille assez banale :
Cependant, et je n’ai jamais compris pourquoi, mon père me traitait souvent de petite dévergondée ou de petite salope.
Je n’étais pas particulièrement effrontée, mais il s’acharnait sur moi comme si j’avais commis les pires fautes. Je n’avais pas la moindre notion du péché, et longtemps j’ai forcé mon imagination à représenter ce qui différenciait une gamine ordinaire, comme mes camarades de classes ou mes sœurs, de la petite salope qu’on me disait être.
[…] Mon père prit l’habitude de me frapper à la moindre faute ou à la plus insignifiante rebuffade de ma part. Il s’emparait alors d’une de ses inquiétantes chaussures noires toujours impeccablement cirées et luisantes, de la ceinture en crocodile marron que mes sœurs et moi lui avions offerte à l’occasion d’une fête des pères ou d’un Noël, et m’en assenait plusieurs coups violents et bien ajustés afin qu’ils atteignissent les parties les plus sensibles de mon corps. (p. 7)
31Cette évocation de la maltraitance infantile, aussi crûment exposée, ne peut que choquer le lecteur. Le trouble ne serait que renforcé par une lecture simpliste, qui conclurait de ce roman que la narratrice n’est devenue une esclave que parce qu’elle fut maltraitée. Et pourtant, la raison assumée est tout autre, faisant écho à l’analyse de Deleuze :
[…] le masochiste se fait battre ; mais ce qu’il fait battre en lui, humilier et ridiculiser, c’est l’image du père, la ressemblance du père, la possibilité du retour offensif du père » (Deleuze, 1967, p. 66).
32En effet, dès le premier chapitre, la narratrice montre qu’elle a réussi à transformer l’injure parentale : « J’ai appris à crier haut et fort que je suis une putain, […] que je suis une salope et je sais le devenir lorsque j’en ai vraiment envie » (Lien, p. 12). Il s’agit notamment, de la part de la narratrice, d’une renégociation sémantique. Définie comme une « recontextualisation d’énoncés insultants […] à partir de leur charge blessante, effectuée par les personnes blessées, avec un effet réparateur » (Paveau, 2019, p. 111), la procédure de « re-signification » permet de se réapproprier un terme injurieux. Mais cette opération n’est pas seulement linguistique, pour la narratrice : le fait de devenir une esclave, et de traduire les sévices en actes d’amour, est une opération de re-signification vitale :
Je n’étais alors qu’une petite fille apeurée. Je refusais déjà de toute ma volonté la prédisposition de ma condition féminine, qui faisait de moi la victime d’un homme.
Je ne me suis jamais résignée qu’au sort que j’avais librement choisi. N’ayant pas la nature d’une guerrière, ne sachant pas opposer la violence à la cruauté, j’ai appris à dominer ceux qui usaient de moi en rendant mystique et ambiguë l’offrande de ma soumission.
C’est ainsi que les esclaves vivent : elles sont les seules à détenir les clefs des caves sombres et humides où les fantasmes des maîtres les hissent au rang de divinités. (Lien, p. 8)
33Le masochisme, d’entrée de jeu, est désigné comme une pratique émancipatoire, qui permet d’échapper à la « condition féminine », ce que tout le roman cherche à prouver. Devenir esclave pour ne pas être victime semble contradictoire, mais il s’agit clairement d’une lutte contre la désublimation répressive. En rejouant la violence masculine, en re-signifiant les gestes patriarcaux, la narratrice propose de lire son roman comme celui d’une émancipation paradoxale.
L’Ange, ou le rêve d’une société sans pouvoir
34Dans Quand tu vas chez les femmes, le personnage de l’Ange s’émancipe par son indépendance vis-à-vis du personnage-narrateur. Celui-ci croit pouvoir la forcer, par son argent, à devenir une maîtresse. Il se pense ordonnateur et dispensateur du désir, mais l’Ange ne se laisse pas diriger, ce qu’il ne peut que déplorer :
L’expérience que j’ai des femmes m’a enseigné que le désir à ce point compact est un ordre, ordre direct, d’inconscient à inconscient… Mais elle ? Non. Elle, non. Elle est la muraille du Temple, le barrage laser. Mon désir ne pénètre pas là, il ricoche, il revient sur moi, plus compact encore, contondant, douloureux. (p. 76)
35L’expression est claire : le narrateur considère que son désir à lui est un ordre, qui se passe d’être explicité. Professeur de psychanalyse, il peut sonder l’inconscient. Cependant, l’Ange échappe à ce qu’il impose aux prostituées, elle ne se laisse pas pénétrer (le verbe est ici à entendre aux deux sens), et se contente de renvoyer le narrateur à ce qu’il est : un oppresseur « contondant » et « douloureux ».
36Il en va presque de même pour la narratrice du Lien, qui détermine que « le sadomasochisme est un art, une philosophie, un espace culturel interdit aux menteurs et aux hypocrites assermentés » (p. 54) Par la mise à nu qu’elle exige, autant de l’esclave que du Maître, la pratique sadomasochiste est présentée dans le roman comme empêchant l’hypocrisie ; elle est, en cela, l’opposé de la société bourgeoise qui requiert le mensonge. Ce renversement des valeurs s’effectue par la notion d’honnêteté : la narratrice souligne à plusieurs reprises à quel point les Maîtres servent leurs esclaves. Par exemple, lorsqu’elle est forcée de se présenter, écartée, face à plusieurs Maîtres, elle explique :
Se présenter de telle façon oblige l’esclave mise à nu à mettre son corps en offrande quels que soient ses défauts, à mieux se connaître, à mieux s’accepter, à mieux s’assumer.
Par cette mise à nu, le corps livré, déshabillé, disséqué, est comme bafoué, humilié sans concession. L’être ainsi exhibé apprend le pouvoir de son corps et l’esclave tire sa force de la fascination qu’il exerce sur le maître. (p. 29)
37Là où l’oppresseur ne pense qu’à son désir et à ses ordres, le Maître permet à son esclave de s’accepter, et d’apprendre quelle fascination elle exerce sur lui. Au contraire de la disharmonie des relations sociales, où le corps se cache et s’efface, où les plus faibles sont marginalisés, le sadomasochisme met au centre des regards le corps offert, et en révèle le pouvoir.
38Les plus faibles sont plus à même de créer ce lien d’intimité. Dans le roman de Rochefort, l’Ange se montre très complice avec les prostituées, elle partage avec elles un sandwich et des discussions badines. Évidemment, le narrateur s’insurge : « […] penser, ça, pardon, ce n’est pas leur affaire, en tout cas pendant les heures, et après tout c’est moi qui paye ! » (Quand tu vas…, p. 35) Il n’est plus le maître du temps dès lors que son argent n’a plus d’emprise. Il ne parvient pas à payer l’Ange ; elle ne se laisse pas attraper. Il a beau la supplier de devenir sa Maîtresse, elle s’y refuse. Sa violence se situe à un autre niveau. Elle parvient à connaître le nom, la profession, la position du narrateur, et fait soudain irruption « [e]n haut de l’amphi, les ailes déployées » (p. 277). Un grand silence se fait, et le narrateur craint de voir sa double vie révélée à tous ses étudiants. L’Ange intervient au moment le plus critique, lorsque le narrateur expose le « diagramme où se démontre […] la gloire de [s]a vie », l’objet de sa thèse. L’effraction de Pétra, de la figure divine qui représente paradoxalement le réel, annule subitement l’illusion psychanalytique :
Ma vue se brouille, une onde de terreur pure se répand dans mes entrailles, va s’épanouir en épanchement abominable ici maintenant devant tous, non ! s’il Vous plaît ! Par pitié non encore un instant, bourreau, moi-même, laisse-moi de grâce le temps d’achever, de crier la vérité de toutes parts menacée, ne permets pas que je sacrifie à mes amers déportements ce qui ne m’appartient pas, appartient à la Connaissance, le monument si chèrement édifié dans le danger, la patience et les piqûres de moustiques et qui tant dépasse le cahotant véhicule qui lui échut, moi, indigne certes ô combien mais porteur, j’arrache de ma gorge le discours ancien, auquel l’expédition récente hélas n’a rien su ajouter, et incapable de me tourner vers mon public j’adorne mon diagramme de petits dessins et divers signes superfétatoires, la parole hachée, le souffle court, j’arrive au poteau couvert de sueurs contemplant atterré l’insane labyrinthe dont j’ai couvert le tableau entier, alors, de là-haut, Sa voix :
— Et qu’est-ce que vous pouvez observer d’autre, d’où vous êtes, que du faux ?
L’Épée m’a cloué à mon diagramme. Muet. (p. 280-281)
39La terreur du narrateur n’est pas, ici, transformée en jouissance. Au niveau du savoir, « la vérité », « la Connaissance », « le monument » s’effondre dans un « discours ancien », en « signes superfétatoires » qui se transforment en un « insane labyrinthe » et finalement en mutisme, alors que peu à peu les « amers déportements » se gonflent dans le « cahotant véhicule », qui termine, le « souffle court », par laisser la parole éclater : l’ordre exposé au tableau n’est que « du faux ». Au narrateur « atterré », au sens littéral, et « cloué », répond l’« Épée » qui se situe « là-haut », et libre, elle, de ses mouvements. Pétra se trouve ainsi libérée, aux yeux terrifiés du narrateur, de la société patriarcale.
40De la même façon, la narratrice du Lien affirme dès le début du roman que « [l]’un des plus grands bonheurs de la vie est de pouvoir liquider les tabous qui nous habitent. Je ne sais rien de plus enrichissant sur la connaissance de soi que d’y parvenir » (p. 12) Le masochisme est vécu comme une expérience enrichissante par la transgression qu’il implique. La narratrice est une masochiste sincère : elle ne fait pas partie des oppresseurs, c’est peut-être ce qui lui permet ce rapport limpide avec elle-même et ses tabous. Si, pour le narrateur de Quand tu vas chez les femmes, il s’agit d’une expérience de « terreur pure », c’est parce que toute sa vie, sa position sociale, est édifiée sur « du faux ». Cette mise en danger est éprouvante ; pour la narratrice du Lien, il n’en va pas de même. Elle commence à bâtir sa vie, et se réjouit de pouvoir le faire sans tabou.
41Cette libération de l’erreur ne s’arrête pas aux narrateurs. Pétra est invitée, de multiples fois, à des soirées masochistes où participent les « compagnons de galère », éditeurs, P.-D.G., journalistes reconnus. « Armée d’un Nikon » (p. 71), Pétra les photographie tous, et utilise ces informations pour les pousser dans des situations compromettantes : tel grand promoteur immobilier se retrouve, un jour d’inauguration, « déculotté vite fait, fouetté à bras raccourcis, planté là tel quel les fesses à l’air sans que fût laissé à quiconque (éventuellement) le temps d’intervenir. Et photographié sur le vif. » (p. 283). L’Ange multiplie les révélations, et force tous ceux qu’elle a rencontrés dans les soirées masochistes à se confronter à leur plaisir, dans la réalité. Chacun de ses coups d’éclat fait la Une, et le narrateur n’a plus qu’à constater qu’elle « vole de ses propres ailes. L’Ange. » (p. 288)
42Le masochisme permet une émancipation par l’inversion des rapports de domination : Pétra devient bien la maîtresse, mais ne se fait pas payer en argent. Elle révèle la double vie des oppresseurs, elle expose leurs faiblesses et leurs ridicules, sa seule existence fait voler en éclats l’illusion de l’ordre naturel. Lorsqu’il comprend cela, le narrateur est pris d’un rire nerveux : « Je ris pour la première fois depuis que j’existe, je ris tout, je ris ma vie entière. Le monde, cette plaisanterie divine, je ris aux larmes. Nu, dépouillé de tout, je ris à en mourir » (p. 293). Le roman se clôt ainsi : Rochefort ne cherche pas à peindre le monde d’après. Ces dernières phrases révèlent le véritable sujet de cette œuvre : le dépouillement. Le dépouillement d’un oppresseur, dans le cas de Quand tu vas chez les femmes, mais il peut aussi s’agir du dépouillement de ce que la société implique de négatif, dans le cas du Lien. La narratrice l’affirme :
Je suis une autre, aujourd’hui : j’ai considérablement changé ; j’ai appris à me contrôler, à réprimer mon agressivité et surtout à communiquer. En fait, ces pratiques constituent un nouveau langage du corps. C’est un nouveau mode d’expression que m’a révélé Pierre au travers de nos fabuleuses expériences sadomasochistes. (Lien, p. 50)
43Elle n’est plus soumise à la violence de la société, ni en lutte avec la société. La narratrice est une femme qui maîtrise son corps et le langage associé : elle peut dès lors communiquer avec les autres émancipé∙e∙s, et leur groupe s’oppose à un mode d’expression ancien, agressif, incontrôlé. De la même façon, à la « plaisanterie divine », qui organise le monde selon des principes moraux fixes, avec ses neufs ciels et ses neufs cercles infernaux, qui organisent le temps selon l’argent et le savoir selon les discours, s’oppose Pétra, qui se contente d’exposer l’hypocrisie des puissants. Par ses photos, elle montre que celui qui défend la thèse de l’Œdipe en est le contre-exemple parfait ; que tel éditeur très moral aime à se faire enfoncer « plumeaux » et « palmiers » dans le fondement (Quand tu vas…, p. 290), etc.
Et la morale devint perverse
44Pour échapper à la désublimation répressive, c’est-à-dire à un refoulement d’autant plus efficace que l’individu lui-même est sommé de se contrôler, Quand tu vas chez les femmes et Le Lien proposent donc une littérature « perverse », en ce que le sadomasochisme y est présenté comme un moyen d’échapper à l’injonction sociale. La récupération par l’ordre bourgeois n’est plus possible, car la pratique sexuelle est redéfinie comme intrinsèquement libératrice. Le narrateur du premier roman perd progressivement le contrôle, au profit de Pétra, qui expose les relations sadomasochistes dans la réalité sociale. En faisant éclater le joug des relations tarifées, qui renforcent le pouvoir du narrateur, elle rend très lisibles l’hypocrisie des puissants et la faiblesse de leur mainmise : il s’agit d’une illusion, d’une plaisanterie universelle à laquelle les individus se soumettent par habitude, ou par intérêt. La narratrice du Lien, pour sa part, apprend à lutter contre ses préjugés et se libère de ce qu’une « bonne fille » doit devenir.
45La déstabilisation des normes sociales passe notamment par un usage paradoxal du langage. En effet, la souffrance est dite dans les termes du plaisir, et inversement. L’érotisation de la violence3 est dénoncée, ainsi que sa banalisation. La société est décrite comme une société du fouet, où les rapports de domination sont irrépressibles ; le sadomasochisme apparaît comme le seul univers où les rapports sont honnêtes, libres, et positifs. Ce renversement des valeurs proposé par Christiane Rochefort est l’occasion pour le roman de disséquer la mentalité des oppresseurs, et le fonctionnement de leur arme favorite : l’argent. En introduisant de l’argent jusque dans les relations sadomasochistes, l’oppresseur reste en position de domination, puisqu’il achète du temps, et cela lui permet d’entretenir à jamais ses illusions. Même s’il est un contre-exemple vivant de certaines théories freudiennes, le narrateur de Quand tu vas chez les femmes ne s’en rend pas compte : son désir « patrisexuel » reste hors de sa grille d’analyse.
46La narratrice du Lien évoque, pour sa part, l’hypocrisie de la société bourgeoise à travers la figure de ses parents. Entre un père violent et une mère qui a épousé sa cause, la narratrice ne trouve aucun réconfort, aucun refuge. Et lorsqu’ils comprennent qu’elle est, malgré tout, heureuse, ils la répudient. À rebours d’une interprétation culpabilisante, la narratrice pose dès le début de son œuvre une explication de ses désirs : il ne s’agit pas de rejouer infiniment les sévices qu’elle a subis enfant, mais plutôt de les resignifier. En privant l’oppresseur de ses marques de domination, elle le rend impuissant.
47Et c’est par ce biais que la libération est possible : la narratrice du Lien découvre dans le sadomasochisme une connaissance de soi et de son corps qui la libèrent des carcans sociaux. Offerte aux regards, soumise aux ordres, elle rencontre ses limites et ses défauts : elle assume ce qu’elle est, car l’hypocrisie est impossible. De même, Pétra force les « compagnons de galère » à rencontrer leurs désirs oppresseurs, à devenir oppresseurs d’eux-mêmes, et finalement à abandonner leurs rôles dominateurs. La mise au jour des désirs qu’elle orchestre est une libération sexuelle au sens strict : il ne s’agit pas de la valorisation sociale d’un sexe acceptable, stéréotypé et reproduisant les rapports de domination. Il s’agit de l’exposition publique d’un sexe pervers, polymorphe, et déconnecté des réseaux du pouvoir : il s’agit d’une société sans fouet, celui-ci étant replacé dans les multiples potentialités d’une sexualité épanouie.