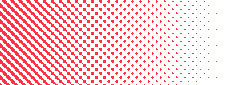Corneille vs Racine, selon La Bruyère : du lieu commun au mème
1« [Corneille] peint les hommes comme ils devraient être, [Racine] les peint tels qu’ils sont. » Extraite du plus connu des parallèles faits entre Corneille et Racine, parmi ceux de Longepierre (1686)1 et de Fontenelle (1693), puis autonomisée, la célèbre formule de La Bruyère a longtemps fourni une porte d’entrée privilégiée de l’histoire littéraire, notamment à destination des élèves. Incontournable y compris pour qui entend s’en démarquer, elle constitue une référence commune depuis plus de trois siècles.
2Son incroyable postérité interroge cependant. D’une part, son originalité toute relative ne semblait pas la prédestiner à un tel succès ; d’autre part, ce propos de La Bruyère n’a cessé d’être contesté parallèlement à ses reprises successives à travers l’histoire. Les raisons d’un tel succès tiennent peut-être alors moins à la pertinence et à la précision de la thèse elle-même qu’à sa forme et à sa généralité, qui en font un canevas étonnamment souple, capable d’embrasser les enjeux axiologiques et les stratégies rhétoriques les plus variées.
Une citation peu rigoureuse
3La formule de La Bruyère est bien connue. Pourtant, elle n’est pas exactement de La Bruyère. En effet, dans le parallèle de Corneille et de Racine des Caractères, rédigé pour la première fois en 1688, elle est soumise à plusieurs précautions oratoires :
Si cependant il est permis de faire entre eux quelque comparaison, et les marquer l’un et l’autre par ce qu’ils ont eu de plus propre et par ce qui éclate le plus ordinairement dans leurs ouvrages, peut-être qu’on pourrait parler ainsi : « Corneille nous assujettit à ses caractères et à ses idées, Racine se conforme aux nôtres ; celui-là peint les hommes comme ils devraient être, celui-ci les peint tels qu’ils sont. […] » (La Bruyère, 2018, p. 88)
4Enserrée dans un passage entre guillemets qui ne se terminera qu’avec le parallèle, la formule s’inscrit d’emblée dans un discours rapporté. De plus, ce discours est lui-même introduit par plusieurs modalisateurs : si, peut-être, ainsi que le conditionnel. Reprendre la formule de La Bruyère revient donc à citer de seconde main, la première étant dissolue dans un « on » anonyme et bien peu péremptoire.
5Mais la formule elle-même n’est pas rigoureusement une citation car les reprises ultérieures couperont le début de la phrase et remplaceront les pronoms anaphoriques (celui-là, celui-ci) par les noms des auteurs. Or, à la lumière du début, la suite apparaît plus nuancée : l’expression « les hommes comme ils devraient être » s’y révèle traduire les caractères et les idées de Corneille ; tandis que les hommes « tels qu’ils sont » ne sont plus que les caractères et les idées du public (les nôtres). Ces deux peintures, qui apparaissent parallèles dans la formule isolée, relèvent en fait de logiques rigoureusement inverses : l’une conforme le public aux caractères, l’autre conforme les caractères au public.
6Enfin, les quelques mots introducteurs qui précèdent les guillemets cadrent la perspective de La Bruyère : il s’agit bien pour lui d’énoncer les traits les plus distinctifs de chaque dramaturge (les plus propres, etc.), de les comparer l’un à l’autre, et non de les caractériser absolument. Dépourvue de ses guillemets et de ses modalisateurs, autonomisée, employée en un sens absolu, la formule que l’on connaît, ainsi isolée, paraît autrement assertive et réductrice.
Généalogie de la formule
7Parmi les voix susceptibles d’inspirer son parallèle à La Bruyère, il y a au moins une autorité. Lorsqu’il conclut son parallèle en rapprochant respectivement Corneille et Racine de Sophocle et d’Euripide (« Il semble que l’un imite Sophocle, et que l’autre doit plus à Euripide »), l’auteur des Caractères souligne déjà sa dette envers l’auteur de la Poétique. Car au poète accusé d’avoir, par nécessité (au sens que le célèbre traité donne à ce terme), commis une entorse à la réalité, Aristote conseillait de faire sienne « la parole de Sophocle, qui disait : Euripide représente les hommes tels qu’ils sont, et moi tels qu’ils doivent être » (1671, p. 138). La Bruyère s’est peut-être souvenu de cette traduction de 1671 lorsqu’il construit son antithèse dans les mêmes termes que ce neuvième paragraphe du chapitre XXV dans l’édition de Norville.
8Mais limiter à cette référence aristotélicienne l’inspiration de cette formule conserverait à La Bruyère l’entière paternité de son application aux deux dramaturges de son siècle. Or, ni la double filiation antique ni l’alternative entre deux manières de « peindre » ne reviennent au seul auteur des Caractères. Son parallèle vient en effet après une série de jugements formulés par ses prédécesseurs ; on en trouve notamment les prémices chez Saint-Évremond et Longepierre.
9Chez le premier, fervent cornélien, affleure déjà cette ligne de fracture entre deux peintures des hommes. L’auteur reproche à Racine de faire plonger les « choses héroïques » dans la « médiocrité », de représenter les personnages antiques « dans l’ordinaire et le commun ». Il regrette que le dramaturge, contrairement à Corneille, ne conserve pas aux héros leur « extravagance » et leur « élévation d’âme », et ne fasse pas « voir, de diverse façon, jusqu'où peut aller la grandeur de l'âme ». Ici toutefois, c’est bien Corneille qui conserve aux personnages antiques leur « véritable caractère », tandis que Racine leur fait « prendre nos sentiments » (Saint-Évremond, [1668] 1969, p. 81 et 90)2. Pour le cornélien, il faut en effet renoncer à la douceur de notre naturel. Son horizon d'attente procède donc à la fois d’une exigence de vraisemblance par rapport au sujet antique réputé plus « grand », et d’une valorisation éthique de cette grandeur : sous sa plume se conjoignent les deux perspectives, morale et poétique. La fidélité au code de représentation des caractères antiques coïncide avec cette « élévation d’âme qui nous [est] étrangère » tandis que la banalité est « purement française » et de notre temps. En ce sens, si Racine peint les hommes tels qu’ils sont, c’est tels qu’ils sont en ce médiocre xviie siècle jugé trop tendre. À l’inverse, si Corneille les peint tels qu’ils devraient être, c’est parce qu’il les peint tels qu’ils étaient supposés être dans cette antiquité peuplée de héros. On l’aura compris, la configuration du problème est plus complexe que dans l’opposition binaire que suggère la formule de La Bruyère dès lors qu’on l’isole. Car ce sont bien deux « vraisemblances » qui entrent en concurrence. D’une part une vraisemblance qui obéit à un code moral, jusqu’à « amalgamer », selon le mot de Gérard Genette (1968, p. 5), vraisemblance et bienséance. D’autre part un vraisemblable que ses défenseurs vont juger plus « naturel », qui se délie du code éthique et fait davantage place aux sentiments. Si l’alternative entre deux codes de vraisemblance structure d’emblée la comparaison entre Corneille et Racine, on voit comment sa reformulation dans les termes de La Bruyère tend à réduire le vraisemblable au seul « naturel ».
10Cette évolution de la notion de vraisemblance s’élabore progressivement. On voit ce procès à l’œuvre dans un essai de l’abbé de Villiers (1675), où l’auteur fait disserter deux personnages sur la pertinence d’un sujet amoureux dans une tragédie. L’auteur convoque alors les deux dramaturges en opposant d’une part l’« admiration » que suscitent des caractères comme ceux de Corneille, « fort éloignés des tendresses de l'Amour » (p. 76), et d’autre part l’attendrissement que suscitent davantage les personnages de Racine3. La nouveauté est que, dans ce dialogue, la peinture de caractères relevés et extraordinaires, d’une part, et celle de caractères plus tendres et communs, d’autre part, apparaissent antinomiques. Ici, non seulement le vraisemblable n’appartient plus qu’à la seconde peinture, mais la comparaison entre les deux œuvres particulières cède subrepticement la place à une distinction entre deux perspectives dramaturgiques générales. Certes on devine la référence à Corneille dans ses personnages aux « sentiments trop relevés et trop merveilleux », et dont « toute [la] conduite » paraît « trop éloignée du vraisemblable » ; et l’on reconnaît aisément l’allusion à Racine dans les caractères plus sensibles et plus vraisemblables que l’auteur leur oppose. Mais Racine et Corneille restent en effet comme à l’arrière-plan de l’échange, de sorte que le propos gagne en généralité, comme lorsque l’un des interlocuteurs regrette-t-il qu’« il y a[it] toujours dans la peinture » des héros admirables, « je ne sais quoi au-delà du naturel » (Villiers, 1675, p. 105-106).
11De la critique de pièces spécifiques chez Saint-Évremond à une dissertation sur un point de morale concernant le genre de la tragédie, l’opposition de fait entre deux dramaturges particuliers glisse donc vers une exclusion symétrique entre deux espèces de dramaturgies. Par-delà les œuvres, le dialogue invite à trancher : représenter soit des caractères idéaux, soit des caractères vraisemblables. En outre, alors que la vérité historique coïncidait avec l’idéal chez Saint-Évremond, chez Villiers la seule vraisemblance bascule du côté du naturel. Et tandis que le premier distinguait entre deux formes de vraisemblance, chez le second une seule vaut encore et demeure tout entière retenue d’un côté de l’alternative. Ces diverses simplifications des données de la comparaison préparent la formule antithétique de La Bruyère. Mais pour qu’advienne dans les esprits l’opposition radicale que celle-ci énonce, non entre deux semblances mais bien entre un idéal (ce qui devrait être) et le réel (ce qui est tout simplement), une dernière transition s’impose.
12Dans son parallèle, Longepierre pousse en effet la logique de l’opposition à son terme. Aux arbitrages antérieurs observés chez Saint-Évremond, opposant l’extraordinaire à l’ordinaire et la grandeur à la banalité, ou chez Villiers, opposant l’admirable au vraisemblable, Longepierre substitue la « pierre de touche du vrai et du faux » ([1686] 2000, p. 169)4. Tout au long de son texte, Longepierre met en regard les personnages « plus grands que nature », « merveilleux », « pas toujours ressemblants » de Corneille, et les personnages tout simplement « vrais » et « naturels » de Racine. Les oppositions entre l’artifice cornélien et le naturel racinien, entre l’orgueil de l’un et l’humilité de l’autre, entre l’esprit et le cœur, se recoupent pour n’en former qu’une. Ainsi chez Corneille, « [l]a vraisemblance même est blessée par ces manières trop spirituelles » (p. 171). La vraisemblance, ici, ne participe plus d’un code des vertus ; elle s’éprouve bien plutôt « [d]ans les endroits pathétiques », lorsque les personnages raciniens « s’abandonnent tout entiers à la seule nature et à la passion » et que Racine « en fait une peinture vive, naïve, et touchante, sans se soucier de la faire brillante et spirituelle ; partout il offre des images vraies, naturelles, suivies, bien placées » (p. 172). Le parallèle XV est des plus nets : Longepierre y déclare Corneille « admirable à bien peindre la grandeur d’âme, la vertu, la fierté, etc. Rien n’est plus grand, plus noble, plus héroïque que les sentiments qu’il étale », alors que Racine excelle « lorsqu’il touche les passions douces, telles que sont l’amour, la pitié, la tendresse, etc. » Mais si Corneille « ajoute un nouvel éclat à ces vertus », Racine, quant à lui, « met au jour » les sentiments. Chez Corneille, c’est l’« esprit » du spectateur qui est « frappé d’une admiration », tandis que chez Racine, c’est son « cœur » qui « se reconnaît » (p. 173). En somme, l’un peint mieux la grandeur d’âme, la vertu, la fierté ; l’autre les passions douces, l’amour, la pitié, la tendresse, l’amour. Les premières touchent à l’esprit, les secondes au cœur. À ces objets correspondent des qualités spécifiques d’expression : l’éclat de Corneille ; la délicatesse, la vivacité, le naturel, la pénétration précise de Racine.
13L’avant-dernière section du parallèle (XXVII) en résume le propos. Longepierre trouve notamment chez Corneille « une beauté plus fière, plus grave, plus vénérable, qui frappe davantage et qui le fait plus admirer » tandis qu’il relève chez Racine « quelque chose de plus tendre, de plus naturel, de plus plein de vie » (p. 182). Enfin, la dernière section (XXVIII) embrasse cette distribution des « beautés » par une double filiation : « disons que Monsieur Corneille approche davantage de Sophocle, et que Monsieur Racine ressemble à Euripide » (p. 183)5. Si l’affiliation de Corneille à Sophocle constitue alors une idée reçue qui date de l’éloge de Guez de Balzac au « Sophocle » français ([1643] 1665, p. 693)6, il n’en va pas de même du rapprochement entre Racine et Euripide, que Longepierre paraît inaugurer. Quoi qu’il en soit, avant La Bruyère, un critique – Longepierre – terminait son parallèle par cette double filiation en l’intriquant étroitement à l’alternative entre deux peintures. De quoi nuancer, en l’occurrence, la nouveauté du propos de La Bruyère dans les Caractères.
14Si « pein[dre] les hommes comme ils devraient être » pouvait encore relever du vraisemblable pour le parti cornélien de l’époque, il n’en va plus de même pour les partisans de Racine qui ne jugent vraisemblable, et bientôt tout simplement « vraie », qu’une peinture des « homme tels qu’ils sont ». Or en autorisant à tenir pour acceptable de représenter sur scène ce qui n’est pas nécessairement exemplaire, et à tenir pour valable ce qui n’est pas forcément moral, cette nouvelle délimitation du vraisemblable fait bouger les lignes non seulement en matière de représentations scéniques mais également, au-delà, en matière de représentations sociales. La formule de La Bruyère, quant à elle, achève cette évolution esthétique et sociétale, puisqu’elle ne se contente pas seulement d’élargir à l’ordinaire réalité des hommes tels qu’ils sont le giron du vraisemblable, et ce faisant de l’acceptable et du valable, elle l’y réduit. Le juste, qui était le bon, sera désormais aussi et d’abord le vrai. Une autre « morale du Grand Siècle » s’affirme dès lors.
Un lieu commun
15L’observation de La Bruyère n’est donc ni isolée, ni inédite. L’opposition entre deux « peintures » des hommes, admirables ou semblables, grands ou médiocres, comme la double filiation antique, ont déjà leurs jalons. La Bruyère n’aura qu’à reprendre ces discours en les synthétisant. Mais pourquoi sa formule, plutôt qu’un jugement antérieur qui eût au moins bénéficié du prestige de la nouveauté, s’est-elle seule gravée dans la mémoire collective ? Il convient d’expliquer ce succès et cette formidable postérité autrement que par une quelconque originalité.
16L’observation de La Bruyère est-elle au moins pertinente, juste, perspicace au regard des œuvres ? Pas davantage à en croire ses critiques. Car la formule est vite et vivement contestée. En 1709 paraît un court essai entièrement consacré à « montrer la fausseté » de la formule de La Bruyère, à laquelle l’auteur déplore que l’« on s’attache » :
Ce jugement, tant on le croit sûr, semble avoir déchargé le public d’examiner jamais autrement la différence de ces deux célèbres écrivains ; je ne m’étonne pas qu’il se soit si bien établi, la mollesse des esprits de ce siècle le favorise. (Thaphinon, 1709, p. 5)
17Revenant sur le parallèle dans sa première lettre à Voltaire (avril 1743), Vauvenargues cite également la formule comme un lieu commun, et la nuance :
Je sais qu’on a dit de Corneille qu’il s’était attaché à peindre les hommes tels qu’ils devraient être. Il est donc sûr, au moins, qu’il ne les a pas peints tels qu’ils étaient ; je m’en tiens à cet aveu-là. (Vauvenargues, 1874a, p. 324)
18Dans ses Réflexions critiques sur quelques poètes, Vauvenargues y revient : « ceux qui se sont aperçus qu’il [Corneille] était peu naturel à beaucoup d’égards ont dit, pour le justifier, qu’il s’était attaché à peindre les hommes tels qu’ils devraient être » ([1745] 1874b, p. 62). Si Vauvenargues nuance la formule, Voltaire la discrédite totalement, voyant dans cette « antithèse de La Bruyère » sans cesse répétée « une insigne fausseté » ([1761] 2011, p. 118). Contre l’observation de La Bruyère, il égrène les contre-exemples qu’offrent les caractères cornéliens et raciniens (Voltaire, 1870, p. 220).
19Pourtant la formule résiste. Bien que jugée incorrecte vis-à-vis des œuvres, elle en ordonne la mémoire collective et la transmission. Au xixe siècle, elle est l’incontournable sujet de dissertation des élèves et étudiants, jusqu’à constituer la leçon d’agrégation de 1861 (Revue de l’instruction publique en France et dans les pays étrangers, 19 sept. 1861, p. 399). Mais soumise à la réflexion, la formule joue un double rôle, celui d’un repère quasi mnémotechnique et d’un problème destiné à susciter la réflexion, comme dans ce sujet du brevet supérieur en 1887 :
La Bruyère a dit que Corneille avait représenté les hommes tels qu’ils devraient être, et Racine les hommes tels qu’ils sont. Cette pensée est vraie d’une manière générale. Montrez cependant que Racine a souvent peint les hommes tels qu’ils devraient être (héroïques), et Corneille les hommes tels qu’il sont (faibles, cédant à l’entraînement des passions). (Hémon, 1892, p. 55)
20Certaines fictions rendent compte de cette prégnance de la formule dans l’éducation des jeunes Français. Dans Le Vin de solitude, Irène Némirovsky montre l’« enfant » en train d’« ânonner » la formule ([1935] 2011, p. 1267). On en retrouve l’écho jusque dans le cinéma français : dans Les Dernières Vacances (1947) de Roger Leenhardt, la première scène montre une classe de rhétorique où le professeur, interprété par le réalisateur lui-même, rappelle la célèbre formule. Celle-ci est également évoquée dans Les Tontons flingueurs (1963), à travers la lecture de la dissertation de la jeune Patricia, comme une « vieille définition » ayant « tant servi ».
21Usée, la formule n’en reste pas moins d’usage. Son emploi sort rarement de cette ambivalence. Ainsi Lagarde et Michard prennent-ils bien quelques précautions oratoires avant de donner à lire ce « parallèle célèbre si souvent repris ». S’ils notent que son auteur « se plaît un peu trop aux antithèses rhétoriques, écueil du genre », ils n’en louent pas moins son « brillant » et sa « pénétration » ([1985] 2003, p. 399). Même les ouvrages d’histoire littéraire plus récents ne peuvent se passer d’aborder au moins ladite formule. Ainsi, quoi qu’il en ait, André Blanc la cite ; car « [p]our bateau que soit devenu le sujet, il se justifie historiquement » (2003, p. 485) ; l’impossible omission de la formule en entérine en même temps l’impérialisme.
22Malgré son discrédit, malgré sa déréliction tant de fois arrêtée, la formule n’en finit pas de poser les termes du débat. Comme le notent Les Échos du 31 mars 2006, le « vieux débat Corneille-Racine – le devoir contre la passion, les hommes tels qu’ils devraient être et tels qu’ils sont, etc. [sic] – a la vie dure » (Costaz, 2006, n.p.). Pour annoncer son dossier spécial consacré aux dramaturges « frères ennemis », Le Figaro littéraire du 13 avril 2006 met aussi en exergue la formule, au conditionnel, en rappelant incidemment les « générations de collégiens et d’étudiants » sommées de prendre parti dans cette querelle (Lapaque, 2006, n.p.).
23La formule constitue donc bien un « lieu commun » ; mais encore s’agit-il de rendre à cette expression toute sa dimension. Dans sa préface à Portrait d’un inconnu (1947) de Nathalie Sarraute, Jean-Paul Sartre attribue plusieurs sens à ce « beau mot » :
[…] il désigne sans doute les pensées les plus rebattues mais c’est que ces pensées sont devenues le lieu de rencontres de la communauté. Chacun s’y retrouve, y retrouve les autres. Le lieu commun est à tout le monde et il m’appartient ; il appartient en moi à tout le monde, il est la présence de tout le monde en moi. (Sartre, dans Sarraute, 1996, p. 36)
24Dès lors, le succès de la formule s’expliquerait moins par son sens, notamment par rapport aux œuvres, que par sa fonction sociale. À cette aune seulement peut se comprendre la postérité de ce jugement sans cesse discrédité. Loin de constituer un paradoxe, ce double aspect recouvre bien plutôt la définition même de la formule : « une unité qui signifie quelque chose pour tous en même temps qu’elle devient objet de polémique » (Krieg-Planque, 2009, p. 54).
Un lieu de mémoire
Les hommes tels qu’ils devraient être face aux hommes tels qu’ils sont. […] Quelques souvenirs de collège et des enchantements ultérieurs permettent à chacun d’avoir son point de vue dans l’affaire. Cornélien ou racinien, il faut choisir. En France, cette sempiternelle querelle est un lieu de mémoire. (Lapaque, 2006, n.p.)
25Ce journaliste du Figaro littéraire illustrait emblématiquement le statut acquis par la formule de La Bruyère, à la fois objet et instrument de la mémoire. Citée, répétée, relayée, transmise depuis plus de trois siècles, elle est, plus qu’un lieu commun, un lieu de mémoire au sens que Pierre Nora a pu donner à cette expression, dans l’ouvrage collectif du même nom. Aussi « abstrait et intellectuellement construit » que peut l’être une simple phrase, cette formule pourrait figurer, en littérature au moins, parmi ce que Nora désigne comme les « blocs les plus massifs de nos représentations et de notre mythologie nationales ». Mais comme le souligne l’historien, « la mémoire en effet est un cadre plus qu’un contenu, un enjeu toujours disponible, un ensemble de stratégies, un être-là qui vaut moins par ce qu’il est que par ce qu’on en fait » ([1984] 1997, p. 15, 7 et 16). Mais que fait-on, justement, de la formule de La Bruyère ? Dans quel « cadre » l’invoque-t-on volontiers et avec quel « enjeu », selon quelle « stratégie » ?
26Pour qui entend saisir une œuvre particulière (Le Cid, Britannicus, etc.) ou l’œuvre d’un auteur dans son ensemble (l’œuvre de Corneille, de Racine, etc.), la formule ne semble pouvoir être, on l’a vu, qu’un « raccourci » réducteur, une « insigne fausseté » ; et les contre-exemples abonderont pour la démentir. Bref, qui trop embrasse (le genre, l’époque, le binôme Corneille-Racine), mal étreint (l’œuvre de chacun).
27Cependant, le jugement de La Bruyère a pu survivre à ces polémiques justement dans la mesure où son souvenir ne s’inscrivait pas dans ce « cadre » d’analyse. Sa postérité coïncide en fait avec un principe d’organisation de la mémoire qui n’aurait pas l’œuvre comme seule unité de mesure. En effet, avant la diffusion massive de l’imprimerie, l’unité de mesure de la mémoire consistait moins dans les livres, qu’on pouvait ranger dans sa bibliothèque personnelle physique, que dans des fragments que l’on pouvait plus aisément ranger dans sa bibliothèque mentale. Ces « mémoires intertextuelle et pragmatique », comme l’écrit Michel Charles (1985, p. 105), « dispersaient dans les cases de la bibliothèque imaginaire non seulement le discours, mais ses éléments mêmes, qui fragmentaient jusqu’à la phrase ». Dans ce cadre tout cognitif, les dizaines de pièces de Corneille et de Racine sont moins aisées à conserver qu’une formule lapidaire. Une mémoire de « morceaux choisis », de passages paradigmatiques, en somme, plutôt qu’une mémoire des œuvres considérées comme totalités autonomes.
28Assurément, la démocratisation du livre imprimé n’a pas fait disparaître totalement cette mémoire par fragments. Elle survit dans des « événements paradoxaux » comme le dictionnaire. Car selon Michel Charles, dans la mesure où un tel ouvrage organise la mémoire selon des unités de mesure aussi minimales que les mots, « il fait jouer, dans le livre, la mémoire intertextuelle et culturelle » (p. 106). Mais d’autres événements paradoxaux peuvent allonger cette liste, comme les recueils de lieux communs, de citations, d’aphorismes ou de maximes, ou bien encore les anthologies, voire des manuels scolaires tels que ceux de Lagarde et Michard, qui ont opté pour le « principe de la collection » en proposant un « recueil de morceaux choisis [qui] n’a pas la prétention d’être savant, encore moins celle d’être complet » mais entend avant tout « permettre une vue d’ensemble » ([1985] 2003, p. 5). C’est donc aussi dans la mesure où cette mémoire intertextuelle survit dans des supports favorisant la fragmentation et la mise en réseau (avec lesquels il faut évidemment compter la « toile » d’internet et de ses « hyperliens »), que la formule a pu suivre son chemin de texte en texte, de citation en contestation, et – on y reviendra – de reprise en détournement.
29À l’inverse et réciproquement, les œuvres ont évidemment toujours existé en tant que telles, bien avant la démocratisation du livre. Mais dans la bibliothèque imaginaire, comme le souligne Jean-Marie Schaeffer, elles sont moins envisagées en tant que totalités closes (structures individuelles d’ensemble) que selon des « “traits” (stylistiques, thématiques, etc.) ». Par exemple, peindre les hommes tels qu’ils sont, ou encore tels qu’ils devraient être. De plus, cette mémoire intertextuelle est davantage organisée « selon des rubriques analytiques (par exemples rhétoriques) » (Schaeffer, 1992, p. 148), comme l’illustre emblématiquement l’antithèse de La Bruyère.
Un canevas
30Comme l’indique encore P. Nora, « les lieux de mémoire ne sont pas ce dont on se souvient, mais là où elle travaille ; non la tradition elle-même, mais son laboratoire » ([1984] 1997, p. 17). En tant qu’elle constitue un tel lieu, la formule de La Bruyère constituerait moins un contenu qu’un contenant, un canevas toujours disponible, toujours susceptible d’être reconfiguré, travaillé et élaboré à nouveaux frais. À un contenu aussi vaste que vague, disponible aux déterminations et aux stratégies les plus diverses, s’ajoutent des considérations propres à la forme oppositionnelle de l’antithèse. L’instauration de rapports différentiels autorise en effet une double, voire une triple prétention : le discernement, la totalité, et même l’équilibre.
31D’abord, le jeu des distinctions, qu'elles soient apparentes ou réelles, confère à l’antithèse une aura rationnelle en semblant faire la part des choses, au sein d’une époque qui conçoit de plus en plus le « goût » comme « discernement » avec La Rochefoucauld, avant que l'abbé Dubos ne valorise au siècle suivant le « goût de comparaison », dont tous les auteurs français du xviiie siècle feront l’équivalent du goût (Lichtenstein, 2014, p. 87 et 193).
32On sait par ailleurs les prétentions totalisantes de l’antithèse, largement promue par Victor Hugo, qui en fait une métaphore du monde, par exemple dans William Shakespeare : « l’antithèse [est] universelle, toujours et partout » ([1864] 2002, p. 346). Ramenée à deux pôles opposés, la diversité du domaine appréhendé paraît en effet aussitôt plus saisissable.
33Commode avant tout, diront les critiques, ce modèle n’en demeure pas moins beau au sens précisément théorétique qu’a pu donner la science à ce mot (voir Weinberg, 1997, p. 125), car il paraît à la fois embrasser une totalité et discerner en son sein. À l’aune des œuvres, l’antithèse pose essentiellement une perspective binaire et a pour fonction d’accuser le trait ; parfois même de façon à promouvoir l’un des termes (Racine) au détriment de l’autre (Corneille). Mais à l’aune du genre tragique, cette antithèse semble susceptible d’offrir une perspective non plus binaire, mais panoramique. Dès lors, si la même figure énonce une contradiction entre deux termes, en l’occurrence Corneille et Racine, elle énonce à un degré de généralité supérieur un certain équilibre. À ce second niveau de lecture, les éléments antithétiques s’excluent encore ; mais ils s’affrontent moins qu’ils ne se répondent. L’attention au duel entre auteurs le cède à une attention au dualisme de l’époque et de la tragédie ; il ne s’agit plus d’opposer deux œuvres singulières, mais de partager en deux le genre de la tragédie au xviie siècle. Ce faisant le discours insiste moins sur l’exclusivité de chaque œuvre par rapport à l’autre, que sur la totalité dont l’une et l’autre participent solidairement.
34Mais les seules qualités de distinction, d’exhaustivité et de juste milieu ne sauraient rendre raison à elles seules du succès de la formule. Car celle-ci est également abondamment reprise en dehors de son giron initial, hors duquel sa perspicacité, sa symétrie, et sa complétude supposées peuvent s’exercer à nouveaux frais.
Un mème ?
35La formule de La Bruyère n’est pas seulement répétée à l’envi, elle est reprise. Non répliquée à l’identique, mais sans cesse reconfigurée. Ainsi Corneille et Racine disparaissent et font place à d’autres entités, qu’il s’agit d’opposer selon les mêmes termes : par exemple Charles Chincholle « est comme Corneille, il peint les hommes non pas tels qu’ils sont, mais tels qu’ils devraient être », tandis qu’Alphonse Daudet « les [prend] tels qu’ils sont » (Claveau, 1889, p. 8.) ; Gustave Flaubert, en procès, affronte une « époque [qui] ne veut pas que l’on montre les femmes et les hommes tels qu’ils sont, mais tels qu’ils devraient être » (Masson, 2019) ; et alors que « Corneille peint les hommes tels qu’ils devraient être, [Fred Vargas] les peint tels qu’ils sont » (Meudal, 2006, n.p.). Les pôles de l’antithèse sont même investis d’éléments d’une autre nature, comme des genres littéraires ou encore l’art et le réel. Selon un journaliste, cet essai de Milan Kundera, Le Rideau, « définit le roman en l’opposant à la tragédie, celle-ci présentant les hommes tels qu’ils devraient être et celui-là tels qu’ils sont » (Larminat, 2006, n.p.) ; et ce personnage du Diable boiteux, Léandro, s’étonne d’un événement qu’il ne croyait « possible que dans la nature du roman, où l’on peint les hommes tels qu’ils devraient être, plutôt que tels qu’ils sont » (Lesage, [1707] 1876, p. 43). Si ces deux propositions livrent des visions opposées du roman tout en recourant à la même formule pour le faire, c’est que celle-ci est bien avant un tout un canevas à remplir.
36Libre de toute prédétermination quant à son contenu, la formule peut aussi bien embrasser des objets non littéraires. On l’appliquera alors sans difficulté au cinéma, pour juger par exemple, comme ce journaliste anonyme de L’Humanité du 13 janvier 2017, que le « cinéaste nippon Naruse, […] pour paraphraser La Bruyère, “peint les hommes tels qu’ils sont”, alors que son contemporain Yasujiro Ozu “les peint tels qu’ils devraient être” » (Anonyme, 2017). Après avoir narré la scène où un personnage cite la formule, tel critique juge le réalisateur « plus proche du premier [Racine] » (Bonnaud, 1996). Pour Bertrand Tavernier et Jean-Pierre Coursodon (1991),
si l’on voulait disserter sur la comédie américaine comme sur la tragédie classique, on ne manquerait pas d’opposer Wilder et Capra, ces deux pôles du genre : Frank peint les hommes tels qu’ils devraient être, Billy, pas menteur et plus sauvage, les peint tels qu’ils devraient l’être, c’est-à-dire tels qu’ils sont. (p. 975)
37Paul Verhoeven, lui, « ne conçoi[t] pas la vie en termes moraux. [Il] essaie de décrire les gens tels qu’ils sont, non tels qu’ils devraient être » (Couston, 2016, n.p.). Puisqu’il s’agit de peindre les hommes, l’art pictural peut aussi reprendre son bien. Aussi dira-t-on de Lucian Freud qu’il « montre les êtres tels qu’ils sont et non tels qu’ils devraient être » (Marnhac, 2005). Dans tous ces exemples, il s’agit toujours de définir en délimitant : en distinguant un artiste d’un autre, d’une pratique, voire encore de certaines conceptions du monde.
38Un tel usage ne pouvait échapper aux discours prétendant rendre compte de ces dernières. Ainsi peut-on lire que Rivarol reproche à De Lisle de Salle d’avoir, « comme Dieu, peint les philosophes, non tels qu’ils sont, mais tels qu’ils devraient être » (Platière, 1802, p. 12). Ainsi lit-on encore que « [t]el Racine, Tocqueville compose avec les hommes tels qu’ils sont et non, à la façon de Corneille, tels qu’ils devraient être » (Onfray, 2017, p. 136). Patricia elle-même, celle des Tontons flingueurs, juge que « si la vieille définition n'avait pas tant servi à propos de Racine et de Corneille, nous dirions que Bossuet a peint Dieu tel qu’il devrait être et que Pascal l’a peint tel qu’il est ». Derrière les auteurs, ce sont donc bien des courants qui s’opposent, comme dans ce passage de La Nausée où Roquentin distingue « l’humaniste qui aime les hommes tels qu’ils sont, [de] celui qui les aime tels qu’ils devraient être » (Sartre, 1938, p. 153). De l’histoire de la philosophie à la dissertation d’une lycéenne, l’antithèse offre ainsi un tour de force rhétorique : elle opère une division entre deux catégories en y incluant tout une matière, combinant de la sorte généralité et spécificité du propos. D’un côté, elle confère au discours la plus grande totalisation, et d’un autre, elle est gage de la particularisation la plus définitive. Car tout en limitant l’analyse à une simple bipartition, le canevas de la formule postule cette bipartition comme une summa divisio indépassable.
39L’alternative étant le modèle d’appréhension spontané de la politique, il était inévitable que la formule y soit employée pour servir à mettre en balance deux visions du monde, deux options, deux corps de doctrine. Ainsi en usera-t-on pour qualifier un responsable qui « consacre plus de temps à la France telle qu’il la rêve qu’à la France telle qu’elle est », se faisant « plutôt Corneille que Racine » (Kerdrel, 2021, n.p.), ou bien encore pour opposer deux rivaux, tels « Delors et Chirac, les Corneille et Racine de la politique – l’un prenant les Français tels qu’ils devraient être, l’autre tels qu’ils sont » (Kovarik, 2011). Il est clair ici qu’une telle présentation antithétique exclut tout débordement ; l’alternative indépassable de l’antithèse sert ainsi une alternance tout aussi indépassable réduisant le pluralisme au binarisme.
40Mais dans la mesure où une certaine définition de la politique a pu tendre à limiter son exercice à la gestion du réel, la binarité de la formule tend à ne plus servir que la cause unique du pragmatisme, comme sous la plume de ce responsable politique déplorant les choix des Français, qui se seraient « toujours reconnus dans Corneille plus que dans Racine » puisqu’ils accepteraient bien mal « de se voir tels qu’ils sont et non tels qu’ils devraient être » (Bourlanges, 2008, n.p.).
41Dans une perspective politique bien différente, mais toujours en recourant à l’exposition d’une fausse alternative, une autrice recourt à la formule pour ironiser à son tour sur la « légende dorée » d’une France résistante dès juin 1940 ou sur « l’esprit du 11 janvier [2015] » :
L’euphémisme a toujours cours, et la faculté de peindre, comme on disait dans ces dissertations d’autrefois où il fallait commenter le parallèle entre Corneille et Racine, le premier peignant les hommes tels qu’ils devraient être et le second, tels qu’ils étaient, la faculté de peindre la réalité telle qu’elle aurait dû être, telle qu’elle devrait être… (Wajsbrot, 2016, p. 85)
42C’est seulement dans la mesure où l’idéalisme, pour le dire sommairement, n’est pas nécessairement discrédité au regard du réalisme, c’est seulement là où l’utopie n’est pas d’emblée sommée de le céder au pragmatisme, que l’usage de la formule conserve à l’alternative un véritable équilibre. En droit, l’antithèse contribue à opposer fortement deux conceptions de la justice. Ainsi les juristes attachés à la notion de responsabilité, que celle-ci soit « mythe ou réalité », ont pu être associés
à Corneille dont on a résumé le théâtre en disant qu’il ne peignait pas les hommes tels qu’ils sont, mais tels qu’ils devraient être. Les partisans du néo-classicisme affirment de même que le rôle du Droit pénal n’est pas de considérer les individus tels qu’ils sont, mais tels qu’ils devraient être, afin de leur inculquer l’idée du devoir. (Léauté, 1961, p. 353)
43L’analogie, et le clivage axiologique qu’elle implique, n’est pas le seul fait de spécialistes. Dans le même esprit, tel journaliste cite La Bruyère pour réclamer « une justice [qui] s’honore à juger les hommes tels qu’ils devraient être. C’est-à-dire tous responsables […] » (Bride, 2011). À l’inverse, pour regretter le manquement d’une réforme du droit civil au « rôle de la loi et du droit, qui se soucient du plus faible », un sénateur cite la formule et déplore que les « représentants du barreau [soient] plus cornéliens que raciniens » (Portmann, 2016, n.p.).
44Le moindre débat de société semble susceptible d’entrer dans les pôles de l’antithèse, jusqu’aux programmes de télévision. Pour opposer les stratégies concurrentes de l’actuel et de l’ancien président de la BnF en matière de numérisation des livres, ce journaliste ouvre son propos en revisitant la formule : « Bruno Racine peint les hommes tels qu’ils sont. Jean-Noël Jeanneney, tels qu’ils devraient être », car le second envisage un « projet de bibliothèque numérique européenne » comme « une réponse et un espoir » face aux géants américains, tandis que le premier, estimant ce « rêve » irréalisable, entend se résoudre au monopole de Google (Beuve-Méry, 2010, n.p.).
45Tous ces détournements servent le propos des locuteurs en l’adossant à un héritage culturel supposé assez familier pour conserver son pouvoir d’évocation, si brève que soit la formule. Surtout, ces variations sur le même thème autorisent les locuteurs ; car la référence commune y devient le faire-valoir d’une thèse singulière. Du neuf, avec de l’ancien.
*
46Canevas partagé et transmis à travers les âges, l’antithèse de La Bruyère demeure disponible aux enjeux idéologiques et aux stratégies argumentatives les plus diverses. En cela, elle constitue bien une structure non seulement prête à l’emploi, mais également offerte à un travail infini de déclinaisons et de détournements. Or cette unité culturelle qui se répand en variant est précisément la définition communément admise du « mème ». La culture numérique a plus étroitement associé ce terme à des images déclinées, transformées et détournées ; mais la notion dépasse de loin ce motif. En droit, cette unité culturelle, comme le « lieu de mémoire », peut s’appliquer à toutes sortes d’objets sémantiques pour peux que ceux-ci soient partagés et partageables, et qu’ils le soient notamment en variant. C’est bien ce qui est arrivé à la formule de La Bruyère. Une fois constituée en lieu commun, elle a passé l’épreuve de la désuétude en demeurant disponible au plus grand nombre de variations. Reste à savoir si elle survivrait à l’oubli total des référents littéraires originaux, ou si la perte de ses référents et signifiés d’origine n’engage pas la dissolution de la formule elle-même. En somme, l’unité culturelle suppose-t-elle une culture unie ? Et la formule peut-elle se conserver sans la conservation de la littérature dont elle procède ?