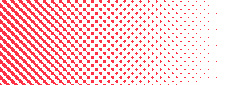Écriture et oralité
L’épopée grecque a vu le jour dans les « siècles obscurs » qui ont suivi l’effondrement de la civilisation mycénienne des Palais. Le genre a permis au peuple grec, qui avait fui le continent et s’était disséminé dans les îles, de garder son identité culturelle en dépit de cette diaspora. Après le monde d’Antoinette Rychner (Buchet/Chastel, 2020) raconte l’effondrement de nos sociétés complexes. Or, dans le récit, ce cataclysme entraîne aussi la renaissance du genre épique et de la performance orale comme ciment de nouvelles formes de communauté. C’était l’occasion de parler avec Antoinette Rychner du rapport entre écriture et oralité dans une période de crise profonde de nos modèles politiques, de notre usage du langage et de notre présence au monde.
***
Effondrements
Jean-Christophe Cavallin : Après le monde est l’histoire d’un double effondrement : l’effondrement de nos sociétés technologiquement complexes, remplacées par divers dispositifs de collectifs résilients ; et l’effondrement d’une civilisation de l’écriture, remplacée par l’émergence d’une nouvelle forme de culture ou de tradition orale (« notre épopée »). Quel lien faites-vous entre les deux phénomènes ?
Antoinette Rychner : Ce lien s’inscrit dans un constat. Dès lors qu’on l’examine sous l’angle de la durabilité écologique et sociale, le secteur culturel se révèle très critiquable. Comment ne pas répliquer le système capitaliste, extractiviste, productiviste à l’intérieur de notre économie d’acteur·es culturel·les ? En tant qu’artiste, je me pose des questions de plus en plus lancinantes sur nos modes de productions — avec le sentiment que dénoncer l’industrie (pétrolière, agroalimentaire, etc.) et la société de consommation ne suffit plus.
J’aimerais en appeler à des chemins de sobriété ou, pour le dire brutalement, à produire moins. Cette idée paraît choquante au premier abord, non seulement parce qu’il existe un tabou autour de la question quantitative (abondance de l’offre des « produits » culturels), mais aussi parce qu’il est dérangeant de mettre sur le même plan biens matériels et biens symboliques.
Je ne remets pas en question le fait que toute société a besoin d’artistes. L’accès à la culture reste à mes yeux un droit citoyen inaliénable et je défendrai toujours l’importance des budgets publics qu’il faut y allouer. Vu notre système de valeurs et l’hyper-matérialisme de notre époque, il semble bien plus urgent de réduire la production de chaussures que la création de spectacles. Pourtant, la stricte séparation entre biens matériels et bien symboliques est uniquement théorique, puisque, dans nos sociétés, la production et la diffusion d’une œuvre implique des flux importants d’énergie et de matière, au même titre que les produits industriels. Qu’on pense seulement à la quantité de courriels générés par n’importe quelle réalisation et au fait que chacun de ces messages électroniques a un impact sur l’environnement.
On pourrait croire que les arts vivants, du fait de leur oralité, consomment moins que d’autres arts, mais voyons ce qu’il en est d’Avignon : « 300 000 affiches collées ; les théâtres tournent toute la journée puisque qu’il y a des spectacles en permanence durant le festival ; les salles doivent être fortement climatisées (période estivale, surchauffe des projecteurs), etc. Le coût énergétique et l’impact écologique doivent être multipliés par 1 500, soit le nombre de compagnies, puis par 200 soit le nombre de théâtres. » (https://www.linfodurable.fr/.../affichage-plastique-et...)
Il faut donc considérer que si le festival d’Avignon avait lieu 7 fois par an dans 50 villes à la fois, son impact serait catastrophique — quand bien même cette démultiplication de spectacles décuplerait la diversité en matière d’esthétiques théâtrales et représenterait un bénéfice socio-économique important du fait de la création de nombreux emplois. Il existe des questions de limites physiques, de croissance critique dans le domaine de la production culturelle comme ailleurs et il me semble urgent de s’interroger démocratiquement autour de ces seuils, proportions et limites, sans prendre de gants sous prétexte que la culture serait sacrée.
Très honnêtement, si je mets de côté des conséquences sociales extrêmement inquiétantes (pertes de revenus, faillites, etc.), le frein brutal imposé par la crise du Covid à la production et à la consommation culturelle ne m’a affectée que de manière très relative. Et cela vaut pour la plupart des autres ruptures de mode de vie que cette crise a entraînées. Oui, l’annulation de projets et de voyages est frustrante voire douloureuse ; oui, les théâtres et les bistrots me manquent, mais je peux sans peine envisager une limitation du nombre d’expériences à notre disposition tout en me projetant dans une vie authentiquement humaine et qui vaudrait la peine d’être vécue.
Depuis une quinzaine d’années, tout en cherchant à faire reconnaître professionnellement mon statut d’auteure, j’ai pris conscience qu’en matière sociale (revenus, protection sociale, retraites), l’économie de la culture n’était absolument pas durable. Et je le dis d’autant plus du point de vue suisse, où le système d’intermittence n’existe pas sous forme comparable à la France. Du coup, je me suis mise à rêver à un univers où la subsistance ne serait plus liée au nombre de productions et aux volumes de diffusion, un monde sans pression économique à la création et à la visibilité, un monde sans concurrence, et même sans droits d’auteurs…
Le propre du récit d’effondrement est de procéder à une table rase fictive, avec l’avantage d’imaginer des structures alternatives de société. En m’appuyant notamment sur Bolo’bolo, un essai d’écologie politique du suisse alémanique P. M., paru en 1983, je me suis plu à imaginer une organisation socio-économique où les communautés prendraient soin de leurs poètes comme de n’importe quels autres de leurs membres.
Le passage par un effondrement autorise aussi à revoir tout l’édifice logistique — infrastructures, circuits de production et de distribution des biens. Je me suis imaginé les formes les plus pauvres, les plus nues techniquement, les plus « pures » d’écriture et de transmission du verbe. « Écriture » au sens d’un acte de résilience, pour se remettre du traumatisme : faire récit, trouver un ordre, redonner sens, quand bien même ce qu’on ressent tient du chaos. « Transmission du verbe » au sens d’un récital, d’une expérience orale « en public », on pourrait dire aussi « échange » car celle ou celui qui chante ou dit reçoit aussi de celles et ceux qui écoutent.
*
1J.-C. C. : Vous avez écrit un livre sur la fin de l’écriture. N’est-ce pas un paradoxe et comment ce paradoxe a-t-il entravé ou nourri la production du texte ?
A. R. : Je ne pense pas avoir écrit un livre sur la fin de l’écriture, plutôt sur l’immortalité, l’irréductibilité et l’universalité du besoin de témoigner. Mais j’ai choisi pour ce faire un mode de publication étroitement dépendant du réseau industriel que je prétends condamné à brève échéance. Alors oui, c’est paradoxal. Comme d’innombrables gestes de la vie sociale, quotidienne… C’est un peu comme si j’avais un pied dans le monde post-effondrement — fruit d’une projection nourrie de données scientifiques — et un pied dans le monde d’aujourd’hui, qui reste ma niche matérielle, sociale, culturelle… Impossible de s’en abstraire !
*
J.-C. C. : Avez-vous mis en place des techniques singulières de partage entre oralité et écriture ?
A. R. : En 2017, j’ai reçu une carte blanche du festival Actoral, à Marseille, et j’ai demandé à deux compositrices-interprètes — Stéphanie Barbarou et Christelle Boizanté — de mettre en voix des fragments du roman que je démarrais. On a performé ensemble, elles par musicalité et bruitages à partir des chants écrits, moi par simple lecture à partir des chapitres de narration à la troisième personne.
Sur le moment, cela m’a beaucoup aidée, parce que je me posais énormément de questions à propos de la nature des « chants » : ce que ma fiction présentait comme « chant » pouvait-il vraiment se prêter à l’oralité ? Ces passages n’étaient-ils pas trop remplis de données géopolitiques et d’informations ? Qu’en serait-il du plaisir de l’émission et de l’écoute ? Pouvait-il en sortir quelque chose qui parle à l’affect, à l’émotionnel, pas uniquement au cerveau ? « Il n’y a aucune rime, me disais-je, aucune métrique repérable, seulement une sorte de rythme que je suis peut-être la seule à percevoir. »
Il m’a suffi d’entendre Stéphanie Barbarou et Christelle Boizanté pour que ces questions tombent d’un coup. Je leur avais envoyé les fragments et elles avaient eu toute liberté pour s’en emparer. Ce qu’elles en ont fait m’a subjuguée. C’était grave, inventif, profond, parfois drôle, comme cet air cadencé à deux voix et maracas tiré du passage de la Moon-cup (premier chant du livre).
*
J.-C. C. : Dans votre expérience, l’oralité est-elle une forme de communication dont le pouvoir de communion est supérieur à celui de l’écriture ?
A. R. : C’est une question que je me pose pour ainsi dire depuis toujours, sans y trouver de réponse définitive, pour la bonne raison que si l’on parle de communication dans l’absolu — en tant qu’une onde, un flux qui se déplace d’un être à un autre ; idée, émotion, influence, ordre, supplication… —, je pourrais citer bien des exemples d’expériences personnelles où le média écrit (correspondance sur papier ou numérique, lecture d’un essai ou d’une œuvre de fiction) s’est révélé plus puissant et fécond qu’un rapport parlé. (C’est peut-être aussi un rapport plus difficile à rattraper quand il implique de la violence, puisqu’inscrit, avec son effet noir sur blanc qui élimine beaucoup du flou d’interprétation et de variantes de remémoration possibles).
Ça me semble donc délicat d’affirmer quelque supériorité (de pouvoir) de l’oralité en soi sur l’écriture.
Cela posé, il faut reconnaître que, sous certaines conditions, c’est précisément son caractère non médiatisé, son essence éphémère, directe et immédiate — partir de l’organe de quelqu’un et atteindre l’organe de quelqu’un d’autre, sans support ni transaction intermédiaire — qui constitue l’avantage spécifique de l’oralité.
À mes yeux (à mes oreilles surtout !), ces conditions sont probablement réunies à partir du moment où il y a une assemblée, un regroupement d’êtres, une concorde d’attentions portées au même objet, dans le même espace, à un moment donné.
Si quelqu’un se met à raconter une histoire, ou à gratter une guitare en présence d’autres personnes et que ça prend, qu’il se passe quelque chose, tout le monde le sent aussitôt : l’attention de chacun converge, et alors, au lieu d’obtenir une addition d’attentions individuelles, on obtient une multiplication, ou démultiplication de ces attentions et dès lors que ce phénomène advient je parlerais de communion.
Un livre — sa lecture silencieuse, mentale et individuelle — peut mettre en communion deux êtres, indéniablement, en tout cas deux esprits, indépendamment du fait que l’un des êtres soit mort.
Mais sitôt que l’on parle de communion de groupe, alors oui l’oralité est la plus forte, la plus opérante, et pas seulement parce qu’elle serait un moyen obligé, le seul possible pour que tout le monde reçoive la phrase en même temps ; j’ai exploré à de multiples reprises l’emploi de l’écrit dans des performances ou spectacles, où le public était invité à lire chacun pour soi un texte projeté sur scène1 ; l’effet n’est pas du tout le même, bien que tout le monde lise la même chose au même moment et dans le même espace !
Un contenu transmis par la voix, c’est-à-dire non « fixé » et qui n’existe que dans le temps de sa profération, prend une valeur particulière parce que proféré uniquement pour les personnes présentes — dans le cas d’un récit épique ou d’une parole poétique ; pour la beauté du geste, comme un cadeau de grand prix — et au prix d’un effort tangible, d’une prise de risque.
Qui dit performance dit mélange de plaisir et de peur ; à cet égard, l’oralité est plus dangereuse que l’écrit, parce qu’elle expose les deux parties, à découvert et avec moins de possibilité de fuite (quitter une salle de spectacle n’est pas discret. Et ne parlons pas de quitter une scène…).
J’ajouterai que, lorsqu’on parle de communion de groupe, la musique me semble jouir d’une supériorité sur le verbe (langage).
Devant des expressions chantées, slamées, où le verbe obéit à des rythmiques, où il pulse, mais plus encore devant la musique sans paroles, qui ne mobilise pas du tout la compréhension langagière, je le ressens toujours, dès la première mesure.
Et lorsqu’en ma présence, quelqu’un·e prend une guitare et joue, même mal, je ressens mon insuffisance d’expression directe, d’expression qui parle au corps, au corps de toutes et de tous en même temps. Aussitôt, ça me renvoie à la lourdeur, à l’artificialité et à la vanité de mon armada à moi, en tant qu’auteure de littérature : édition, chaîne du livre, cercle critique et de réception assez restreint qui doit savoir lire ma langue (pas seulement le français, mais un français qui joue parfois avec le suisse-romand), être sensible à des codes tels qu’une ironie peut-être spécifique à un groupe socio-culturel, etc…). Tout ceci est balayé en trois secondes par la portée de la musique, que je ressens comme infiniment plus inclusive, universelle et immédiate.
(Bon j’écris et je publie toujours, et je n’ai pas encore pris le moindre cours de guitare, donc il faut croire que le phénomène ne m’a pas complètement découragée…)
Mais c’est un complexe qui a très certainement joué dans l’écriture d’Après le monde, dans mon désir d’y mettre en scène des communions de groupe à travers du verbe chanté, et dans ce que j’y raconte à propos de la différence de personnalité entre mes deux bardesses ; l’une plus en retrait et plus introvertie, que j’associe à l’écriture-lecture mentale, l’autre prête à se « mouiller » dans l’oralité et ses happenings, prête à tenter un rapport instantané à autrui, sans filtres et sans filet.
*
J.-C. C. : Dans Après le monde, la récitation publique des deux bardesses succède à la pratique d’« organiser des brunchs » qui était l’ultime mode de regroupement ou de réunion d’une société technologique complexe, largement atomisée, sur le point de s’effondrer. « À quel point nous réunir comptait », récitent les deux aèdes. Pourquoi l’oralité semble-t-elle impliquer dans votre livre un nouveau rapport au collectif ou une nouvelle forme de pratique sociale réunifiante par rapport à l’écriture ?
A. R. : Les avantages que j’ai cités plus haut (éventuelle supériorité de l’oralité sur l’écriture, qui se vérifie en tout cas pour la communion de groupe) n’ont en soi rien de nouveau. Ce qui est peut-être nouveau — ou archaïque — et qui nous frappe puisque nous sommes immergés dans une société technologique complexe, c’est que ces récitations ou happenings oraux se produisent, dans l’univers de mon roman, de manière spontanée, sans grande préméditation ou accord préalable des parties. Ça naît, ça s’approuve et ça s’apprécie sur le moment, au contraire du concert d’aujourd’hui ou de la lecture publique, qui, s’ils se présentent comme des actes de communication directe, sont en fait le produit d’une longue planification et transaction entre deux parties — émetteur·e/récepteur·e —, sans parler des équipes qui les mettent sur pied et les organisent. Pour que le moindre événement « culturel » ait lieu, il y a tout un travail préalable de demandes d’autorisation, de contrats, de négociations commerciales, d’opérations de promotion, d’annonces en ligne, etc. Finalement, ce qui dicte que l’événement ait lieu ou pas et ce qui lui donne son crédit (artistique, monétaire, social) n’est que très partiellement le fruit des forces en présence dans l’espace et le moment où la performance a lieu.
Même les fameux brunchs d’aujourd’hui, s’ils échappent mieux à la marchandisation (on n’achète pas de billets d’entrée et on y apporte une tresse fait maison !) sont planifiés à l’avance, et souvent par l’entremise de messages postés sur les réseaux, d’échanges Whats’app, etc.
*
J.-C. C. : Dans les dernières pages du livre, le dernier manuscrit de l’épopée de Christelle et de Barbara est détruit et une jeune femme se met à improviser un chant repris par le « chœur unanime » de femmes réduites en esclavage. Après les multiples tentatives de conjonction entre culture de l’écrit et pratiques de l’oralité qui jalonnent le livre, est-ce finalement l’émergence d’une post-littérature exclusivement orale, un retour aux sources du chant et à une épopée véritablement « orale et collective » ?
A. R. : Assurément, il y avait à la fois l’ambition de créer une fin cathartique, avec un genre de résolution, et l’envie de montrer une pulsion orale et créatrice dépassant l’individu et sa condition de mortel — soit un « triomphe » relatif. Mais je ne crois pas que cette fin allégorise le dépassement de l’écrit par l’oral, avec valeur d’annonce, d’avènement pour le futur, dans la mesure où pour moi les communautés de Malmö et de Törmänen continuent d’exister après la fin de mes héroïnes. Entre écrit et oralité — entre les légitimités respectives de ces deux modes de création, leur valeur ou pertinence, leur adéquation à nos capacités techniques et à nos besoins symboliques et sociétaux —, je n’ai pas voulu choisir.
*
J.-C. C. : Barbara commence à rédiger un poème à la mort de son mari. C’est l’origine de ce qui deviendra l’épopée composée par Barbara et Christelle. Est-ce que la nouvelle pratique du récit ou du témoignage sur ce qui « nous » arrive s’apparente pour vous à un travail du deuil ? Est-ce que le récit peut être une façon de rendre acceptable le mal qui vient et l’étendue des pertes et des renoncements que ce mal va entraîner ?
A. R. : Je crois beaucoup aux vertus thérapeutiques de l’écriture, du récit ou témoignage, dans le sens d’un protocole qui rend possible d’accepter, de transcender le tragique. J’en ai fait récemment l’expérience très personnelle, à travers l’écriture et la publication de Peu importe où nous sommes (Genève, Éditions d’autre part, 2019), qui revient sur les six mois de traitement de notre fils aîné pour une leucémie (5 ans au moment du diagnostic). Je suis convaincue que ce récit a été, comme vous le dites, « une façon de rendre acceptable le mal » qui avait surgi. D’abord pour moi seule, au moment de créer le récit, ensuite pour d’autres, au moment de la parution qui a fait de ce livre un geste non seulement littéraire, mais aussi éminemment social : rendre hommage à la communauté médicale, à celle des parents d’enfants malades, à celle des amis et de la parenté qui nous ont beaucoup soutenus…
Mais ce texte témoigne d’une aventure qui dans la vie s’est bien terminée (notre fils est en rémission) et le récit est rétrospectif (comme l’écriture de Barbara à propos de la mort de son homme). Aussi bien l’exemple du dernier chapitre, avec le personnage de Zuulikki qui se met à chanter dans une situation désespérée, répond-il peut-être davantage encore à ce problème du deuil — même du deuil anticipé — et des moyens à notre disposition pour y faire face. J’ai essayé de situer l’initiative de Zuulikki à l’intersection entre deuil et travail prospectif, subversif. Zuulikki pleure ce qui est arrivé et continuera d’arriver : la mort, la perte, la destruction, le mal. Peut-être le simple fait de pleurer à plusieurs, et sous une forme esthétisée ou ritualisée représente-t-il une consolation en soi ; c’est ce que j’ai voulu dire par « commune affirmation d’être autre chose que de la chair en sursis ». Au regard du cosmos ou de la biologie, les humains ne sont-ils rien d’autre que des organismes promis à l’extinction, individuellement et comme espèce ? Du point de vue de la consolation, ce n’est pas tellement la vérité qui importe, mais la capacité de défier cela à plusieurs, et sous une forme soignée, sacrée.
J’ai aussi voulu faire émerger l’idée que ce chant est une résistance, au sens politique, parce qu’il défie l’oppression des geôliers et rallie, mobilise un groupe de victimes. Ça donne une ouverture sur un renversement possible, même si les forces en présence sont inégales. C’est donc à la fois une pratique pour accepter et pour ne pas accepter — un épisode de résilience et un épisode de résistance.
*
Les bardesses
J.-C. C. : L’effondrement de l’empire romain fut précipité par les forces conjuguées des invasions barbares et des progrès du christianisme. Au-delà de raisons conjoncturelles (les noms et prénoms de vos deux collaboratrices Stéphanie Barbarou et Christelle Boizanté), doit-on voir dans le couple formé par Barbara et Christelle une forme d’allégorie historique ?
A. R. : Vous me voyez fascinée, comme souvent, par la richesse des interprétations possibles ! Rien n’est faux, toute hypothèse est recevable. C’est juste l’écart de perspectives qui peut être rigolo, entre le moment de l’écriture et le sens donné après coup par celles et ceux qui reçoivent l’œuvre… Alors non, je n’ai pas du tout pensé à l’effondrement de l’empire romain en créant mes bardesses, mais un texte est sans doute toujours plus intelligent que son auteur·e. La thèse semble cohérente. Et puis il est vrai qu’un jour, devant mon manuscrit, ça m’est passé par la tête qu’il y avait « barbare » dans « Barbara »… Mais je ne savais pas du tout quoi faire de cette découverte !
Voici approximativement la genèse de création de ces deux personnages — à prendre avec précaution (je me méfie toujours des récits de genèse qu’on construits après-coup, qui ont une fâcheuse tendance à devenir autonomes et peut-être artificiels par rapport aux processus réels, imperceptibles et trop subtils pour être identifiés et organisés de manière chronologique).
D’abord il y a eu une sorte de vision d’une « paire », d’un duo d’inséparables (gémellité ou sœurs siamoises) aux caractères antinomiques, qui me permettrait de mettre en scène les différentes puissances de l’oralité et de l’écriture. Ce dédoublement m’autorisait en outre d’exprimer des points de vue divergents sur des thèmes comme celui de l’écriture inclusive — accord au « féminin générique », etc. Bref, je pourrais attribuer aux deux bardesses mes questionnements et tiraillements d’auteure. Je savais qu’elles seraient des démiurges, des compositrices. J’ai pensé assez tôt à deux strates de texte, chants/chapitres, dans l’idée de varier mes armes, et je savais qu’une strate serait enchâssée dans l’autre, avec cette production intra-diégétique des chants qui permet d’accéder à l’histoire de leur composition.
Ensuite, ou peut-être en même temps, il y a eu la volonté de ne pas limiter l’histoire au destin de personnages principaux. Dans mes écrits « de chauffe », je n’avais pas encore de prénoms et désignais mes bardesses par des lettres. J’ai préféré éviter le A, qui induisait fatalement un personnage Alpha. Du coup, je les ai désignées par B. et C., et comme je ne savais pas comment continuer, c’est resté longtemps leur appellation et devenu une identité par la force des choses.
Finalement, dans le roman achevé, on peut quand même identifier des personnages principaux : les deux bardesses, et leur entourage proche. Ce développement a été plus fort que moi…
J’ai patiné un moment pour savoir quels autres personnages je créerais et comment s’articuleraient leurs trajectoires. Une étape-clé a été le fait de caler ma structure sur celle de l’alphabet, de pousser jusqu’au bout le principe du B., C., D., etc. Autant de chants que de voyelles, autant de chapitres que de consonnes. Des réglages liés au montage du récit sont venus assouplir cette règle. Le nombre et l’emplacement des chants n’a plus respecté celui des voyelles ; mais s’agissant des consonnes, la règle s’est conservée. J’ai d’abord écrit une version complète avec Bée, Cée, Dée, etc.
Mon éditrice a trouvé que cette formule créait un problème d’incarnation qui entravait le suivi du récit et j’ai tout remplacé par des prénoms. Pour moi, ce livre devait atteindre une capacité « d’emporter » la lectrice ou le lecteur dans une histoire, par un souffle épique, il devait viser des phénomènes d’identification et contribuer à transmettre une alerte. Cet enjeu me paraissait plus important que le jeu stylistique ou le geste formel (même si une recherche de forme n’est jamais gratuite).
Cela m’a coûté de remplacer Bée et Cée par Barbara et Christelle, davantage que pour les autres personnages, parce que je m’étais attachée à ces dénominations. J’aimais « Bée » tout spécialement : bée, béance…
*
J.-C. C. : Pouvez-vous préciser le fonctionnement complémentaire ou conflictuel du couple d’une scribe agrippée à la pratique et à l’archivage de l’écrit (Barbara) et d’une bardesse s’aventurant vers de nouvelles formes d’oralité (récitation rythmique, improvisation) ?
A. R. : Une réponse désinvolte serait de dire que Barbara est affligée du complexe : « La littérature écrite, c’est bien joli pour un public de festival, dans l’entre-soi de spécialistes, mais ça ne vaut rien en situation de vie ». Et je caricature à peine…
Plus sérieusement, il y a bien sûr aussi la question de la mémorisation. J’associe la confiance en la mémoire humaine à une espèce de lâcher prise (lâcher tout support externe). Parfois, je me vois en train de consigner, à partir de ma biographie ou de ce qui se déroule dans mon imagination, pléthore de détails dans mes carnets (notes pour de futurs chantiers d’écriture) et j’y décèle quelque chose de maniaque, de maladif. Ça rejoint une phrase d’Annie Ernaux, à propos de ce qu’elle appelle l’être littéraire : « quelqu’un qui vit les choses comme si elles devaient être écrites un jour ». (Mémoire de fille, 2016). Cela résonne à mon oreille de manière péjorative, comme si cela revenait à tout vivre dans l’idée que cela serve un jour, comme si on parlait ici de la peur de perdre, de laisser filer une substance : à nouveau, s’accrocher, se tenir à l’écrit ; voire, encore plus loin, exploiter la substance vivante à des fins de postérité.
Mais quand on sera mort, à quoi bon les carnets ? — à part pour être étudié par la classe des spécialistes qui, dans le contexte d’Après le monde, est largement éliminée.
Blague à part, Barbara est pour moi une figure empêchée, souffrant d’un handicap dans la vie, la vie sociale en premier lieu, tandis que Christelle fait office de figure libre et saine, vivante et ouverte. Il existe même, dans les versions antérieures du texte, des épisodes où d’autres femmes voulaient co-écrire (écriture collective) et où Barbara refusait. Elle était à nouveau la figure bloquée.
En même temps, j’ai un profond respect pour la littérature écrite, inscrite. Je trouve qu’il faut du courage (celui de la révision des épreuves d’imprimerie, où mes textes peuvent soudain m’apparaître comme des preuves susceptibles de se retourner contre moi) pour laisser partir un texte sous forme définitive vers sa vie publique, du courage pour se dire « j’aurais pu écrire tout autre chose, mais j’ai écrit ça, et il faut l’assumer ». Seule, en tant qu’individu.
Je me sens très attachée aux formes traditionnelles : écriture individuelle, figure de solitude, du silence, maison d’édition qui apporte une caution spécifique (à mes yeux, un livre auto-édité n’a à priori pas du tout la même valeur qu’un livre édité au sein d’une maison que je respecte). Ces formats classiques m’imprègnent et me servent de modèles, ce qui ne saurait exclure mon attirance et mon intérêt pour des formes improvisées et/ou collectives et/ou orales qui ont longtemps existé dans l’histoire de l’humanité et que je présente comme des voies nouvelles, possibles dans l’hypothèse que le marché du livre, l’imprimerie en masse et les institutions universitaires n’existeraient plus. Pour l’instant, dans notre monde, ces formats coexistent et c’est pourquoi j’ai deux personnages, deux bardesses qui représentent des voies complémentaires. C’est aussi pourquoi je n’ai pas hiérarchisé les canaux (oral/écrit) par lesquels l’épopée se propage et se conserve.
Vers la fin du roman, en 2049 après la plus longue ellipse, on trouve à la fois un hommage à la transmission orale — Xiang, qui a appris des chants d’épopée en russe, que j’imagine nés des compositions françaises de Barbara et Christelle, mais mémorisées, traduites et transformées au fil du temps et des lieux — et un hommage à la transmission écrite — le personnage de Vannina qui, au contact des scribes et bibliothécaires de Hambourg, devient compositrice originale, puis emporte avec elle des fragments écrits de l’épopée dans la communauté de Malmö. L’existence de communautés d’érudits et de lettrés comme la « nouvelle Hambourg » ou la « nouvelle Malmö » est donc montrée comme essentielle à la conservation de l’épopée, tout comme la transmission orale, qui se fait parallèlement : je n’ai rien sacrifié.
*
J.-C. C. : La dialectique ou le dialogue entre écrit et oral, est-ce une façon de négocier le lien entre le local (récitation in situ) et le global (transmission, conservation) ?
A. R. : Oui, dans la mesure où les moyens de reproduction de la voix (enregistrements audio, supports et échanges analogiques et surtout numériques) sont devenus peu accessibles. On est dans un monde où « des milliards de gigabytes se sont à tout jamais volatilisés » et où l’oralité signifie interprétation vivante, contraintes d’unité de temps et d’espace.
En revanche, les moyens de reproduction écrite existent encore, bien que dans des volumes plus restreints qu’aujourd’hui, et il est dit de Malmö que c’est une communauté « œuvrant sur supports numériques, réseaux satellites autant que sur papier, parchemin, lithographie et terre cuite », qui « s’était donné pour but la conservation de savoirs encyclopédiques et la mise en circulation des analyses les plus récentes ».
Avec cette mention d’une « mise en circulation » (sous-entendu avec d’autres communautés, aux vocations intellectuelles et scientifiques similaires) j’associe bel et bien l’écrit au global et à la transmission, la conservation. (On connaît des exemples de transmission de récits oraux sur de très longues durées, mais c’est une civilisation de l’écrit qui a produit la mondialisation).
*
J.-C. C. : Le statut d’Après le monde en tant que genre est assez ambigu. À l’évidence, ce n’est pas une œuvre orale. Même la poétique des chapitres épiques ne semble pas relever de la poétique du chant ou des formes de l’oralité. Elle est tout au contraire profondément ancrée dans la stylistique syntaxique et intellectuelle très complexe de l’écrit. Est-ce que je me trompe ?
A. R. : Non, vous ne vous trompez pas. C’est d’ailleurs une des critiques que j’ai reçues : le fait que même les chants relèvent d’une poétique de l’écrit. Peut-être n’ai-je tout simplement pas trouvé la forme pour ces chants ou peut-être suis-je restée coincée dans un paradoxe du même genre que celui évoqué plus haut : choisir le moyen de l’écriture pour parler de la « fin de l’écriture » / choisir une stylistique et une syntaxe de l’écrit pour représenter l’oralité…
Toujours est-il qu’il y avait dans mes intentions de départ une stylistique et une syntaxe particulières (mais peut-être mal appliquées, ou pas systématiquement) pour les chants. Je voulais m’inspirer de textes que je qualifierais de « textes-listes » : à savoir Autoportrait d’Édouard Levé, et Je mange un œuf de Nicolas Page, écrits l’un et l’autre à la première personne du singulier. Je voulais créer cet effet « portrait », mais à la première personne du pluriel, en alignant des énoncés commençant par le pronom, et ne donnant qu’une information par unité :
Nous avions constamment faim. Nous avions mal au ventre. Les corps décomposés nourrissaient les rats, les mouches et les cafards, la tête nous tournait. Nous ne supportions plus notre propre odeur. […] Nous étions poursuivies. Nous étions en alerte. Il fallait repartir. Nous étions prises nous-mêmes de tremblements. De sueurs. De fièvre ou d’asthénie. Nous sentions nos boyaux se convulser. Du liquide s’échapper. Nous avons connu des soifs inextinguibles, d’effroyables angoisses. Des taches de toutes couleurs sont apparues sur nos peaux, et des striures. Nous avons saigné du nez. Craché du mucus. Vomi des glaires. Nous roulant sur nous-mêmes, à cause des crampes.
Est-ce que ça entretient quelque rapport à l’oralité ? En tout cas, j’y vois une forme de scansion, une poétique spécifique, différente de l’écriture des chapitres, que je voulais expressément plus conventionnelle, plus « réaliste xixe », avec ses passés simples, sa narration à la troisième personne et cette sorte de neutralité qui n’attire pas l’attention sur elle.
*
J.-C. C. : Toujours à propos du genre, mais dans une autre acception, vous présentez la nouvelle culture orale post-littéraire comme une culture au féminin — au féminin pluriel. À l’Homère de la tradition littéraire occidentale se substituent ces deux (Ho)mères d’une nouvelle épopée. En quoi est-ce important pour vous que Christelle et Barbara soient des femmes et qu’elles soient deux ?
A. R. : J’ai longtemps été de celles qui disent trouver le mot « autrice » moche, (sans même s’apercevoir qu’elles ne pensent rien de tel à propos du mot « lectrice », ou « spectatrice »…) ou qui estiment que les politiques de quota (parité) sont absurdes, car « ce sont les compétences qui doivent compter, indépendamment du genre »… jusqu’à ce que je me réveille, et que je comprenne qu’historiquement, aucun changement de société majeur ne s’est jamais produit de lui-même, « par magie » : il y a toujours eu besoin de mouvements de lutte, de mesures servant de levier, de revendications, d’exemples et de comportements incitatifs…
Le projet Après le monde est arrivé à un moment de mon parcours où je voulais mettre en place une écriture stratégique. J’avais depuis longtemps conscience que le langage est vecteur d’andro-centrisme dans notre société ; au niveau grammatical (le masculin l’emporte), au niveau du vocabulaire (un être humain se dit homme) et finalement aussi dans nos traditions en matière de fiction littéraire et cinématographique (si on veut raconter l’histoire d’un être humain, on va prendre par défaut un personnage de genre masculin ; si l’on se saisit d’un personnage féminin, il est probable que l’on ait quelque chose de particulier à raconter sur cette identité spécifique de genre).
Forte de ce constat, j’ai estimé que le moment était venu de contrer ces réflexes, et ceci sur deux axes : remise en question de la norme grammaticale dans l’écriture des chants ; et remise en question de la norme d’identité de genre « par défaut » des personnages, par le choix de personnages exclusivement féminins pour les chapitres, et cela même pour raconter des événements qui sortent de la catégorie d’événements traditionnellement attribués aux personnages de femmes — traditionnellement attribués parce que, dans un certain imaginaire collectif, ils continuent de constituer le « cœur » du destin féminin : la sphère sentimentale, séduction, besoin de protection, amours, mariage, (in)fidélité, enfants, vie privée…
J’ai montré beaucoup de femmes occupant des fonctions publiques importantes, et environ la moitié d’entre elles sont présentées sans que l’on fasse mention de leur état civil, de leur orientation sexuelle, et de si elles sont mères ou non. En revanche, il est vrai que la construction des personnages centraux, Barbara et Christelle, m’a offert un lieu d’articulation du thème de la création intellectuelle et de la parentalité/maternité, qui font partie de mes thèmes de prédilection.
*
La haine du chant
J.-C. C. : À maintes reprises, on sent chez les personnages épisodiques d’Après le monde, une espèce de défiance ou de mépris à l’endroit de l’entreprise épique de Christelle et de Barbara. Pourriez-vous nous parler un peu des raisons ou de la signification de cette « haine de la poésie » (Ben Lerner) en tant que « bullshit lyrique » (Antoinette Rychner) ?
A. R. Je n’avais pas conscience d’avoir fait apparaître la manifestation de cette haine à plusieurs reprises ; c’est vous qui me le faites remarquer. Dans le passage en question, celui du « bullshit lyrique », cette hostilité traduit une question de fond : dans une situation globale qui, six ans après la phase aiguë de l’effondrement, est encore celle de la pénurie, du manque de biens et d’infrastructures de première nécessité, est-il vraisemblable que l’on se consacre à la poésie ?
En l’occurrence, j’ai fait ce que l’on fait quand on n’arrive pas à trancher entre des intuitions contradictoires : se décharger d’une tension sur différents personnages. Delphine endosse la quintessence du « priorité aux besoins pratiques » : « ces deux-là [les bardesses] n’avaient-elles donc rien d’autre à glander que d’inventer des trucs abscons, à l’heure où tant de choses étaient à relancer, reconstruire, entretenir et protéger ? » Au chapitre suivant, le personnage de Faye va incarner une vision tout autre, où la création poétique et l’entretien de l’esprit permettent de tenir et d’envisager le monde, fin et suite (c’était l’un de mes titres de travail, j’ajoute la mise en gras). Pour elle, il est plus que jamais essentiel de penser l’avenir social, d’examiner la construction des identités, de mener des réflexions politiques — tout cela en se préoccupant du moyen esthétique.
Les premiers chapitres du roman mettent en scène des problématiques de création. (On voit Barbara et Christelle discuter de ce qu’elles sont en train de créer ensemble). Peut-être leurs questions se posent-elles à toute créatrice ou tout créateur, quel que soit le régime et l’époque ? Par essence, ces questions tiennent pour moi d’une certaine vulnérabilité existentielle, liée à la différence de statut entre ce qui existe et ce qui n’existe pas encore : l’œuvre, aussi longtemps qu’elle n’est pas réalisée (et peut-être même aussi longtemps qu’elle n’a pas été accueillie en tant qu’œuvre par une communauté et ses institutions), dispose de moins de crédit, de moins de légitimité et d’autorité que tout ce qui existe objectivement dans le monde. C’est donc une bataille quotidienne contre tout ce qui, dans ce même monde, pèse davantage, pour consacrer suffisamment de moyens à l’entreprise un peu folle que représente la transformation d’une substance imaginaire en objet concret. Une œuvre peut démarrer sa vie aux soins intensifs : elle part parfois d’un rien — une idée infime, une pure impulsion — et il faut veiller à la maintenir allumée, la faire grandir, lui insuffler ce qu’il faut pour qu’elle parvienne à un degré d’existence respectable, jusqu’à la rendre capable de s’autonomiser, de tenir sans l’assistance de son auteur·e.
Je ne connais pas la « haine de la poésie » selon Ben Lerner. En revanche, j’ai toujours été extrêmement frappée par la manière dont les autrichiens Bernhard ou Handke parlent de la haine à l’encontre des intellectuels (de la part des dit·es « manuels »). Dans le roman Extinction, Bernhard se livre à tout un délire sur les travailleurs en bleu de travail… C’est fabuleux, parce que ça exprime parfaitement le complexe de celle ou de celui qui, au contraire du travailleur en tenue, n’a rien de concret à montrer pour prouver qu’il ou elle travaille — je veux dire rien à montrer durant le processus, avant l’aboutissement public de l’œuvre. Je ne peux m’empêcher de citer ce merveilleux passage du roman :
Des milliers de gens enfilent leur treillis, le matin, et sont pris pour des travailleurs à plein temps, autrement dit des gens qui travaillent, alors qu’ils ne sont autres qu’une armée de fainéants retords qui ne font que causer des dégâts et ruiner le monde, et qui ne pensent qu’à leur ventre, c’est tout. Mais les intellectuels sont vraiment trop bêtes pour voir cela, a dit mon oncle Georg. Pour eux, l’entrée en scène la plus médiocre d’un ouvrier ou d’un artisan paresseux, pourvu qu’il porte son bleu sur la scène du travail entièrement mensongère, est déjà une raison d’avoir mauvaise conscience.
Ce passage m’a longtemps fascinée, parce qu’il raconte quelque chose de très puissant sur les divisions de classe (chez Bernhard on trouve souvent le personnage de classe aisée qui doit parler à l’aubergiste, au jardinier, à l’employé de maison… et chacun semble sur sa rive, irréconciliable). Quelque chose de cet irréconciliable de classe me parle très fort, mais une partie de moi s’agace aussi en lisant Bernhard, parce que je crois à la possibilité qu’on puisse être à la fois garagiste en bleu de travail et lectrice ou lecteur ému·e de littérature — et même, si l’occasion nous en est donnée de manière non menaçante, garagiste en bleu de travail et créatrice ou créateur de littérature.
*
J.-C. C. : À propos de cette défiance, comment pensez-vous la fonction de la littérature par rapport à l’action ? Y a-t-il pour vous (comme pour Delphine) un temps pour agir et un temps pour chanter ? Cette relation conflictuelle entre poésie et action serait-elle différente dans le contexte d’une pratique orale (épopée) et non écrite (roman, etc.) ?
A. R. : Non, pour moi cette relation conflictuelle n’est pas différente selon qu’on parle de pratique orale ou écrite. (Si ce n’est qu’on peut marcher, labourer, réparer ou construire tout en chantant ?)
Du point de vue social, ou de la survie d’un groupe, elle se pose pour moi en termes de division du travail : quel temps peut prendre un individu pour composer puis interpréter un chant, (ou composer et chanter en même temps si c’est improvisé), tandis que d’autres vont produire de la nourriture, prodiguer des soins médicaux, inventer des techniques, etc ? Et quel sera son droit (le droit de celle ou de celui qui produit une valeur symbolique) à la nourriture, aux soins produits par autrui ? À quelles conditions et comment une société donnée nourrit-elle ses artistes ? Est-ce qu’il y a un arrangement qui est trouvé sous forme d’échange : tu produis de l’art, nous produisons des vêtements et de la nourriture, et nous assurons ta sécurité ?
L’expression « il y a un temps pour… » est intéressante ! Dans la bouche de Delphine, elle signifie priorité, hiérarchisation. Du point de vue de la vie individuelle, en revanche, cette expression résonne pour moi de manière beaucoup plus apaisée. Cela signifie simplement que, sans opposer corps et esprit, il y a un temps pour créer (créer intentionnellement, avec un but de réalisation qu’on se donne) et un temps pour manger, dormir, se promener, aimer, s’adonner à la conversation.