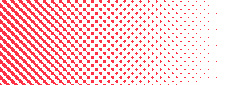Récits, rites et territoires
Un reste de lueur
Des rituels sur la zad de notre dame des landes, de l’importance des émotions, de ce que peut l’art, de la transformation d’artiste hors-sol en habitant·e aux pieds d’argile, de la boue comme modèle, du jeu comme pratique d’écriture collective et de comment continuer, parce qu’il le faut bien.
-h-
**
Pour fabriquer un monde nouveau, il faut partir d’un monde qui existe. Aucun doute là-dessus. Pour en découvrir un, peut-être faut-il en avoir perdu un. Ou être soi-même perdue. (Ursula K. Le Guin1)
117 janvier 2018, les infos à la télé. Édouard Philippe annonce l’abandon du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
2Mars 2018. Zad de Notre-Dame-des-Landes. Avec un ami que Thibaud a retrouvé en manif peu de temps auparavant, on découvre les Fosses Noires, le Gourbi, les 100 Noms, Le Hangar de l’Avenir, Bellevue, la forêt de Rohanne, les petits chemins et les routes, les maisons « en dur » et les constructions aux formes folles.
3Avril, les expulsions. La zad avait eu à affronter l’opération César en 2012. En 2018, l’État tente à nouveau d’expulser celles et ceux resté·e·s sur la zone. Les images sont délirantes aux JT, des gaz lacrymo partout, LBD, GLIF4, des hélicos, des drones, des gendarmes mobiles en rangs, des gens partout dans les champs, les prés, des combats. Les habitant·e·s de la zad appellent au rassemblement.
Thibaud va y aller, moi je ne vois pas bien à quoi je pourrais servir, j’ai peur, je me sens inutile. Une conférence de presse a lieu à
La Colonie, à Paris, avec des architectes pour évoquer et soutenir le territoire, ce qui s’y joue et ce qui se fait massacrer par les « forces de l’ordre ». Un type invité débarque avec son sac de rando sur le dos, dit qu’il était à la zad le matin-même, et que bien que les médias ne cessent de montrer l’inéluctable défaite, tout en fait y est possible. Il raconte qu’il n’est pas militant, pas stratège, qu’il a peur de se battre, mais peu importe, il faut le maximum de gens là-bas. Prise d’une espèce d’emphase, j’appelle Thibaud, vas-y, c’est bon, je viens.
4Routes bloquées, des contrôles partout. Un tank au carrefour et un camion avec lance à eau pointée. Les gendarmes en armures font barrage. Raquettes, foulards et lunettes de piscine pour les autres. Dans la forêt qui longe l’un des champs, des seaux de pommes de pin, des filets de chasse rouge en plastique et des citrons. L’absurdité pointe au milieu de cette tension palpable. Les hélicos la nuit te suivent de leurs spots quand tu vas pisser, un drone vole en rase-mottes au-dessus de la tente le matin, et des tractopelles géants tracent des ornières dans les chemins forestiers et les prairies.
5Et puis une après-midi, des morceaux de bois sont déplacés en une longue chaîne humaine, et une charpente est montée au milieu d’un champ en quelques heures. Lorsqu’elle est finie d’être dressée, une tentative est faite pour la déplacer à plusieurs. Les bras s’en saisissent, à l’intérieur, à l’extérieur, à l’avant, à l’arrière, il n’y a bientôt plus de place. Un. Deux. Trois. Le tout se soulève dans une grande inspiration, se déplace sur quelques mètres. C’est colossal.
Où une charpente est portée à bout de bras.
« C’est bon on repose, merci pour l’aide ! » « Nan, allez, on continue ! », « Quoi ? », en chœur « Oui, jusqu’au Gourbi ! » Alors la charpente à nouveau se soulève et avance. La structure en bois se meut, est mue. Et ça fait des heures que ça dure. Une tonne cinq, portée à bout de bras ou sur la hanche, à faire attention aux fossés, aux ronces, aux pieds de la personne devant. La créature se déplace comme sur des coussins d’air à travers les haies, qu’il faut tronçonner pour permettre son passage. Un barricadier apostrophe les porteur·se·s « Bande de gros nazes à cause de vous on va perdre ! Y’a des trous partout ! », « Mais ferme ta gueule, tu gâches tout ! Tu comprends rien à la magie ! » Et la voilà qui avance dans l’herbe, dans la boue, sur la route et sur les talus, sur fond de Rihanna qui donne le rythme, parce que la structure shine bright like a diamond dans cette heure entre chien et loup, celle où tout est irréel. Et ça chante, et ça hue, et ça invective et ça rigole. Un mégaphone et des frontales servent de guides pour transporter le nouveau Gourbi jusqu’à l’emplacement où les gendarmes mobiles l’ont détruit hier. L’étonnement qu’ils vont avoir demain, à voir cette chose magnifique qui a surgi en une nuit. S. se retourne et dit : « tu vois ce qu’on peut faire quand on est ensemble ?! » Ça donne envie de pleurer. Plus que quelques mètres, il fait nuit. Des lumières rougeâtres flamboient au-dessus de nous, des feux d’artifice pétaradent, on voit le ciel noir violacé marronnasse au travers des poutres en bois, et le ciel voit la bande d’énergumènes qui transporte une putain de baraque à mains nues s’arrêter et poser la masse. Liesse.
Ce moment a changé notre réalité.
6Ce porter fut un choc. Un choc politique, par ce geste de construire malgré les expulsions, de déplacer une charpente malgré les barrages policiers, de chanter, et rire, et crier, malgré la fumée lacrymo. Une audace à plusieurs. Et un choc esthétique, synesthésique, une expérience qui remplit tout. C’est magnifique, d’une beauté sans pareille, signifiante. Faire partie de cette harde, monstrueuse, joyeuse, puissante nous a transformé·e·s ; il y a un avant et un après cette expérience collective. Presque de l’ordre du rêve, les lignes de tracteurs dans la nuit, phares allumés, la charpente se soulevant dans les haies comme au ralenti, les fumigènes rouges qui crèvent dans le ciel, créent des images qui s’ancrent et nous étourdissent. Vertige.
7Le lendemain, tanks et tronçonneuses font face au Gourbi tout jeune né. On filme depuis le champ avec un gros zoom, l’image tremble avec cette distance, on est loin et près à la fois. Des personnes sont assises à califourchon sur la charpente, à plusieurs mètres du sol, pour empêcher sa destruction. Face à nous, une ligne de journalistes, et derrière, les gendarmes qui empêchent d’atteindre le Gourbi. Lorsque tout le monde a été dégagé de là-haut, quelques coups de tronçonneuses et le tank roule comme au ralenti sur la charpente de bois qui s’effondre. Son belvédère lui aussi est saccagé, alors qu’il était caché dans un petit coin de champ derrière des ronces.
Puis il nous a fallu prendre des chemins de traverse et couper par les champs pleins de boue, parmi les restes de grenades, à patauger dans des flaques aux teintes iridescentes, pendant que les vaches nous regardent fuir.
8Depuis 2015, nous envoyons des candidatures pour des résidences d’artistes qui ne paient pas, ou peu, en France et ailleurs, sans vivre nulle part et vivotant partout. On travaille en duo à réaliser des installations qui parlent de temps, de savoirs, d’imaginaires, de mémoire, de communauté humaine, en traversant des histoires faites d’extraterrestres, de dauphins et de LSD, à partir d’objets perdus dans des greniers, de pierres ramassées sur les bords de routes, de masques en latex et de casques de moto tunés. Nous nous appelons -h-, une lettre, presque une coquille dans un texte, un souffle.
9On a fui la zad pour un retour à la normale. Sélectionné·e·s pour une résidence d’artiste d’un mois à Essen, nous partons en Allemagne, pour un projet, La Zone, sur fond de géographie anarchiste2 et des pratiques de stalker3. D’une tente humide où nous étions réveillé·e·s par les odeurs de lacrymo tous les matins et les sommations au mégaphone, nous passons à une chambre avec petit-déjeuner inclus dans un hôtel trois étoiles.
10Le contraste rend absurde ce que nous vivons. On ne se remet pas. On ne se remet pas de la violence, de la tension, on ne se remet pas de l’exaltation, on ne se remet pas de l’intensité, de la puissance de ce qui a été vécu là-bas. Ce moment en particulier, ce porter de charpente nous habite. Quand on présente notre travail et le projet sur lequel on bosse, on finit plusieurs fois par parler de la zad et des expulsions qui datent d’il y a quelques jours à peine. Nous sommes hanté·e·s par la zad. Quelque chose en nous qui était déjà ébranlé a fini de s’ébrécher et est en cours de transformation. On discute avec les autres artistes en résidence de ce qu’est l’art, de ce que peut l’art, ce que peuvent les artistes, et comment être au monde.
11Et là, nous sommes en « résidence », nous résidons, alors que nous n’habitons pas. Un mois, trois semaines, le temps de créer des liens, d’arpenter ce lieu étrange, ex-mine devenue patrimoine, et le soir se rendre dans un hôtel où l’on ne vit pas, avec plein d’autres résident·e·s temporaires. Si nous avons été chamboulé·e·s par la zad, c’est que le choix d’être zadiste engage aussi les corps à lutter pour des manières d’habiter, pour un territoire qu’ils et elles ont choisi. Hébété·e·s, c’est ce que nous sommes à ce moment-là, traversé·e·s par des moments de colère de ne pas être foutu·e·s de prendre position, encore à distance du réel par un zoom à fond derrière un appareil photo. C’est nos positions d’humains et d’artistes qui deviennent tout d’un coup bancales. L’en dehors du white cube devient l’enjeu ; ne plus chercher à créer une œuvre finie, statique, dans une sorte de hors-sol, hors-contexte, hors-sujet, mais plutôt participer à construire ces mondes dans lesquels nous nous inscrivons, à constituer le textus, le tissu.
12De juin à août, nous sommes en résidence d’artistes dans le quartier de Belleville à Paris. C’est une ancienne usine de clefs désaffectée devenue d’abord squat d’artistes, puis « squat légal » sous le patronage de la mairie, aujourd’hui transformée en ateliers pour plasticien·ne·s. C’est difficile d’être là, nous ne savons plus comment faire. Nous multiplions les recherches, les connexions, les liens, essayant de trouver un sens, un fil, et plus nous en trouvons, plus tout est difficile, nous voilà farci·e·s de frustrations et d’impuissance. Mais la fécondité des pratiques de luttes et de résistances, des cerfs-volants en Palestine à la cérémonie des bâtons à la zad, les formes que prennent les émeutes, les grèves, les manifestations, les occupations, les révolutions nous touchent, on est juste avant les gilets jaunes et l’inventivité des ronds-points. Lorsque nous sortons dans l’allée qui relie les différents ateliers, le cœur des conversations est peuplé de ques-tionnements sur les galeries, la communication, les expositions, les bourses prestigieuses, le ré-seau et le marché de l’art. Les grèves de la SNCF et de la RATP sont ignorées, « ah bon, quelle grève ? » et les films en slow-motion de villes fantômes au Moyen-Orient côtoient des crèches post-modernes en céramique. On pensait que c’était la vie qu’on voulait, qu’on serait fier·e·s. Un membre de la famille a envoyé un message pour fêter cette année de succès. Quelle rigolade. Amer·e·s. Désespéré·e·s. Qu’est-ce qu’on fout là ? Qu’est-ce qu’on veut ? Dépassé·e·s, et inutiles. À ressasser la force de ce moment sous cette charpente, les déplacements à petits pas, les « stop ! » et les « allez ! », les « à gauche ! » et les « attention aux ronces ! », « aux fossés ! », « on pose ! », à se rappeler la raideur des épaules qui tentent de rentrer dans les tétris des autres épaules qui portent, les bras qui tremblent parfois sous le poids, l’immensité de l’obscurité qui nous baigne. Et la charpente qui ressemble déjà à une maison sur nos têtes.
13Septembre, retour à la zad. Les expulsions ont laissé des traces partout, mais un relatif calme s’est instauré. L’ami retrouvé insiste pour que nous allions rencontrer Jay et Isa4 à la Rolandière. Qu’est-ce qu’ils vont en avoir à faire de nous, les touristes qui n’ont rien d’autre à dire que « on est des amis de S. », on était là aux expulsions, cinq secondes dans le temps de cette lutte contre l’état qui s’inscrit sur des années, dérisoire notre présence comparée à ce que vous avez accompli de grandiose. Ça en devient débilitant de penser comme ça. Et puis, au détour d’une balade dans la forêt de Rohanne, à quelques dizaines de mètres de la Rolandière, on traverse le champ qui mène jusqu’à l’ancienne ferme où un espace d’accueil et une bibliothèque ont été mis en place, et aussi un phare qui se dresse là où une tour de contrôle de l’aéroport aurait dû prendre place. Une palissade préserve le lieu de vie du collectif, qu’une habitante nous invite à franchir lorsqu’on évoque Jay et Isa.
14Jay nous invite à venir boire un jus de pomme à l’intérieur, nous dit qu’il s’apprête à partir en forêt avec Sandro5, le type au sac à dos vu à la conférence de presse à Paris, qui est là lui aussi. Ils s’en vont récolter des matériaux pour réaliser des masques. Une centaine doit être conçue pour les participant·e·s d’une balade qui aura lieu le soir de l’événement Terres Communes, le 30 septembre, où la forêt, sa lisière, seront traversées comme des espaces de rêve et de résistance, en lien avec les guerres des Demoiselles en Ariège au xixe siècle. Nous partons avec eux collecter mousses, écorces au sol, branches mortes, feuilles, pommes de pain, mais aussi filets de chasse et grenades atrophiées qui restent des expulsions, s’amoncellent dans les sacs de course. Des clous, des ficelles, et un pistolet à colle permettent d’assembler ces éléments hétéroclytes. S’élaborent alors des machins, des espèces de chouettes bizarres, des têtes en toile de jute avec des yeux de grenades, des voiles dont la bouche n’est faite que d’aiguilles de pin et d’un champignon sombre qui semble en sortir. A la nuit tombée, les masques fraîchement réalisés sont portés sur les visages, nous sommes six ou sept et nous nous enfonçons dans les bois pour en tester les aspects pratiques, puisque la balade aura lieu de nuit quinze jours plus tard. Séance photo, on ne se connaît pas, mais cette nuit-là scelle quelque chose. Nous laissons la Rolandière en proposant de revenir un peu avant l’événement pour aider.
15Quand nous revenons, il n’est plus question de masques. L’idée a changé, et voilà que Jay et Isa nous partagent le script de la balade, pointent deux endroits : là où gisent les ruines de deux cabanes, la Datcha et Puiplu, détruites pendant les expulsions. Ils nous disent, nous aimerions que vous fassiez quelque chose sur ces lieux. Petit rire gêné, nous ne sommes même pas de la zad, la première fois que nous sommes venu·e·s date d’il y a cinq mois, nous ne savons rien des personnes qui les habitaient. Nous ne pouvons imaginer ce qui a pu être vécu là, où les traces de violences cohabitent avec les restes du lieu de vie. Comment pourrions-nous être légitimes ? Nous ne savons pas très bien, nous sommes des étranger·e·s. Et cette question de légitimité est en même temps complètement soufflée par la confiance que nous accordent Jay et Isa.
16De la structure volante du Gourbi à l’amas effondré de la Datcha, c’est tout un imaginaire de la maison et de l’habiter qui se déploie. Et nous nous attachons à cette idée lorsque la Datcha redevient cabane, des lignes de leds venant souligner les portes et fenêtres qui sont à nouveau debout, du son des expulsions repris des vidéos disponibles sur Youtube est remixé et crié par un mégaphone sur un tapis où transperce une fougère. Puiplu s’est transformée en une créature fantastique, une énorme limace translucide faite de fines bâches de peinture qui se gonflent et changent au gré des vents, laissant voir au-dessous ce qui reste, éclairé de l’intérieur par des phares de voitures connectés à une batterie. Deux personnes dansent un butô au milieu des ruines, dans le spectre volant de bâches, et s’animent au milieu de la nuit sur un mix de sons d’orages, de tempêtes et d’éruptions solaires. Ces instants signent une rupture. Quelqu’un est venu nous parler, quelqu’un avait été touché·e, et voyait dans les ruines de la Datcha sous cette autre forme quelque chose qui résonnait du traumatisme des expulsions et d’une nécessité du soin.
1730 décembre, nous revenons sur zone, à la Rolandière, pour travailler aux préparatifs du premier anniversaire de l’abandon du projet d’aéroport le 17 janvier 2019 avec Jay et Isa. Commémorer la victoire de la zad répond à plusieurs enjeux : cette victoire contre l’état est pleine d’amertume et de blessures, une certaine idée de la zad a disparu avec la destruction des cabanes insolentes sous les chaînes des tanks. L’abandon du projet d’aéroport ne peut être désolidarisé de ce traumatisme des expulsions. Des personnes ont engagé des risques énormes, vitaux, pour protéger l’embryon fragile d’utopie menacé par les forces étatiques gigantesques des institutions militaires et administratives conjointes. Alors, là, à quatre, nous allons penser un rituel. Un mot venu combler un vide, s’emparer de nos doutes et les métamorphoser en engagement, en responsabilité.
1817 janvier 2019. De cette histoire récente nous allons devoir nous saisir de la violence et de la beauté, de la joie d’une victoire et du deuil qui l’accompagne, pour exorciser ces traumatismes dont on ne sort que difficilement, raviver les histoires sans discours, les mettre en gestes. Parce qu’il ne s’agit plus là d’un spectacle de rue ou d’une pièce de théâtre. C’est autre chose, un autre chose pour mettre en valeur des rôles passés sous silence, la boue, les tritons, des liens, l’imaginaire en jeu, des rapports de force démesurés. Il s’agit de marabouter, faire un rite de guérison, redonner de la force à la lutte de ce mouvement qui est sorti blessé, épuisé. Et donc on fait des recherches sur « l’animal-totem » de la zad, le triton-marbré, dont une marionnette avait été construite pour parader en manif. On regarde des vidéos de biologie tritonne ou des points colorés imagent la manière dont des cellules se dédifférencient quand un membre ou un organe est coupé ou abîmé, et reconstituent ce qui manque. On fait des recherches sur les masques en terre pour rendre hommage à la boue. On découvre les masques des Asaro Mudmen, ou Holosa, en Papouasie Nouvelle-Guinée, dont l’origine selon Wikipedia tient dans les années 1950 à une compétition lors d’une foire d’agriculture. Après avoir regardé des vidéos Youtube des Mudmen comme si c’étaient des tutos, on se lance alors dans le modelage de l’argile, à quatre, et ça, en soi, devient un rituel. Une infusion de basilic sacré dans des bols de terre de la zad, et nous nous lançons à faire des accumulations de boudins de terre, des trous pour les yeux, des marques distinctives pour chaque cellule qui portera le masque. Nous sommes dans un grenier qui sert de dortoir d’habitude, désormais bâché de toute part pour maîtriser le taux d’humidité et le séchage des terres crues qui deviendront des masques de dix kilos chacun. On élabore des manières de signifier les forces adverses à l’aide de matériaux divers, on imagine les différents moments, des plans sommaires sur lesquels nous déplaçons de petites figurines en papier nous permettent de penser l’enchaînement, les différents rôles. On simule le chamboule-tout géant qui mettra à terre la ligne de flics, on conçoit les accessoires6. Et le jour J, on briefe les pseudos-gendarmes, les cellules, Finkelstein venu faire du tambour, la personne guidant le triton, celle qui allumera la sono ou le phare, les gilets jaunes d’Angers qui protègeront la parade, la procession, sur la route. Des questions essentielles se posent sur cette dimension rituelle, comment guider, qui guide, la nécessité de masques ou non, de leur esthétique exigent beaucoup de discussions.
19Ce 17 janvier est blindé7. Un banquet gargantuesque clôt la journée, avec une vente aux en-chères d’objets légendaires de la zad. Mais avant, une marche aux flambeaux traverse la forêt de Rohanne, et l’on entend les chants puissants et joyeux, points de lumière dans la nuit qui annoncent l’arrivée imminente dans le champ de bataille. Lorsque la procession passe la lisière, des groupes s’organisent alors : la marionnette géante de triton marbré nécessite d’être portée par trente personnes pour se mouvoir, il est accompagné de quatre créatures mirobolantes, les cellules pluripotentes, et de toutes les personnes qui lanceront des boules de farine aux figures de trois mètres incarnant les CRS et gendarmes, déjà en ligne, à quelques centaines de mètres d’eux, et qui commencent leur danse avec des pétards. Et c’est un peu grotesque, on voit les bambous qui soutiennent la longue créature en tissu, les têtes des « forces de l’ordre » laissent voir des os cartoonesques lorsqu’ils se décrochent des corps, on reconnaît les oripeaux textiles des annonces de liquidation totale qui habillent les gendarmes, on voit la couverture de survie qui fait l’intérieur du cœur.
20C’est l’exutoire qui passe par le jeu, les gendarmes et les voleurs, balancer de la farine à la gueule de machins géants, crier « on y va ! » pour mouvoir le triton de trente mètres, chanter sur Bonnie Tyler parce que du mystique pointe son nez dans la pop culture8. Il s’agit là de bricoler, d’prendre des p’tits bouts de trucs et puis d’les assembler ensemble9. Et voir ce qui surgit. On fait du mix, du sample, tout de bric et de broc, syncrétismes bigarrés, et on danse au bord du monde dans une synesthésie affolante, qui rend folle, qui écarte l’adulte pour laisser place au désordonné, au costume, au subversif. Se jouer de la honte et tenter là de sortir de soi. Littéralement sich ausleben en allemand, s’épanouir, se laisser déborder par l’enthousiasme, la possession, être possédée, être emporté. Après la bataille digne d’un jeu de rôles grandeur nature fantasy, une des personnes qui agitaient les silhouettes des marionnettes géantes de gendarmes nous confie son émotion d’avoir été là dans ce champ à attendre de jouer le combat tout comme il l’avait fait lors des expulsions.
C.A.R., rituel du 17 janvier 2019 (monstro-gendarmes), photo -h-.
21Le lendemain, après avoir ramassé les dépouilles des ennemis qui parsemaient encore le champ, nous déjeunons à l’auberge du Q de plomb. Une discussion s’engage autour de la fonction des rituels, et de leur intérêt, ici sur la zad. À plusieurs nous forgeons le terme d’animisme kitsch pour qualifier ce qui a eu lieu. L’humour prend une place importante dans notre approche des rituels, bricolage de jeux de mots et de détours : nous jouons sérieusement.
2217 janvier 2020, un an a passé, de nouvelles fondations pour l’un des premiers lieux à avoir été détruits lors des expulsions de 2012 ont été posées, et une charpente doit être levée ce jour-là à la Gaîté. Un rite bâtisseur accompagne cette levée afin d’en marquer le lien symbolique avec les expulsions, et forger une résonance avec le rite de l’année précédente. Autres formes, autres lieux, autres symboles, mais des choses se font écho. Les rites meurent lorsqu’ils deviennent répétition et non plus re-commencement10 » : les masques en terre crue des cellules pluripotentes sont à nouveau utilisés. De masques ils deviennent coupes, de coupes ils redeviennent boue. Un sigil, sceau magique, a été dessiné en lien avec l’érection de la charpente et les permis de construire déposés en ce début d’année. Il est tracé au doigt plein de boue à même la charpente par les cellules pluripotentes dont l’habit de lumière de l’année dernière a migré sur le visage, sous le masque de terre qu’elles ont retiré. À leur suite, les personnes présentes trempent leur doigt dans la boue contenue dans les masques retournés et dessinent ce même symbole, sur le bois. Puis les masques sont broyés à l’aide de bâtons ceints d’ajoncs dans les fondations de la charpente qui s’est élevée juste avant à la force des bras et d’un Manitou, s’inscrivant dans ces traditions de maçons d’accrocher des bouquets de fleurs, d’enterrer des chaussures ou des chats, de cacher des objets, de clouer des chouettes au grenier. Objets de superstition, chasse au trésor, capsules temporelles. C’est une relation à la terre, on lui a pris, on lui redonne. Ce qui avait été pris à la boue redevient boue, dans une espèce de solve et coagula baroque. C’est un emprunt augmenté de ce qu’on y a investi. Tout comme nous, la matière est transformée par l’expérience.
23Ce 17 janvier 2020 a pointé de son gros doigt plein de boue ce sur quoi notre attention devrait se porter : les nuances fines entre spectacle et spectaculaire, la solennité et le ridicule, l’élite, « sachante », à distance, seule à maîtriser des « codes », et cette distance qui transforme ou non les « autres » en spectateurs ou en personnes agissantes qui « adhèrent » à ce qui est en train de se passer. La croyance en un objet de culte n’est pas l’enjeu, mais croire que son geste est important, savoir où placer son attention, déterminer ce à quoi l’on tient, et transformer son régime de relations au territoire, aux autres vivants, à la mémoire le sont. Sur les différents rites qui ont été accomplis aux cours des 17 janvier depuis cette première occurrence, différents « paramètres rituels » ont été explorés selon les situations : de jour, de nuit, en intérieur, en extérieur, masqués, non masqués, parlants, non parlants, chantés, dansés ou pas. Parfois exubérants ou ubuesques, parfois intimes et touchants, parfois grandioses et bricolés, parfois pensés trop rapidement, parfois perclus de références indigestes. L’important dans leur émergence sont l’intention et le faire, car le sens d’un rite procède d’un mouvement, d’une gestuelle, de nos langues, corps. Le faire plutôt que l’œuvre achevée, déjà morte, de l’artiste, le faire encore et encore, jamais complètement figé, ni complètement instable. « Peut-on créer des rites qui, par définition, sont hérités11 ? », demande Michèle Fellous. Nous ne pensons pas être plus aptes ou plus légitimes à « concevoir des rites », nous, ce groupe de quatre personnes, association de deux duos, devenu depuis la C.A.R., la cellule d’action rituelle, un nom qui sonnait comme une blague entre nous. Pourtant il a bien fallu qu’un jour chaque rite ait sa première fois, une première forme, sans préhistoire tout à fait. Le rituel permet une continuité et une perdurance des liens qui s’opèrent dans un collectif. Il s’inscrit dans la relation, la relation comme lien, et la relation comme transmission, une manière d’apprendre et de partager qui prend dans différents codes et registres et s’affranchit de l’écrit et de l’oral, une expérience sensible, à la fois personnelle et partagée, étrange.
24Ce rite bâtisseur du 17 janvier 2020 est un chamboulement, et nous pousse à chercher plus encore à définir ce que peuvent être les rituels, les aspects intimes ou communs que cela peut prendre, questionnant aussi ce qui doit nous échapper. Certains points de frictions ont été mis en lumière, à travers le choix de ne pas donner d’explication sur ce qui se passe, d’en avoir fait un moment très solennel. Il a été mis en évidence de façon flagrante « le risque de la secte » qui entre en conflit avec ce qui nous touche à la zad, la vie commune, la remise en question des hiérarchies et rapports de domination, et l’invention collective.
25Depuis ce présent choral sous la charpente mobile du Gourbi, jusqu’à l’émotion générée par ces endroits détruits qui ressurgissent, l’évidence de ce qu’un passage par le collectif peut faire advenir s’est imposée à nous. La nature de notre rapport à l’expérience esthétique a radicalement changé. En êtres sensibles, il nous faut questionner la texture même du réel, sa densité, son intensité, à travers les histoires que nous nous racontons et vivons collectivement, ensemble, sans spectateurs.
26Fin janvier, au cours d’une réunion de travail avec la C.A.R., nous décidons de nous intéresser aux rythmes des changements de saisons, des intensités de lumières qui varient, de nos distances au soleil, aux étoiles et au cosmos qui évoluent cycliquement. Pour nous aider nous reprenons le calendrier celte des huit grandes fêtes de l’année. Nous nous concentrons sur quatre moments : l’équinoxe de printemps, Beltaine (dans la nuit du 30 avril au 1erı mai, qui marque le réveil printanier, hybridé avec la journée internationale des droits des travailleur·se·s), l’équinoxe d’automne, et le solstice d’été.
2720 mars, Équinoxe de printemps, autour d’un trou dans le noir, au carrefour de la Saulce. Parfois quelques voitures au son déformé par la vitesse éclairent en long le rassemblement bizarre. Pas de lampadaires ici. Et beaucoup sont là. C’est inattendu. À vélo, à pied, même sur une plateforme de camion à ciel ouvert. La nuit nous entoure. Personne ne semble vouloir allumer sa lampe frontale. Une sorte d’intimité se crée. On chuchote. Ça va démarrer.
28On lit un texte d’Ursula Le Guin. Un passage qui évoque le travail de son père, le temps qui passe, la perte des connaissances indigènes, la transmission qui ne se fait pas, les traces, ce qu’on fait de ces traces, un attachement au territoire et des manières de dire cet attachement12. De faire au mieux. Puis des consignes sont données. Une pierre doit être ramassée au sol, des gravats, du remblai de la route défoncée. En tenant cette pierre, penser à une chose que l’on souhaite effacer de l’avenir, et la jeter dans la flotte qui s’est accumulée dans un trou en ce premier jour de printemps, en hurlant ce mot dans le coude du bras qui ne tient pas la pierre, dans une imitation élégante d’un geste barrière d’éternuement. Car le coronavirus est là. Fontaine de Trevi à l’envers, ce que l’on dit n’est pas ce que l’on souhaite. Chacun·e s’empare ensuite d’un bâton d’un mètre, morceaux de châtaigniers qui avaient été utilisés pour un rituel de protection de la forêt de Rohanne l’année précédente. Toutes et tous se saisissent d’un bout et tendent à la personne de derrière l’autre bout, de manière à former une longue ligne. D’un mouvement prudent et saccadé, la créature serpentine prend peu à peu forme et se dirige vers le champ, en silence, dans le noir. Puis elle traverse un feu placé au milieu de la couronne d’aubépines qui servira le 1er mai, avant de passer sous une arche illuminée. Comme unique point de regard, un autre feu se dresse, nous nous plaçons autour.
29On parle d’être sans contact dans ce moment si particulier. Autour de ce feu, pour toucher du vivant, pour faire rhizome à notre manière, nous glissons nos doigts dans la terre. Cybèle/Rhéa donnant naissance aux Dactyles, forges et magie. Le feu, la terre, les doigts en éventail enfoncés dans du mou. Il nous faut retrouver par les mains dans la terre, quelque chose qui fonde notre rapport sensuel au monde. De l’achillée est distribuée pour être plantée afin que quelque chose advienne, un quelque chose dont on a envie, plus tard dans l’année13. Une danse, une farandole, un fest-noz, une ronde se fait autour du feu pour sceller le pacte, puis une bière, brassée ici sur la zad, parée de dessins de chauve-souris ou de triton, de salamandre ou de musaraigne d’eau qui vivent aussi là.
30Rester dans le noir, ne garder comme lumières que des feux dont on se tenait à distance, a permis de laisser l’honneur aux voix. Bien que celles-ci soient connues, une certaine vulnérabilité s’instaure. Le groupe n’est pas mis à distance, parce que tout le monde porte le même masque, celui de l’obscurité. Un changement fondamental a lieu là, après moult discussions à ce sujet : place à la parole. Il n’est plus question de guider sans explications, il s’agit de partager les tentatives, les explorations en donnant les clés pour comprendre ce qui amène là, à faire ce geste, à se placer comme ça, sans que cela paraisse être des instructions vides de sens.
31Fin mars, quand le premier confinement arrive, nous sommes accueilli·e·s à la Rolandière, où il est décidé après quelques jours qu’il serait préférable pour les personnes les plus à risque vis-à-vis du virus de s’isoler. Nous passons donc tous les deux presque trois semaines quasi seul·e·s. Chaque jour, nous remplissons nos sacs de livres et partons dans la forêt. Dans une clairière que certain·e·s nomment le sanctuaire, nous nous asseyons sur des troncs d’arbres couchés et lisons à haute voix et à tour de rôle, Ursula Le Guin, Baptiste Morizot, Charles Stépanoff, Michel Serres, Vinciane Despret, Emanuele Coccia, Donna Haraway, Émilie Hache ou Tim Ingold. Le chant des oiseaux couvre presque nos voix, des chevreuils nous surprennent parfois dans leur course. Ce sont des moments étranges, intimes, mêlés de rires gênés et de gros yeux effarés lorsque d’un coup tout semble trouver un sens. Des conversations sur la nécessité d’un changement des imaginaires s’élaborent, mêlant féminisme et préhistoire, littératures et syncrétismes, décolonisation et care, chthulucène et anarchisme.
32Dans le texte Voyager dans l’invisible, les descriptions des tentes claires et sombres font écho à nos questionnements sur les rituels, sur l’imaginaire, l’imagination, sur l’art. La tente claire est l’espace du chamane spécialiste qui canalise toute la lumière sur lui, donnant en spectacle ses relations avec l’invisible. La tente sombre partage cet invisible. Ici pas de lumière, seulement du son et des images mentales, chacun peut y être chamane, tour à tour.
33Nous commençons alors à regarder ce que nous avons accompli avec les rituels depuis un an et demi à travers le prisme de ce nouvel outil théorique. Nous retrouvons dans l’expression de la tente claire notre peur de constituer une caste de spécialistes qui serait en charge de tous les aspects spirituels de la vie du collectif. Et nous voyons dans la tente sombre une forme vers laquelle nous souhaitons tendre. Nous venons de, et vivons dans une société de la tente claire, où toutes les histoires nous sont contées par des experts de la narration, nous assistons en spectateurs aux pièces de théâtres, aux projections de films, aux objets d’art alignés dans les galeries, à la pléthore de séries Netflix ou Amazon. Au fil de nos discussions, nous comprenons qu’il va nous falloir bricoler notre propre « tente », dans un espace intermédiaire et mouvant, entre le clair et l’obscur. Une tente grise où tirer parti de nos pratiques claires, les détourner, pour soutenir un partage des histoires dans le noir.
34Avril. La nuit du 30 avril au 1er mai est celle de la fête celte de Beltaine, miroir de Samain, qui a lieu au cours de la nuit du 31 octobre au 1er novembre. C’est le retour de la lumière, la fertilité des sols, la fin de la saison sombre. Elle mène à la journée du 1er mai qui est un jour de commémoration internationale des luttes sociales, et qui prend racine dans la répression de militants anarchistes à Haymarket Square en 1886. Cette nuit est un moment charnière, un espace liminal où s’entremêlent dimensions poétiques, cosmiques et politiques, un reflet de la façon dont nous nourrissons notre approche, en piochant dans différents mondes.
35Un soir, projection du film Midsommar14 dans le salon de la Rolandière, on y voit des références à ce que nous avions trouvé au fil de nos recherches. Les peintures murales des dortoirs qui décrivent une mythologie inspirée du paganisme nordique, un mât de mai qui domine le village, les danses auxquelles la personnage principale doit participer, le banquet et les vêtements qui sont autant de manières d’élaborer une dimension cérémonielle. Dans la Transfu, qui est une grande cabane se trouvant dans le jardin de la Rolandière et qui sert de réserve à la bibliothèque du Talus, nous consultons des livres sur les druides ou encore l’alchimie, où il est question d’oursins fossiles retrouvés dans les tumulus mortuaires, des « œufs cosmiques », nids de serpents, du serpent comme animal à l’essence androgyne, ni mâle ni femelle, qui mue et se transforme, meurt et revit, à la fois cercle et trait. Durant la préparation, C. nous avertit qu’un serpent mort gît justement sur la route, Nath enfourche un vélo, tient le serpent au bout d’une branche, pour le récupérer avant que des camions ne lui passent dessus. Avec cette convergence de micro-découvertes, l’œuf et le serpent deviennent les motifs qui guident l’élaboration de ce rituel : l’œuf et le serpent, symboles de renaissance, un lien de la vie à la mort à la vie à la mort. À la vie, à la mort ! Lorsque nous déplaçons l’arbre qui servira à confectionner l’arbre de mai, nous creusons un trou entre les racines de sa souche et y déposons le serpent de la route par-dessus lequel nous brisons un œuf frais. D’un arbre mort à un mât debout, le surgissement du vivant. L’érection d’un mât de mai a des aspects phalliques, et « queeriser » le mât est un enjeu important à nos yeux pour refléter l’explosion du charnel, des désirs et des individus. Au cours d’une discussion à quatre nous évoquons le texte d’une sorcière qui voit en un mât de mai un énorme gode-ceinture qui permet à la Terre de copuler avec l’univers, érotisme cosmique de l’axis mundi, cercle et trait. Pour célébrer cette fertilité et ces cycles toujours recommencés, un montage vidéo inspiré des écrits d’Andreas Weber sur l’écologie érotique met en lien des paradisiers et des black blocs dans une succession de séquences mêlant parades amoureuses et parades politiques du 1er mai. Limaces hermaphrodites en pleins ébats sexuels, émeutes en noir et blanc ou en couleur se déploient sur une bande-son électro, pour une démultiplication des rapports sensuels et des rencontres possibles.
36Selon Wikipedia, le « principal rituel de Beltaine consiste en des feux allumés par des druides où le bétail passait afin qu’il soit protégé des épidémies pour l’année à venir15 ». Et comme nous sommes en pleine pandémie de Covid-19, Sardine, la vache la plus vieille de la zad, la première arrivée, va passer entre deux feux. Une pratique de Beltaine consiste également en l’érection ou l’entretien du mât de mai, autour duquel des danseurs et danseuses tiennent des rubans attachés au sommet, et les tressent en dansant. Ainsi cette nuit-là, du 30 avril au 1er mai, nous avons déplacé et écorcé l’arbre, confectionné des rubans de plus de vingt mètres, creusé un trou d’un mètre cinquante de profondeur sous la pluie dans un champ à la lumière de lampes frontales, repris une couronne d’aubépines et d’ajoncs qui avait servi pour l’équinoxe de printemps, bu des cocktails aux noms édifiants, fait cuire au feu de bois du pain autour de branches de noisetiers, des oignons et des betteraves dans de la pâte à sel, peint comme un serpent qui monte à l’arbre un long ruban rouge jusqu’au sommet, fait un jeu de balle dans un labyrinthe comme on le faisait à Pâques dans les cathédrales, dansé jusqu’à trois heures du matin sous les lumières de la projection du mash-up vidéo de riot et de green porn. Notre parti-pris ici est d’énoncer les gestes de transformation, les règles du jeu. L’espace du rituel est pensé comme un espace pédagogique, un espace de transmission. C’est un espace de mutation pour nous ; en partageant nos recherches, nos réflexions, la réalisation, en donnant les clefs nous en faisons un bien commun et partagé et cessons d’être des artistes.
37Le matin suivant, l’arbre que Dudu la jument avait tiré jusqu’à l’Ambazada est devenu mât de mai, porté sur les épaules jusqu’au trou où il sera dressé. Un feu est allumé pour en brûler le pied afin d’éviter le pourrissement trop rapide une fois mis en terre. Chacun·e prend sa place selon ses compétences et envies. Des charpentiers et charpentières sont là, des architectes, une amie marin aussi. Ensemble iels nous guident, placent les cordes, le camion, les chèvres que nous tenons pour soulever le mât pendant deux heures. Au milieu des herbes, dans la brise, un violon est sorti et ses notes nous accompagnent. Puis l’érection se termine, de longs rubans blancs tombent depuis la couronne végétale au sommet du mât. Nous les tressons dans notre première danse de mai.
38Septembre. Dans la poursuite de ce calendrier des équinoxes et des solstices, l’équinoxe d’automne 2020 a lieu le 22 septembre. Sur les sites wiccas pleins de photos d’autels et de recettes, sur des fonds en camaïeu ocre, rouge, et brun, Mabon est évoqué. Il n’est pas vraiment nécessaire d’aller vers ces sites pour découvrir que c’est la fête qui inaugure la période sombre de l’année, la perte de soleil peu à peu, les températures qui chutent avec, les pluies, la boue. C’est une période compliquée pour beaucoup, avec ces changements d’heures qui donnent l’impression qu’on doit souper à 18 h, cette fatigue qui semble embrasser tout le collectif, un alanguissement qui réclame du confort, de la chaleur, et un chocolat chaud sous la couette. À une autre époque, les temps saisonniers et l’agriculture instauraient les rythmes de vie, dictaient les moments où retourner vers l’intérieur, et ouvrager les objets qui composaient le foyer : sculpter une cuillère, un beurrier, un napperon, un édredon. C’est justement le temps du groupe, du vivre ensemble. Place aux veillées, aux histoires au coin du feu, aux peurs aussi, associées aux périodes sombres et à la nuit en général. L’automne est liminal, un entre-deux de glissement. Terre noire en sommeil, les glands dénudés et rouges au sol, comme écorchés, les ombres se transforment, les vents, les chants des oiseaux et les couleurs changent. Les maladies, les rhumes, les grippes fragilisent, et le coronavirus hante les contacts, même pour les personnes qui souhaitent faire fi de la pandémie. Cette fatigue, cette appréhension de l’humidité et de la perte de lumière, et ce virus qui confronte différentes manières de vivre ensemble et d’envisager l’accueil et le lien sont au cœur de ce rituel en préparation. Les enjeux de soin et de force qui animaient déjà le premier rituel du 17 janvier 2019 font écho ici. Retrouver de la force, faire groupe, prendre soin.
39Le jour où la nuit commence à s’allonger réclame du réconfort, un sentiment d’appartenance à un groupe, presque familial, de l’ordre de la maisnie, celles et ceux qui vivent sous le même toit, sur le même sol, celui de la zad. Une après-midi sur le canapé de la Rolandière on regarde une vidéo où Claude Gaignebet16 évoque la figure d’Arlequin, la mesnie Hellequin, un cortège de revenants. Arlequin et Hellequin présentent le même élément *quin, qu’il est aisé de métamorphoser en kin pour faire écho au making kin développé par Donna Haraway, alliances improbables et « parentèles dépareillées17 ». Un habit d’Arlequin est un habit bigarré fait d’éléments divers, rapiécés, raccommodés, c’est aussi un ouvrage fait de fragments pris chez différents auteurs, et ce sont aussi des restes réarrangés vendus aux pauvres. C’est ainsi que sont pensés les rituels, pioche de gestes et d’histoires de différents lieux et temps, de matières hétéroclites et hétérogènes qui s’agencent en un être foutraque, en métamorphose, marqué par les mouvements incessants de transformation, en lien avec le territoire et les êtres qui le peuplent. Nous sommes nous-mêmes arlequiné·e·s, expressions de différentes cultures et histoires, et les rituels sont marqués par ce patchwork.
40Le personnage du frangeux, lors de l’équinoxe d’automne, est pensé comme un hybride d’homme sauvage et d’Arlequin. Au milieu d’un cercle de feu qu’il faudra oser traverser, il se met à tourner, des franges de tissus chatoyants et de multiples mains forment son costume. Ces franges doivent être arrachées au frangeux sans être touché·e· par cet être fougueux, pour ensuite être accrochées à l’arbre appelé la déesse18, qui donne l’air de faire le poirier, la tête enfoncée dans la terre du plus vieux talus de la zad, dans la forêt de Rohanne. Lorsque le jeu un peu dangereux est terminé, chaque personne a sa loque. F. a revêtu son costume de fête, un lapin rose, mi-Alice, mi-Matrix, et sert de guide. Du mât de mai où prenait place le cercle de feu, il emmène le groupe par la forêt jusqu’à la déesse, devenue là arbre à loques, qui soigne ses/nos forces dans la période sombre19.
41C’est la saison de la chasse, et dans un mouvement très lent de poursuite du lapin rose, le voyage continue dans la nuit à travers la forêt pour aller vers un endroit accueillant — l’accueil —, dont les bougies suspendues au plafond, le chocolat chaud, les muffins et le feu dans le poêle rappellent des ambiances de « longues soirées d’hiver ». Nos recherches pour cet équinoxe d’automne nous avaient mené·e·s à la figure d’Artémis, déesse de la mythologie grecque qui s’accompagne des animaux sauvages et est aussi la chasseresse. Elle est souvent représentée sous la forme d’un animal, la biche, à laquelle nous rendons hommage au travers de la figure de l’oracle à la tête de biche. Là, dans la pénombre, la biche met sur la piste. Elle est là-haut, au-dessus de l’accueil, au cœur de la bibliothèque, assise sur un fauteuil dans lequel elle se fond. Dans une alcôve, elle attend les oraculés, ceux qui vont articuler une pensée commune, activer la poésie collective, passant de l’oral à l’écrit dans cet espace habité de livres. Le petit Robert est l’un de ses outils de médiation, blague sur la polymastie qui marque parfois les statues d’Artémis. Dans l’antichambre, quatre personnes à la fois épluchent quatre pommes en une longue épluchure qu’elles vont devoir présenter à l’oracle qui les attend derrière le rideau. C’est une pratique vue dans la série Charmed, un sortilège pour connaître l’identité de son amoureux transi : il faut jeter la pelure de pomme et y voir se dessiner une lettre. Ici la lettre lue à l’oracle donne accès au dictionnaire sur les genoux de la biche devineresse que celle-ci présente comme une vulve offerte, sheela-na-gigs vivante. À la lettre désignée, la personne met au hasard son doigt sur la page, et là, un mot20. Après avoir reçu ce mot, elle quitte la biche pour le transmettre à l’assistant dans l’alcôve adjacente. Ce dernier le tape sur un ordinateur, connecté à un écran à l’étage au-dessous, dont l’aura crève la pénombre de la salle aux bougies. De l’espace de la bibliothèque, en haut, l’espace des histoires, des utopies, des virtualités, des imaginaires, le mot se déplace par la magie des câbles et des écrans vers l’espace d’accueil, en-dessous, pour être lisible de toutes et de tous et former un texte. La lettre est devenue mot puis phrase. L’intimité d’une rencontre étrange, un mot extrait au doigt et à la lumière rouge, l’articulation à voix haute et sa réécriture numérique laissent place au groupe rassemblé devant l’écran qui voit la liste devenir peu à peu poésie, dérivé de ποιέω, poiéō, faire.
4217 janvier 2021, quelques jours ont suffi, là des plots de béton, les ronces aplaties sur cette partie du terrain, là l’argile jaucre, roucre par endroits, la pluie qui transforme tout en bouillasse. Quelques jours et là déjà une charpente. Quelques jours et des années depuis la destruction des Planchettes en 2012.
43La charpente d’une future école des tritons se dresse comme un miroir sur ces mêmes lieux. Des charpentier·e·s ont bossé des heures durant, parfois sous le crachin à sept mètres de hauteur, pour qu’aujourd’hui il ne reste que les deux dernières fermes de la charpente à lever. Une brochure accompagne cette journée, qui raconte la destinée de ce lieu, sa vision pédagogique, tournée vers l’éducation populaire. Une charpente, qui prolonge l’histoire d’autres charpentes, celle de la Gaîté levée l’année dernière, et toutes celles qui ont été détruites en 2012 et en 2018, mais aussi celle du Gourbi portée à travers champs et qui ne dura qu’une nuit. Une charpente donc, sur laquelle le même sigil peint à la boue l’an dernier à la Gaîté est tracé au fusain de saule fait maison. La boue qui saisit, agrippe et maintient nos corps au sol est fidèle au rendez-vous. Un karaoké-rituel prend place : transformé, le morceau Anarchy In The UK des Sex Pistols devient un hymne anarcho-animiste. Des waders bricolées sont maintenant un costume de triton·e queer. Un tissu jaune se déroule depuis le haut du bâtiment et claque au vent, les paroles de la chanson y sont inscrites en rose sur jaune, au bas quelqu’un·e en ciré jaune et lunettes de soleil tient une longue perche recouverte de paillettes se terminant par une main faite d’un gant de ménage rose. On répète un couplet pour que tout le monde se chauffe. La musique démarre, la perche-main pose le rythme en oscillant maladroitement. Nous sommes plusieurs centaines et nous chargeons le sigil en chantant fort comme des punks, dont l’iroquoise crée un écho avec celle du triton crêté de la zad. La parade amoureuse de l’animal est mise en lien avec le mouvement engagé des années 70-80 et le tout se termine dans une transe bizarroïde, les bottes aspirées par la terre mouillée, au son d’une fanfare venue là pour l’occasion. En route ensuite pour l’Ambazada, où un goûter gargantuesque d’entremets, de macarons, de pâtisseries de toutes sortes, éléments d’un luxe communal et coloré qui ont pris des jours à être confectionnés (panne d’électricité la veille en prime) est servi. L’après-midi se remplit de chants, de danses, jusqu’à la nuit où un concert baroque fait péter la magie, la compagnie créole enflamme les foules à l’accordéon, on saute sur And now you do what they told ya, et c’est la même transe qui nous habite.
*
44Faire feu.
« Comme le désir sexuel, la mémoire ne s’arrête jamais. Elle apparie les morts aux vivants, les êtres réels aux imaginaires, le rêve à l’histoire21. »
45Il y a toujours eu des rituels à la zad, des échos de l’ensilage du sarrasin qui se fait nu, ou encore des feux de la Saint-Jean et de brasiers flottants22. Il y a aussi ces moments de manifestation, de rassemblement, comme la cérémonie des bâtons en 2016, où des milliers de personnes ont planté un bâton dans une haie près du hangar de l’avenir, en faisant serment de revenir quand il faudra de nouveau défendre la zad.
La première fois que je suis venu à la zad, c’était à l’occasion de la fête de la victoire le 10 février 2018. J’avais réussi à trouver mon chemin jusqu’aux Fosses Noires et à y rejoindre S. Avec lui nous étions allés jusqu’au Gourbi, qui à l’époque était encore un bâtiment géodésique, à cinq minutes à pied de là sur la route des Fosses. Puis il avait disparu je ne sais où me laissant au milieu de milliers de personnes. Nous étions dix mille environ à être venu·e·s ce jour-là. Des collectifs d’autres territoires en lutte avaient apporté avec eux des maquettes géantes des projets qu’ils combattaient, une poubelle nucléaire pour les gens de Bure, ou encore un éco-quartier pour les Lentillères. Des cortèges comme celui-ci s’élançaient de tous les coins de la zad pour converger vers le Hangar de l’Avenir. Là-bas, au milieu d’un immense champ, un avion en bois avait été amené afin qu’il soit brûlé, lui et toutes les maquettes. Des milliers de personnes se sont mis à danser autour d’un immense feu de joie, de la boue jusqu’aux genoux, la masse de leurs corps fendue par d’énormes créatures, le triton de la zad et un crocodile venu d’ailleurs.
46Il y a un sens du sacré dans les gestes que nous faisons là. C’est un sacré comme Starhawk23 le construit, dans une éthique de l’attention, et non de soumission. Les rituels sont des expressions de ce à quoi nous tenons, du care, fragments de ce qui est sacré à nos yeux, ce territoire, ses habitants ; ils racontent des liens tissés, augmentent la réalité, transforment sa qualité. Nous cherchons à donner forme à des créations collectives, y faire fructifier ce qui nous touche, nous importe. Dans ces situations de liminalité se créent des liens étranges, les regards échangés racontent l’enchantement, l’émerveillement. Il s’agit d’un être-là où « apparaît un type original de rapports humains, fondé sur la liberté et la spontanéité, [que l’on] nomme communitas par opposition à l’ensemble des rapports sociaux structurés par le système hiérarchique des statuts, des états et des normes : la societas24 ». Les rituels que nous expérimentons prennent racine et se confondent dans le jeu, le registre de croyance y est le même, formant un espace de projection et d’invention pour la communitas, comme dans le cadre de « ces jeux que les enfants savent inventer pour sauver un après-midi promis à l’ennui, avec leurs règles créées ad hoc, compliquées et changeantes, avec leurs interdits, leurs prescriptions, et tout ce travail de l’imaginaire qu’ils produisent grâce à la puissance de nomination de la parole ». Des « et on dirait que » et des « comme si » qui transforment le cours de l’histoire et les règles du monde.
47Jouer ensemble à se raconter des histoires, trouver des manières de conter le vécu, fabriquer des masques pour célébrer l’abandon d’un projet d’aéroport, simuler une bataille pour soigner les plaies encore présentes, régénérer le collectif par un évènement cathartique. Jouer ensemble à invoquer, à lancer des sorts en parcourant la lisière d’une forêt, rituel d’entourage pour rappeler que cette forêt est aussi part du collectif. Appeler un arbre, « la déesse », mi-sérieux·se, mi-ironique, accorder la parole à une biche, du savoir à un lapin rose, pour imager d’autres types de relations. Making kin, et reconnaître dans d’autres que soi une affiliation, des affinités, ces « autres », autres qu’humains, avec lesquel·le·s créer des parentés, une phylogénie qui se détache de la pensée biologique ou qui vient tout du moins l’altérer. On s’y sent aussi y appartenir, d’une certaine façon, même si la sensation d’être arrivé·e·s « après la bataille », littéralement, parfois nous tient encore. La peur d’être de ces personnes parfois bien intentionnées qui finalement œuvrent à la gentrification, les artistes après les ouvriers, avec les étudiants, avant les cadres, les ingénieurs néo-ruraux, les personnes en « crise de mode de vie » comme on l’a entendu dire, encore plus avec le coronavirus, et l’éco-tourisme comme horizon. On voit bien autour de la zad, fleurir les pavillons beiges, trop heureux de se répandre dans ce territoire où les haies ont été préservées alors que des pistes de béton devaient tout aplanir pour la future métropole du grand Nantes.
48C’est un espace de jeu où il ne s’agit pas d’être reconnu·e·s comme les créateur·rice·s des rituels, mais ceux-ci comme étant issus d’une écriture collective. Et nous ne parlons pas seulement d’une écriture à quatre. Le rituel se construit par une présence, une envie d’être là, une envie de faire advenir les choses. Si personne n’est là, il n’y a rien. Nous souhaitons que la figure de l’artiste telle que nous la connaissons disparaisse, mais ce n’est pas pour glisser vers celle du prêtre, autre figure masculine de domination intellectuelle aux codes hermétiques. Peut-être que pour l’instant c’est un groupe restreint qui « s’occupe » de ça, de penser des rituels, de participer à repenser un calendrier commun qui s’extrait d’un temps uniforme, d’un temps d’intérieur de bureau devant son ordi, où chaque journée est la même, qu’il pleuve, vente, qu’il y ait du soleil, ou qu’il fasse moche, qu’il fasse chaud ou froid, qu’il y ait de la lumière ou pas. Mais ce groupe se nourrit de tout ce qui existe autour, des évènements, histoires, relations, des reliefs et des textures du territoire, d’une intrication de luttes politiques, sociétales, situées, et des sensibilités qui se mélangent. L’espace trouble du rituel est celui d’une expérience commune et intime de l’indicible, de ce que l’on tente de nommer sans jamais y arriver, ce que l’on ne voit pas mais qui est ici rendu sensible. Les réalités s’y superposent sans s’exclure ni se fondre, l’espace-temps y est dédoublé. Insaisissable, ce qui y est vécu crée une distorsion temporaire de la réalité.
49Au détour d’un repas, certain·e·s nous demandent quand aura lieu le prochain rituel. Et au moment de répondre, une exclamation : « Ah mais oui, pour l’équinoxe de printemps ! ». Dans une lettre ouverte aux ami·e·s du Chiapas qui sont venu·e·s cet été à la zad, les rituels sont évoqués comme une pratique des habitant·e·s de la zad, premier signe de notre disparition en tant qu’instigateurs et instigatrices de ces dits rituels. Ce qui au début était appelé spectacle est désormais naturellement appelé rituel et l’implication de celles et ceux qui y viennent s’en trouve renforcée. Un langage commun, une culture commune.
50À l’écriture de cet article, nous sommes confronté·e·s à la difficulté de rendre compte de tels événements, du danger de réification de l’écriture, de mener une démarche paradoxale. Comme le dit l’anthropologue James C. Scott : « From the moment a spoken text (a particular performance) is frozen in writing as preserved speech, it effaces most of the particularity of its origin — cadence, tone, pauses, accompanying music and dance, audience reaction, bodily and facial expression — any one of which might be essential to its original meaning. [...] Oral culture exists and is sustained only through each unique performance at a particular time and place for an interested audience25. » Et cette légitimité qui nous hantait, continue de nous traverser, lorsque nous disons nous, à deux, à quatre, à dix, ou deux cents. Encore plus particulièrement lorsqu’on se trouve à essayer de transmettre une expérience qui se trouve atrophiée, appauvrie par les mots, confronté.e.s à l’irracontabilité de ce qui est en train de se passer, au point d’inventer des mots moches. Nous pensons cependant que c’est nécessaire, que cette contradiction ne doit pas nous empêcher de partager ce qui se fait ici afin de pouvoir nourrir d’autres possibles, d’autres tangibles, en d’autres lieux.
51Le rituel tel que nous le travaillons à la zad est un outil politique, un outil de soin qui permet de puiser des forces pour les luttes sociales, anticapitalistes, et écologiques. Avec la C.A.R., nous développons une pratique bancale, un jeu d’équilibre, où nous expérimentons un syncrétisme gloubiboulguesque, un mélange de restes du dimanche soir, un sacré profane d’aujourd’hui, mix de pop-culture et de calendrier celte, de masques en rideaux de porte brillants de mille feux et d’autres en terre crue, de dates propres à l’histoire de la zone et de mythes qui ont traversé les temps. Le geste et la geste se réassemblent en ces objets fantasques et disparates que sont les rituels, révélant tout autant qu’ils recomposent les trames de nos mondes.
52Fabuler à mort, jeter, recommencer, faire des liens étranges, marrants, dramatiques, tout mélanger. Se faire phagocyte tout comme ce capitalisme qui digère et se réapproprie tout. Ne pas manquer de nourriture, ne pas se trouver désemparé et dévoré par souci de pureté. En tant que -h-, nous investissons dans la C.A.R. notre volonté de disparaître de la scène et d’habiter un sol, d’être situé·e·s, que les choses qui se déroulent là ne peuvent se dérouler que là, à ce moment-là, bien que des formes ou des histoires semblent faire écho ailleurs. Et c’est ça qui nous sépare des dynamiques capitalistes du marché de l’art et de son white cube, partout lisse et égal de la même manière, comme un terminal d’aéroport se répétant à l’infini.
53Nous voilà ancré·e·s sur un territoire, ou plutôt dans un sol, qui se présente une bonne partie de l’année sous forme de boue. Cette matière liante et mouvante qui change de forme et s’adapte sous les contraintes, les pressions, les flux, c’est la gadoue avec laquelle on joue et modèle. Elle coule dans les interstices, à travers les fissures, elle sert à bâtir des maisons en terre-paille, à marquer des charpentes ou des fronts, à faire des objets à foutre au feu pour devenir céramiques, et durer, durer. C’est la boue dans laquelle les zadistes se sont battu·e·s et grâce à laquelle les zadistes ont résisté contre un État. Les rituels sont justement là pour accompagner cet ancrage de la zad dans un temps géologique, biologique et cosmique, la projeter sur des générations, en accrochant au mythe de la zad qui existe déjà, d’autres types d’histoires et des gestes en résonance. Pour celles et ceux qui ont vécu ces moments, et pour celles et ceux qui viennent après, après la bataille, et qui construisent ensemble une culture. C’est faire le souhait que toujours ces histoires se transforment au contact de l’autre, avec les frictions du temps, des recommencements, dans cet espace où parfois l’on pense qu’il ne se passe plus rien.
54« L’avenir est devenu inhabitable. Et à mon sens, cette disparition de l’espoir ne peut provenir que d’une incapacité à affronter le présent, à vivre dans le présent, à vivre en individu responsable parmi d’autres êtres dans le monde sacré de l’ici et maintenant, c’est-à-dire tout ce que nous possédons, tout ce qu’il nous faut, pour fonder notre espoir26. »