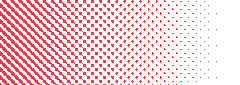Le « scintillement de la putrescence ». Poésie, cinéma, fantastique, horreur
« […] il y a ici des médecins et des commissaires qui veillent à ce qu’on n’étende pas le champ de la poésie aux dépens de la voie publique. »
(Gérard de Nerval, Lettre à Ida Dumas)
« Laurie, totalement abandonnée de cette manière, est incroyablement belle. […] Richard ne bouge plus, totalement subjuguée par Laurie, en position de morte […]. »
(Bertrand Bonello, « La Mort de Laurie Markovitch », Films fantômes)
1Pour ne rien dire des rapports d’ensemble entre cinéma et poésie, ni de la pertinence éventuelle d’une dichotomie entre un cinéma dit de prose et un autre dit de poésie1, la question plus spécifique, mais non moins complexe, de l’application du vocable « poétique » à la sphère filmique a été récemment débattue, diversement commentée et illustrée, au sein de numéros spéciaux. Ainsi, pour rester dans le domaine français, des revues en ligne Textimage2 et Revue critique de fixxion française contemporaine3, ou, pour le format papier, d’Action poétique4 (côté création), ainsi que de CinémAction5 et Recherches et travaux6 (côté critique)7. Un éventail de possibles traits définitoires ou discriminants a dès lors pu être proposé, de manière le plus souvent sinon conjecturale, tout au moins provisoire et circonspecte, s’étendant de l’association d’idées-images et de l’évitement de la narrativité (il en irait, plus largement, d’un primat de la forme et du visuel, dans le plus ou moins droit fil de Victor Chklovski8) à l’abstraction lyrique et à l’autoréflexivité en passant par l’onirisme et le maniérisme. Plus lapidairement — plus radicalement aussi, peut-être —, on pourrait en outre retenir, du côté des créateurs, les réflexions d’un Philippe Grandrieux, dont l’œuvre est loin d’être indifférente à notre propos et à notre genre de prédilection. Ainsi évoque-t-il des « intensités », des « rapports » plutôt que des « raccords » ; plus concrètement — plus originellement aussi, peut-être, car plus en amont —, il fait du rejet de toute continuité dialoguée la condition sine qua non d’une poéticité potentielle de l’écriture scénaristique9. Il serait, enfin, loisible d’en appeler à un Pierre Alferi dont le salutaire caveat demeure, en toute bonne méthodologie, à méditer : « Je crains que tout ce qui cherche de la “poésie” hors des mots, fût-ce dans un montage abrupt et des poses “expérimentales”, ne se condamne au poétisme (c’est-à-dire finalement au kitsch)10. » C’est là, en un sens, inviter à re-poser et re-penser sur nouveaux frais la question de l’intransitivité poétique des images (là encore, dans la mouvance du formalisme russe), de la consubstantialité de la poésie et du langage, de l’irréductibilité du poétique tant à une stylistique précise qu’à une simple « sensibilité » (ou modalité de relation au monde). Aussi la quête de poésie hors les murs, si l’on peut dire, risque-t-elle fort de verser dans la copie dévaluée ou dans l’auto-caricature, sur le versant artistique, ou bien dans l’approximation et le pur impressionnisme, dans le champ critique. À titre de simple exemple, et concernant le seul second plan, mentionnons Philippe Garnier, ancien journaliste à Libération et collaborateur à Cinéma, Cinémas, qui, tout en se targuant d’une approche empirique du cinéma et vouant aux gémonies toute herméneutique, croit emboîter le pas à Robert Benayoun, à soixante ans de distance, en faisant d’une soi-disant « alchimie » poétique la source à la fois de l’insuccès initial et de l’éclatante postérité de ce remarquable hapax que fut, pour Charles Laughton, La Nuit du chasseur (The Night of the Hunter, 1955) : « Laughton avait traduit le livre touffu mais parfois trop “écrit” de Davis Grubb en autre chose, et cette autre chose est la poésie du film, ce par quoi le film perdure aujourd’hui et lui assure son statut cultissime11 ». Indépendamment d’une très riche recherche documentaire et d’une incontestable verve dans sa restitution, cette sorte d’amphigouri, par ailleurs assez caractéristique de ce que l’on peut glaner à foison parmi la critique de fans en ligne tous azimuts, se passe de tout commentaire… Il importera, en revanche, de revenir plus loin au film de Laughton.
*
2Que faut-il retenir de ces considérations d’ensemble, trop hâtivement synthétisées, si d’aventure on songe à les appliquer au genre qui nous requiert ? D’aucuns se souviennent que Roger Caillois, en son temps, mettait semblablement en garde contre toute extension abusive du terme « fantastique », sous peine que son acception n’en devienne purement négative (« tout ce qui s’éloigne de la reproduction photographique du réel12 »). Quoi qu’il en soit, symétriquement parlant, de l’appellation paradoxale « réalisme poétique » dans les années 1930 ou du goût pour la poésie onirique du « merveilleux » tant à l’époque du muet que sous l’Occupation et dans l’immédiate après-guerre, force est de noter que toute tentative de rapprocher ou de penser ensemble l’aire du fantastique et de l’horreur, d’une part, et le champ poétique, de l’autre, semble se heurter à une catégorie conceptuelle a priori oxymorique, s’attacher à un appariement générique d’emblée perçu comme à la fois inadmissible et impossible, rencontrer l’aporie d’un régime d’incompatibilité foncière. Dans un texte au titre bataillien, « Poétique de l’immonde13 », Frédéric Astruc propose des commentaires aussi judicieux que suggestifs. Tout en cheminant vers un questionnement assez proche de mes propres préoccupations — « seule l’image inédite serait de nature à susciter une émotion poétique », « certains sujets résistent-ils à la poésie ? », « l’immonde est-il propice à la construction poétique ? », « l’horreur est-elle miscible à la poésie ? » —, la réflexion me paraît aboutir in fine en contrée peu ou prou balisée. Avec un film comme Hunger (2008) de Steve McQueen (qui, par ailleurs, ne ressortit guère au genre du fantastique ou de l’horreur), la poésie naîtrait, très surréalistement, pourrait-on dire (même si le référent retenu par le critique est plutôt celui de l’arte povera), « d’un désir iconoclaste », d’une « transgression érigée en blasphème ». Avec Morse (Låt den rätte komma in, 2008) de Tomas Alfredson (remarquable réinterprétation du motif vampirique qui s’inscrit, donc, elle, pleinement dans notre champ), il en irait à la fois d’un « dépassement du réel » (soit, d’une « transcendance du plan ») et d’une « circulation du noble à l’ignoble [créant] une forme poétique ». Pour s’en tenir à ce deuxième exemple, si le double geste ou mouvement est assurément mis en évidence par l’analyse, la propriété de sa résultante ne va pas de soi — pour autant qu’elle soit démontrable… Les deux principales conclusions sont dès lors aussi séduisantes que sujettes à caution : « la poésie sourd du croisement improbable d’un certain tabou de la représentation et de sa monstration partielle contextualisée » ; « un même désir de transcender l’enregistrement mécanique de l’acte par une injonction poétique, ou comment l’esthétique accomplit une médiation du réel par la transfiguration ». Si le poétique est ainsi posé tant au départ (injonction) qu’à l’arrivée (création d’une forme poétique), ce qui a chance de constituer son essence, ou sa « qualité différentielle » (dirait un Francis Ponge), resterait à définir ou à interroger précisément.
3C’est là, on l’aura compris, moins pointer des carences que dire la difficulté de la tâche. Il y faudrait rien moins qu’un grain subtil, d’infinies nuances, une palette de différenciations, ainsi qu’une variété d’angles d’attaques et de points d’entrée — et ce, conjointement à une réduction du spectre. Vaste programme, noble ambition… Une première distinction serait sans doute à établir, par-delà les langues et les cultures (qui, par définition, façonnent les taxonomies), entre fantastique et horreur. On conçoit sans peine que le premier puisse accueillir le poétique ou s’en accommoder, notamment sur le registre fantomal, irréel ou évanescent et, plus généralement, pour tout ce qui s’intègre à une esthétique de l’ambiguïté, du trouble et du frisson. On peut penser a contrario que la veine horrifique, privilégiant l’épouvante, l’angoisse, l’effroi ou, pire encore, le gore et le viscéral, ne saurait que se montrer frontalement réfractaire à ce même élan poétique. On verra plus loin que cette perception intuitive n’est peut-être qu’une fausse évidence, mais c’est la polarisation même du genre, censément incontournable, entre, d’une part, la suggestion, la retenue, l’ellipse, la litote, le hors-champ, le clair-obscur et, d’autre part, l’excès, la monstration, la sidération, l’hyperbole, le plein cadre, qu’il serait à propos d’interroger. Quant à la poésie plus proprement dite, il serait sans doute prudent et souhaitable de faire la part des effets ponctuels (par touches) et des effets globaux (ou systématiques), diffus et explicites, discrets (voire secrets) et affichés. Si une poésie obvie n’est pas nécessairement plus aisée à atteindre ou à produire qu’une poésie obtuse, on conviendra que l’échelle, davantage encore que le degré ou la modalité, représente un facteur prépondérant : faire sourdre ou advenir un instant poétique dans un plan ou au sein d’une assez brève séquence n’est guère comparable à une « ambiance » ou à une disposition (à défaut d’un illusoire dispositif ?) poétique soutenue de bout en bout d’un film. Afin d’éviter les chausse-trapes du subjectivisme (pensons, par exemple, à l’usage fréquent par les critiques et autres bloggeurs anglo-saxons du qualificatif atmospheric, lequel est volontiers rendu en français par « plein(e) de poésie »…), il pourrait être fructueux en ce sens d’explorer une possible application du concept allemand de Stimmung, hérité de Kant, puis des Romantiques d’Iéna, à notre problématique — et, au-delà, à l’analyse filmique, ce qui, à ma connaissance, serait inédit14. Résistant aux facultés du discernement et de la description, ce terme est lui-même difficilement traduisible, comme on sait, en notre langue, puisque couvrant un empan sémantique assez ample (tonalité/atmosphère/humeur) et établissant une interface ou une articulation entre sujet et objet, dedans et dehors, moi et monde.
4Or il y aurait précisément lieu de s’interroger sur le sens (directionnel) de la poésie au cinéma : ce que, ou qui, le film poétise importe, au fond, peut-être moins que ce qui, ou qui, poétise le film. À moins que l’enjeu véritable ne se situe, plus précisément, dans l’interaction, ou une forme de résonance harmonique, entre l’état thymique et l’œuvre. Il n’est que de faire retour sur le cas plus particulier du fantastique ou de l’horreur. On n’ignore pas que les vrais esthètes du genre, selon l’expression consacrée et en l’espèce éloquente, tendent à se reconnaître (entre eux plus encore que dans la perception d’autrui) à une aptitude inhabituelle. Celle de passer outre : autrement dit, de faire abstraction des faiblesses, aberrations et autres invraisemblances d’un film, qu’il s’agisse d’œuvres assumant sereinement leur statut de série B (… ou Z) ou se parant, à rebours, des atours du cinéma d’art et d’essai (disons, pour s’en tenir à la même année 1960, Le Masque du démon de Mario Bava pour la première catégorie, Et mourir de plaisir de Roger Vadim pour la seconde). Et ce, pour mieux fondre sur des pépites émergeant d’un fond caillouteux, pour se délecter de minuscules joyaux sertis ou enfouis, c’est selon, dans un bien médiocre écrin (que l’on songe au jeu d’acteurs, au dialogue, au doublage, à la mise en scène ou… à tous ces éléments réunis). C’est dès lors le spectateur, tout au moins l’amateur averti, qui en viendrait lui-même à poétiser le film par extraction d’éléments ou par actualisation d’un potentiel latent. Un regard spectatoriel moins consciemment affûté ou exercé qu’intuitivement discriminant ou « sélectif » agirait ainsi à la manière d’un crible pour éliminer les impuretés, arracherait l’ivraie prosaïque pour ne recueillir que le bon grain poétique. De là à penser non seulement que la précieuse poéticité se trouve avantageusement (ou serait-ce perversement… ?) rehaussée par le prosaïsme ambiant ou environnant, mais que l’une se mesure à l’aune, voire se goûte à proportion, de l’autre, il n’y a qu’un pas, dont on peut concevoir que maint aficionado ne demande qu’à le sauter allègrement…
*
5Faute de pouvoir poursuivre davantage ces multiples « lièvres », et avant d’examiner, à la fois plus modestement et plus localement, un possible point de catalyse ou de cristallisation autour de scènes spécifiques (sous les espèces et les auspices combinés d’Ophélie et de Poe), on se bornera à ce qui est, selon moi, un noyau constitutif et incontournable de la poéticité filmique, tout particulièrement dans le genre ici concerné. À savoir : la question de la (non-) narrativité, généralement conjointe à une certaine forme d’a-discursivité, déjà évoquée plus haut. Sans aller jusqu’au geste radical de la dénarrativisation volontiers rencontré en régime expérimental ou avant-gardiste, la poésie fantastique ou horrifique tend indéniablement à déjouer ou contourner la narrativité — disons, à faire pièce à la pente narrativisante inhérente à la mise en image filmique —, plutôt qu’à l’évincer ou à l’araser tout à fait. Deux modalités principales peuvent se dégager :
61/ par dépossession et/ou désancrage du récit.
On en voudra pour exemple ponctuel, au sein de ce flamboyant chant du cygne du fantastique en noir et blanc qu’est Le Masque du démon [La Maschera del demonio] de Mario Bava (c’est aussi, concomitamment, son premier long métrage à part entière), cet instant où la caméra, déliée de tout impératif narratif comme de tout point de vue clairement assignable, laisse sciemment s’éloigner le coche des protagonistes pour brusquement pivoter et se rediriger, comme de son propre chef, vers la crypte où il ne fait guère de doute que la maléfique Asa, sorcière jadis suppliciée, s’apprête à reprendre souffle et vie. Le mouvement d’appareil « autonome » ne fait pas que devancer et étancher la pulsion scopique du spectateur. Il offre, en outre, une échappée, un détour vers un pur moment d’horreur poétique où l’envoûtement se mêle à l’épouvante, la beauté plastique au macabre : un dépôt de sang clapotant semble croupir au fond des orbites caves d’Asa, gisant dans son tombeau enténébré telle une noyée au corps raidi ; lesquelles orbites ne tardent pas à s’emplir de globes sans pupilles, lactescents et luminescents.



Mario Bava, Le Masque de Satan (1960) : « Le réveil de la sorcière Asa »
7Ainsi encore, plus structurellement, du Vaudou (I Walked With a Zombie, 1943) de Jacques Tourneur dont on a pu dire que, procédant par « rapprochements, symétries, reprises, échappées, assonances » et autres rimes visuelles, il s’acheminait, en lieu et place d’un dénouement proprement dramatique, « vers une floculation poétique »15. La focalisation passe, en effet, de la première personne (anamnèse de Betsy Connell) à la troisième (prise en charge de la narration par la caméra) pour finir par « une incantation impersonnelle », de sorte qu’« il n’y a plus de récit16 ». Il conviendrait d’ajouter, toujours sur le plan duel de l’énoncé et de l’énonciation, que, dès les toutes premières minutes du film, la Stimmung entend rivaliser, en quelque sorte, avec la Dichtung, comme l’attestent les propos (Dichtung) désabusés du très byronien Paul Holland visant à dessiller les yeux de la jeune et naïve Betsy, ébaubie devant l’apparente beauté du monde (Stimmung). Il ne faudrait voir, selon lui, dans ce déceptif spectacle, entre voûte étoilée et mer d’encre tropicale, que « the glitter of putrescence » : « There’s no beauty here. Only death and decay17. » Il n’est pas interdit de penser qu’une telle formulation oxymorique (« le scintillement de la putrescence »), reprise de manière programmatique ou emblématique dans mon propre intitulé, est à même, sinon de subsumer les chatoyantes modalités du poétique cinématographique en régime fantastique, à tout le moins de délinéer la poésie du film de Tourneur… Cette dernière se joue peut-être dans une sourde tension entre incipit et explicit, comme si la démystification ou démythification tôt effectuée (incipit), on vient de le voir, par la parole — et une parole éminemment séduisante et habile, donc quelque peu diabolique : Wesley ne déclare-t-il pas que là réside « la fameuse arme » de son demi-frère, Paul, lequel arriverait, précise-t-il encore, à dénaturer jusqu’au sens de « ce mot, “beau” » ? — devait, à l’autre bout (explicit), être mise à l’épreuve par une remythification par l’image ou un glissement vers ce que l’on pourrait qualifier de carmen visuel (s’agissant, aussi, d’un film imprégné de magie noire).
8L’imploration quasi incantatoire en voix off qui, on le suggérait, vient s’y superposer en coda, après l’« acte » ultime (le « meurtre » de Jessica la morte-vivante, par coïncidence de l’épingle fichée par le prêtre vaudou dans une poupée à son effigie et de la flèche arrachée par Wesley à la statue de Saint Sébastien — écho visuel bientôt prolongé par les harpons des pêcheurs découvrant le corps de la noyée), voudrait restaurer un cloisonnement étanche, équitable et harmonieux, entre les deux domaines : « Oui, Seigneur, aie pitié de ceux qui sont morts, et donne la paix et le bonheur aux vivants. » Or, l’image s’obstine à les confondre — littéralement, lorsqu’il y a effet de surimpression. Ce qui frappe dans ce retour à la matrice océanique, outre sa dimension de rituel paradoxalement ophélien (c’est en fait le vivant, Wesley, qui entraîne avec lui, dans le suicide par noyade, une morte-vivante défunte, s’il se peut dire, qu’il porte dans ses bras) et la rutilance du soleil sur les vagues (qui continue de renvoyer au fil rouge de notre intitulé), c’est l’orthogonalité de l’espace. Cette caractéristique est curieusement passée sous silence dans un essai monographique qui, dans le même temps, fait un emprunt très pertinent à la phénoménologie bachelardienne (temps horizontal de la prosodie vs. temps vertical de la poésie) pour conclure à un « passage de la cristallisation mélancolique au temps suspendu de la pure perception », à un basculement du « récit romanesque » vers « de purs instants poétiques »18.





Jacques Tourneur, Vaudou (1943) : « Jessica-Ophélie prise dans l’orthogonalité »
9Ces quelques photogrammes évoquent assez une spatio-temporalité orthonormée. On notera l’horizontalité de la forme inerte de Jessica dans les bras de Wesley marchant à reculons sur la grève vers la planéité marine, « poursuivi » par la démarche somnambulique, alanguie et empesée, de Carre-four (le nom — pivot d’orientation ou intersection géométrique — est bien fait pour véhiculer la prégnance de la vectorisation), zombie aveugle à la silhouette efflanquée, droit comme un piquet, les bras tendus en avant comme pour prendre possession du corps de celle que, de fait, il portera à la toute fin, après qu’on l’a repêchée. Un plan en surimpression croise à la lettre, sur un fond d’eau écumeuse venant lécher le rivage, les corps de Jessica et de Carre-four, comme s’il s’agissait de deux noyés, l’une horizontale, l’autre vertical, l’une pâle, l’autre ébène. Un nouveau fondu prolonge l’effet thanato-hypnotique en réinscrivant immédiatement Jessica en un semblable assemblage cruciforme, cette fois-ci avec les pêcheurs nocturnes portant flambeaux et psalmodiant un chant haïtien (« Ô Marie Congo »). Citons, à notre tour, l’axiomatique bachelardienne : « Le mystère poétique est une androgynie19. » Et encore ceci : « C’est dans le temps vertical d’un instant immobilisé que la poésie trouve son dynamisme spécifique20. » Ou serait-ce, en termes surréalistes, l’illustration filmique du « stupéfiant image » aragonien comme de la « beauté convulsive » bretonienne, « érotique-voilée, explosante-fixe, magique-circonstancielle21 »… ?
102/ en faisant de la trame narrative un tissu à peine conjonctif et, au mieux, secondaire — exemplairement dans le sous-genre du giallo, polar all’italiana en vogue dans les années 1960-1970, où le fil de la « détection » per se, non content de le céder au suspense et à la terreur, se voit généreusement mâtiné d’« exploitation » érotique.
11Partant, la discursivité se trouve minimalement reléguée à des moments intermédiaires, le plus souvent enkystés dans une intrigue filandreuse ou oiseuse, un dialogue pâteux et un jeu d’acteurs indigent. Intrinsèquement de basse tension, lesdites périodes intercalaires (au titre, insistons-y, de simples intermèdes et non plus de matériau structurant) permettent essentiellement aux spectateurs de patienter, de récupérer et de souffler, avant de « saliver » derechef : de laisser remonter en eux l’anticipation de l’effervescence — d’une scène à faire à l’autre, donc, entre deux morceaux de bravoure. Ainsi en va-t-il notamment, mais sans exclusive, dans le cadre d’une psycho-dynamique spectatorielle propre au cinéma « vernaculaire » de type terza visione (soit, des films de genre projetés dans les salles des zones rurales ou des banlieues industrielles pour un public peu éduqué) dont le filone du giallo transalpin serait, justement, un archétype22. Selon les contours d’un tel tracé sinusoïdal, une profonde inversion de la hiérarchie axiologique s’opère : là où le récit ne revêt plus qu’une fonction apéritive ou transitionnelle, les séquences-phares ou pièces de résistance, à la faveur desquelles la violence homicide, fortement sexualisée, littéralement se déchaîne, constituent de spectaculaires points d’induration ou de cristallisation valant pour eux-mêmes. Pour le dire autrement, ce sont autant de points d’arrêt, bien davantage que d’acmé ou d’aboutissement, de la linéarité narrative23 ; points d’arrêt, certes, sous forme de tableaux ou de compositions, mais qui n’en sont pas moins éminemment dynamiques.
12Prenons l’exemple de Mario Bava, inventeur du giallo et précurseur de la veine du « body count » (selon l’anglicisme en vigueur) avec Six femmes pour l’assassin (Sei donne per l’assassino, 1964). L’intitulé du film, au même titre que telle hypothèse triviale de l’inspecteur en charge de l’enquête à propos des motivations du meurtrier en série (« Peut-être la vue de la beauté lui fait-elle perdre le contrôle de lui-même, et alors il tue »), l’indique assez. À rebours de toute convention narrative comme de toute velléité psychologisante (le fil rouge du carnet de la même couleur s’apparentant à un McGuffin hitchcockien), la mécanique filmique livre en offrande, ou en pâture, à un sadique masqué (dont l’identité ne s’avérera pas par hasard multiple, en nombre et en genre, puisque, aussi bien, il s’agit de nous-mêmes en tant que spectateurs/trices…) d’affriolantes victimes féminines. Celles-ci finiront donc aussi inanimées que les mannequins (motif « bavaesque » obsédant, encore prolongé par la statuaire antique des jardins alentour) parsemant la maison de haute couture où l’action se trouve confinée, ou par tel plan confondant les deux figures, la vive et l’inerte (voir le reflet dans la psyché et l’écho chromatique ci-dessous). On a pu, à propos de ce film, évoquer avec justesse la « logique autarcique » d’une « machine célibataire »24. Risquons, à notre tour, l’idée plus spécifique d’une machine érotico-thanato-poétique qui fonctionnerait à la manière d’un kaléidoscope de la beauté féminine subissant les affres de la corruption, de la torture, de l’agonie et de la mort, selon une modulation à la fois féroce, esthétisante et perversement sensuelle. Si Peggy a, par exemple, la face défigurée par un poêle incandescent, si un gant à griffes d’acier est enfoncé dans le visage de Nicole, Tao-Li, elle, après avoir été noyée dans sa baignoire, a les poignets tailladés par le rasoir de l’assassin pour faire croire à un suicide. Un plan cut nous montre sa mine de poupée immergée, yeux bleus écarquillés et lèvres carmin, tandis qu’un nuage de sang vermeil vient lentement s’épandre depuis le bas du cadre sur le haut de son buste. La valeur poétique s’origine ici non seulement dans la beauté ou la fraîcheur du « masque » mortuaire, mais également et peut-être surtout dans la confluence du statique (plan fixe) et du dynamique (écoulement sanguin).

Mario Bava, Six Femmes pour l’assassin (1964) : « Les deux “mannequins”, ou le rouge et le noir »

Mario Bava, Six Femmes pour l’assassin (1964) : « Un bain de sang »
13Grand continuateur du giallo, Dario Argento n’hésitera pas à reprendre ces motifs tout en les radicalisant ou en les baroquisant, de sorte qu’il tire l’expressionnisme chromatique cher à Mario Bava vers le tableau vivant, la composition picturale, ou encore l’opératique. La filiation s’affermit, certes, par la médiation privilégiée du fétichisme facial féminin — ou, plus justement, de la fétichisation de la mise à mal méthodique, du saccage maniaque de ce fétichisme. Ainsi de cette victime des Frissons de l’angoisse (Profondo Rosso, 1975) dont le visage est ébouillanté dans un bain brûlant (en un condensé, en quelque sorte, des exemples tirés de Six femmes… ci-dessus) ; ainsi encore de cette déformation en masque grotesque ou faciès monstrueux de la frimousse de la jeune étudiante au début de Suspiria (1977) par simple (si l’on ose dire) écrasement contre une vitre. Ce dernier exemple, toutefois, n’est autre que le prélude à la première grande scène macabre du film où le Grand-Guignol en vient, dans les plans conclusifs, à se conjuguer à l’art abstrait géométrique dans le goût de Malevitch, par exemple.

Dario Argento, Suspiria (1977) : « Rictus poético-horrifique »




Dario Argento, Suspiria (1977) : « La mort d’une femme comme l’un des beaux-arts »
14Dans Ténèbres (Tenebre, 1982), on pensera plus volontiers encore à l’abstraction lyrique25, lorsque la gerbe d’hémoglobine projetée sur la surface blanc immaculé d’un mur intérieur par le bras sectionné à la hache d’une accorte victime (Jane) crée un saisissant effet de fresque à la Pollock. Quoi qu’il en soit, on voit le privilège poétique accordé au maniérisme fétichiste de la forme, à la beauté plastique non pas tant de la femme, peut-être, que de l’image, les films d’Argento tendant tout particulièrement à thématiser, dans le sillage de Blow-up (1966) d’Antonioni, la question de l’herméneutique iconique. On perçoit de même qu’une indicible poésie puisse éclore à la croisée de la plus abominable concrétude ou corporalité et de l’abstraction la plus stylisée, de l’énergie vitale et de la pulsion mortifère, de l’enkystement et du déversement, de l’affect viscéral et de la contemplation esthétique.

Dario Argento, Ténèbres (1982) : « Dripping vertical »
15De Bava à Argento en passant par Tourneur, c’est la mort poétisée ou esthétisée — et ce serait là une possible ligne de partage ou de clivage entre fantastique et horreur : poétisation vs. esthétisation de l’image violente, angoissante, terrorisante ou sidérante — d’une figure féminine qui semble pour partie hanter le genre, en dépit de traitements différenciés, voire diamétralement opposés. Faut-il y voir un lointain héritage d’un célèbre précepte du grand Edgar Allan Poe ? Rappelons-en l’origine et la teneur, non sans noter auparavant que de l’inventeur américain du fantastique moderne, le patronyme même (sur lequel a, du reste, été forgé un qualificatif : « poesque ») est en quelque sorte — serait-ce un hasard objectif ? — déjà inclus au sein du vocable qui nous concerne, a fortiori dans la graphie anglo-saxonne qui se dispense de l’accent diacritique : poe(try), poe(tic). Voire, plus discrètement, au sein du substrat étymologique de ce même vocable, puisque aussi bien cette fabrique26 ou ce faire (poiesis/poien), l’auteur les a longuement dévoilés et commentés, autour de ce qui demeure son poème le plus fameux (Le Corbeau), dans un texte intitulé The Philosophy of Composition (1846). Soit, de manière moins abstraite — ou, si j’ose dire, plus prosaïque — dans la traduction française due à Baudelaire : Genèse d’un poème. On laissera ici de côté les considérations d’ordre psychobiographique, qui ont pu faire florès sur ce texte (perte précoce et répétée de figures maternelles ou féminines), ainsi que le hiatus parfois pointé entre la méthode et la pratique, le principe et son produit (que l’on en tienne pour un exercice — aussi ingénieux fût-il — de pure rationalisation a posteriori, ou, plus radicalement, pour une intention mystificatrice). Si la causalité axiomatique présidant à l’argumentation s’avère quelque peu sujette à caution, tant une part d’arbitraire et de raideur mécanique paraît prévaloir tout au long de l’essai, résumons tout au moins l’enchaînement d’implications dont l’aboutissant nous intéresse au premier chef. La mélancolie ayant été préalablement posée par Poe comme « le plus légitime de tous les tons poétiques27 », il ressort que le plus mélancolique de tous les sujets, à savoir la Mort (« selon l’intelligence universelle de l’humanité28 »), atteint logiquement son plus haut degré de poéticité lorsqu’il « s’allie intimement à la Beauté29 », laquelle a été tôt définie comme rien moins que « l’atmosphère et l’essence de la poésie30 ». Il s’ensuit, de manière quasi arithmétique, que « la mort d’une belle femme est incontestablement le plus poétique sujet du monde31 ». Avec pour corollaire que « la bouche la mieux choisie pour développer un pareil thème est celle d’un amant privé de son trésor32 » (a bereaved lover — un amant endeuillé ou éploré —, écrivait Poe, de manière plus dénotative). Observons, au passage, qu’il s’agirait, d’une part, d’une mort, si l’on veut, effective (soit, d’un état-constat), plutôt que d’un mourir, d’une agonie (soit, d’un passage-devenir) ; d’autre part, d’une thématique ou d’un sujet de réflexion (topic), et pas nécessairement d’une représentation. On peut penser qu’un certain cinéma fantastique, à plus forte raison le genre de l’horreur — mais Edgar Poe le tout premier ne s’y était-il pas essayé dans ses Histoires extraordinaires ? —, vont tendre à privilégier le processus et/ou sa mise en scène : moins la finalité ou le non-retour du Nevermore, en somme, que la persistance ou la revenance du toujours-encore.
*
16« La mort d’une belle femme est incontestablement le plus poétique sujet du monde » : nous avons vu, à travers les exemples examinés jusqu’ici, combien ce motif — fût-il feutré ou sanglant, fût-il scintillement à la surface d’une putrescence occultée ou immersion subi(t)e dans un cloaque théâtralisé, fût-il sous-tendu par un deuil mélancolique (comme le souhaitait visiblement l’auteur du Corbeau et tend à l’incarner le film de Tourneur) ou par la brutalité abjecte de l’acte (synesthésiquement mise en scène par Argento, lequel sait pourtant, à l’occasion, détourner la formule de Poe pour parer à des accusations réitérées de misogynie) — a pu féconder ou déployer les résonances poétiques du fantastique et de l’horreur cinématographiques. On aimerait in fine se pencher brièvement sur un cas à la fois spécifique et récurrent de ce principe poesque. Il s’agit de la figure ophélienne, dont on sait combien un Gaston Bachelard, qui fait de l’eau « l’élément de la mort jeune et belle33 », a pu la privilégier dans sa réflexion sur « la valeur de dématérialisation où se reconnaît l’instant poétique34 ». On se souvient que, dans la pièce de Shakespeare, la noyade de la fille de Polonius n’est pas représentée sur scène, mais relatée, d’où un effet saisissant, tant hypotyposique que poétique35, de l’annonce de cette mort par la Reine (Hamlet, IV, 7). D’où, aussi, une certaine part d’ambiguïté quant à la nature de cette disparition. S’agit-il d’un accident, conformément au récit de Gertrude : une branche cède, entraînant la chute d’Ophélie et sa « mort fangeuse », après que ses vêtements imbibés d’eau ont cessé de la soutenir, tandis qu’elle-même continue de chanter « insensible », semble-t-il, « à sa propre détresse », ou comme « naturellement formée pour cet élément » [native and indued / Unto that element] ? Ou bien d’un suicide, comme le laisse entendre le débat entre les deux paysans creusant la fosse de la pauvre défunte (V, 1) ? D’où, enfin, la prépondérance concomitante de l’image (poétique) et de la non-visibilité, qui ne pouvait qu’attiser, symétriquement, la soif de visualisation et de mise en scène. D’Eugène Delacroix et John Everett Millais à Frances MacDonald et Odilon Redon en passant par Paul Delaroche, Alexandre Cabanel et Constantin Meunier, la fortune picturale de la scène n’est plus à rappeler. L’histoire de ses avatars cinématographiques, en revanche, reste largement à écrire, notamment sur le versant générique qui nous requiert36.
17Si L’Atalante (1934) de Jean Vigo n’en relève nullement, il nous offre une première esquisse, entre poésie onirico-aquatique et amour fou surréaliste, entre documentaire et spectralité. Plonger sa tête dans l’eau pour y mirer l’être aimé : le marinier inconsolable de Vigo radicalise ce fantasme de conte merveilleux que lui avait soufflé sa jeune épouse en s’immergeant tout entier dans les profondeurs fluviales. C’est là, en surimpression à l’image, qu’il retrouve cette dernière dans sa robe de mariée, les bras relevés, son corps de ludion en suspension, à la manière d’une ballerine de boîte à musique ou d’une sirène égarée dans une boule à neige. L’effet de floculation est dû à l’abondance de bulles d’oxygène exhalées par Jean (dont le corps virevoltant et le visage disproportionné par rapport à la « figurine » de Juliette lui prêtent des allures d’animal marin à la fois agile et imposant, admirateur ou curieux plutôt que rôdeur ou prédateur), lesquelles semblent par ailleurs créer une forme ectoplasmique, pendant en quelque sorte de la figure fantomale de Juliette. Cette dernière s’apparente, en outre, à une version subaquatique d’un plan antérieur où la mariée en blanc, s’enlevant sur le fond d’une nuit d’encre, arpentait à pas menus le toit lui-même luisant de noirceur de la péniche, de sorte qu’elle en venait à sembler marcher ou se tenir sur l’eau.


Jean Vigo, L’Atalante (1934) : « La Bête et la figurine »

Jean Vigo, L’Atalante (1934) : « La mariée marche sur les eaux »
18La vectorisation spatiale et l’ophélisation sont encore plus sensibles dans un film comme La Nuit du chasseur. La première est avivée par l’inversion symétrique entre, d’une part, la scène du meurtre de Willa Harper, fortement stylisée et explicitement inspirée par l’expressionnisme allemand37 (au niveau tant du décor que de la gestuelle et du clair-obscur), où un plan de Willa, yeux encore grand ouverts (ne les fermant qu’à l’instant où le poignard va s’abattre sur elle), les bras croisés sur sa poitrine, telle une martyre étendue sur l’autel sacrificiel de sa couche, la rapprocherait presque d’une noyée flottant dans l’obscurité environnante de la chambre, et, d’autre part, la découverte de son cadavre immergé, assis sur le rebord de la voiture, le buste droit, les paupières closes.


Charles Laughton, La Nuit du chasseur (1955) : « La martyre horizontale et la noyée verticale »
19Quant à la seconde composante, elle se trouve accentuée par une brève narration, par l’intéressé lui-même et postérieure à la visualisation (distinction dont nous avons noté la prégnance dans Hamlet),de ce que l’oncle Birdie a entr’aperçu, de sa barque, au fond de la rivière. L’une poétise, si l’on veut, ce que l’autre naturalise. Ce qui revient à dire que les deux sont solidaires, par-delà l’intercalation entre elles de la séquence où le terrible Harry Powell traque les enfants jusque dans la cave où ils se tapissent en vain, sans être redondantes. « Si tu l’avais vue, Bess. Au fond de l’eau… avec ses cheveux dansant autour d’elle… comme des roseaux flottant sous l’eau. Et cette entaille à la gorge… on aurait dit une autre bouche. » Le doublage comme le sous-titrage peinent à rendre pleinement une poésie (autant langagière que visuelle, donc) qu’il ne serait pas abusif de qualifier de « plébéienne », au regard du statut social et du phrasé du locuteur38... Le saisissant monologue confié par le pauvre veuf au portrait de sa défunte Bess (ce qui est peut-être une manière détournée de s’adresser à la noyée elle-même) prolonge, sans conteste, l’association, voire la con-fusion, de la figure ophélienne avec le milieu aqueux via la synecdoque de la chevelure flottante39, un peu plus tôt visuellement diffractée et démultipliée par les plantes et autres algues ondulant à l’horizontale. Birdie attire conjointement l’attention sur une sinistre blessure qu’aucun gros plan ne mettait en évidence dans la séquence subaquatique (bien qu’elle y fût visible), mais qui rappelle, de loin, la chute d’un autre poème, bucolique, de Rimbaud, « Le Dormeur du val » : « Il a deux trous rouges au côté droit. » Est-ce à dire que se trouve vérifiée l’affirmation de Bachelard qui veut que « l’image d’Ophélie résiste même à sa composante macabre que les grands poètes savent effacer40 » — en l’occurrence, selon une forme d’euphémisation écranique qui, pour autant, est loin d’oblitérer tout à fait un certain frémissement ? Il convient de confronter cette question à d’autres exemples, non sans relever au passage que le reste du film, au premier chef la descente de la rivière sous la voûte céleste, ne se fera pas faute de poétiser les peurs enfantines — que ce soit par le théâtre d’ombres, le chant (hymne, comptine) ou le bestiaire —, touchant peut-être de la sorte à un statut très privilégié dans la pensée bachelardienne : « Comme tous les grands complexes poétisants, le complexe d’Ophélie peut monter jusqu’au niveau cosmique. Il symbolise alors une union de la Lune et des flots41. »
20Le Carnaval des âmes (Carnival of Souls, 1962) de Herk Harvey : un autre hapax, largement ignoré de nos jours, sinon des inconditionnels de série B qui lui vouent un culte inaltérable (David Lynch et George Romero en tête…) ; une autre automobile engloutie dans un autre fleuve42, avec, à son bord, non plus une seule héroïne, mais un trio féminin ; l’une d’elle est une autre Ophélie, miraculeusement rescapée celle-là, semble-t-il au premier abord, de la muddy death shakespearienne. Limbique et errante, cette dernière (Mary Henry) passe par des phases subites d’absence au monde : autrui ne semble plus la voir ni l’entendre (le « charme », à la dernière occurrence, sera « poétiquement » rompu par un chant d’oiseau), et elle-même perd momentanément toute connexion auditive avec le milieu ambiant. Elle est surtout tourmentée et traquée par des (visions de) zombies blafards et hagards : la mine blême et patibulaire d’un inconnu (incarné, bien que non crédité, par le réalisateur) s’inscrit dans la vitre de sa voiture, en surimpression au propre reflet de Mary (suggérant ainsi une identité ou une parenté ontologique), puis surgit droit devant, le regard hypnotique et charbonneux, ce qui oblige la conductrice à une embardée et à une sortie de route. Lors de sa première visite à ce lieu irréel et spectral que constitue un espace forain désaffecté sur les rives du Grand Lac Salé (le parc de loisirs Saltair, source d’inspiration première et lieu-clé du film), Mary, face à la planitude de l’horizon désert, lance une pierre dans l’eau. Un insert cut fugitif nous révèle le visage du même inconnu, gisant ensommeillé, tel un vampire, sous les eaux légèrement turbides. Peu après, lors d’une transe qui s’empare de Mary jouant de l’orgue à l’église, le chatoiement des rayons de la lune à la surface du lac tire le mort-vivant de sa somnolence : écarquillant les yeux, il émerge de l’eau, avant d’être imité par l’une de ses congénères. S’ensuit une folle sarabande, en accéléré, puis au ralenti. La scène se reproduira in fine, et in praesentia cette fois-ci, l’héroïne redirigeant ses pas, comme en réponse à une irrésistible force d’appel ou à une attirance magnétique, vers le parc d’attractions abandonné. Un groupuscule de revenants livides remonte des profondeurs du lac et, sur la piste de danse en plein air aux lampions soudainement rallumés, la ronde macabre ne tarde pas à se réenclencher. À son tour zombifiée, Mary ne peut désormais se soustraire aux bras de l’inconnu et virevolte un temps avec lui. Sa fuite sera vaine, car — l’épilogue nous le confirmera, tandis qu’elle est repêchée, avec ses deux amies, de son tombeau aquatique — sa place est, suite à sa chute fatale du haut d’un pont à bord d’une voiture, au royaume des morts.

Herk Harvey, Le Carnaval des âmes (1962) : « Rescapée de la muddy death… »

Herk Harvey, Le Carnaval des âmes (1962) : « Le regard hypnotique du mort-vivant »

Herk Harvey, Le Carnaval des âmes (1962) : « Zombies aquatiques »
21Force est de le reconnaître, l’impact des moments de vision(s) poético-oniriques est à proportion de la gangue de réalisme prosaïque qu’ils taraudent (plus celle-ci est épaisse et poisseuse, plus celui-là est puissant et éclatant) — tension dialectique qui subira, à quelques années de là, un tour de vis supplémentaire avec La Nuit des morts-vivants de George A. Romero (Night of the Living Dead, 1968), dans un registre socio-politico-horrifique. Pour autant, une part d’ambivalence persiste : qui ne voit — sinon elle-même, longtemps aveuglée ou médusée par sa propre éclipse — que Mary nage, à la lettre plutôt qu’au figuré, en revenante plutôt qu’en Ophélie, entre deux eaux ? Entre la surface et la profondeur aquatique ; entre la vie et la mort ; entre le diurne et le nocturne ; entre le cauchemar et l’hallucination ; entre le réel et le fantomal. Exemple d’opacité, d’indécidabilité ou de résistance herméneutique dont on pourrait faire un autre noyau constitutif ou définitoire de la poésie fantastique à l’écran — une poésie intervallaire, en somme. Que nous relate, au juste, la diégèse : les visions incohérentes de Mary durant sa brève agonie (entre la chute initiale de la voiture dans le fleuve et son halage final) ? sa survie temporaire dans un monde parallèle ? une expérience de type perception extrasensorielle ou mort imminente ? Le trait d’union qu’allégorise la Mary Henry du Carnaval des âmes en morte-vivante ophélienne est dans le même temps trait suspensif, là où d’autres films s’emploient à instaurer une poétique de la traversée (plutôt que du passage) ou de l’épanchement, à l’instar de l’étonnante séquence onirique qui précède l’épilogue de Et mourir de plaisir et s’amorce par un basculement de la couleur au noir et blanc consécutif à l’acte vampirique. Apparaît, sur fond sonore de gargouillis, une naïade tête-bêche qui pourrait être son double et incite Georgia à la rejoindre de l’autre côté — un autre côté devenu espace liquide qu’une source lumineuse indéterminée surexpose en son centre — de la porte-fenêtre de la chambre. Ouvrant la croisée, Georgia se précipite dans ces eaux claires avec force remous — Ophélie à la verticale, jurerait-on (l’image jouant d’une certaine confusion des repères géométriques)43 —, avant de se retrouver à fouler pieds nus le sol détrempé d’une cour d’honneur où tournoient des danseurs déguisés.


Roger Vadim, Et mourir de plaisir (1960) : « L’eau-miroir, ou la perte des repères spatiaux »
22Ailleurs encore, on parlerait plus adéquatement d’un effet poétique de décollement ou d’arrachement, de sortie — à la fois de l’ornière générique et du labyrinthe domiciliaire. Ainsi de l’inattendue conclusion de ce diamant noir qu’est Les Yeux sans visage44 (1960) de Georges Franju, juxtaposant la mort macabre du père chirurgien dévoré et défiguré par la meute de ses chiens de laboratoire (préalablement libérés de leurs cages par Christine) et la frêle silhouette de sa fille, masque blanc inexpressif immuablement rivé sur son visage, cheminant, dans une volée de colombes et d’un pas fébrile (sans être hésitant), vers un destin certes nocturne, mais pour autant indéfini. Ni rédemption ni résolution : un suspens perpétuel. Ni fugue ni errance : une sortie du cadre sans décadrage, un éloignement vers un point de fuite. Il ne serait pas incongru de poser que le film scinde ou détache in fine ce qu’il s’est évertué sinon à confondre, à faire se côtoyer en un lugubre compagnonnage. En un sens, Christine rompt, en bout de course, avec les genres : le mélodrame, en affranchissant Paulette, l’un des cobayes humains du Dr. Génessier ; l’horreur, « en libérant poétiquement les animaux45 ». Faut-il dès lors voir, dans « le carnage familial » ultime, « un fait divers magnifié par l’explosion lyrique de la forme46 » ? Pour ma part, j’évoquerais plutôt un décollement : non plus prélèvement d’un greffon facial (comme lors de cette séquence chirurgicale prolongée jusqu’à l’insoutenable qui a fait la renommée du film auprès des gorehounds), mais détachement de Christine tout entière, et d’elle-même, par rapport à son environnement et à la sujétion dans laquelle elle était tenue. Décollement, et non pas tout à fait décollage, même si l’héroïne de Franju s’affirme bien comme l’équivalent aérien, éthéré, mais tout aussi mélancolique, de la figure ophélienne ; même si l’envol des colombes accompagne et allégorise tout ensemble l’émancipation de l’héroïne. Le (et la) geste poétiques sont ainsi moins en contradiction qu’en tension avec l’un des actes constitutifs du septième art, à savoir le montage, lui-même articulé autour de la collure, tout au moins à l’ère pré-numérique. Telle qu’elle se présente dans Les Yeux sans visage, la chirurgie, tout comme le cinéma, ne s’exécute-t-elle pas fondamentalement en un double mouvement de découpage et de collage ?



Georges Franju, Les Yeux sans visage (1960) : « La blancheur de la femme au masque et de ses colombes »
*
23Outre la validation de l’évitement ou du contournement de la narrativité au titre de marque subsumante et la suggestion d’un éventuel clivage entre poétisation (versant fantastique) et esthétisation (versant horreur), notre étude aura donc permis de dégager un nombre de noyaux conceptuels — de la Stimmung au carmen visuel, en passant par l’orthogonalité spatiale ou le point d’arrêt dynamique — autour d’un rapprochement, communément perçu comme irrecevable et/ou irréalisable, entre les deux aires considérées. Des effets ou des processus poétiques propres à notre genre cinématographique ont de même pu être mis en avant, qui favorisent tant les réseaux d’innervation que les jeux de compénétration : hybridation de la corporalité et de l’abstraction, de la viscéralité et du maniérisme ; sensation de suspens, de décollement ou d’épanchement ; labilité ou indécidabilité herméneutique, opacité ou résistance épistémologique. Le travail resterait à poursuivre, notamment à partir du rôle crucial de la musique dans la poéticité à la fois sépulcrale et élégiaque d’un certain fantastique, ou autour d’une figure complémentaire d’Ophélie telle qu’Alice au pays des merveilles. Quoi qu’il en soit, la poésie mélancolisante du fantastico-horrifique laisse inéluctablement, à l’instar du Corbeau de Poe, un « souvenir funèbre et éternel47 ».