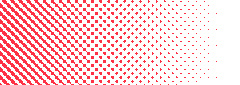Que peut-on faire avec les textes illisibles ?
1Quelles que soient les subtilités d’une théorie littéraire dont les arguties sont parfois perçues par le sens commun comme un effort de rationalisation de mauvaise foi, l’illisibilité semble être le nom d’un échec, d’une impasse – celle à laquelle est empiriquement confronté un lecteur devant un texte dont il n’arrive pas à poursuivre la lecture. Dans ce cas, l’illisibilité qualifie un simple fait, voire moins qu’un fait – un défaut. Le texte illisible n’en perd-il pas dès lors sa valeur littéraire ? Faire une place positive, dans les études littéraires, à un concept comme l’illisibilité, serait de ce point de vue aussi absurde que de faire la critique gastronomique de l’immangeable. Répondre à ce défi signifierait démontrer que la littérature ne se donne pas nécessairement à lire (on peut faire bien des choses avec un texte), ou que, bien qu’illisibles, certains textes réclament bien de la part de leur récepteur une attention de type littéraire. La mise en évidence des pratiques qui, quoique ne relevant pas de la lecture, sont commandées par un texte à son récepteur, permettrait de libérer le concept d’« illisibilité littéraire » de son apparence d’oxymore.
2La réflexion sur l’illisibilité, bien sûr, n’est pas tout à fait nouvelle. Goût du paradoxe ou de la dialectique, les avant-gardes théoriques des années 1950 et 1960 sont même allées jusqu’à en faire une sorte de gage de la littérarité. Dans la mystique blanchotienne de l’écriture comme dans le lacanisme sémiotique de Kristeva, l’illisible, preuve de la lutte de l’écrivain avec la nuit de l’être ou forme littéraire d’un inconscient transgressif, serait l’origine – et finalement le fondement – de la véritable littérature. Dans ces théories, qui relèvent de la poétique plus que de l’esthétique, l’illisibilité serait la propriété du texte qui, au niveau des conditions de possibilité de son existence, a le plus de sens. L’acte d’écriture, particulièrement entropique, serait ainsi caractérisé par une perte maximale de lisibilité : la transformation d’une signification incandescente en un texte incompréhensible. En fait, l’approche de Blanchot comme celle de Kristeva se nourrissaient du travail, théorique et pratique, de Mallarmé, et de sa conceptualisation d’un « mystère » dont il faut préciser qu’il n’est nullement réductible à ce qu’en a dit la théorie de « l’œuvre ouverte » – autre grande tentative de conceptualisation de l’illisibilité des œuvres, qui relevait cette fois de l’esthétique et non plus de la poétique. Mais restant dans le cadre du paradigme communicationnel, elle ne faisait de l’illisibilité qu’un moment (avant le travail herméneutique du lecteur) de la lisibilité, et de la lisibilité (de l’œuvre classique) une illisibilité non-consciente d’elle-même.
3Ainsi, dans les deux premières approches, la lisibilité de l’œuvre littéraire était ramenée à sa production, mais sa réception n’était pas interrogée ; dans la troisième, la réception était bien thématisée, mais l’illisibilité se réduisait à une lisibilité incomplète, ou en puissance (le texte y était en attente d’une sorte de projection, par le lecteur, de lisibilité). Or, se demander ce que nous pouvons faire avec des textes illisibles implique de comprendre l’illisibilité à la fois comme une propriété du texte (rigoureusement opposée à la lisibilité) et du point de vue de la réception. Pour cela, il nous semble possible de revenir, une fois de plus, à l’intuition de Mallarmé. Celui-ci considérait en effet qu’il y avait une véritable différence de nature entre lisibilité et illisibilité : le mystère est un objet relevant de l’ontologie. Dans « Le Mystère dans les lettres », il répondait ainsi à Proust :
Je préfère, devant l’agression, rétorquer que des contemporains ne savent pas lire.—Autre part que dans le journal ; il dispense, certes, l’avantage de n’interrompre le chœur des préoccupations.
Lire
—Cette pratique1.
4Nous nous inspirerons dans les lignes qui suivent du double mouvement de cette citation : lire, d’une part, est une pratique (dont le décodage informationnel n’est qu’un cas particulier), et la lecture du texte mystérieux s’oppose, d’autre part, à la lecture du journal, conçue comme refus d’interrompre le « chœur des préoccupations ». Par souci de clarté, nous appellerons la première pratique, celle qui se confronte aux textes littéraires « illisibles », l’illecture, réservant le terme de lecture à la réception linéaire de textes synthétisables par la conscience (pour passer à la page Pn, il faut que les pages {P1, P2,…, Pn-1} aient été transformées en une idée).
5Et même si l’on peut recevoir de manière non-linéaire des textes lisibles (comme celui qui ne glane dans un roman qu’une phrase par-ci par-là, pour la seule beauté du style ; ou comme l’universitaire qui problématise le texte selon des thèmes transversaux) et réciproquement, il reste que certaines œuvres réclament une attention linéaire et d’autres un type de réception ne relevant pas de la lecture : comme tous les dispositifs techniques, on peut se rapporter aux œuvres autrement que selon leur utilisation optimale ; mais que l’on se serve dans certains contextes d’un balai comme d’une matraque, et réciproquement, n’empêche nullement qu’un balai balaye mieux (et assomme moins bien) qu’une matraque. Pour autant, bien sûr, une distinction si sommaire ne saurait suffire, ni à caractériser des genres, ni à décrire des pratiques : elle ne parvient à épuiser ni la grande profusion des textes, ni la multiplicité des « styles de lecture2 » qu’ils autorisent ou qui les saisissent – ni, a fortiori, la pluralité des lectures que l’on peut appliquer à un même texte3. Pour autant, cette distinction garde sa pertinence, dans son schématisme même ; conceptuelle plutôt qu’empirique, fonctionnelle plutôt que descriptive, elle peut nous aider à articuler l’organisation sémiotique d’un texte singulier (The Waste Land, dans notre exemple) aux grands modes noétiques par lesquels de la pensée se produit4.
Is The Waste Land a waste of time?
6The Waste Land de T. S. Eliot a fait couler beaucoup d’encre. Dès sa sortie, il a donné lieu à de multiples interprétations, souvent exclusives les unes des autres ; on l’a vu comme un poème de réaction et un poème d’avant-garde, un soubresaut chrétien et un manifeste moderniste, un ready-made et une épopée. Le seul point d’accord de ses critiques porte sur sa difficulté, voire sur la pure et simple impossibilité de tirer de sa lecture une signification assurée et unique5. Et finalement, sur l’impossibilité de passer, comme on était habitués à le faire jusque-là, d’un vers à l’autre, dans le procès continu de la lecture. On aurait donc là un des premiers textes de part en part illisibles. Il faut dire que les cinq « chants » qui le composent sont traversés de mouvements n’ayant, semble-t-il, pas de rapport entre eux, et l’intérieur même de chaque mouvement apparaît comme n’étant qu’un montage de renvois intertextuels, de jeux de mots et d’images mystérieuses. Par exemple le passage suivant :
Frisch weht der Wind
Der Heimat zu,
Mein Irisch Kind,
Wo weilest du?
“You gave me hyacinths first a year ago;
They called me the hyacinth girl.”
– Yet when we came back, late, from the Hyacinth garden,
Your arms full, and your hair wet, I could not
Speak, and my eyes failed, I was neither
Living nor dead, and I knew nothing,
Looking into the heart of light, the silence.
Öd’ und leer das Meer6. (v. 35-42)
7Les lignes qui précédaient (« (Come in under the shadow of this red rock) […] I will show you fear in a handful of dust. ») décrivaient un paysage désertique, dans un style proche de celui de l’Ancien Testament. Notre passage, quoi qu’il n’en soit pas séparé par un saut de ligne, marque une rupture à la fois formelle et de contenu : il semble essentiellement composé d’un dialogue entre la fille aux hyacinthes (« hyacinth girl ») et son amant (il lui offre des hyacinthes, il dit « we ») – même si à y regarder de plus près, rien n’implique que l’auteur de la seconde partie du dialogue soit un homme. Et il n’est d’ailleurs pas impossible que ce soit la fille aux hyacinthes qui ait repris, un peu plus tard, la parole. Ou qu’il s’agisse d’ailleurs d’un « homme aux hyacinthes », voire d’un certain Hyacinte, puisque c’est un prénom de garçon et que Hyacinth n’est pas un adjectif, en anglais – une interprétation qui paraît plus difficile, néanmoins, quand on considère la présence de l’article défini « the ».
8Le premier résultat de la lecture d’un tel texte, c’est qu’il est bien difficile à paraphraser. On peut essayer de passer d’une ligne à l’autre, mais le fait de ne pas savoir au fond ce que le texte nous dit rend impossible la synthèse nécessaire à la poursuite d’une lecture continue. Au lieu de les simplifier dans une idée, chaque nouvelle phrase complique et problématise la signification des phrases précédentes. Dès lors, d’un tel passage, on doit dire qu’on ne sait pas ce qu’il est, comment il fonctionne, pourquoi il est comme il est. On peut malgré tout essayer de détailler les différents mécanismes qui produisent une telle illisibilité.
9Reprenons l’expression « Hyacinth garden » : faut-il comprendre le « jardin aux hyacinthes » ou le « jardin d’Hyacinthe » ? Il apparaît que « hyacinth garden » revient dans le brouillon du vers 124 de The Waste Land, mais sans cette majuscule qui ajoute de l’ambiguïté puisqu’elle fait hésiter le mot « Hyacinth » entre le nom commun et le nom propre. Cette présence de la majuscule, qui vient contrarier la transformation sans reste du poème en information, concerne les effets de sens produits par la matérialité du texte, et qui viennent brouiller la transparence de son idéalité sémiotique. On peut appeler ce type d’illisibilité matérielle ; elle concerne aussi, par exemple, les rapports entre les caractères italiques et les caractères romains, ou la tabulation des vers en allemand. Dans un autre registre, c’est ce type d’illisibilité qui contribue à l’impossibilité de paraphraser un poème comme Un coup de dés – ou tout texte dont la forme ne semble pas le fruit du hasard, sans qu’on puisse avec certitude en donner la signification (c’est-à-dire la faire passer en une idée). Derrière cette illisibilité matérielle, l’expression « Hyacinth garden » met en jeu un second type d’illisibilité, celle-là syntaxique : car au-delà de la question de la majuscule, ce sont deux types de rapport grammaticaux (« garden » est-il le complément du prénom « Hyacinth », ou « hyacinth » celui du nom « garden » ?) qui sont en jeu ici. Le problème concernerait donc maintenant le rapport des idéalités sémiotiques entre elles (et non plus dans leur lien aux signifiants qui les portent). C’est le cas dès qu’une phrase échappe aux règles de la syntaxe, ou superpose l’une sur l’autre deux interprétations également possibles sans que l’on puisse trancher. Quelques lignes plus loin dans The Waste Land, un passage très intéressant (vers 77 à 89) nous permet d’illustrer ce point :
The Chair she sat in, like a burnished throne,
Glowed on the marble, where the glass […]
Doubled the flames of sevenbranched candelabra
Reflecting light upon the table as
The glitter of her jewels rose to meet it
From satin cases poured in rich profusion;
In vials of ivory and coloured glass
Unstoppered, lurked her strange synthetic perfumes
Unguent, powdered, or liquid - troubled, confused,
And drowned the sense in odours; […]7. (v. 80-89)
10L’illisibilité syntaxique tient ici à la superposition de deux structures exclusives dans les mêmes termes. En effet, plusieurs mots du texte d’Eliot peuvent être indifféremment lus comme des verbes au passé ou des adjectifs (« troubled » : troublaient, ou troubles, « confused » : brouillaient, ou confus), de même que l’on ne peut décider à la seule lecture que « poured » (v. 85) renvoie à la lumière ou au scintillement des bijoux (voire aux bijoux eux-mêmes). Mieux encore : ce n’est pas seulement que les mots soient polysémiques, c’est que l’acte de lecture est ici comme la vague d’un jeu de dominos qui fait passer les mots d’une position à l’autre. Lorsqu’il arrive à « troubled, confused », en venant de « powdered » (adjectif : en poudre), le récepteur est invité à considérer qu’il s’agit d’adjectifs qualifiant les parfums : ils sont troubles, confus. Mais en passant au vers suivant, le verbe « drowned » semble rétroagir sur eux, et les redéfinir rétrospectivement comme verbes, eux aussi : ils « troublaient », « embrouillaient » les sens.
11Si l’on revient au passage cité plus haut (vers 31-42), on peut observer un troisième niveau d’illisibilité, inter-propositionnel : les phrases n’ont semble-t-il pas de rapport les unes avec les autres. Ainsi, les vers allemands ne partagent ni leur langue, ni leur thème, avec les vers qu’ils encadrent. Ils proviennent du libretto de Tristan und Isolde (ils en sont parmi les premiers vers), et signifient : Un vent frais / Souffle vers la patrie / Mon enfant irlandais, / Où es-tu maintenant ? Quant au dernier, on peut le traduire ainsi : Terne et désolée la mer.
12L’interprétation la plus valable, sans doute, serait celle qui pourrait synthétiser en l’idée la plus simple le plus grand nombre d’éléments du texte. Comment s’y prendre ici ? La place de Tristan und Isolde dans les histoires d’amour, celle de Richard Wagner dans le nihilisme post-schopenhauerien, comme dans l’émergence de l’art moderne, sont connues. Dans ce cadre, on pourrait mettre en évidence le fait que Dante, dans le dernier chant du Paradis (Chant XXXIII),articule le thème de la lumière à celui de la Sybille et de l’iris (c’est-à-dire l’hyacinthe). C’est le moment où l’amour fait accéder le poète à la contemplation d’une vérité divine. On y lit (dans la traduction Lammenais) : « parce que ma vue, devenant pure, pénétrait de plus en plus dans la splendeur de la haute lumière qui de soi est vraie. Ce que je vis ensuite surpasse notre langage, impuissant à le peindre comme la mémoire à aller si loin. » Le texte d’Eliot nous présenterait une expérience semblable : voir le silence dans le cœur de la lumière. Mais sa signification, simplement, serait opposée : ce silence serait la marque de l’indicible néant, non du divin. Reprise d’une anecdote (l’homme aux lilas) dans l’écho de Wagner et dans l’écart à Dante, le fragment de la fille aux hyacinthes, fleurs sanglantes (chez Ovide, Apollon, en le tuant, transforme les gouttes de sang du jeune homme en hyacinthes) d’un jardin désolé, pourrait signifier ceci : que l’amour n’est plus ascensionnel.
13Le problème, c’est que cette interprétation laisse beaucoup (trop) de restes : elle n’explique ni l’itérativité du don d’hyacinthes, ni la période d’un an, ni le surnom « fille aux hyacinthes », ni qui sont « eux », et pourquoi ses bras remplis, les cheveux mouillés ? Tout cela n’apparaît que comme un ensemble décousu de thèmes bigarrés. Peut-être des traces du réel en sa contingence idiote ? Ou les signes d’une autre interprétation possible, plus renseignée, plus cultivée, englobant plus de références intertextuelles et débouchant sur une unité de sens plus serrée ? C’est plutôt que l’unité du texte n’est garantie ici que par la proximité spatiale des fragments sur la page : mi-visuelle, mi-instituée par les règles éditoriales. L’existence du sens synthétique (c’est-à-dire : de la lisibilité) de The Waste Land n’est d’abord qu’un postulat de la raison lectrice, adossé à une perception matérielle orientée par les traditions. Chercher un sens à tout prix, c’est jouer celles-ci contre l’expérience de la lecture – ou plutôt, ici, de l’impossibilité de la lecture. Car dans The Waste Land, les scènes, les personnages, les temps et les lieux et mêmes les narrateurs, tout change, rien n’est stable. C’est le quatrième type d’illisibilité, celle qui concerne le texte comme tout – holistique.
14Dans un article qui a fait date, désirant justifier l’art d’Eliot tout en prenant acte de cette illisibilité, I. A. Richards proposait de caractériser The Waste Land comme « music of ideas »8. On ne peut pas, expliquait-il, comprendre un texte ; pas plus qu’on ne peut véritablement « comprendre » un morceau de musique. Pour autant, on ne tire pas argument de cette impossibilité à pointer précisément ce que la musique « veut dire » pour en dénoncer la légitimité artistique. Par cette démonstration, il voulait s’opposer aux aficionados de la lecture comme interprétation.
15La thèse de Richards est stimulante, articulant en arabesque l’ouverture des significations et l’unité de la figure ; elle l’est d’autant plus qu’elle semble énoncer une évidence, alors qu’elle est assez subtile. Car Richards ne dit pas « musique des mots », ou « musique des signifiants », ce qui serait trivial et proche du pléonasme. « Musique des idées » ou « musique des signifiés », veut dire que le poème et ses mots sonores ne sont guère l’essentiel. Que l’épaisseur des mots (qu’un fétichisme un peu scolaire nous a habitués à traquer et à lister en allitérations et assonances) ne vaudrait guère mieux que celle des traces sur la partition. Musique : articulation (et non pas synthèse) du multiple ; musique des idées, non des sons ; articulation harmonique de la pluralité des significations ; intelligible béance dégagée à la surface du poème ; buée, figure.
16Pourtant, malgré ce qu’elle a de séduisant, l’analogie ne tient pas. Car il y a précisément débat sur les idées qui sont dans le poème (l’illisibilité n’est pas seulement holistique, mais aussi matérielle, syntaxique, inter-propositionnelle), et l’on ne s'accorde pas sur la nature des signifiés présents. Si c’est de la musique, c'est une musique dont la nature des éléments est variable et dépend de l'investissement affectif et culturel du récepteur (sans être pour autant n'importe quoi : nul ne dira que le fragment cité plus haut énonce une recette de la flammenkuche). À l’inverse, les notes de musique sont ce qu’elles sont, ne sont que ce qu'elles sont. Il y a peut-être discussion sur le sens de la figure totale (ce dont peuvent rendre compte les interprétations variées, par des musiciens d’une sensibilité différente, d’une même pièce), mais chaque do est un do, aucun ré n’est autre chose qu’un ré. La musique des sons (c’est-à-dire : la musique) est l’articulation mouvante de points d’identités. Le poème d’Eliot est articulation mouvante de points eux-mêmes mouvants. The Waste Land est une arabesque de cinq moments dont on n’est pas certain du sens, chacun composé de morceaux qu’on ne sait pas articuler, eux-mêmes faits de phrases énigmatiques pleines de mots dont on ne sait pas s’ils sont des noms ou des images, du propre, du figuré, ou un son de passage. C’est un enchâssement de doutes ; une sculpture mobile, comme celles de Calder, mais sans partie solide ; une poupée russe de mystères.
Pragmatique de l’illecture
17Illisible, The Waste Land n’est pas non plus n’importe quoi. Il faut tenir, contre une interprétation hâtive de la théorie des communautés interprétatives, l’idée qu’il y a de la littérature tout comme il y a de la non-littérature. Dans Quand lire, c’est faire, en effet, Stanley Fish raconte qu’après un premier cours donné à une première classe, quelques bribes d’une bibliographie étaient restées sur le tableau. Les élèves d’un second cours, pénétrant dans la classe, se laissèrent persuader qu’il s’agissait là, malgré son inintelligibilité, d’un poème – habitués qu’ils étaient à l’illisibilité. Ne faut-il pas en tirer argument pour dire qu’il n’y a pas de différence de nature entre la non-littérature et la littérature, et que c’est le récepteur qui fait l’œuvre ? Stanley Fish écrit : « Ce n’est pas la présence de qualités poétiques qui impose un certain type d’attention mais c’est le fait de prêter un certain type d’attention qui conduit à l’émergence de qualités poétiques9 ».
18En réalité, quelle que soit la manière dont on interprète la fable de Fish (que l’on considère que l’ensemble d’énoncés épars soit effectivement devenu, par l’intermédiaire du geste du professeur, un poème, ou non), elle ne contredit pas l’idée qu’une différence existe entre illisible non-littéraire et illisible littéraire. Le geste de Fish est sans doute purement institutionnel : il n’empêche qu’en instituant le texte en œuvre pour ses étudiants, il leur ouvre par là-même un champ d’investigation littéraire. Autrement dit, être littéraire, pour un texte, que cette propriété soit ou non relative au contexte institutionnel, c’est faire faire un certain type d’actions à un récepteur (dans le cas de l’exemple de Fish : une explication de texte). Ici, la différence entre littérature et non-littérature dépend d’un geste extérieur au texte (institutionnel) ; mais dans la plupart des cas (lorsqu’il ne fait pas débat qu’un texte est littéraire), si la dimension littéraire du texte ne dépend guère du contexte institutionnel, c’est que le texte a intégré ce geste qui est en réalité une commande, ou une invitation faite au récepteur de commettre un certain nombre d’actions. Parmi ces actions, on doit bien sûr compter, dans le cas des textes lisibles, la lecture. Mais lorsqu’ils sont illisibles, les textes littéraires commandent autre chose.
19Depuis L’Œuvre ouverte d’Umberto Eco, la prise en compte de la littérature moderniste revenait, d’une part, à ne voir entre lisibilité et illisibilité qu’une différence de degré (malgré le témoignage de l’expérience, qui comprend très vite la différence de nature entre Finnegans wake et Oliver Twist), et d’autre part à refuser la séparation nette entre littérature et non-littérature. C’est qu’à force de vouloir faire de l’œuvre un message, de telles approches communicationnelles laissaient de côté le fonctionnement de la machine textuelle. Elle restait prisonnière d’une conception « informative » de la littérature, selon laquelle celle-ci dit quelque chose – par opposition à une conception « formative » selon laquelle, d’abord, elle fait quelque chose. Cette distinction est au cœur de l’ouvrage de Joshua Landy, How To Do Things Wit Fictions, dont le titre est un clin d’œil direct à celui d’Austin, How To Do Things With Words (seule la traduction française du titre de Fish, Quand lire, c’est faire, renvoyait quant à elle au même ouvrage d’Austin, et seulement dans sa traduction française, Quand dire, c’est faire). S’intéressant indifféremment à une littérature « lisible » ou « illisible » (de Platon à Beckett en passant par Chaucer ou Mallarmé), Landy plaide pour une approche pragmatique. Il se porte en faux contre une conception informative selon laquelle la littérature proposerait des thèses, des messages ou des conseils. Il ne s’agit pas pour autant, pour lui, de nier l’existence de tout contenu, mais bien plutôt de montrer que celui‑ci, loin d’être lafindu texte, est également unmoyenau service de son efficacité pragmatique : « C’est bien sûr vrai que les fictions sont “à propos” de quelque chose, mais ce “propos” […] est une partie importante de leur fonctionnement10. » Landy propose de considérer chaque texte comme un dispositif pratique, une sorte de manuel destiné à un certain type d’utilisateur prédéfini, et dans lequel le contenu de pensée « n’est jamais l’enjeu » (p. 15), dans lequel il « n’est toujours qu’instrumental » (p. 16).
20Si les concepts de lisibilité et d’illisibilité ne sont guère les objets de l’investigation de Landy, on peut en conclure que, davantage que du point de vue du contenu qu’un texte communique ou ne communique pas, ils doivent être compris dans le cadre d’une pragmatique de la réception. Etre lisible, pour un texte, ce serait d’abord faire (ou faire faire) quelque chose (et réciproquement être illisible, ce serait ne pas faire ou ne pas faire faire cette chose – et aussi, peut-être, faire faire autre chose). La lisibilité n’est plus alors qu’un cas particulier de la littérature : celui du texte dont l’effort implique de la part du récepteur une attention linéaire, continue, homogène – comme moyen (de conversion, de propagande, de divertissement, etc.) ou comme fin (dans une « littérature pure » ou revendiquant une forme d’« art pour l’art »).
21Ainsi, voir dans une œuvre littéraire un dispositif sémiotique qui donne à penser (ce que devient avec l’intervention du professeur la liste bibliographique du tableau noir de Fish), et qu’il faut utiliser selon un certain mode, permet de comprendre que lire n’est qu’une pratique parmi d’autres : ce n’est que le mode linéaire et continu de la pensée (quand elle se nourrit de l’utilisation d’un dispositif sémiotique). Ce mode correspond à des dispositifs eux-mêmes linéaires et continus, comme, par exemple, l’épreuve (opérée par une épopée permettant à une communauté politique de sélectionner des vertus politiques) ou l’expérience de la conscience (telle que peut la jouer un roman)11. Mais s’il existe des modes non linéaires, ou non continus, de la pensée, alors on doit pouvoir concevoir des dispositifs textuels qui les activent, et auxquels on ne peut par définition pas se rapporter par cette activité linéaire et continue que l’on appelle lire. Pour savoir quels sont ces modes, il faut comprendre comment le texte illisible essaie de disposer de l’attention de son récepteur.
22Résumons. Un texte lisible contient (ou instaure) un plan de sens linéaire et homogène. Très pratiquement, cela veut dire que son récepteur (croit qu’il) peut passer (sans autre procès) au mot, à la phrase, au paragraphe suivant (ou sauter, comme dans Marelle de Cortazar, trente ou cent pages plus loin : la linéarité au sens où nous l’entendons ici est celle du plan de sens, non de l’organisation matérielle des pages). Pour lui, la lisibilité du texte revient donc au fait qu’il soit possible de le synthétiser sans reste par la conscience, donc de changer tout le texte en idée du texte. Sans reste, ou, plutôt, sans reste significatif (car il peut toujours exister des mots ou des phrases que nous ne comprenons pas), c’est-à-dire signalant l’existence d’autres plans de sens hétérogènes, et même contradictoires avec le premier. Car dans le cas de l’illisibilité de la poésie contemporaine, c’est une véritable « dénégation » qu’organise le texte : les mots deviennent par exemple des néologismes (dont la signification n’est soudain plus univoque, par exemple chez Philippe Beck) ou les vers des aphorismes (prenant souvent l’allure de paradoxes, comme chez René Char), ou les fragments n’ont plus de rapport évident entre eux (comme c’est exemplairement le cas dans The Waste Land). Dans ces cas, le texte commande son illisibilité, met activement le sens en faillite. L’illisibilité est alors liée au fait que malgré son appel au récepteur le texte ne permette à celui-ci pas de le synthétiser en une idée.
23Que de tels textes soient malgré tout littéraires, cela implique qu’il existe des manières de donner à penser (et de là, des modes de la pensée – puisque nous avons défini la littérarité comme cette propriété qu’ont certains dispositifs textuels de donner à penser) non linéaires, discrets ou hétérogènes. Les formes de hiatus que nous avons repéré dans The Waste Land, et qui sont responsables de son illisibilité, et la recherche d’un appel au récepteur, lui expliquant comment utiliser le dispositif sémiotique, nous guideront dans la recherche de tels modes. Reprenons notre lecture.
Noétique de la pensée par coups
24The Waste Land ne fonctionne pas comme un texte lisible ; ce n’est pas ce type d’attention que le poème d’Eliot réclame de son récepteur. Comment fonctionne-t-il ? Que doit-on (que peut-on) faire avec lui ? Pour le savoir, il faut repérer la manière dont il s’adresse à nous, et comment il essaie, rhétoriquement, de nous positionner (de disposer de nous, pour qu’on dispose de lui) puisqu’il ne s’agit pas de n’importe quel texte illisible, mais d’un texte littéraire, et qu’il doit donc bien contenir une demande d’attention, quelle qu’en soit la forme (il est fait pour être tenu entre nos mains, et regardé, étudié, questionné – sinon lu). Il est dans ce cadre remarquable que, tout au long du texte, The Waste Land s’adresse à son récepteur – au point que certains auront considéré que lui, le lecteur, en était le héros véritable12. Il s’adresse à lui, non seulement parce que le texte met constamment en scène des dialogues ou des adresses dans lesquels la deuxième personne du singulier est abondamment utilisée, mais aussi parce qu’il semble lui proposer une sorte de mode d’emploi. Le passage suivant nous en donne une idée :
Madame Sosostris, famous clairvoyante,
Had a bad cold, nevertheless
Is known to be the wisest woman in Europe,
With a wicked pack of cards. Here, said she,
Is your card, the drowned Phoenician Sailor,
(Those are pearls that were his eyes. Look!)
Here is Belladonna, the Lady of the Rocks,
The lady of situations.
Here is the man with three staves, and here the Wheel,
And here is the one-eyed merchant, and this card,
Which is blank, is something he carries on his back
Which I am forbidden to see. I do not find
The Hanged Man. Fear death by water.
I see crowds of people, walking round in a ring.
Thank you. If you see dear Mrs. Equitone,
Tell her I bring the horoscope myself:
One must be so careful these days13. (v. 43-59)
25Ce fragment, tout aussi apparemment déconnecté des autres que ceux que nous avons lus plus haut, semble relater une séance de Tarot avec Madame Sosostris, voyante. Comme dans les autres fragments, il s’agit d’une sorte de collage de références intertextuelles hétérogènes. Le nom de la voyante pourrait ainsi être une allusion à un personnage d’Aldous Huxley, Sesostris (dans le roman Crome Yellow, publié en 1921, soit un an avant The Waste Land). Mais il faut bien voir que les références mobilisées par Eliot dans ces lignes ne sont pas accidentellement obscures ; elles servent à troubler l’univocité du texte, pour faire déraper le monologue de Madame Sosostris vers un sous-texte érudit, ou érotique. Ainsi, « Those are pearls that were his eyes » est une citation de Shakespeare (La Tempête, acte I, scène 2). Il s’agit d’un extrait d’une chanson d’Ariel, l’esprit de l’air et du souffle de vie ayant provoqué, pour le compte du magicien Prospero, la tempête à l’origine du naufrage. Il y décrit la noyade fictive et la transformation du Roi de Naples en corail. Mais dans la bouche de Madame Sosostris, le « Those » reprend sa valeur déictique ; les perles sont alors celles qui entourent ses doigts, son cou. « Fear death by water » est le titre de la partie IV de The Waste Land, qui raconte la noyade du marin phénicien. L’expression peut aussi renvoyer au baptême, tel qu’on le trouve décrit dans l’évangile de Matthieu. « Belladonna » signifie bien sûr « jolie femme » en italien, mais c’est aussi une plante toxique, qui doit son nom au fait que les Italiennes instillaient dans leurs yeux du jus de belladone pour dilater leur pupille. « Lady of the Rocks » pourrait être Mona Lisa ou, du même Vinci, la femme de La Vierge aux rochers. D’après certains commentateurs, il faudrait mettre en lien la « Lady of situations » avec la prostitution, la question du travestissement, l’infertilité et, finalement, la stérilité du Roi pêcheur dans le mythe de la Terre gaste.
26Les références de ce réseau de renvois ne nous intéressent pas en tant que telles, ici. Du reste, tous les textes – même lisibles – sont composés à partir d’une culture qu’ils rappellent plus ou moins explicitement. Mais la différence, ici, c’est que T. S. Eliot lui-même a agrémenté la première édition de son poème d’un ensemble de notes dans lesquelles il donne l’« élucidation » (c’est son mot) de certaines de ces références. On a là un premier type d’invitation explicite au récepteur : le texte, sinon à lire, serait à élucider. Premier coup.
27Mais ce n’est pas tout, car le passage cité plus haut raconte une scène chez la voyante, c’est-à-dire chez un charlatan faisant profession d’interpréter les cartes d’un jeu de tarot. Tous les éléments comptent ici : il s’agit d’un jeu, d’une part, on propose de le lire, d’autre part, c’est un charlatan enfin, qui propose de lire, plutôt que de jouer. Pour le premier point : un jeu (comme les échecs, par exemple) est un dispositif dont l’utilisation requiert un ensemble hétérogène de coups (le cavalier bouge selon une règle qui n’est pas celle du pion ou celle de la dame) – et non pas le rapport linéaire et continu d’une lecture. Deuxième point : alors qu’il s’agit pourtant d’un jeu, on propose au personnage de lire, c’est-à-dire d’interpréter les différents éléments et de les intégrer à un récit linéaire et homogène (qui donnerait le sens du futur). Enfin, c’est un charlatan : non seulement il n’existe aucun rapport entre les images des cartes et les visions auxquelles elles donnent lieu (ainsi, ce n’est pas la carte du marin phénicien, mais l’absence de celle du Pendu, qui débouche sur l’ordre de craindre la « mort par l’eau »), mais la seule prévision de l’avenir concerne, prosaïque, un rendez-vous (qui cache, d’après certains commentateurs, une aventure) avec une certaine Mrs. Equitone (dénotant semble-t-il la femme d’Eliot lui-même). Et cette remarque, d’une banalité ridicule et réjouissante : « One must be so careful these days ».
28Or, il se trouve que dans ses notes autographes, T. S. Eliot détaille quelques points du symbolisme taromantique qu’il mobilise. On serait ainsi tenté d’interpréter le poème à cet aune, d’autant que nous y sont livrés des éléments qui permettent d’opérer quelque chose comme une grande synthèse : du Pendu au Dieu de Frazer, de celui-ci au Roi pêcheur de la terre gaste dont traite le livre de Weston, From Ritual to Romance, qu’Eliot présente comme sa principale source. Selon cette piste et de proche en proche, on pourrait croire avoir accès à la synthèse d’un un sens global ; mais heureux d’avoir trouvé là les clés d’un symbolisme bon marché, tout se passe en réalité comme si le récepteur en quête de sens était en train de tirer les cartes de sa propre divination ; lui-même risque de se transformer en charlatan (celui qui fait semblant de comprendre des cartes) ou en dupe (celui qui croit les interprétations qu’on lui en propose). Qu’il n’oublie pas, plutôt, le début de la note d’Eliot : « Je ne suis pas un familier de la constitution exacte du paquet de Tarot, dont je me suis explicitement écarté pour suivre ma propre voie. » Et si la fin de la note emporte malgré tout son jugement, peut-être reconnaîtra-t-il l’autorité rétrospective de l’auteur, écrivant dans Frontiers of criticism : « Mes notes attirèrent un mauvais type de lecture de la part des chercheurs de sources. C’était juste, indubitablement, que je paie mon tribut aux travaux de Jessie Weston ; mais je regrette d’avoir envoyé tant d’enquêteurs se fourvoyer sur la fausse piste du Tarot et du Saint Graal14. »
29Le tarot est un jeu de cartes. Mais dans les mains d’un charlatan, il s’adresse à un client en quête de sens. Or, le texte multiplie les déictiques : presque chaque ligne compte un « Here », un « you » ou un « I » – des mots dont, par définition, le sens dépend du contexte. Dans le cadre de The Waste Land, il n’est donc pas exagéré de considérer que « here » peut signifier « dans ce poème », « you » le récepteur, et « I » T. S. Eliot lui-même. À suivre cette piste, la seule interprétation dont les cartes du Tarot seraient le symbole, en tant que pratique charlatanesque, c’est alors celle de la propension du récepteur à lire ce texte au lieu de jouer avec lui : s’en remettant aux madames Soleil de la critique, ou cherchant lui-même, sans méthode, à épuiser quelque signification flottant dans le ciel des idées textuelles. Car, avant d’être un ensemble de cartes à interpréter, avant d’être lisible, un jeu de tarots est d’abord un jeu. Et il se trouve que la deuxième partie de The Waste Land s’intitule « A Game of Chess ».
30Selon cette hypothèse, donc, un tel texte serait composé de pièces, dont on doit disposer selon des règles diverses, et attendrait de la part du lecteur la production d’un ensemble de coups. Non pas pour le lire, mais pour jouer avec lui, c’est-à-dire pour l’activer. Un retour sur la manière dont on s’est soi-même comporté face à The Waste Land montrerait que, loin de l’avoir lu selon l’attention linéaire et continue que l’on oppose par exemple aux romans, on a effectué un tel ensemble de coups, ponctuels, locaux, hétérogènes. Nous en avons noté, dans le travail préparatoire à l’écriture de cet article, huit : décrire, élucider, traduire, comprendre, mémoriser, ruminer, méditer, théoriser sont autant de pratiques que le texte nous a invité à produire, dans une sorte de corps à corps, pour pouvoir (pour nous sentir le droit de) passer à la ligne suivante. C’est cette pluralité de coups qui remplace la synthèse tranquille du sens dans la lecture. Chacune de ces actions n’est peut-être pas un « atome pratique » (peut-être est-elle composée d’actions plus essentielles) et pourrait être encore détaillée, mais cela suffit à fonder l’affirmation suivante : le texte illisible demande au lecteur (via l’appel des notes ou de l’apostrophe) de produire un ensemble d’activités qui ne relèvent pas de la lecture, pour passer à la ligne, à la phrase suivante. Il apparaît, ici, comme un jeu de cartes textuel qui réclament un ensemble de coups qui se succèdent dans des ordres variables et ne se synthétisent pas en une idée.
*
31Quel est l’intérêt d’une telle pratique ? Seulement ludique ? L’enjeu est pour nous de savoir si un tel jeu ne relève pas, au bout du compte, d’une manière de penser. Peut-on faire une noétique de la pensée par coups ? Si, comme nous l’avons suggéré, la lecture n’est qu’un cas particulier de la réception des dispositifs textuels littéraires, ceux où le mode de la pensée mise en jeu est continu et linéaire, ce que nous avons dans un premier temps identifié comme l’illisibilité de The Waste Land apparaît maintenant comme la propriété d’un dispositif textuel fonctionnant comme un jeu de cartes (ou d’échecs ; de toutes façons comme un jeu) réclamant une attention nourrie d’une pluralité de coups hétérogènes. Mais s’agit-il là d’un mode de la pensée ? On comprend bien que l’on peut penser par une expérience fictive de la conscience, ou par une épreuve des postures politiques : les grands romans du xixe sièclesont parvenus à penser les formes de l’émancipation, et les épopées grecques les vertus politiques du bon roi15. Mais que peut-on penser par une partie de cartes textuelles ? Quel est l’output sémiotique qu’une illecture de The Waste Land peut produire ? L’hétérogénéité des coups et l’impossibilité de synthétiser dans la conscience la pluralité des dimensions du texte n’impliquent-elles pas que la partie en question ne puisse aboutir à quelque chose relevant véritablement de la pensée ? Peut-il seulement exister une pensée par coups hétérogènes ?
32Non seulement il semble qu’un tel mode noétique soit possible, mais la philosophie, depuis la révolution wittgensteinienne, tend à considérer que la pensée est essentiellement une activité discontinue et articulée, traversant des dispositifs composés d’actions hétérogènes, et qu’elle ressort, en somme, des multiples coups de jeux de langages pluriels16. S’il en est ainsi, alors l’illecture relève bien de la pensée – puisqu’elle « permet et exige d’opérer des sauts entre différents plans de réalité17 » (Yves Citton la nomme « interprétation »). Mieux, c'est maintenant l'existence d'une littérature demandant à son récepteur une attention non discontinue, plurielle et articulée, d’une attention linéaire et continue – une « lecture » – qui devient étrange, et problématique. Comment considérer une telle linéarité ? Est-elle structurelle (mais alors il faut dire que cette littérature qui donne à lire ne donne pas à penser) ou bien n’est-elle au contraire qu’une sorte de voile rhétorique de lisibilité, pudiquement posé sur une machinerie complexe, faite des mêmes éléments hétérogènes que ceux qui font la littérature illisible ? Dans ce dernier cas, la lecture ne serait qu’un cas particulier des rapports possibles aux textes littéraires même lisibles. N’est-ce pas en effet après le développement de la poésie, depuis Mallarmé, que la théorie littéraire a pu appliquer à la littérature lisible, sous des formes multiples valorisant à chaque fois un type de coup (de la poétique aux théories de la réception, de la génétique au structuralisme, etc.), les outils nés de l’illecture ? On peut ainsi proposer de romans comme Le Rouge et le Noir des études qui décrochent de la continuité narrative de l’expérience de la conscience, pour y repérer les structures, en élucider les hypotextes, etc. De là, on peut considérer que l’un des résultats pratiques les plus évidents de la littérature illisible, c’est le développement d’outils critiques hétérogènes, permettant des coups applicables à la littérature lisible. Les études littéraires se constituent alors comme une boîte à outils contenant différentes méthodes qui valent comme autant de ressources, à mobiliser dans les parties multiples de ce jeu sérieux, à la faveur duquel les textes lisibles deviennent des textes illisibles comme les autres.