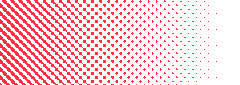Ward de Frédéric Werst : de l’œuvre perdue à l’œuvre réinventée
1Soit cette scène : on découvre ce qu’on ne savait pas exister – mettons le codex maya, le popol Vuh. Une cosmogonie se révèle aux consciences occidentales ; un texte inconnu sort de son tombeau, et s’offre dans toute sa nouveauté, même si on savait qu'il n’était que caché, oublié1. La perte apparaît alors comme un gain, parce qu’on ignorait qu’elle avait eu lieu. L’apparition d'un passé inconnu fait cet effet. Le roman de Frédéric Werst, Ward, fait cet effet : surgissent des limbes de l'imagination non seulement un peuple, les Wards, mais leur littérature, la totalité de leurs écrits, et surtout leur langue, le wardwesan. Le premier volume de ce vaste projet, Ward ier-iie siècles, se présente donc comme l’ « anthologie de la littérature d’un peuple imaginaire » dans une langue imaginaire2. En même temps que s’ajoute ce nouveau rayonnage à nos bibliothèques, un rayonnage fantôme en tant qu’il est purement fictif, surgit aussi tout ce que ce découpage a exclu, tous les auteurs qui n’auront pas été inventés, tous les fragments que l’on ne lira jamais. La découverte et l’invention sont donc doublement ourlées par la perte, qui prend elle-même deux visages : le possible non actualisé (ce qui a n’a pas été inventé, mais aurait pu l’être) et la promesse (les possibles qu’ouvre le projet Ward). Ainsi, paradoxalement, le livre total est un livre troué d’absences. De fait, pour restituer l’histoire d’un peuple, des siècles de culture, il a fallu à l’auteur non pas parachever la perfection d’un monde clos, d’un livre clos, mais tout au contraire produire un livre en morceaux. Telle est bien la force du fragment tant d’un point de vue esthétique (pour les Romantiques, le fragment est le tout) que d’un point de vue historique et archéologique (le fragment est l’œuvre du temps qui a détruit les objets, les textes, mais le tout est reconstituable par l’imagination). Au croisement de ces deux logiques, Werst crée des fragments qu’il donne pour les restes d’une longue histoire, instaurant d’emblée par ce principe créatif une tension entre le perdu et le tout. Elle se manifeste d’abord, et de manière évidente, par la posture du philologue-historien, sélectionnant et transmettant : les extraits présentés relèvent en effet tantôt de la sélection dans un plus vaste ensemble, tantôt de la conservation aléatoire d'œuvres incomplètes. Ils ne restent cependant à aucun moment isolés : ils s’organisent au contraire en une bibliothèque fantôme qui répertorie, classe, rassemble les œuvres. Un tel acte tendrait à faire de l’auteur un démiurge aux pouvoirs illimités s’il ne programmait sa propre disparition. Ce qui se perd in fine, c’est le principe même de sélection des fragments, le grand ordonnateur à l’origine de l’opération de fabrication de l’œuvre perdue. En miroir, la place du lecteur est entièrement redéfinie : lire ce qui n’a pas été écrit, c’est, littéralement, écrire ; la création la plus démesurée assure, paradoxalement, les conditions de la lecture la plus créatrice.
***
1. Extraits, fragments, ruines, fantômes : l'œuvre comme reste
2Le bris du texte est visible immédiatement, visuellement, au premier coup d’œil : la page est brisée horizontalement par les colonnes reproduisant les textes pour la première en wardwesan, pour la deuxième en français, et verticalement par la séparation entre l'introduction historique et les extraits présentés. Ce bris qui instaure un régime du discontinu et de l’incomplet place l’œuvre sous le signe de la perte, d’une perte organisée par la poétique du récit. La perte devient, ensuite, l’objet d’un discours qui l’érige non en principe esthétique, mais en fiction philologique : l’auteur-philologue constate ainsi dans les chapeaux introductifs la perte de tout ou partie d’œuvres disparues sous l’effet du temps. Il note ainsi la disparition quasi totale des textes littéraires d’avant Zaragabal :
Les premiers auteurs dont on ait gardé la trace auraient ainsi vécu au Qemael au milieu du iie siècle avant Zaragabal. On connaît ainsi un premier poète, Kemband, ainsi qu’un premier prosateur, Sabarmôn, même si rien ne semble avoir survécu de leur œuvre que des bribes dont l'authenticité est au demeurant controversée3.
3Ce discours précautionneux, multipliant les signes du doute et de l’incertitude (le conditionnel ; « semble », « controversée »), imite clairement le discours de l’historien ou du philologue travaillant sur des textes antiques. Le deuxième tome ajoute encore à cet effet, l'auteur faisant référence aux manuscrits et aux sources des textes retenus :
SOURCES. On possède plusieurs tablettes authentifiées de L’Anabase de velours. La plupart emploient le syllabaire de Xamarkân et doivent donc dater de la seconde moitié du iiie siècle. Il existe des divergences entre ces versions, notamment en ce qui concerne l’ordre des groupes de mots. Le texte a sans doute été remanié par des lettrés soucieux de le mettre à leur goût. On a quelque fois supposé que l’original avait pu être écrit en wardwesân dialectal. La version que nous transcrivons ici est celle que Monmargôn a offerte au roi Arambôn en 265 ou 266. Elle n’en recourt pas moins au syllabaire de Xamarkân, exception faite de quelques rares signes usités dans l’école de Wora4.
4L’auteur en philologue date son objet, recense les hypothèses possibles sur l’écriture du texte, et en retrace l’histoire. Par effet de retour, son anthologie se dote donc des prestiges de l’antique, dont tout, hélas, n’a pas été conservé.
5Tous les textes n'ont cependant pas ce statut de ruine. Une grande partie d’entre eux sont en effet donnés pour des extraits, comme le mentionne l’introduction à L’Inventaire étymologique de la langue wardwesan d’Atwashōn : « nous en donnons ici plusieurs extraits »5. Certaines œuvres ont un statut particulier : le fragment n’est pas seulement un moyen de sélection, mais le mode de composition original. Le même Atwashōn est comparé à Gamâz en ces termes : « au contraire de Gamâz qui n’a laissé que quelques fragments, son œuvre se présente sous forme de traités6 ». La comparaison au traité indique clairement que le fragment est bien le genre dans lequel s’exprimait Gamâz. L’œuvre de ce philosophe n’est pas reproduite directement, mais apparaît à travers les « Khōn Gamâz » que Khazalōn a rassemblés : les « propos du maître » sont de fait des séries de fragments numérotés, reproduits tel quels dans les deux volumes de Wards7. La pratique de l’anthologie se trouve ainsi thématisée dans le livre citant des auteurs qui la pratique. À dire vrai, le deuxième volume, multiplie ces genres anthologiques, des compilations à l’Anthologie de Harthar qui « comprend de nombreux fragments8 ». Extraits d’un tout ou fragments sélectionnés parmi d’autres semblables, ces morceaux de textes font signe vers la perte, en tant qu’ils signalent les contours de leur découpage, autant de lignes brisées ou courbes, comme une pièce du puzzle qui fait rêver au tout recomposé.
6L’extrait est ainsi posé là à côté de la ruine ou du fantôme, qui éloigne plus radicalement du tout encore, puisque celui-ci est irrémédiablement perdu. La perte ne s’arrête pas à la littérature d’avant Zaragabal, dont la perte complète a été signalée ; elle touche aussi ponctuellement et partiellement des œuvres postérieures : « Les fragments qui composent cet ouvrage d’Azhabke, du moins pour ce que nous avons conservé, expose la doctrine gamazienne sur les “cinq éléments”9 ». Le temps a fait son œuvre, aidé parfois par les éléments. Le roman n’échappe pas à la « mythologie des éléments10 », à la scène archétypique de l’incendie de la bibliothèque : « l’incendie de la Tour Blanche de Qemael, en l’an – 130 […] aurait détruit le peu de textes littéraires existant à l’époque »11. Renvoi à une scène fondatrice de l’histoire de l’Occident (la bibliothèque d’Alexandrie), cet épisode est aussi profondément intertextuel (songeons à « La bibliothèque de Babel » de Borges), et creuse donc doublement l’espace de la perte : elle transforme les ouvrages disparus en fantômes, mais spectralise aussi les œuvres déjà écrites qu’elle convoque à l’état d’ombre. Il est intéressant de constater que l’épopée fondatrice du peuple Ward a été dévorée par l’incendie et réduite à l’état de « vestige », se rendant en quelque sorte disponible pour l’avenir, pour les siècles (les volumes de Ward) à venir qui, anticipe-t-on sur le modèle de Vaclv Hanka, McPherson ou Lönnrot, pour reprendre ses exemples à Judith Schlanger, s’empresseront de « fabriquer le trésor fondateur12 ». L’absence comme perte rejoint ici l’absence comme promesse. De fait, l’épopée ward fait véritablement figure de texte idéal pour une telle opération de réécriture et de récupération, car elle concentre tous les traits de l’œuvre à reconstituer : œuvre orale aux nombreuses versions, langue archaïque qui « pose plusieurs problèmes de compréhension13 », œuvre partielle, largement détruite dans l’incendie de la bibliothèque :
À l’origine, il semble que l’épopée ait été transmise oralement, ce qui explique l’absence de texte unique. On connaît un certain nombre de fragments qui datent du ier siècle avant Zaragabal et qui correspondent à des épisodes du récit guerrier bien attestés par ailleurs. Ces vestiges, dont la rareté est peut-être due à l’incendie de la bibliothèque de Qemael en l’an - 130, sont rédigés et versifiés dans une langue archaïque. Néanmoins, on ignore si la totalité de l’épopée avait été mise par écrit à cette époque14.
7La présence physique de l’épopée est minimale (quoique sa puissance mentale soit maximale), mais elle s’impose, bien qu’elle devienne purement fantômale par endroits. Certaines notes infrapaginales renvoient en effet à des épisodes absents du récit. La note 4 page 148 fait allusion à un épisode de la guerre de Wagamarkan, la prédiction de la prêtresse, relatée dans l’extrait donné page 146. En revanche, la note 6 de la même page évoque l’épisode du pont de Wemera, mentionné dans la notice de présentation de La Guerre de Wagamarkan page 43, mais sans être raconté dans aucun des extraits donnés15. L’absence avérée, la référence signalée mais non remplie, fait mesurer l’étendue de la perte du texte épique.
8Ainsi, cette littérature et ce passé imaginaires finissent par prendre les dimensions de l’histoire et du légendaire. Or, de ce fait, Ward ier-iie siècles ne peut plus seulement être décrit comme organisant poétiquement la perte dans une œuvre en morceaux. Car le roman prend dès lors les proportions de la bibliothèque, d’une bibliothèque fantôme concurrente de la nôtre, dont on pourra interroger le pouvoir reconfigurant. En cela, elle se confond tout entière avec l’œuvre perdue, qui, comme le rappelle Judith Schlanger, lorsqu’elle est retrouvée modifie notre perception de l’ensemble de la bibliothèque: « ce n'est plus un passé d’engloutissement et d’abîme, car ce n’est plus un passé révolu et définitif. […] c’est un passé résurgent, inachevé, qui n’est pas clos mais qui déborde sur le présent pour l’enrichir16 ». C’est exactement ce que ressent le lecteur de Ward : soudain, il apparaît que le temps n’est pas clos, pas plus que l’espace, et qu’à côté de nos bibliothèques qu’on croyait comptées et circonscrites en surgit une autre, qui vient « enrichir » le présent.
2. Une bibliothèque fantôme: l’œuvre comme spectre de la mémoire culturelle
9En quoi peut-on dire que Ward invente véritablement une bibliothèque avec sa logique et sa complexité ? Pour inventer une bibliothèque, il suffit, pense-t-on, d’y placer des livres qu’on dote d’un contenu, de citer des titres, d’imaginer des auteurs et leur parcours, comme l’a fait Roberto Bolaño dans La Littérature nazie en Amérique. Or cela suffit à créer une bibliothèque fictive, mais pas une bibliothèque fantôme, un double des nôtres : Ward a ceci de particulier qu’elle ressemble à ce qu’on connaît de nos bibliothèques, des lieux réels avec leur mode de classement comme des lieux métaphoriques, obéissant aux règles du fonctionnement de la mémoire littéraire.
10Le premier principe de cette bibliothèque ward est parfaitement formulée par Judith Schlanger, évoquant la mémoire des œuvres : c’« est une mémoire héroïque, elle a besoin de noms17 ». Frédéric Werst ne se contente pas d’inventer des auteurs si illustres dans le genre qu’ils pratiquent que la postérité a retenu leur nom : le mythologue Abis, le conteur Artabôr, la poétesse Wôna Manaon pour en citer quelques-uns. Il formule aussi le problème de l’attribution des livres, qui renvoie directement à notre besoin de noms dont parle Judith Schlanger. On lit ainsi à propos d’un recueil de poèmes : « Ces poèmes n’ont pas de nom d’auteur connu, même si la tradition en attribue certains (et notamment les deux premiers que nous présentons ici) au poète Warêd18 ». L’attribution, ici nullement assurée, pourra être revue plus tard : la « tradition » place ce qu’elle lit sous la caution d’un nom admiré, comme les érudits le firent avec les œuvres du pseudo-Aristote au Moyen Âge19, sans autre garantie que leur intuition.
11Le nom joue un rôle important dans ce qui constitue le deuxième pilier de la création et de sa mémoire : la transmission, l’influence ou encore la constitution d’écoles rivales. Le nom du poète Warêd revient ainsi dans le texte de présentation d’un autre auteur, qui se serait inspiré de son œuvre : « ce sont des imitations assez fidèles de Warêd20 ». On devine une filiation, une influence ou simplement une admiration, dont procède l'imitation, le désir d’égaler le grand poète ; « au cœur des lettres se trouve l’admiration », rappelle Judith Schlanger21. C’est, dit-elle, la loi de l’espace lettré. C’est aussi celle de la bibliothèque ward. De l’émulation produite par les modèles naissent les écoles : le « monument », dont parle Schlanger22, se dresse en leur cœur, justifiant leur constitution, nourrissant l’inspiration des disciples. L’école d’Aênen concurrence ainsi l’école de Saphagabal, où école est à entendre tant au sens d’influences partagées que de lieu d’enseignement : « Par ce nom [école de Sphagabal] on désigne non seulement un établissement d’enseignement situé dans la capitale du Makdar […], mais encore l’ensemble des disciples d’Atwashōn et des auteurs influencés par cette tradition »23. Si les modèles, comme Warêd, s’imposent d’emblée, il faut attendre leiie siècle pour que ces « écoles » se forment, le roman obéissant bien au temps lent de la mémoire culturelle. Ward iiie siècle déploie ce passage du temps, le réfléchit et le fait sentir à son lecteur, en soulignant des filiations d’abord, comme dans cette note commentant une phrase de Nashōn dans Le Livre du lieu : « la notion de « paroi » (keth) est ici reprise à Atwashôn »24. Le passage du temps est sensible, ensuite, par la manière dont le roman joue avec la mémoire du lecteur : ainsi, dans Du Monde, Nashōn cite une phrase d’un auteur duiie siècle, Kundis (« Kundis écrit que “Parathon a lieu partout dans [zon] le monde” »25), phrase qui figure dans le premier volume, quoique sous une formulation différente (« Parathon se trouve en tout lieu »26).
12Dans ce temps lent de la mémoire, des familles se créent, mais aussi des genres, qui évoluent, et des formes qui naissent ou, au contraire deviennent caduques. Le genre est d’abord principe de classement, tel que la « table raisonnée », à la fin du premier volume, le fait apparaître : « dans cette table, on a suivi, plutôt que l'ordre strictement chronologique, la classification, par genre ou par école27 ». La deuxième partie, consacrée au ier siècle, fournit ainsi un échantillonnage de littérature religieuse, de mythes, de prose, de philosophie, de « poésie » et de « drame », de géographie, d’histoire, de médecine et de droit. Le genre, en tant que forme, est, ensuite, principe de création dans l’espace littéraire : au seul ier siècle se développent le phazaron, « la plus ancienne forme poétique pratiquée par les Wards de l’Aghar »28, les chants de Jedra (la poésie officielle avec ses « vers de circonstance29 »), le zanton, une « poésie assonancée30 », le conte31, le « kandel ab westatha » ou « spectacle royal32 », le « zhanaron » ou « florilège », répertoriant les symboles des fleurs33, et le « thār » ou « trône », racontant « les faits mémorables d’un roi »34. Ces formes se définissent par des critères formels et thématiques et s’inscrivent dans une histoire, qui les situe : ainsi le « genre de l’athamanton » au iie siècle, texte en prose qui décrit un paysage, « préfigure l’athazon qui se développera au iiie siècle »35. Le rattachement de l’œuvre à son genre dans les introductions historiques insiste sur une continuité dont Judith Schlanger dit qu’elle est le propre de l’historiographie : « c’est l’historiographie qui tire des traits, là où l’avancée poétique pose des œuvres »36. L’historiographie ne voit que « des variantes qui s’étalent de proche en proche »37, et de fait, c’est ainsi que sont traitées les variations perçues par rapport à un cadre : « Tout en respectant les contraintes formelles et thématiques qu’impose le genre du Phazaron, elle [Wona Manaon] les adapte à la tonalité funeste dictée par les circonstances »38. L’effet de continuité contribue donc à poser l’auteur en historien d’une littérature fantôme en devenir.
13Mais l’évolution des formes littéraires ne s’arrête pas au seuil de leur genre; elle se mêle à celle de la langue : l’œuvre ne s’empare pas seulement de la langue comme d’un outil, mais contribue à en fixer les canons, à la déplacer, à l’inventer. La Lettre à la nation des Wards de Samazōn ainsi que sa deuxième épître « fixeront la norme classique en usage dans le clergé39 ». C’est l’évident constat que nous faisons en ouvrant les dictionnaires : le sens des mots s’est transformé avec leur usage, fixé dans les textes littéraires, mais aussi philosophiques, juridiques ou médicaux pour les emplois spécialisés. On sort là du strict espace littéraire pour entrer dans le domaine plus vaste de l’évolution linguistique. Or, de fait, ce roman paraît bien davantage raconter l’aventure d’une langue que parler la langue de l’aventure, d’abord parce que le cadre dans lequel s’inscrivent les fragments présentés déborde celui du fait littéraire, ensuite parce que la puissance de reconfiguration du récit tient davantage à l’invention linguistique qu’à l’inventivité formelle des textes. On reconnaît en effet beaucoup d’éléments familiers dans ces textes wards : le conte présente des « motifs stéréotypés » qui sont aussi ceux de nos contes, et si les « règles strictes » du phazaron sont inédites40, elles ont tout des formes fixes de la tradition poétique européenne. En revanche, la langue wardwesan, avec ses redécoupages du réel, impose un violent décadrage de nos perceptions et des évidences. On lit ainsi dans l’introduction du traité de physique de Azhabke, De la matière, que « le nom de “physique” ne convient pas exactement ici, la langue wardwesan n’ayant pas de terme qui corresponde à notre concept de nature41 ». Le concept de nature est si fondateur pour la philosophie occidentale qu’il est difficile de penser sans lui. Au-delà de la bibliothèque fantôme, c’est donc une langue fantôme qu’impose d’apprendre Ward ier-iie siècles, une langue qui double, et qui traduit, ou plutôt depuis laquelle est traduit le texte français. Les rapports de l’original (dans une langue fictive) à la traduction sont de fait profondément perturbés, et ce qui se perd dans cette opération, c’est à la fois l’original et l’origine de l’œuvre, son principe premier.
3. L’originel perdu : l’œuvre comme texte à écrire
14Ward est un roman bilingue, le texte en wardwesan étant imprimé sur la colonne de droite et le texte en français sur la colonne de gauche, disposition textuelle qui fait du wardwesan, d’une langue inventée, la langue de l’original. C’est ce que confirme d’ailleurs Frédéric Werst dans ses interviews : « J’écris directement en wardwesân puis je traduis en français, soit immédiatement, soit avec un délai, ce qui me permet d’être dans un véritable exercice de traduction puisque j’ai alors oublié ce que j’ai écrit, je redécouvre les textes42 ». Le livre de Werst tord ainsi le cou à la hiérarchie littéraire sanctifiant l’original aux dépens de la traduction, car il condamne le lecteur ou bien à considérer comme ayant valeur de référence un texte écrit dans une langue imaginaire, ou bien à lire dans une traduction explicitement donnée pour contingente, réduite au statut de variante matérielle, de « simple possibilité » parmi d’autres43. Ward iiie siècle propose d’ailleurs des traductions concurrentes pour un même texte, signées par différents traducteurs44. Ainsi, Alice Mazmaren a retraduit divers poèmes dans sa Poésie ancienne des Wards45, « d’une manière qui tente d’en restituer les jeux phonétiques46 », alors que la première version en était plus littérale. La conséquence d’une telle instabilité textuelle est double : d’une part, l’œuvre, dans sa lettre même, ne semble plus fournir de garant de son sens ; l’auteur, en tant que traducteur, peut se tromper ou déformer la lettre du texte. D’autre part, le lecteur est mis en position de s’approprier cette langue et de devoir la traduire, grâce au lexique et à la grammaire du wardwesan mis à sa disposition en fin de volume. C’est ce que se sont empressés de faire nombre de lecteurs, eux-mêmes créateurs d’idéolangues ou les pratiquant simplement : on lit sur des forums d’échange de nombreux commentaires concernant le degré d’élaboration du wardwesan, sur son fonctionnement, sur sa prononciation ou sa traduction47. De fait, lire pleinement cette œuvre, réaliser son programme, pour reprendre le vocabulaire d’Umberto Eco, serait donc le traduire, proposer une traduction concurrente à celle qu’il lit. Lire l’œuvre perdue, l'œuvre en morceaux, l’œuvre fantôme, c’est écrire après en avoir appris la langue perdue. Car si le wardwesan est bien une construction, il doit « compenser » la perte des langues : « Il paraît que tous les quinze jours une langue disparaît de la surface de la planète. Ce seul fait suffirait à justifier que la littérature puisse prendre la peine de penser, sinon de compenser, une telle déperdition48 ».
15Ce repositionnement de l’auteur et du lecteur en compagnons et en traducteurs est inscrit dans la fiction: Mazawaron définissant le bonheur comme dérivé de « maz » (« avec ») fait de la traduction la forme suprême du bonheur :
On nomme […] traduction les discours qui concernent aussi la troisième personne, c’est-à-dire la réalité extérieure à quoi l’on peut se référer comme si on traduisait d’une langue à une autre. Celui qui converse ne se soucie pas de la langue qu’il emploie, parce qu’il sait déjà qu’elle lui est commune à lui et à ses auditeurs, mais celui qui traduit entrevoit l’importance de la langue, si bien qu’il s’adresse à l’auditeur pour lui parler d’une chose nouvelle et en utilisant des formules habiles. C’est ainsi que la traduction comprend certes le passage d’une langue à l’autre mais encore tous les textes et les discours écrits, dans la mesure où tout auteur est en même temps une sorte de traducteur. L’auteur dit en effet des choses qu’il est seul à comprendre dans une langue étrangère, au sujet d’une réalité extérieure qu’il est seul à connaître, mais qu’il peut, grâce à l’écriture, exprimer et transmettre à autrui49.
16La traduction ne se limite pas au passage d'une langue à une autre pour en assurer la compréhension mais désigne toute opération de transmission d’une réalité nouvelle, et s’étend donc à « tous les textes et discours écrits ». À cette figure d'intermédiaire s’oppose celle du démiurge qu’incarne le dieu Parathōn, figure de l’autorité et de la violence, de la destruction et de la négation de l’autre: « Je changerai un jour votre terre en une boule de feu et de glace, de telle sorte que votre demeure elle-même devra mourir50 », lit-on dans le Livre de Parathōn, qui appelle pourtant les hommes à la piété. On comprend donc bien que c’est moins l'auteur qui se retire de son propre texte (ce qui n’aurait guère de sens) que l’auteur comme démiurge qui abandonne son pouvoir à ses lecteurs. La référence heideggerienne à l’abandon des dieux n’est pas gratuite, elle est essentielle – mais elle est ironique. Dès l’épigraphe, le texte de Heidegger a ce statut ambigu :
Mais le vide du mot « être », la disparition complète de sa force d’appellation, ce n’est pas là un simple cas particulier de l’usure générale de la langue; en réalité, la destruction de notre relation à l’être comme tel est la raison véritable de l’ensemble de nos mauvais rapports à la langue.
17Paradoxalement, la fiction ward illustre à la fois le « vide du mot être », puisqu’en effet la langue ne dispose pas de ce mot, et la centralité de l’être et de Heidegger, qui plane comme une figure tutélaire sur le roman. Pour commencer, la quête ontologique qui a conduit Heidegger à explorer l’étymologie pour rapprocher « être » de « habiter », dans L’Introduction à la métaphysique51, puis dans Qu’appelle-t-on penser?, lui permet d’établir que « être » remonte au germanique wesan (« demeurer, habiter », « rester à demeure »). « Wesan » comme « ward-wesan » qu'un bon heideggerien traduirait par « être ward ». Ensuite, et plus profondément, le temps de l’Être, tendu entre un « passé originaire » inconnu et un « avenir (…) qui reste en attente »52, est celui du peuple ward : non seulement le vocabulaire ward compte les verbes « ne plus être » et « ne pas être encore », mais l’historien ward s’attache autant à la « connaissance du passé » qu’au « savoir sur le futur projectif »53, au passé et au futur, donc, comme attente pour toujours suspendue. Enfin, les Wards, qui ont vécu le retrait de Margon, l’abandonnement de Parathōn54, cette expérience première de l’abandon des dieux, font entendre « cette tonalité [qui] s’enracine dans le pays et la met en attente sous un ciel menaçant55 » : la fuite des dieux marque le moment de la fondation de la communauté, puisque de fait le retrait de Margon est un épisode fondateur de la mythologie ward. Mais la référence à Heidegger s’apparente davantage à un jeu, qui prend place parmi les nombreux jeux que le livre n’en finit pas de proposer, un jeu à la fois sur l’allusion détournée et sur l’étymologie. Le lexique de fin de volume et le chapitre central offrant de larges extraits de l’Inventaire étymologique de la langue wardwesan lance le lecteur sur des jeux de piste et de rapprochement dont on ne donnera qu’un exemple : l’inventaire dit que zana- est la racine de histoire, dire, mentir, conseil, littérature, information, négocier, idée. Or dans le lexique figure un mot supplémentaire : zanama traduit par néant, mais dont l’auteur a proposé cette autre traduction, au cours d’une conversation, meilleure selon lui – lieu des crânes. Ainsi, zanama, lieu où retourne le dieu Margon56, est littéralement une production de la tête, histoire, mensonge ou néant, un lieu du crâne en ce sens. La référence heideggerienne au retrait des dieux est comme brouillée par le renvoi direct à l’activité fictionnelle, exhibée. Ward met donc en place une lecture moins révérencieuse que ludique, dans laquelle le lecteur cherche comme le petit Poucet les cailloux ou les fils à tirer pour recomposer des lignées silencieuses dans les mots de la langue inventée.
18Ward ier-iie siècles et Ward iiie siècle offrent une première version de l’œuvre perdue comme œuvre trouée, marquée par l’absence et la ruine. La composition par fragments, qui invite ou bien à une lecture archéologique, ou à l’abandon à la discontinuité, semble pourtant s’unifier dans la continuité d’une mémoire, d’une bibliothèque fantôme, dotée des caractéristiques de la mémoire culturelle telle que la décrit Judith Schlanger. Mais cette apparence est illusoire car ce qui se joue dans l’œuvre est un jeu du lecteur moins avec la lettre qu’avec les mots – jeu de la traduction, jeu de l’étymologie : le démiurge assurant au texte sa cohérence a disparu et le sens (la direction heideggerienne par exemple, en bonne place pour donner le la au roman) se disperse au vent.