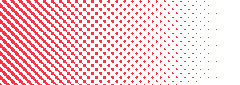La langue de personne ou l’outre-langue des écrivains de nulle part
Mais souvent telle qu’un incendie,
Éclate la confusion des langues.
Friedrich Hölderlin, Le Vatican
Je n’ai qu’une langue, ce n’est pas la mienne.
Jacques Derrida, Le Monolinguisme de l’autre
1Parmi les déroutants désastres en cours, liés à la subordination de tout, jusqu’à notre liberté, à des considérations économiques, la langue n’est évidemment pas épargnée, notamment à travers la consommation culturelle à la mode et la novlangue propagée par les médias. Parée de tous les atours d’une illusion de liberté savamment orchestrée, cette marchandisation, ad nauseam, de la culture contribue en fait à conforter la domestication des êtres et des esprits. Car à travers cette assuétude qu’on nous inocule à consommer indifféremment des produits culturels, comme du coca light, les manœuvres d’assujettissement et les outrages qui sont faits aussi bien au langage, à la pensée, la sensibilité, l’imagination, les rêves, les désirs, les corps, opèrent une véritable destruction et uniformisation de la vie intérieure, menacée par cette culture jetable, sans estomac, séparée de la vie comme de la question du sens, et indexée à la diffusion d’un prêt-à-penser, prêt-à-consommer et prêt-à-parler. Ainsi, le rétrécissement et la standardisation indigente des pouvoirs du langage ne sont pas moins inquiétants que les catastrophes en tous genres (environnementales, nucléaires, financières, démographiques, alimentaires), qui ont mis à nu les mécanismes pervers d’un capitalisme à l’agonie et d’un système consumériste à bout de souffle. Mais si l’on tient vraiment au peu de liberté qui nous reste encore, l’interrogation d’André Breton en 1924 n’est-elle pas plus que jamais impérieuse : « la médiocrité de notre univers ne dépend-elle pas essentiellement de notre pouvoir d’énonciation ?1 »
2Néanmoins, massivement et quotidiennement, les pouvoirs de la parole, sacrifiés à tant de viles besognes, médiatiquement soumis à l’hégémonie du tout-communication, participent davantage du bavardage (le gazouillis généralisé de Twitter), de la prolifération de l’insignifiance et d’une ruine conjointe du langage. Lequel est rendu tout à la fois instrumentalisé, standardisé, labile, aplati, affadi, à la fin tant et si bien sclérosé qu’il semble s’en aller, à vau-l’eau, rejoindre le destin des « paroles gelées » de Pantagruel. Un gel des mots qui, dans l’indifférence presque générale, s’est infiltré dans les mœurs et dans tous les domaines, participant conjointement de la normalisation des manières de dire, de penser et de vivre. Sous l’influence de cette phraséologie mécanique et réitérable des bourreurs de crânes, le langage courant se réduit ainsi comme peau de chagrin à des automatismes langagiers, vidés de sens et de toute présence. Ainsi empêtré dans le formatage appauvri de cette novlangue, on en oublie que « le langage sert à vivre » (Benveniste), que la monnaie vivante des mots aide à penser et à vivre, peut mener loin dans la vie, et que, de même que les corps parlent, les motsaussi, en vertu de l’inconscient physique qu’ils charrient, font l’amour, que ce corps-de-la-langue a un pouvoir immense de pénétration, tout aussi invisible que physique, un poids de chair, de sang, de vie et de mort : « On ne sait jamais, remarquait Valéry, à quel point, et jusqu’à quel nœud de ses nerfs, quelqu’un est atteint par un mot, – j’entends : insignifiant. Atteint, – c’est-à-dire : changé. Un mot mûrit brusquement un enfant2. »
3Mais face à l’actuelle propagation de cette langue fantôme, au-delà de la linguistique, il ne s’agit nullement de revendiquer un quelconque purisme ou conservatisme, le remugle d’une improbable « pureté » des idiomes, défendus par des traditionalistes maniérés ou recroquevillés. Car à travers la contamination des lieux communs langagiers se cachent en fait des abîmes autrement inquiétants, quant au triomphe du non-sens et la propagation du vide dans les esprits et les sensibilités. Plutôt, la question revient d’abord à penser le langage, et comment l’écrivain, en inquiétude du langage et de la langue, en mesure la profondeur, le prestige comme l’opacité, les possibilités, la destination et les limites, plus que l’instrumentalité ou la beauté. Car si tout passe par le langage, sans s’y réduire, il faut aller au-delà des signes, ne pas restreindre le signifié au signifiant, sous peine de perdre de vue l’expérience sensible, l’expérience du texte et des idées, au-delà de l’herméneutique technicienne – oubli de l’homme, qui fait de la littérature un objet privé de vie. Littérature in vivo contre littérature in vitro, inerte, pétrifiée, sans estomac. Du reste, l’écrivain n’est jamais maître du langage, étant à la fois possédé par lui (jusqu’à être la proie d’une fureur d’écrire, furor, mania ou daimon) et comme dépossédé – au moins depuis « l’ère du soupçon » qui est la nôtre et perdure, quant aux pouvoirs des mots, de véritables « sables mouvants » (Bataille), saisis dans leur impuissance à dire la réalité, malgré toute « rage de l’expression » – crise du langage indissociable d’un ébranlement, d’une mise en doute et en question de « l’humain ». Ainsi, tout écrivain semble œuvrer à la fois « avec » et « contre » la langue, appartenant bien à une langue, tout en se tenant à part : à la fois appartenir et se tenir à part, tenir (à la langue, par la langue) sans appartenir. Car la langue nous constitue bel et bien, sans nous appartenir, étant sans demeure, sans appropriation – ce que l’on pourrait appeler la langue de personne ; mais l’écrivain investit cette langue en créant une autre langue dans la langue, une outre-langue, ou devenir-autre de la langue, sorte de langue rêvée, qui consiste à parler-ailleurs-autrement. Du coup, de même que la gloire d’un écrivain, sauf à être réduit à un porte-drapeau, échappe à l’enrégimentement académique comme aux célébrations mortifères du Panthéon, la langue française ne saurait être acculée au « génie » ou à une hypothétique identité nationale.
La terreur de Babel
4« Le langage », écrit Henri Meschonnic, « étant ce dans quoi, par quoi, on pense et on vit une vie humaine, […] je pose en principe que si on ne pense pas le langage, on ne pense pas, et on ne sait pas ce qu’on ne pense pas. On vaque à ses occupations3. » Et les invocations incantatoires d’un hypothétique « prestige » ou « génie » de la langue (française ou autre) et d’une tout aussi ambiguë « exception culturelle », défendue et illustrée par l’idée de la francophonie qui plaide pour l’universalisme mais n’est qu’un particularisme provincial, n’y suffisent pas, voire même peuvent se révéler nuisibles ; on sait bien quelles crapuleuses manœuvres de colonisation et de domestication par la langue sont pratiquées sous couvert d’« humanisme » ou de « civilisation ». L’exaltation et la sacralisation d’une « langue maternelle », comme propriété d’une communauté, se lie à l’invocation de la terre comme propriété de cette même communauté, avec tous les phantasmes de l’origine, de la pureté et de l’homogénéité que cet attachement charrie. Deux grands périls pèsent sur les langues : l’hégémonie de l’anglo-américain comme langue internationale de la communication et le repli identitaire, national ou nationaliste de la langue, nourrissant les vieilles idéologies communautaristes ; double menace à laquelle il faudrait en ajouter une troisième, non sans rapport avec la première : la disparition de centaines de langues, souvent liée à l’hégémonie des langues dominantes que l’on doit parfois apprendre pour une question de survie. Dans cette économie tragique, que la domination soit militaire, économique ou symbolique, toute culture est coloniale, imposant la loi de sa langue, la maîtrise commençant par le pouvoir de nomination, ce qu’a montré Jacques Derrida dans Le Monolinguisme de l’autre, parlant, à partir d’une confession de son statut personnel de Juif-Français-d’Algérie, « d’une terreur dans les langues », dont le maître lui-même n’est pas propriétaire, car il n’y a pas d’appropriation absolue, la langue n’appartient pas, fût-elle « la langue maternelle » :
Voilà ma culture, elle m’a appris les désastres vers lesquels une invocation incantatoire de la langue maternelle aura précipité les hommes. Ma culture fut d’emblée une culture politique. « Ma langue maternelle », c’est ce qu’ils disent, ce qu’ils parlent, moi je les cite et je les interroge. Je leur demande, dans leur langue, certes, pour qu’ils m’entendent, car c’est grave, s’ils savent bien ce qu’ils disent et de quoi ils parlent. Surtout quand ils célèbrent si légèrement la « fraternité », c’est au fond le même problème, les frères, la langue maternelle4.
5Cette question de l’imposition d’une langue, qu’elle soit ouverte, armée ou plus rusée, dissimulée sous les alibis d’un humanisme généreux, déborde largement le seul champ linguistique ou grammatical, les phantasmes d’identité souveraine et de pureté de la langue ayant d’emblée des répercussions politiques, sociales, religieuses, culturelles, artistiques et littéraires, le modèle linguistique souverain faisant loi – la langue est à la fois le support de la loi et l’objet d’une loi, quand elle n’est pas la loi même lorsqu’elle est imposée à la maison ou à l’école – et sculptant des figures culturelles, symboliques, socio-culturelles dont l’imposition et l’aliénation peuvent être plus ou moins vivement ressenties à travers des discours dont il serait dangereux de penser qu’ils soient sans efficace sur les actes et les comportements. Par ailleurs, à côté de cet embrigadement par et de la langue, comme le disait Primo Levi, « là où l’on fait violence à l’homme, on le fait aussi à la langue5 », et les écrivains de l’irréméable (d’où l’on ne revient pas), ces survivants lazaréens que furent Levi, Jean Améry, Robert Antelme ou Paul Celan, en ont tenté l’impossible mais nécessaire témoignage, écrivant à partir de « la catastrophe », « cette blessure sans cesse ravivée », ce que Varlam Chalamov, rescapé d’un autre enfer, désigna quant à lui comme le besoin vital de poésie, véritable pain, le cinquième besoin humain après la faim, la sexualité, la défécation et le plaisir d’uriner. C’est ainsi que Paul Celan invente une « contre-langue », faisant le procès d’une langue dans laquelle a été décidée, dite et écrite « la catastrophe » selon laquelle les figures humaines ont perdu leur humanité, de même que Pierre Guyotat écrit une langue « matricide », contre la langue, fait à la langue dans laquelle il est né le procès des procès qu’elle a instruits contre ceux qu’il a fait siens : les Algériens asservis. Mais en réalité, c’est toute (la) langue qui est en cause. Écrire, c’est résister, ou mieux, inventer, et « témoigner pour la vie », comme disait Deleuze, faire signe de vie. L’écriture serait ainsi traversée par un principe d’insubordination, inconditionnée, face à tout ce qui s’impose partout : l’inégalité, la violence, la souffrance, l’aliénation, la servitude, la bêtise, l’ennui, l’humiliation, etc.
6Au-delà de tout enracinement, les livres ne sont que des passages, déplacements dégagements, pour reprendre tels titres d’Henri Michaux. L’écriture est passage, c’est-à-dire qu’elle cherche à ouvrir une voie dans l’opacité du réel, une voie sans voie, selon les termes du Tao, un chemin tortueux, entre errances et détours, à l’écart des chemins tracés d’avance et sus par cœur, ces vérités de morts vivants. « Passage » signifie aussi qu’elle passe, réfractaire à l’immobilité, lieu de métamorphoses et d’échanges compliqués, ponts jetés sur l’invisible n’apparaissant que pour disparaître. De là la fulgurance de la poésie, tout au moins de certains poètes, pour qui la poésie est d’abord « en route » (Mandelstam), « en chemin » (Celan), « en avant » (Rimbaud), une mise en route du langage, dans le devenir, avançant vers ce qu’on ne connaît pas, pariant sur un ailleurs, inconnu. Ces « passages » sont aussi évidents quand il y a passage d’une langue à une autre, ce qu’est bien sûr la traduction, mais pas seulement, car elle est aussi création, au-delà de la communication d’un hypothétique « message » original, travail et métamorphose de la langue d’arrivée elle-même, la fidélité à l’original n’étant que peu de chose sans la liberté du langage ; la traduction travaille sa propre langue, comme éveillée, élargie et approfondie par la langue étrangère. Néanmoins, le danger menace alors de glisser vers une conception métaphysique, voire théologique du langage, ce dont témoigne la première philosophie du langage de Walter Benjamin (voir par exemple Sur le langage ou « La tâche du traducteur »), pour qui la traduction cherche à atteindre le noyau d’un « pur langage ». Ce risque d’une essentialisation du langage, nettement référencée au registre éculé du paradis perdu, nourrit tous les phantasmes et mythes de l’originel, de la parole sacrée, tous les Retour(s) Amont, depuis l’archaïque rêvé par Hölderlin jusqu’à la grammaire psychotique de Jean-Pierre Brisset, délirant sur la langue secrète des origines, en passant par la nostalgie baudelairienne du paradis perdu, l’âge d’or de Nerval, L’Ombilic des Limbes d’Artaud, autant de remontées vers l’immémorial ou le primitif, des mémoires de l’oubli, qui cherchent, selon l’expression de Salah Stétié, à « donner forme à tous les bégaiements de l’origine6 », à travers le désir d’une « langue de la langue ». Mais ne serait-ce pas là surestimer les capacités du langage et les pouvoirs de la parole ? N’est-ce pas accorder au langage une importance vertigineuse ? Cependant, peut-on complètement esquiver tout reste de croyance dans le pouvoir magique des mots ? « Au commencement était le verbe » : il n’est pas dit, malgré la mort de celui à qui l’Ancien Testament rapportait allégoriquement cette affirmation, que cette parole, avec tous les rêves d’infini qu’elle charrie, ait perdu toute signification, tant il est évident que n’échoit à ceux qui sont dans l’abandon, la servitude et le déni de toute liberté, la seule liberté de la langue par laquelle l’humanité peut dire, librement, son assujettissement et son désir d’affranchissement, comme si le verbe, libre, était ce qui reste de Dieu, mort, lequel est ce qui fait que le verbe, le rythme, le chant restent et résistent – un verbe d’autant plus libre que c’est tout ce qui est humain qui contraint à la liberté, quand bien même on fera le procès des langues dans lesquelles les figures humaines ont perdu leur liberté.
7« La » langue n’existe pas, de même qu’il n’y a pas de métalangage ; il y a bien plutôt des langues et un défaut d’origine, un défaut des langues, toutes plus ou moins enlisées dans « la terreur de Babel », « la Fosse de Babel », mais l’écriture, en particulier la poésie, consiste précisément à suppléer ce défaut. Elle porte en elle les germes d’une autre langue, transforme le langage tout en transformant la vie, douant « d’authenticité notre séjour », « seule tâche spirituelle » aux yeux de Mallarmé : « Les langues imparfaites en cela que plusieurs, manque la suprême : penser étant écrire sans accessoires, ni chuchotement mais tacite encore l’immortelle parole, la diversité, sur terre, des idiomes empêche personne de proférer les mots qui, sinon se trouveraient, par une frappe unique, elle-même matériellement la vérité7. » Le fameux « céder l’initiative aux mots » n’est pas tant célébration que transformation de la vie et du langage, acte de langage. Dans « ce jeu insensé d’écrire », il s’agit en somme de rejouer le destin du langage, de le faire bouger, ce qui consiste aussi bien à faire bouger les êtres et les choses, car l’écriture est une expérience et la pensée se construit sur de la matière (« L’esprit n’est que l’état d’esprit des corps », dit Luca), au-delà des clivages entre concepts et affects, l’alchimie verbale étant d’abord une physique verbale, mots, idées et corps liés. Et dans le cas de la traduction, surmontant le dilemme qui oppose le dicible à l’indicible, il s’agit moins d’une question linguistique que poétique, le travail étant de création, car on ne traduit jamais une langue mais la langue d’un écrivain ; traduire Hölderlin ou Celan en français ne revient pas à traduire de l’allemand en français, mais à traduire le langage singulier de Hölderlin ou Celan en un français singulier : invention d’un langage. « Passage » d’une langue à une autre, à travers la transformation, l’altération, la réécriture d’une langue « donnée », écrire est toujours l’ouverture d’un monde possible et fait « arriver » quelque chose à la langue, a fortiori dans le cas d’écrivains ayant choisi d’écrire dans une langue étrangère.
8De là que certaines voix, venues d’ailleurs, insufflent un souffle nouveau à la parole écrite dans la langue d’élection. Mais l’on pourra tout aussi bien dire que l’écriture créatrice en général tend à devenir une langue étrangère, brouillant les frontières entre lisibilité et illisibilité, illimitant la langue. Néanmoins, il apparaît bien que la plupart de ces écrivains venus d’ailleurs donnent à la langue française, selon des résonances très différentes, une tournure, une saveur, un souffle, un corps particuliers, singuliers, inédits, bénéfices d’une liberté plus grande (?) par rapport au bon usage et aux règles convenues, par rapport à l’ordre syntaxique et paradigmatique de la langue, car rien d’atavique ne semble entraver ou retenir leur soif d’émancipation, que l’on prenne par exemple l’Irlandais Beckett, le Roumain Luca, le Grec Égyptien Fardoulis-Lagrange ou le Libanais Salah Stétié. Voix ouvrantes, comme des appels d’air, la liste serait longue, contentons-nous de quelques noms, dont la plupart ont très tôt baigné dans un milieu francophone, par le biais de l’école, mais pas tous, l’élection du français ayant parfois été plus tardive (ou simplement épisodique dans les cas de D’Annunzio, Rilke ou Wilde) : Giacomo Casanova, Jean Potocki, Tristan Tzara, Benjamin Fondane, Ilarie Voronca, Julien Green, Isidore Isou, Eugène Ionesco, Mircea Eliade, Emil Cioran, Ghérasim Luca, Samuel Beckett, Amadou Hampâté Bâ, Edmond Jabès, Léopold Sédar Senghor, Georges Schehadé, Joyce Mansour, Georges Henein, Michel Fardoulis-Lagrange, Aimé Césaire, Albert Cossery, Andrée Chedid, Abdellatif Laâbi, Tahar Ben Jelloun, Salah Stétié, Jorge Semprun, Hector Bianciotti, Milan Kundera… auxquels il conviendrait d’ajouter toute une pléiade de « nouveaux » écrivains francophones issus de l’Afrique du Nord ou de contrées plus lointaines, comme le Chinois François Cheng ou les Japonais Ryoko Sekiguchi, Hisashi Okuyama, Akira Mizubayashi ; pour ne rien dire de nombreux anonymes – qu’on songe, pour n’en citer qu’un, à cette savoureuse Confession sexuelle d’un anonyme russe. Et si l’on parle de philosophie, l’on pourrait ajouter, sans être exhaustif, les noms de Carl Einstein, Emmanuel Levinas, Cornélius Castoriadis ou Kostas Axelos.
Langues de passage : être (de) nulle part
9Pour la plupart d’entre eux, mais pas tous, le choix de la langue française coïncide avec l’exil, même si parfois, chronologiquement, cette élection précède ou suit le départ. Dans presque tous les cas, le passage d’une langue à une autre est lié à un passage des frontières, un voyage, un départ à la fois physique et métaphysique, qui signe toujours une certaine mort, un exil dont la part de libération se démarque difficilement de celle des épreuves. Et un exil définitif, pour ne pas dire éternel, dans la mesure où le sentiment de l’errance à travers la langue est souvent plus aiguisé chez ces écrivains venus d’ailleurs, dont la véritable patrie semble bien être l’exil – « écrivains de nulle part8 », comme l’écrivit un jour Georges Henein à Cioran, comme s’ils étaient voués à être des apatrides (« Nous autres “sans-patrie” », disait Nietzsche), dérivés dérivant, géographiquement et linguistiquement : être de nulle part, selon les vertus de l’oubli, et être nulle part, ou partout, selon les pouvoirs de l’ubiquité et de l’utopie. Et selon notre indécidable partage entre visible et invisible, qui nous lie à tout ce que nous ne sommes pas, « nulle part est partout et le pays où l’on se trouve, d’abord9 », écrivait justement Jarry. À la base de tout exil, il y a toujours quelque insubordination, un refus de l’enfermement, qu’il soit géographique, politique, mental, culturel, linguistique, métaphysique ou physique, souvent tout à la fois ; et il y a aussi un désir d’émancipation, un rêve d’ailleurs, une promesse (de libération) que certains désenchantements de l’exil géographique relèguent néanmoins aux seules vertus de l’écriture – oxygène ou planche de vivre propre à susciter quelque appel d’air et échappée face aux horizons obstrués. Le passage des frontières tend dès lors à leur abolition, quelles qu’elles soient, faisant apparaître leur artifice historique et leur violence, et à une extension, un bouleversement du regard qui nous sauve de l’entropie : « Je sais que je n’arriverai à m’installer nulle part, la lumière abolissant toute frontière, empyrée pour les êtres éphémères et éblouis10. » Sans doute que dans ses élans, tout entier dans la langue et tout entier dans la vie, le rêve, dans sa route vers ce Pays où l’on n’arrive jamais, pour parler comme André Dhôtel, l’écrivain ne fait-il qu’errer, divaguer, sans jamais arriver. Entre les voyages dans le réel et ceux dans l’imaginaire, la frontière est mince, mais l’épreuve de cette porosité, voilée de métaphores, et de ces passages possibles par-delà les cloisonnements, les antinomies psychiques et métaphysiques, nécessite d’abord de surmonter le grand conflit entre langage et présence, quelque chance risquée dans l’aventure, ouvrant l’horizon et l’éventail des possibles, et laissant béantes les failles de l’interprétation, dans une intensification réciproque de la réalité que l’on vit et de la langue qui l’interroge.
10Pour certains, le choix de la langue d’écriture et l’exil ne signifient pas un renoncement à la langue maternelle, même si dans presque tous les cas l’écriture finit par se fixer dans la langue française (sauf quelques exceptions, comme Beckett, qui écrivit tantôt en français, tantôt en anglais, ou Kateb Yacine, en français, arabe et tamazight), la langue maternelle n’étant plus réservée qu’à des échanges privés. Mais au départ, qu’il s’agisse par exemple des Roumains ou des Libanais, nombreux sont ceux qui ont presque toujours vécu dans une double culture – le poète libanais Salah Stétié parle même de ses « deux langues mères » – ou sont issus de milieux culturels étrangers très francophones ou francophiles, qu’il s’agisse de la haute bourgeoisie du Caire (Georges Henein) ou des milieux intellectuels et artistes roumains (Tzara, Fondane, Voronca, Ionesco, Eliade, Cioran, Luca). Certains étaient donc déjà des frontaliers, aux frontières entre deux langues, deux cultures, « hommes du double pays » ou « de la double culture » (Salah Stétié), des passeurs. Mais le poète en particulier n’est-il pas, comme le disait Saint John-Perse, celui « qui déplace de nuit les bornes de la propriété foncière » ? Quelle est dès lors la véritable patrie ? Celle d’où l’on vient ou celle où l’on va ? Pour l’écrivain, il semble bien qu’on habite d’abord une langue, davantage qu’un pays, et que la patrie n’est pas un lieu, mais l’écriture, « un lieu sans lieu », hétérotopie, voire utopie.
11Cioran, qui a commencé à écrire en français à l’âge de trente-sept ans et confessait avoir toujours écrit pour se libérer, s’alléger, se guérir de ses obsessions, commente ainsi ce changement de langue :
Si on en croit Simone Weil, changer de religion est aussi dangereux pour un croyant que changer de langue pour un écrivain. Je ne suis pas tout à fait de cet avis. Écrire dans une langue étrangère est une émancipation. C’est se libérer de son propre passé. Je dois avouer cependant qu’au commencement le français me faisait l’effet d’une camisole de force. Rien ne saurait moins convenir à un Balkanique que la rigueur de cette langue. […] Lorsque plus tard je me suis mis à écrire en français, j’ai fini par me rendre compte qu’adopter une langue étrangère était peut-être une libération mais aussi une épreuve, voire un supplice, un supplice fascinant néanmoins11.
12Concevant l’écriture comme une thérapeutique, « une entreprise de santé », Cioran, médecin de sa propre maladie, a voulu se délivrer des chaînes de la mémoire, adoptant une nouvelle langue, reniant ses premiers excès lyriques, écrivant des fragments ironiques avec la lucidité du désespoir et un humour ravageur, mais il est resté écartelé. « En français, on ne devient pas fou », disait-il, sous-entendu pour lui, un Balkanique, en raison des contraintes syntaxiques du français, ce qui représente une contrainte d’écriture supplémentaire ; car évidemment, écrire dans une langue étrangère suppose des efforts et une étrangeté manifeste :
Ça a été une sorte de révélation cette langue, qui est tout à fait sclérosée. Parce que le roumain, c’est un mélange de slave et de latin, c’est une langue extrêmement élastique. On peut en faire ce qu’on veut, c’est une langue qui n’est pas cristallisée. Le français, lui, est une langue arrêtée. […] En roumain, il n’y avait pas cette exigence de clarté, de netteté, et je comprenais qu’en français il fallait être net. J’ai commencé à avoir le complexe du métèque, le type qui écrit dans une langue qui n’est pas la sienne. Surtout à Paris12…
13Abjurant son passé, la rupture avec sa langue natale est définitive pour Cioran, qui parlera toujours comme un condamné à mort, en sursis, avec une inquiétude irrémédiable et une dérision impitoyable de toutes les vanités du monde, ayant la force d’être cruel mais dissimulant mal le sentimentalisme dont il se défendait pourtant. Peut-être que la langue française était la plus adaptée à sa voix froidement et agressivement ironique ; à travers elle, il se découvre des affinités électives avec la pensée fragmentaire de Pascal ou les moralistes français, Chamfort, La Rochefoucauld, partageant leur goût des aphorismes, de la formule cinglante, leur obsession du style et une vision désabusée de l’humanité, auxquels il ajoute – la France étant à ses yeux le pays le plus civilisé, mais aussi le plus usé, fatigué – l’hystérie d’un vouloir-vivre douloureux mais héroïque, une plénitude de l’être dans la consumation.
14Aux yeux de nombreux écrivains, penseurs ou artistes, la France est souvent apparue comme un « pays intelligent », qui a (ou prétend avoir) le sens de l’universel et jusqu’au xxe siècle, toute l’intelligentsia européenne s’exprimait en français. Mais ce « prestige du français » ne va pas sans critiques. Ainsi, aux yeux de Salah Stétié, les écrivains français institutionnels « sont un peu épuisés, épuisés parce que la France est un vieux pays qui a la couleur de son ciel, qui a la couleur de la cervelle, un vieux pays de matière grise13. » Pour beaucoup, le français apparaît comme une langue à la fois logique et fluide, une langue de nuances, une langue de philosophes (Descartes), de l’investigation psychologique (Racine, Rousseau, Proust), la langue des Droits de l’homme. Mais tous les discours sur la légendaire « clarté rationnelle » du français ne tissent qu’une image idéalisée et suspecte de la langue, à laquelle il conviendrait d’opposer une « clarté obscure », comme le fait Henri Meschonnic en ne séparant pas la réflexion linguistique de ses conséquences dans les débats historiques et politiques, qui s’emparent souvent de la langue comme d’une légitimation d’autant plus forte qu’implicite. Si l’on croit parfois identifier une langue à des qualités propres et figées, c’est en projetant sur elle des sentiments d’amour ou de dépit dont la suspicion demande à être pensée. Ainsi, décliner les « vertus » soi-disant intrinsèques d’une langue donnée est périlleux et cette essentialisation risque d’entraîner sur la pente de l’appropriation et des propriétés « pures » d’une langue, marque d’un phantasme identitaire, nommé par Derrida « construction politico-phantasmatique de l’appropriation ». Il n’y a pas d’essence de la langue, même si l’on cherche parfois à l’enfermer derrière les barricades des frontières, patrie ou identité – n’est-il pas toujours « dangereux d’essencier14 », s’inquiétait Henri Michaux.
15On écrit pour être (« ÊTRE littérature », selon Kafka, « une entrée réelle dans la vie ») et on crée une langue dans une langue, quelle qu’elle soit, « natale » ou pas, au-delà de toute nationalité. L’écriture est une « forme de vie », vie de soi et vie du langage liées – une forme de vie qui transforme une forme de langage, et une forme de langage qui transforme une forme de vie, selon la formule essentielle de la poésie comme expérience, et vie, d’Henri Meschonnic. Expérience singulière, la question de l’idiome rejoignant ici celle de la singularité, de chaque être et de chaque expérience, terme à entendre selon l’étymologie latine, ex-periri, éprouver, la traversée d’un danger (periculum) – « Écrire est rechercher la chance15 » (Bataille). Expérience d’un idiome singulier. On écrit pour vivre et on fait vivre la langue, qui vit elle-même d’une vie qui échappe infiniment, toujours en devenir. Au-delà de tous les liens ataviques et communautaires liant la langue à une nation ou un territoire, toujours plus ou moins aliénants, asservissants, exclusifs, enclos ou forclos, une lettre de Marina Tsvétaïeva à Rilke, dans laquelle elle évoque les derniers poèmes, écrits en français, du poète allemand, semble tout résumer :
Goethe dit quelque part qu’on ne peut rien réaliser de grand dans une langue étrangère – cela m’a toujours paru sonner faux. […] Écrire des poèmes, c’est déjà traduire, de sa langue maternelle dans une autre, peu importe qu’il s’agisse de français ou d’allemand. Aucune langue n’est langue maternelle. Écrire des poèmes, c’est écrire d’après. C’est pourquoi je ne comprends pas qu’on parle de poètes français ou russes, etc. Un poète peut écrire en français, il ne peut pas être un poète français. C’est ridicule. Je ne suis pas un poète russe et c’est toujours un étonnement pour moi d’être tenue pour telle, considérée comme telle. On devient poète (si tant est qu’on puisse le devenir, qu’on ne le soit pas tous d’avance !) non pour être français, russe, etc., mais pour être tout. Ou encore : on est poète parce qu’on n’est pas français. La nationalité est forclusion et inclusion. Orphée fait éclater la nationalité, ou l’élargit à tel point que tous (présents et passés) y sont inclus16.
16Ce que dit là Marina Tsvétaïeva de l’écriture poétique est vrai de toute écriture et un écrivain n’est pas un étendard de la patrie ; elle ajoute cependant : « Néanmoins, chaque langue a quelque chose qui lui appartient en propre, qui la fait ce qu’elle est. » En effet, le français n’est pas l’allemand, et la poésie de Rilke n’est pas tout à fait la même en allemand et en français ; mais à chaque fois, le poète ou l’écrivain fait « arriver » quelque chose à la langue, en vue d’un au-delà de la langue elle-même, au-delà des mots (Words, words, words) et au-delà de la littérature elle-même, qui ne vaut que comme tentative de vivre et penser autrement, comme si l’écrivain, à l’instar de Louis-René des Forêts, rêvait « d’un langage / Non asservi aux mots17 », ou d’aller « au bout de la possibilité misérable des mots18 » – ce qui revient au même pas au-delà (dans les deux sens du terme). C’est pourquoi tout grand texte est une réécriture de la langue, signifiant aussi la faillite de toute théorie structuraliste ou formaliste du signe – faillite ainsi formulée par Meschonnic dans sa Critique du rythme : « Un linguiste ne peut plus cacher qu’il échoue devant la poésie19 ».
17Il n’empêche que chaque langue a ses spécificités, sa ou plutôt ses musiques propres, ses « saveurs » ; celles du français, qui ne tissent qu’une image plus ou moins conventionnelle mais constituent une « saveur dans la différence », Salah Stétié les trouve en particulier dans la langue de Racine, qu’il décrit ainsi : « Racine est une corbeille de fruits, tout de limpidité, et sous ces fruits, on le sait de reste, un serpent s’est glissé qui, endormi, se réveillera20. » Cependant, si la langue de Racine est bien du français, elle est un français particulier, daté, obéissant aux règles de la prosodie et de la rhétorique classiques, idiome magnifié par le talent de Racine, mais qui ne saurait constituer un canon absolu, sa « musique », sa syntaxe et son lexique n’étant ni ceux de Céline ni ceux de Proust, ni même de Molière. Comme disait Victor Hugo, « la langue française n’est point fixée et ne se fixera point ». Aucune continuité ininterrompue dans la langue ni aucun arrêt. Néanmoins, malgré des racines parfois communes, malgré les croisements, les emprunts, les évolutions, créolisations et autres métissages linguistiques, les mots d’une langue sont les mots d’une langue et « la mer » ne sera jamais thalassa, the sea, das Meer ou el mar. Un autre poète libanais, comme Salah Stétié, Georges Schehadé, écrivit lui aussi en français, parce que, dit-il, quand il était enfant, il entendit le mot « azur », et ce mot, qu’il ne comprenait pas, a suffi à aimanter l’appel de l’inconnu, déclencher en lui l’amour d’une langue à laquelle il allait consacrer sa vie, ou plutôt selon laquelle il allait engager sa vie, donner un sens à sa destinée. De même, Rilke dit avoir choisi d’écrire en français pour la beauté du seul nom de « verger », titre de son dernier recueil. Encore faut-il ajouter qu’au-delà des différences historiques, montrant qu’une langue ne cesse d’évoluer, de vivre et demeure infixée, infixable, les mots d’une même langue ne sont pas les mêmes d’un écrivain à l’autre, en particulier chez les poètes, qui les font (re)naître d’une vie nouvelle, révélant toute l’étrangeté de leur polysémie, résonance, profondeur et devenir. Le mot « azur » par exemple, avec son mélange de clair et d’obscur, de densité matérielle et d’immatérialité, ne dit pas la même chose chez Baudelaire, Mallarmé ou Rimbaud, pour prendre des quasi-contemporains. Après l’« azur sans bornes » de Hugo, pour Baudelaire, dont « la musique creuse le ciel » sans étoiles, l’azur renvoie à l’horizon rêvé du paradis perdu, à « La Vie antérieure », dans le désenchantement agonisant des soleils romantiques ; l’azur, pour Mallarmé, c’est d’abord la cruelle hantise de l’Idéal, son « instinct de ciel » dont il subit le vertige jusqu’au néant, dans son effort vers les sources du langage et de la pensée ; l’azur, pour Rimbaud, dans sa poursuite sans fin d’une poésie du devenir, « en avant », est « noir », c’est la hauteur vainement spirituelle qui nous empêche d’être au monde et qu’il faut « écarter », pour vivre en « fils du soleil », « étincelle d’or de la lumière nature ».
18Faut-il rappeler l’origine latine du terme « mot », mutum, désignant un son privé de sens, pour dire qu’un mot n’est pas qu’un mot, arrêté, fixé, momifié, embaumé dans une définition, et que le rêve mallarméen de « donner un sens plus pur aux mots de la tribu » ou de « céder l’initiative aux mots » demeure inachevé, expérience et acte de langage toujours à inventer ? L’écrivain soustrait ainsi ces mots aux définitions abstraites ou sclérosées du dictionnaire, en leur redonnant, au-delà du sens, leurs « besognes » (Bataille), fussent-elles celles de « grandes irrégularités de langage », autant dire leur ferment de bouleversement, de raisons et déraisons d’être, leur pouvoir d’« ameuter la vie », par-delà les rétrécissements spirituels. Un langage en acte, physique, comme une respiration, un souffle, dont Artaud reconnut et incarna l’importance majeure, lui qui, comme « passé au langage », selon la formule de Henri Thomas, écrivait ainsi à Jean Paulhan :
Mais que l’on en revienne si peu que ce soit aux sources respiratoires, plastiques, actives, du langage, que l’on rattache les mots aux mouvements physiques qui leur ont donné naissance, et que le côté logique et discursif de la parole disparaisse sous son côté physique et affectif, c’est-à-dire que les mots au lieu d’être pris uniquement pour ce qu’ils veulent dire grammaticalement parlant soient entendus sous leur angle sonore, soient perçus comme des mouvements, […] et voici que le langage de la littérature se recompose, devient vivant21.
19Ainsi revigorée et revigorante, fixée nulle part, la langue est moins un code qu’une pratique – il ne s’agit pas de l’utiliser (réduction à des fins utilitaires, communicationnelles), mais de la pratiquer ; elle vit, bouge, vivante et mutante, métisse, et les écrivains la font bouger davantage encore, en la réécrivant, selon un certain étrangement de la langue22, révélant toute l’étrangeté au cœur de l’humain et du réel. Et si l’élection d’une autre langue, dans un rapport passionnel, vivant, à la langue, à la langue comme corps et esprit, accroît les dimensions de notre existence et de nos territoires intérieurs, au sens large du terme, mental et humain, il demeure une part d’obscurité dans cette langue, qui est au fond la part de mystère dans l’homme. Comme l’érotisme, le désir, la langue porte en elle et préserve sa part d’« infracassable noyau de nuit », et la poésie ses racines de nuit, dont le caractère énigmatique est indissociable de l’énigme non moins insondable de l’homme et du monde.
20L’exil dans la langue est donc errance, comme l’exil physique, il passe, outrepasse et efface les frontières, non sans quelque écartèlement (« écart-tellement ») ou écartement, dans une langue de l’écart, langue écartelée, écart de langue, au risque de l’égarement. De la sorte, l’acte d’écrire étant ancré dans une immense solitude, comme beaucoup d’autres, Cioran s’est toujours situé en dehors du troupeau, se définissant comme un véritable parasite, une sorte de monstre. Lâchez tout que l’on pourrait retrouver chez de nombreux écrivains qui se tiennent à l’écart, hors de « la tribu », au risque d’être prisonniers d’une posture (se camper dans un style est une sclérose toujours menaçante dont Pierre Michon a décrit le prestige et les dangers dans Corps du roi) : Flaubert : « L’artiste, selon moi, est une monstruosité – quelque chose de hors nature » ; Isidore Ducasse : « Faut-il que j’écrive des vers pour me séparer des autres hommes ? » ; Kafka : écrire m’a fait « faire un bond hors du rang des meurtriers » ; Artaud : « je ne suis pas mort, mais je suis séparé » ; Guyotat : « J’ai peur parce qu’écrire me sépare de la horde ». Hors de la horde, hors de la patrie, apatride, Cioran le fut, comme Ghérasim Luca, autre Roumain qui se voulait « égaré », irréductible (« Être hors la loi / voilà la question / et l’unique voie de la quête »), refusant de s’enraciner, n’appartenant à aucune communauté, tourné vers d’autres horizons. Pour Cioran, comme pour Rimbaud, une patrie, « c’est de la glu » : « Je me sens détaché de tout pays, de tout groupe. Je suis un apatride métaphysique, un peu comme ces stoïciens de la fin de l’Empire romain qui se sentaient “citoyens du monde”, ce qui est une façon de dire qu’ils n’étaient citoyens de nulle part23. » « Homme du monde, c’est-à-dire homme du monde entier », disait déjà Baudelaire. Insituable, réfractaire à tous les états civils, l’apatride Cioran refuse le carcan de l’identité, cette imposition sociale de quelque étiquette que ce soit : « Je suis juridiquement apatride, et cela correspond à quelque chose de profond, mais qui n’est ni idéologique ni politique, c’est mon statut métaphysique. Je veux être sans patrie, sans identité24. » Ce refus de la patrie revient à franchir les bornes et s’affranchir du père, quitter la mère, changer de langue, désapprendre autant qu’apprendre, acquérir et s’appauvrir (ce que devrait être tout véritable voyage), une tentative pour se libérer des lois de la famille, de l’État, de l’Église, de la société et de la langue.
Langue de personne
21Errante, la langue est aussi de personne, n’appartient à personne, langue de personne, qu’on ne possède pas et dont nul n’est maître. Ainsi, à la limite, comme le déclarait l’écrivain algérien Kateb Yacine : « Aucune langue n’est étrangère », à partir du moment où le poète ne se résigne à aucune aliénation ni patrie linguistique. Changer la langue ou changer de langue est pour un écrivain en proie aux appels et à la pensée du dehors, faisant un certain usage du monde, une possibilité d’affranchissement et montre que la langue est pour lui une demeure, elle-même sans demeure, sans appartenance et sans maître, de même qu’à la limite, l’œuvre n’appartient pas à son auteur, tant d’écrivains ayant eux-mêmes revendiqué l’anonymat du langage, assignant leur texte au « vent du dehors », comme dit Bataille. Il n’y a pas d’idiome pur, et il s’agit d’inventer un nouvel idiome, unique, singulier, par un écart de langage, une langue autre, natale, naissante, hétérogène, sans demeure, c’est-à-dire dégagée de toute communauté, de toute demeure, familiale, sociale, ethnique ou nationale, une langue sans papiers, sans domicile fixe, nomade. C’est cette impossible appropriation que décrit Jacques Derrida en déclarant « je n’ai qu’une langue, ce n’est pas la mienne », mesurant ainsi toute la profondeur vertigineuse de l’étrangeté de sa propre langue. Un vertige que ne cesse de creuser l’écrivain, dont « les beaux livres, selon la fameuse formule de Proust, sont écrits dans une sorte de langue étrangère ». C’est ainsi que les illuminations incendiaires de Rimbaud, la bombe silencieuse de Mallarmé, le délire pataphysique de Jarry, la parole soufflée d’Artaud, le déluge verbal de Céline, les trous de l’innommable de Beckett, la cabale phonétique et « le tangage de la langue » de Luca, par exemple, sont autant de devenirs-autres de la langue, des langages féroces, gestes verbaux qui attentent à la langue, l’écriture se faisant abîme de la langue – comme abîme que recèle le langage en lui-même –, abîmant la langue, subversion et outrage des codes de la langue, du bon goût des grammairiens ou des littérateurs, expérience qui amène tout le langage à une limite, en vertu d’un infini pouvoir de recréation verbale, ce qui exclut tout monolinguisme au sens strict. On ne saurait donc enchaîner une langue à une essence ou une identité forclose dans ses liens à une nation, de même que la notion de « langue maternelle » ne constitue pas un atavisme infranchissable ou une propriété naturelle, même si elle est souvent invoquée comme un attachement indéfectible à une certaine sacralité des racines. Les innombrables exemples d’écrivains, exilés ou pas, ayant fait le choix d’écrire dans une langue étrangère sont l’incarnation même que la langue a d’autres racines que celles édictées par le territoire, la famille ou la doxa, le pouvoir et les dominants, les lois et les codes de la nation, les droits du sang ou du sol. À travers l’écriture, il s’agit de rejouer le destin du langage – qui engage aussi celui de l’homme, puisqu’il serait d’une légèreté insensée de penser que la langue vit indépendamment de l’homme et vice-versa.
22Depuis quelques années, de nombreuses voix se sont élevées pour dire comment la littérature française échappe à la nation et est en train de devenir, selon l’expression de Michel Le Bris, une « littérature-monde » en français. Davantage que dans l’exotisme de l’outre-mer, on est là dans l’outre-langue. Symptomatique, même si anecdotique, l’année 2006 aura vu en France la plupart des grands prix littéraires de l’automne décernés à des écrivains d’outre-France : le prix Goncourt et le Grand Prix du roman de l’Académie française attribués au franco-américain Jonathan Littell (en 2007, le second de ces prix a été décerné au gréco-français Vassilis Alexakis et en 2008 le Goncourt est revenu au franco-afghan Atiq Rahimi), le Renaudot au congolais Alain Mabanckou, le Femina à la canadienne Nancy Huston, le Goncourt des lycéens à la camerounaise Léonora Miano. Michel Le Bris n’hésite pas à parler d’acte de décès de la francophonie ; et il n’a pas complètement tort, tant la francophonie officielle est teintée de supériorité morale, de paternalisme drapé des idéaux de la Révolution et des Lumières, et place la littérature dite « francophone » à la périphérie, dans les marges de la littérature dite « française », laquelle, avec sa manie des étiquettes, forte et fière de sa longue tradition des lettres, dominée par l’hégémonie de la place forte parisienne, juge parfois avec condescendance ce qui s’écrit outre-France, loin des « anciens parapets », le renvoyant au folklore et au pittoresque. Pourtant, à proprement parler, on ne parle pas le « francophone », il est de plus en plus difficile de distinguer le français « de souche » et le français « francophone », si l’on ose cette tautologie, et l’écrivain français est lui même un « écrivain francophone ». On juge aussi parfois les auteurs « francophones » comme les sauveurs de la langue française, comme s’il y avait péril en la demeure et un trésor immémorial à sauver ; certes, il y a un héritage, mais qui n’existe qu’en fonction de ce qu’en font les héritiers, et comme le dit Alain Mabanckou, « on n’écrit pas pour sauver une langue, mais justement pour en créer une25… » Il est certain que ce nouvel élan d’une langue revivifiée comme creuset des possibles et cette prise de conscience d’une littérature française, ou plutôt en français, aux voix multiples, venues d’ici et d’ailleurs, à l’heure d’un télescopage mondial des cultures et d’une américanisation du monde, à l’heure aussi d’une marchandisation accrue de la littérature, est un appel d’air salubre, comme le fut en son temps, enracinée dans l’histoire de la colonisation, la poésie de la négritude, l’apologie du métissage, d’un Senghor ou d’un Césaire, dont Breton disait qu’elle est « belle comme l’oxygène naissant ». C’est donc la fin d’une certaine idée de la « francophonie », avec tout ce qu’elle véhicule d’un peu dévalorisant, et l’émergence d’une littérature-monde en français dans laquelle peuvent dialoguer les écrivains de l’Hexagone et ceux d’ailleurs, tous « écrivains français », ou plutôt, parce que les frontières de la francophonie seraient abolies, tous autres « français », écrivains d’une outre-langue ou autre langue française, laquelle serait enfin délivrée du lien ombilical avec la nation, et de son génie propre comme phantasme du génie de la nation, ce que Michel Foucault appelait « le narcissisme monoglotte des Français26 ».
23À l’encontre de cette polyphonie, donner une nationalité à la langue revient à la fossiliser, ce que stigmatisait Marina Tsvétaïeva dans sa lettre à Rilke. C’est bien pourquoi, Kateb Yacine, considérant la langue comme une arme et la langue française comme le « butin de guerre » des Algériens, pouvait déclarer en 1966 :
Ce qu’on appelle « francophonie » est une machine politique néo-coloniale, qui ne fait que perpétuer notre aliénation [...] mais l’usage de la langue française ne signifie pas qu’on soit l’agent d’une puissance étrangère. Au contraire, notre usage du français peut devenir une arme. [...] j’écris en français pour dire aux Français que je ne suis pas français27.
24Sa position par rapport à la langue, manière de l’arracher à son servage, selon le vœu de Breton, n’est guère différente du rapt de la langue de ses tortionnaires par Jean Genet, d’Artaud disant écrire « pour les analphabètes », de la langue contre la langue qu’écrit Pierre Guyotat, donnant une langue aux « sans voix », ceux que l’Histoire désavoue et réduit à un état non-humain, ou de la position d’Antoine Volodine qui revendique « écrire en français une littérature étrangère » – de même que Paul Celan écrivit sa « contre-parole » en désécrivant sa « langue maternelle » devenue « la langue-de-mort » des bourreaux, langue enrôlée dans l’horreur et complice du désastre. Aujourd’hui, contre toutes les aliénations, oppressions, discriminations, enfermements dans des limites, derrière des murs, la conscience liée de l’homme et du monde en devenir et d’une langue en devenir, de la « totalité-monde » « mondialité » davantage que « mondialisation », qui n’est qu’une « globalisation », sans monde, réduit à un « marché-monde », voire une uniformisation, standardisation et grégarisation – ou du « Tout-Monde », pour reprendre le terme d’Édouard Glissant, ne peut que conduire à une littérature-monde, par-delà les continents, les frontières, les nationalités, les arbres généalogiques, les états-civils, faisant résonner la polyphonie, la multiplicité, l’étrangeté et l’inconnu qui habitent la langue et le monde, ici et ailleurs, partout.
25Pour Ghérasim Luca, le recours à une langue « non-maternelle » fut un geste d’affranchissement radical : le « règne de l’Un » n’est pas inéluctable. Il faut dire que né à Bucarest en 1913 dans un milieu juif ashkénaze, il s’est trouvé très tôt en contact avec de nombreuses langues, en plus du yiddish et du roumain, notamment le français et l’allemand. Depuis sa jeunesse dans le Bucarest cosmopolite de l’entre-deux-guerres jusqu’à la solitude exilée des dernières années parisiennes, amoureux passionné de la « liberté libre », laquelle n’est autre que l’horizon humain, ouvert, Ghérasim Luca s’est voulu obstinément hors des frontières, revendiquant un « parler apatride », hors la loi. Vivant poétiquement « l’Anti-Œdipe » qu’allaient théoriser Deleuze et Guattari, son exil linguistique est la conséquence directe de sa volonté subversive de libération de la condition œdipienne, qu’il formule dans L’Inventeur de l’amour, La Mort morte et dans un Manifeste non-œdipien depuis lors perdu : couper le cordon ombilical, en finir avec « l’homme axiomatique » et avec tous les ordres. Refus qui s’inscrit à la fois dans l’histoire littéraire et dans l’Histoire, dans l’unité poétique et politique de l’invention d’une voix. En rupture avec tout alignement politique ou communautaire, avec tous les conformismes insupportables, les comportements stéréotypés, refusant les concessions et allégeances du « métier » littéraire, Luca cherche une langue délivrée de tout joug, en appelant notamment à une expression débridée de l’érotisme, arme par laquelle il lutte contre l’uniformité accablante des discours. Ne pouvant séparer Histoire et histoire personnelle et ne pouvant refuser l’emprise de l’histoire familiale sur le discours sans faire l’économie de l’inconscient, son entreprise poétique tente néanmoins de dénouer l’emprise immédiate de l’Histoire et de rouvrir la question suspendue de la relation entre inconscient individuel et inscription dans l’histoire collective.
26Celui que Deleuze appelait « le plus grand poète de langue française » fut poète parce que, roumain de naissance, juif sans sentiment d’appartenance, religieuse, ethnique ou nationale – il se définissait lui-même comme « l’étran-juif », étrangeté qu’il partage avec cet autre exilé roumain juif que fut Paul Celan, auquel il fut d’ailleurs lié par une profonde amitié –, il eut à se défier très tôt des mythes qui habitent le phantasme de « maîtriser » les langues et le savoir, parce que sa parole fait vaciller la croyance en la fixité de la langue. Pour Luca, le langage est porteur d’un « secret manifeste », mais un secret dont le sens se dérobe dès qu’on s’avise de le fixer : instabilité, incertitude, valorisation du secret et son érotisation, à l’opposé de tous les mythes qui nourrissent plus ou moins implicitement les idéologies, les discours positifs et les principes d’identité. C’est pourquoi, s’il reconnaît l’importance des explorations d’inconnu entreprises par la Kabbale, Hegel, Engels, Freud ou Breton, il suspecte toutes les figures édifiantes et rejette toute forme de pétrification d’un héritage littéraire, philosophique et mythique. Avec une confiance absolue dans la parole, il fait ainsi éclater au grand jour la contingence de ces mythes, manifestant une défiance radicale à l’égard de la langue commune et des croyances linguistiques. Cette voix discordante s’empare donc des représentations philosophiques contemporaines et la danse de sa pensée, toute de révolte et de jubilation, fait vaciller ces totems, en révèle les insuffisances, les incertitudes. Si la poésie est affaire de langage, Luca fait aussi le pari que cette physique du langage, davantage que toute métaphysique, peut modifier nos représentations du monde et notre insertion dans celui-ci. Discours intempestif qui est à la fois « sonde » et « flèche », c’est-à-dire exploration des territoires de la pensée et nouvelle perception du langage et de l’univers. Cette diffraction ne l’épargne pas. Comme Rimbaud (« Je est un autre »), Nerval (« Je est l’autre »), Lautréamont (« On me pense ») ou Rodanski (« Mon âme en cette absence – loin »), Luca a toujours eu l’impression de penser hors de soi, d’être pensé (« Je suis hélas donc on me pense », dit-il dans « Le Tangage de ma langue »), sans que cet autre n’apparaisse jamais clairement, objectivement, aussi insaisissable qu’inépuisable. Comme on est loin du jeu de dupes de la société, de ses leurres mortifères et des ruses de l’identité, ce concept fantôme, piège symptôme de notre époque, dès lors qu’un individu, traversé par les sortilèges inséparables de l’être et du non-être, éprouve le tourment d’être sa propre énigme et cherche avant tout à inventer sa liberté, manière de reposer la lancinante question du « qui suis-je ? » et celle, liée, du devenir nietzschéen (« comment devient-on ce qu’on est ? »).
27La magie de l’identification par le nom d’écrivain s’accompagne d’une destruction du mythe sur lequel les interprétations philologiques et linguistiques prétendent faire reposer l’identité. En l’occurrence, de son vrai nom Zola ou Salman Locker, Ghérasim Luca est un pseudonyme, et ce choix du nom d’écrivain est une résistance à la folie des catégorisations identitaires. Luca se choisit, comme il le dit lui-même, « un nom et un égarement », brouillant ainsi les limites de la dénomination. Refus d’un certain type de croyance en la détermination contraignante des origines, ouverture de la mémoire à une invention de soi qui revêt le symbolique d’une aura imaginaire : l’exilé insoumis conquiert ainsi une liberté symbolique à l’égard du nom propre, dont la langue française affirme que l’individu le porte. Les écrivains sont familiers de ce recours à un pseudonyme, manière de réduire virtuellement l’arbitraire du signifiant. Comme Cioran affirmait qu’on habite une langue et non un pays, le pays de Luca, c’est son corps et son identité, sa voix, sa « déraison d’être », mais sa voix s’est aussi lancée dans un travail de sape de la langue française, la mettant en question, la torturant, la métamorphosant en un babil en attente d’une nouvelle harmonie. Le français n’est pas pour lui, poète nomade, une langue de refuge, mais une matière suffisamment vierge pour se plier à la recherche d’une autre expression de l’individualité, exploration qui perçoit dans les circonvolutions d’une langue incessamment re-parcourue les espaces où virtuellement peut soudain s’ouvrir une brèche. Exilé au-delà de toute patrie, toujours en bordure de, « étranger », le poète est un émigré dans l’espace et le temps, au sens donné par Marina Tsvétaïeva, « étranger et libre », comme le dit Paul Celan dans le dernier poème du recueil De Seuil en seuil. Cet exil linguistique met aussi en question l’identité du sujet lui-même, étiquetage identitaire dont les masques mondains emprisonnent le vivant dans « ces états catastrophiqués », comme disait Artaud, du « moi » et du « soi ». En effet, au-delà de la schizophrénie que peut engendrer l’exil, l’identité est souvent volontairement questionnée, voire mise en pièces, par ceux qui en refusent les ruses, la codification et la claustration. Ce refus de l’identité codifiée, indivise et assise, passe par un travail de la langue, un questionnement spéculaire sur l’acte d’écrire et finalement une défiance à l’égard du langage dont on ne peut user que pour en éprouver les limites. C’est pourquoi l’exil linguistique est un parler ailleurs-autrement, à la fin exilé dans la langue elle-même, dépossession, expression d’un je errant, perdu ou lointain, ailleurs, en devenir, hors-jeu, hors la loi et hors de soi.
28Le désir d’identité est toujours trahi, erratique par essence, sans cesse ajourné par l’apparition de ses ombres et de ses doubles, l’individu étant « l’illimité se pensant limité27 ». L’identité, indéfinie et infinie, fait défaut, ne réside que dans le manque et la béance du rapport à l’autre, et la psychanalyse nous a enseigné qu’elle se manifeste bien souvent comme symptômes pathologiques. Elle n’existe pas, les miroirs dévisagent le monde et ne renvoient qu’une image ambiguë de soi : une énigme, un secret qui échappe. La vérité est nomade et multiple, l’erreur enracinante et une, consistant souvent en une identification butée. À l’opposé, à travers la multitude des possibles, se dévoilent les correspondances entre infini réel et infini verbal, intemporel et temporel. Le singulier, parce qu’il est multiple, échappe à toute définition close, qu’on considère le corps et la conscience, et s’affirme dans l’invention de soi, comme homme « incréé », hors assignation identitaire ou anatomique. Sans remonter jusqu’à la parabole du rêve du papillon de Tchouang-tseu, chez de nombreux écrivains, exilés géographiquement ou non, le refus de l’identité, la haine du sujet constitué et de tout ordre s’allient bien souvent à la recherche d’une langue singulière, hétérogène, pour qu’il n’y ait pas un Je qui triomphe, mais que puisse se faire entendre la multiplicité des voix, euphoniques et discordantes, qui interfèrent en soi – autant de façons de se créer soi-même et de dévoiler ce que nous sommes sans le savoir : le « Je suis caché et je ne le suis pas » de Rimbaud, « la disparition élocutoire » de Mallarmé et de tant de poètes misant sur l’effacement du moi ou sur l’incertitude de ses doubles pour embrasser ou déchiffrer le monde, de Nerval à Jean-Pierre Duprey en passant par les Surréalistes ou ceux du Grand Jeu, la dépossession de soi dans l’unisme de Malcolm de Chazal (« Le plus court chemin / De nous-mêmes / À nous-mêmes / Est l’Univers »), le « corps sans organes » et multiple d’Artaud le Mômo (« Je suis l’infini », écrivait-il à la fin de sa vie), Mes Propriétés de Michaux, misant sur tous les « gènes insatisfaits » (« J’écris pour me parcourir »), Gilbert Lely et le luxe de Ma Civilisation clandestine, le renoncement de Bataille aux prérogatives du sujet (« J’écris pour oublier mon nom ») au profit de la dépense et d’un excès inassimilables, l’effacement de soi dans la parole de Celan, enchevêtrée de voix et tendue vers un Autre, « Je » et « Tu » confondus, l’intranquillité des hétéronymes disparates de Pessoa (« Mon nom est Personne »), le pronom « je » pulvérisé dans les bribes de parole de Beckett, le devenir loup ou fantôme de Luca, la polyphonie dissonante qui met à mal l’intégrité de la voix intérieure de Louis-René des Forêts, les échos multiples de l’être et ses métamorphoses dont l’écriture conduit aux confins de l’impersonnalité chez Fardoulis-Lagrange, la déperdition ensorcelée d’un Rodanski qui brouille les cartes du moi (« Je suis si vaste d’être seul / Je me croirai multiple »), l’invisibilité mondaine de Blanchot et son dessaisissement du pouvoir de dire « je » – autant de quêtes de l’autre en soi ou plutôt des autres en soi, l’infini des possibles au-delà même de la simple dualité du moi qui enferme encore Faust lorsqu’il s’écrie « Deux âmes, hélas ! habitent en ma poitrine ! » Comme si l’écriture (de soi), manière d’expier le moi en faisant advenir l’inconnu et le monde en soi, s’écrivait d’abord contre soi-même, en donnant voix à ce qui en l’homme ne parle pas, l’inhumain, l’innommable, l’impossible, le non-humain par quoi l’homme est traversé : la mort, l’infini, Dieu, l’animal, la nature… « Qui écrit est en exil de l’écriture : là est sa patrie où il n’est pas prophète28 », écrit Blanchot.
29L’inconfort d’une telle situation touche aux limites où pointe la tentation du silence, la répudiation finale du verbe, mais il semble bien que ce soit une telle limite qui ait constitué pour Samuel Beckett un point de départ, inlassablement interrogé. L’homme Beckett, éminemment secret, est un cas à part, un homme séparé, à l’écart, comme tombé de la lune, comme en dehors de l’histoire, peu francisé au fond, arborant sur son faciès d’aigle et son regard lointain une sorte de noli me tangere suprêmement lucide et impénétrable : « un être en dehors, disait de lui Cioran, qui poursuit un travail implacable et sans fin. On dit, dans le bouddhisme, de celui qui tend vers l’illumination, qu’il doit être aussi acharné que “la souris qui ronge un cercueil”. Tout véritable écrivain fournit un effort semblable. C’est un destructeur qui ajoute à l’existence, qui l’enrichit en la sapant29 ». Le fait est qu’il creuse, sonde et sape la langue, forant des trous dans le langage, des trous d’air dans le Tout du langage, pour tenter d’approcher le fond de l’innommable, tendant vers une parole qui se vide comme un sablier, vers l’absence, le blanc. Une écriture tout en « écarts de langage » qui tisse une mythologie du dénuement et qui en s’écrivant s’use, s’enlise et se métamorphose, mais va néanmoins de l’avant, comme affolée par l’illusion du point final. À remplacer le rocher de Sisyphe par les mots, il interroge jusqu’au vertige, jusqu’au « coma », l’angoisse et la finitude de l’homme, en cherchant sa voix, sans qu’elle n’advienne jamais, audible seulement dans l’après-coup de ses traces. Car les mots sont des fictions, le langage est un piège qui donne l’illusion d’un moi assuré à celui qui parle, un piège où rien ne se prend, une danse interminable des mots qui cherchent éternellement leurs significations et ne consacrent que le simulacre ou la faillite, l’inachèvement, de la parole et du corps : « dire des mots jusqu’à ce qu’ils me trouvent », telle est sa tâche impossible, tant la voix ne nous appartient pas. Posant la question de l’origine du langage, cette voix, emmurée par le langage convenu et dissous dans le vacarme du bavardage, emmurée dans les mots, se dissout dans le silence, sapant toute confiance naïve dans le langage, rendu caduc. Dès lors, au risque consenti de l’aphasie, les pronoms et prénoms importent peu et la folie du texte est une entreprise condamnée à l’échec ou à la répétition, ne pouvant élucider l’origine ou la destination de son énonciation.
30« C’est de moi maintenant que je dois parler, fût-ce avec leur langage, ce sera un commencement, un pas vers le silence, vers la fin de la folie, celle d’avoir à parler et de ne le pouvoir […]. M’avoir collé un langage dont ils s’imaginent que je ne pourrai jamais me servir sans m’avouer de leur tribu, la belle astuce. Je vais le leur arranger, leur charabia. Auquel je n’ai jamais rien compris du reste, pas plus qu’aux histoires qu’il charrie, comme des chiens crevés. Mon incapacité d’absorption, ma faculté d’oubli, ils les ont sous-estimées. Chère incompréhension, c’est à toi que je devrai d’être moi, à la fin. Il ne me restera bientôt plus rien de leurs bourrages. […] Sur leur propre terrain, avec leurs propres armes, je les balayerai, et leur pantin raté avec. Des traces de moi, j’en trouverai peut-être à la même occasion30 », écrit-il dans L’Innommable.
31« L’Innommable » est donc moins ce que l’on ne peut nommer que celui qui ne nomme ni ne se nomme, nomme à peine ses propres « traces », l’absent qui se désolidarise des affectations du langage dit humain dont on use et abuse dans la culture des mémoires et donc des sens uniques. C’est celui qui affecte le langage.
32Beckett ne vécut que dans les mots, « gouttes de silence à travers le silence », comme il est dit à leur sujet dans L’Innommable : « tout est une question de voix. Ce qui se passe, ce sont des mots31 ». Mais cette parole spectrale atteint à sa limite, la rage de parler se trouve coincée et ne peut que murmurer ou crier, entre aphasie et logorrhée, réduite à un filet de voix, fantôme ou ombre qui halète, suffoque, tel un ahan de condamné à mort, condamné à parler pour vivre, sans trouver sa voix. Son travail de ruine concerne moins la langue française elle-même, que le langage en soi, qui porte le silence en soi ou tend au silence, comme un « prolongement convulsif de la parole32 ». La parole est la grande affaire de Beckett, sa seule respiration, son seul mouvement (« Les mots vous font voir du pays avec eux d’étranges voyages », écrit-il dans Comment c’est), jusqu’à la vacuité suprême synonyme d’infini, contenue par exemple dans ce titre, Sans, énoncé en anglais Lessness, vocable forgé par Beckett et sans équivalent approprié en français, même si Cioran lui suggéra un jour le mot « sinéité ». Pour cet exilé au milieu du monde et de ses mots, comme pour Cioran ou Luca, l’écriture (et la langue française) ne permet pas de communiquer mais de vivre, inventer sa liberté. Et n’est-ce pas le même but qu’assignait Breton à la poésie, n’ayant d’intérêt qu’à être « une solution particulière du problème de notre vie33 » ?
Langue sans demeure
33Vivre ou survivre, c’est-à-dire se trouver et trouver sa voix, s’inventer une voix/voie. Dans cette approche de la parole, sans appropriation, l’étrangeté du langage apparaît d’autant plus fortement que Beckett ou Luca écrivent dans une langue qui leur est originellement étrangère une langue autre, altérée, hétérogène, rendue ainsi doublement étrangère et d’autant plus singulière, puisqu’il s’agit par cette invention de tenter de dire ce dont on ne peut parler. Les expériences d’Artaud, Celan, Beckett, Rodanski ou Luca se résument à un pas au-delà, une tentative inachevée et infinie pour s’en sortir. « Comment s’en sortir sans sortir ? », lançait Luca. En écrivant « contre », contre la langue familière, médiocre instrument de communication, quand il n’est pas la sourde dictée de servitudes et habitudes, contre soi également, dans une surconcertation vigilante et fébrile de sa propre écriture. Ce langage qui cherche à s’affranchir des codes, traversé par le refus de tout asservissement, guidé par un impérieux Non Serviam, non asservi aux mots, est donc inséparable d’un devenir, « un devenir-autre de la langue », comme dit Deleuze, ce qui éloigne de l’identification, de l’imitation, de la Mimésis. C’est ainsi que Paul Celan a écrit une autre langue, une « contre-langue », une « contre-parole » (Gegen-Wort), « étrangère », étrange, comme Michaux écrivait « Contre ! ». Dans tous les cas, il s’agit selon la lapidaire formule de Rimbaud de « trouver une langue », « trouver le lieu et la formule », trouver des « armes miraculeuses » par « une écriture hors langage » selon Blanchot, de « grandes irrégularités de langage », « le langage de l’impossible » selon Bataille, « le mot qui fut silencié » (das erschwiegene Wort) selon Paul Celan, « le mot unique » selon Baudelaire, le rêve d’« un mot total, neuf, étranger à la langue » selon Mallarmé, des « rechargeurs de mots » pour René Daumal, des « mots sans mémoire » pour Leiris, une « Parole d’avant les mots » pour Artaud, « une langue de la langue » selon Salah Stétié, « une faille dans le langage » pour Fardoulis-Lagrange, etc.
34Ces inventions d’une langue, qui s’émancipent des règles codifiant son usage, sont aussi une invention de soi en même temps que l’invention d’un monde, la tentative d’expression d’un autre monde possible, le recours à une langue étrangère redoublant l’étrangeté de ce monde possible. En ce sens là, l’écriture, en particulier la poésie, est une expérience de langage, dans un esprit et un corps, aux limites périlleuses du sens, selon les trois acceptions du terme : sensation, signification et direction. Se déracinant de « la langue maternelle » et de la loi des racines (on voit là la distance prise par rapport à Heidegger), il s’agit de l’invention d’une nouvelle langue, sans demeure, comme dit Marc Crépon en reprenant ce mot cher à Derrida, c’est-à-dire dégagée de toute communauté et enracinement. En effet, que la langue soit explicitement ou non envisagée comme « cause nationale », un certain imaginaire des « territoires linguistiques » identifie les êtres à une langue, à un nom et une terre, et il est vrai que chacun de nous porte en soi une langue comme « demeure », qu’il « habite ». Mais la langue « maternelle », c’est aussi la langue de la loi, de la société, de l’autorité, du père, celle que Kafka désavoue et ne veut pas « posséder », ce dont il témoigne à maintes reprises dans son Journal ou sa Lettre au père. C’est pourquoi il écrit une autre langue dans la langue (l’allemand), sortant la langue hors d’elle-même, une langue hétérogène qui échappe à la voix du père et tente de redonner un souffle de vie, pour déjouer les rapports de force et de domination. Seule cette langue à inventer offre à Kafka une possibilité de salut, « une entrée réelle dans la vie », le reste n’étant que servitude stérile et aliénation dont il égrène les supplices dans son Journal :
[C]omme si les mots étaient de la viande crue, de la viande coupée à même ma chair (tout cela m’a coûté). Enfin, je dis la phrase, mais il me reste une grande terreur, parce que je vois que tout en moi est prêt pour un travail poétique, que ce travail serait pour moi une solution divine, une entrée réelle dans la vie, alors qu’au bureau je dois, au nom d’une lamentable paperasserie, arracher un morceau de sa chair au corps capable d’un tel bonheur34.
35Sa « demeure » n’est donc pas la « langue maternelle », celle de la famille, du père, de la société, langue dont la familiarité convenue lui reste étrangère.
36Pourtant, à première vue, l’équation « langue maternelle » = vie semble souvent aller de soi, comme une évidence que l’on énonce avec une naïveté tranquille. Ce sentiment de sécurité et de maîtrise au sein de la langue a été invoqué, après le désastre de la guerre, par Adorno et Hannah Arendt, qui parle de son attachement indéfectible à la langue allemande, attachement à une certaine sacralité des racines, comme si cette langue était son bien le plus propre, absolument irremplaçable : « seule demeure la langue maternelle […]. Ce n’est tout de même pas la langue allemande qui est devenue folle ! […] rien ne peut remplacer la langue maternelle35 ». Pourtant, les nombreux exemples d’écrivains ayant changé de langue et ayant inscrit leur intimité dans une langue étrangère démentent aisément cette assurance solennelle de l’enracinement dans la langue maternelle, qui peut ne pas être le lieu originaire et irréfragable de la voix et du sens. L’originarité présumée naturelle ou sacrée de la langue maternelle n’est pas absolue et ne garantit pas, par essence, un sentiment ultime de familiarité et de liberté. La paternité de cette langue dite maternelle demeure énigmatique et arbitraire, largement envahie de phantasmes et de fictions, comme ces « fictions légales », à la fois remplaçables et irremplaçables, que sont la Mère, le Père dans leur unicité absolue.
37Certes, chacun de nous a une langue pour demeure, ce que dit aussi Derrida, qui se dit lui-même « monolingue » et assigné à une seule langue, qu’il habite et respire, parlant même de la « pureté » secrète de son français, sans qu’il puisse toutefois se l’approprier, car cette langue est elle-même sans demeure, au-delà de toute forme de propriété et appartenance. Elle ne se confond ni avec un « idiome pur », ni avec la langue maternelle, étant plutôt à chercher, comme un rêve de langue, promise, en attente, consistant à « faire arriver quelque chose, à cette langue », comme une possibilité d’émancipation. Ainsi Kafka, Tchèque, juif, fasciné par le yiddish (dérivé de l’allemand), écrit en allemand, mais il met la langue allemande hors d’elle-même, créant une langue « à l’écart », irréductible à toute communauté, car il écrit en vertu de cette impossibilité d’écrire qu’il évoque dans sa longue lettre à Max Brod de juin 1921, commentée notamment par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans Kafka. Pour une littérature mineure, parlant de « déterritorialisation » pour désigner la nécessité de « faire un trou » dans le corps constitué de la langue, dans la langue commune : creuser une langue mineure, autre, dans une langue majeure. Exilé dans sa propre langue, « autant dire qu’un grand écrivain est toujours comme un étranger dans la langue où il s’exprime, même si c’est sa langue natale. […] C’est un étranger dans sa propre langue : il ne mélange pas une autre langue à sa langue, il taille dans sa langue une langue étrangère et qui ne préexiste pas36 ». De la même manière, Céline commence par bousculer sa langue natale, dans le Voyage au bout de la nuit, en réintroduisant à la fois la langue populaire et le corps dans le français, déséquilibre qu’il accentue dans Mort à crédit, jusqu’à la danse des mots de Guignol’s band, véritable explosion exclamative de la syntaxe.
38L’invention de cette langue « étrangère », autre, idiome singulier, hétérogène, ne se fait pas sans quelque cruauté. Comme Lautréamont, Rimbaud, Artaud ou Cioran, Luca renoue avec une certaine fureur, qui n’est pas plaisir de la destruction, mais refus de toute complaisance, se voulant irréductible, irréconciliable, héros-limite de la poésie vécue. C’est ainsi qu’il tourmente la langue française, comme s’il voulait lui faire rendre gorge, écrivant une langue en colère, sorte de cabale phonétique qui vise à libérer le langage et l’homme ; le mot étant comme un être enfermé dans sa condition humaine et dans l’ordre grégaire, il s’agit pour Luca d’aller vers le « non-mental ». Pariant sur le fait qu’il y a un langage au-delà des mots eux-mêmes, comme le baiser est un langage, des mots il fait des organes, pour reprendre un mot cher à Artaud, des « extraits du corps », car la langue s’incarne autant dans le corps que dans les idées. Alchimiste, explorateur, maître de la métamorphose plutôt que de la métaphore, il lance le français à l’infini, affolant l’énergie folle de la morphologie de la langue. Le bégaiement de cette parole en ébullition, cette danse de la poésie, à la fois fuite éperdue du sens et multiplicité jubilatoire des sens, se jouent au-dessus de l’abîme, oxygène au bord de l’asphyxie, et s’abîme en mutations sonores, du murmure au cri, de l’invocation à la logorrhée. Sous le murmure le cri, sous le cri le murmure : « la brûlante morsure des mots ». Luca ne pouvait qu’étouffer dans un monde où les mots, abusés ou abusifs, gonflés ou vidés, trop mous ou trop rigides, archaïques ou victimes de la mode, c’est-à-dire aussitôt démodés, galvaudés, semblent manifestement perdre tout pouvoir. Au-delà de sa rage face au monde du dehors, c’est en effet sur les mots eux-mêmes qu’il bute, comme sur autant de résidus des vieilles métaphysiques, car les lois du langage demeurent, malgré tout, et nous emprisonnent. C’est bien les mots eux-mêmes, qui risquent d’étouffer (« Tous les mots m’étranglent », écrit Bataille dans un poème), que Ghérasim Luca, vampire des mots, étreint et viole à la fois en un « numéro d’acrobatie infinie » et avec eux tous les possibles de l’amour, toutes les femmes du monde, tout le devenir incandescent et désirable du monde.
39Il fait donc vibrer, vaciller, chanceler, chalouper, tanguer, tourbillonner, balbutier, bégayer, murmurer ou crier la langue, au bord d’un gouffre verbal, il la broie et pulvérise, inventant une « physique élémentaire » et instable, en mouvement perpétuel, de la langue. Expérience verbale qui, unissant la pensée et l’affect, le conduit à « s’oraliser », à « prendre corps » à travers la chance et l’épreuve d’un bégaiement de la langue, selon une « orgie de mots » qui agit « sur un monde qui se nie / se noie et se noue / au fond de ma gorge » (« Le Tangage de ma langue »).Donner un son, un corps, du souffle au langage, tel fut dès l’origine le chant sacré de la poésie, avec son pouvoir de création, même si l’homme moderne ne veut plus croire que le mot « pluie » puisse mouiller, ou qu’un chant d’amour soit capable d’ouvrir des bras rétifs ; l’enfant, lui, s’en souvient quand il sacre ses chimères avec les mots, parce qu’il ose l’incantation. Par une coïncidence du jeu et du sérieux, le bégaiement, qui conduit le langage à une limite, introduit dans la chair des mots du silence, une trouée, obstinément réitérée, que met en scène Héros-Limite, épopée poétique de l’invention du zéro, de ce « plein vide foré dans le grand tout » de ce grand « trou métaphysique ». Le « sorcier poétique-politique » Luca fait ainsi bégayer la langue pour introduire la dissonance dans l’exercice habituel et uniforme du langage, bégaiement qui n’est pas sans rappeler l’ancien et fameux vers de saint Jean de la Croix : un no sé qué que quedan balbuciendo (« Un je ne sais quoi qu’ils vont balbutiant »), ou encore la langue de Paul Celan, âpre, haletante, environnée de blancs, creusant le silence, « cristal de souffle » entre murmure et stridence, dont les répétitions compulsives frôlent parfois le bégaiement, se disent dans « les fissures du mourir », comme dans ce poème de La Rose de personne, réduit à des bribes de paroles : « bégayer seulement, bégayer, / toutoutoujours / bégayer » (nur lallen und lallen, / immer-, immer- / zuzu37). Pour Celan, bâillonné et « la langue coupée » par le désespoir, l’altération tranchante de la langue consiste en une refonte alchimique qui tente de sauver quelque chose des ruines de la catastrophe, un souffle vital qu’il porte comme s’il était « le dernier à parler ». Pour Luca, la pratique hallucinante du « bégaiement poétique », inventif et libérateur, vise une invention de soi en même temps qu’une invention de langue : la chair du poème innerve la chair du poète, et réciproquement. Sans cette violence, née des violences et asservissements de l’Histoire, et sans cette tentative d’arrachement, la parole en resterait à un bégaiement proche du mutisme premier ; mais elle répercute les sursauts et tremblements du monde, en passe par l’expérience du « bruit du temps », selon l’expression de Mandelstam, qui écrivait :
Que voulait dire ma famille ? Je ne sais. Elle était bègue de naissance, et cependant elle avait quelque chose à dire. Sur moi et sur beaucoup de mes contemporains pèse le bégaiement de la naissance. Nous avons appris non à parler, mais à balbutier, et ce n’est qu’en prêtant l’oreille au bruit croissant du siècle et une fois blanchis par l’écume de sa crête que nous avons acquis une langue38.
40La parataxe d’Hölderlin, la logorrhée d’Artaud, le bredouillement des clochards métaphysiques de Beckett, le souffle coupé et « le monde à rebégayer » de Celan ou le bégaiement de Luca ne disent pas autre chose et ne sont sans doute que des « balbutiements maîtrisés » de la quête d’un sens ou de « l’ab-sens », « la part maudite », mal dite ou toujours à dire, de la fureur d’écrire de ces suppliciés du langage.
Langue rêvée
41Toucher ainsi à la langue, c’est faire un saut dans l’inconnu. Avec Michel Fardoulis-Lagrange, qui conduisit la langue française vers d’autres rivages, inconnus, « aux abords des îles déshéritées ou fortunées », écrire est aussi refaire le monde, et non l’imiter. Lui aussi fut en inquiétude du langage et sans demeure, son questionnement vacillant entre poésie et philosophie, ébloui par des « évidences occultes » dont l’énigme est préservée, voué à l’inachèvement dans sa quête du mot inouï : « Il existe un mot dont le mûrissement est toujours retardé et qui rend l’humanité bègue39 », écrit-il dans Le Grand Objet extérieur. Fardoulis-Lagrange s’engagea sur « un chemin oublieux », intemporel, en « inconnu majeur » dont la parole, sans affinité avec ses contemporains et sans filiation, hors des cadres conventionnels, demeure inactuelle dans une époque vouée aux faux-semblants du bavardage et au vacarme de la communication ; et quand, par emphase, le langage se prend pour idéal, il sombre en « une perpétuelle fuite dans l’éloquence40 », rendu de plus en plus labile par l’obligation d’utilité faite au sens, le besoin maladif et insipide de se rassurer et de remplir le monde de significations vite consommables. « Supérieur inconnu » donc, que seuls des esprits aussi perspicaces que Georges Bataille, Michel Leiris, Paul Éluard, Jean Paulhan, Max Jacob ou Georges Henein ont reconnu comme l’initiateur d’épiphanies inédites, remarquables par l’ampleur du verbe et leur mystère intact. Voici comment il s’est décrit lui-même pour se plier à une présentation de soi dans un dictionnaire : « Né durant l’année des inondations, il n’a jamais su pour autant naviguer ; il se considère comme un naufragé ayant une chance de se perpétuer. Adulte, il s’est vu exclu de son temps, de son groupe dont il n’a d’ailleurs pas vraiment fait partie. Étranger aux choses, abstrait dans ses relations, il a l’existence incertaine. […] L’âge ne lui a rien apporté de plus que le réseau énigmatique des mots41 »
42Écrire est refaire le monde, mais ce monde, né de l’éclatement voilé du monde rationnel, de la perte de toute vérité transcendantale, demeure insaisissable, mouvant, instable : l’homme est toujours aux prises avec la réalité infinie qui le déborde, au même titre que la langue ou le rêve. Néanmoins, incarnant tout ensemble le sphinx et la sibylle, Fardoulis-Lagrange élargit les dimensions du quotidien et ouvre les circonstances temporelles et spatiales à celles du mythe, à la recherche d’un langage tenant en même temps du rêve et de la réalité – étant, comme Salah Stétié aura pu le dire de Rimbaud, « entièrement dans le rêve et [...] entièrement dans la langue42 ». Plongé dans les vertiges et les apories de ce texte inconnu, entre mémoire et oubli, engagé dans le labyrinthe de terra incognita, il fait parler la nuit poétique du langage sous le soleil du Grand Midi, renouant avec toute la mythologie, tragique et solaire, de ses grands Ancêtres Grecs – un atavisme puissant, bien au-delà de la tribu familiale, qui ne cessera de le guider, sous l’emprise d’une cosmogonie peuplée de gestes ordinaires et de hauts faits. C’est ainsi qu’il se situe « nulle part », semblant appartenir à d’autres cieux, en route vers les contrées futures de l’esprit, happé par les vertus de l’oubli et aimanté par le pays rêvé des Hyperboréens. Le « je » disparaît alors dans une voix anonyme qui retrouve l’impersonnalité du chœur de la tragédie grecque. Et si Fardoulis ne cesse d’interroger les arcanes de l’enfance, s’il en appelle au prestige de l’enfant dont la figure est centrale dans son œuvre, double de l’auteur et symbole du recommencement, il se souvient moins de sa propre enfance que de l’enfance du monde. Rien n’est plus opposé à la rédemption personnelle de Proust par la mémoire que l’enfance immobile de Memorabilia, affiliée aux temps primordiaux et à la lumière blanche du dehors, ou « l’enfant joueur » de Théodicée, enfant dieu qui recoupe Hermès, Apollon et Dionysos. Le texte n’est pas une mémoire, dont l’auteur a pu dire qu’elle appartenait à la culture et à la philosophie, mais une nouvelle naissance, étreignant les cordes sensibles de l’existence et dont le langage est ancré dans le présent – « ce temps qui ne vieillit pas » –, un dévoilement auquel préside cet « art divin, l’oubli ». Ramenant la pensée aux deux sources fondamentales du jour et de la nuit, par quoi il s’apparente à Hölderlin, Fardoulis-Lagrange affirme ainsi que la plus haute exigence de la pensée est de se dissoudre elle-même, en se portant au dehors, dans l’impensable, vers « l’originel », éliminant la conscience au profit de la lumière ou des ténèbres.
43Il ne se tient nulle part, ne s’installe nulle part, comme le langage ne se laisse détenir nulle part. Le texte, en s’offrant à tout instant des perspectives fuyantes, est le théâtre d’infinies métamorphoses, scandées avec une frénésie baroque qui rappelle celle des Chants de Maldoror, en particulier dans les premiers livres, que surplombe la figure tutélaire de Lautréamont. Dès lors, métaphores, analogies et symboles, tous métamorphoses du Même, établissent des passerelles et ravivent l’interrogation et la même passion de l’infini. Et si les images s’apparentent parfois au surréalisme, Fardoulis-Lagrange n’écrit pas sous la dictée du langage, mais cherche, sans maîtriser son objet, ce que le langage a à lui dire. Ainsi, sans pratiquer l’écriture automatique, il prend garde aussi de ne pas sombrer dans le système d’un symbolisme allégorique. Tissée dans une prose secrète et complexe, sans égards pour les contrats de lisibilité ordinaire, son écriture labyrinthique et en ébullition déroute et nous laisse dans le clair-obscur de l’extase, face à l’énigme irrésolue du texte. Par une alchimie unique, cette obscurité de l’écrit interroge celle de l’être, reflet incarné dans la langue, figure instable de l’inconnu. Il faut affirmer que la langue française tient là un de ses stylistes les plus extraordinaires, bien qu’il se soit toujours défié de tout lyrisme et des images faciles, réécrivant jusqu’à 80 fois la même page. Prose hors norme dont l’arborescence occulte n’est sûrement pas sans rapport avec les origines grecques de Fardoulis ; au passage, il ravive d’ailleurs le substrat de langue grecque du français : « syzygie », « péan », « hiérophante », « palinodie », « corybante », « gymnopédie », « coryphée », « thrène », « satrapie », « empyrée », « psychopompe », « héliaque », « pélagique », etc. Cependant, l’avènement de cette parole se défie de la religion de l’art et de l’ivresse des mots ; à la volonté de puissance par les mots, le « verbe divin », s’oppose donc une Volonté d’impuissance, car le langage reste énigmatique, en proie à un manque dans les réponses tronquées de l’écriture. Néanmoins, Fardoulis-Lagrange s’en remet à cet inachèvement et mise tout sur les ressources de l’imagination poétique et du mythe. Au final, il apparaît bien que le véritable secret, c’est celui de la langue elle-même, qui demeure le Grand Objet extérieur, ce qu’il nomme « le mythe du langage », tout se disant au-delà des mots, dans les failles du langage, dont nous ne sommes que des intermédiaires, traversés et transportés par lui. Mais chez Fardoulis-Lagrange, ce n’est pas « le mythe qui se greffe sur le langage43 », mais le langage qui crée le mythe, par la magie de l’écriture, élargissant le regard grâce aux pouvoirs infinis de l’imagination. Incarnant toujours l’oracle de Delphes, en attente de quelque chose qui ne vient pas mais ne cesse d’être appelé, « en avant », qui ne se montre pas ni ne se cache, mais fait signe, l’œuvre de Fardoulis, demeure ouverte, inachevée, et incarne ce sans issue de l’aporie, selon lequel le fait esthétique est peut-être, comme l’écrit Borges, « cette imminence d’une révélation, qui ne se produit pas44 ». Dans cette quête, Fardoulis-Lagrange s’est emparé de la langue française pour la livrer nue aux rivages des origines ou de l’incréé, à la « mémoire blanche » du non-vécu, engouffrant son œuvre dans un fracassant silence, celui des horizons ouverts de l’utopie, « cette seconde instance du présent45 ». Son texte ne décrit pas une extase, mais est lui-même extase, comme une langue rêvée. Pas de hauts faits, sinon ceux du langage, affiliés au vent salubre du dehors : « Limbes et destinées seraient réunis en profondeur sous la calligraphie de signes à la surface des sables, texte exhaustif inspiré par l’esprit des vents46. »
***
44Si le xixe siècle a été celui du sacre de l’écrivain, le xxe siècle aura été celui de ses doutes et de son sacrifice, la littérature ayant souvent plaidé coupable, car dans sa visée de l’impossible, elle ne cherche pas à communiquer, à peine y voir plus clair ; mais, sans prétendre changer le monde ni refaire la vie, écrire consiste à vivre, survivre, tenter de donner quelque sens, incertain, à sa vie, la flécher : tenter un pas au-delà. Ce n’est pas non plus reconnaître son appartenance à une langue, ni à un ordre, esthétique ou politique, mais (s’) inventer, l’une par l’autre, une voix et une vie. On écrit pour « être ». Ainsi, Louis-René des Forêts, à qui s’imposait la nécessité de « dire et redire encore », « n’aura fait usage de la parole que pour se construire un monde vivable : qu’elle disparaisse et celui-ci cesse aussitôt de l’être47 ». Comme si, malgré tout, pour l’auteur du Bavard, qui semble parler en se taisant, l’ostinato irrépressible du langage l’emportait sur le sacrifice des mots. Pas à pas jusqu’au dernier, c’est en vertu de cette invention d’une voix singulière, venue d’ailleurs et inachevée, qu’en touchant au langage, la littérature sort de la littérature et que l’écrivain n’est pas un littérateur, mais écrit une langue et est écrit par elle. La langue est sa demeure, à lui, l’écrivain de nulle part, langue elle-même sans demeure, qu’il affecte, touche, au sens physique du terme, afin de bouleverser la vie et tenter de donner quelque forme aux figures du pensable et de l’informulé.
45Cependant, l’affranchissement est infini, et la mise en garde de Georges Bataille tranchante, car l’expérience de vie et l’artifice de l’art sont inséparables, de même que l’on n’échappe pas au langage : « Je ne puis regarder comme libre un être n’ayant pas le désir de trancher en lui les liens du langage. Il ne s’ensuit pas, cependant, qu’il suffise un instant d’échapper à l’empire des mots pour avoir poussé le plus loin que nous pouvons le souci de ne subordonner à rien ce que nous sommes48. » Telle est, dans cette irruption du langage hors de ses gonds, la situation intenable de l’écrivain, obligé de parler ou de mourir, contraint d’altérer une langue dont il sent confusément les limites, mais dont il pense aussi qu’elle est son unique brûlot et le seul réceptacle d’une vie non asservie, sa planche de salut autant que sa caisse de résonance. Engagée sur ces lignes de fuite de la liberté, aimantée vers un point d’être à l’horizon, abolissant territoires et frontières, la langue apparaît alors comme une recréature et l’instrument d’une recréation, autant qu’une machine contre le temps et la mort. Par son déploiement, dans le sillage des chemins qu’elle trace, des voix ou lueurs qu’elle allume, il s’agit encore et toujours de donner sens à l’aberration de la vie, poursuivre le point de fuite, aventureux, de sa liberté encore inconnue. Cet appel au-dehors, qui nous rappelle à quel point nous sommes partagés entre l’espace du dedans et l’espace du dehors, entre le propre et l’étranger, prend corps et langue dans cet au-delà de la langue, outre-langue, parole à la fois créée, créatrice et recréée. À la fin, sans que l’on puisse déterminer si le langage est la « maison de l’être » ou l’être « la maison du langage », demeure l’injonction de Hölderlin, ce sans-patrie rêvant d’une communauté ouverte, dont le retirement final, dans la solitude de sa tour, se partage entre extase et naufrage des mots, dans l’abîme d’une langue venue d’ailleurs, mots ruinés d’un balbutiement idiomatique, mélange d’allemand, de grec, d’italien et de français : « Mais ce qui nous est propre, il faut l’apprendre tout comme ce qui nous est étranger […] car, répétons-le, le plus difficile, c’est le libre usage de ce qui nous est propre49. » Injonction dont l’exigence devrait nous saisir en nos temps de nihilisme triomphant, cynique ou désenchanté, et de replis identitaires, car pas plus que la langue, la communauté n’est une essence ou une propriété, elle est à faire, à personne, de personne, comme don ou dette, inachevée, dans une ouverture et coexistence aux autres qui nous rappellent à notre propre étrangeté et altérité. Face aux multiples fausses promesses de libération, comme au-delà de toutes les barricades de l’horizon humain, c’est du cœur de cet obscur partage entre le propre et l’étranger, le proche et le lointain, le familier et l’étrange, que se trament d’infinis passages et mystérieux échanges, susceptibles de rouvrir le champ des possibles. Et nul doute que la langue, quand elle est embrasée par la passion de l’infini et le refus d’un « monde en cage », nous permet d’interroger ce qui nous lie et en même temps dévoile la vertigineuse distance qui nous sépare et se creuse au fond de notre propre énigme.