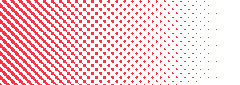« Fières identités ferrant l’immortelle égocentricité, les langues nous langent de nous et nous bercent des seuls sons qui nous résonnent, les langues nous miroitent ». (Il n’y a plus de pays, Vents d’ailleurs,2012)
Jean-Luc Raharimanana, http://www.caravanedesdixmots.com/accueil/contributions/points-de-vue/de-lorigine-des-langues-et-de-la-lemurie-en-particulier-jean-luc-raharimanana, consulté le 23 juillet 2013.
Jean-Luc Raharimanana est né il y a un peu plus de quarante ans à Antananarivo, la capitale de Madagascar, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Il a enseigné, avant de s’engager résolument par l’écriture : récits, théâtre, poèmes. Son roman Za, paru aux éditions Philippe Rey en 2008, est particulièrement remarquable du fait de son expérimentation linguistique. Le texte donne à entendre les « excuses et dires liminaires » de Za, qui se déversent avec la même force que celle du « fleuve de cellophane » qui a emporté le corps de son enfant : son quasi-monologue intérieur charrie détritus et immondices – parmi des éclats de rire. Cette image de la dérive est grosse d’une dénonciation des tortures et des corruptions opérées dans un lieu qui ne sera pas nommé mais qu’on peut identifier comme Madagascar ou plus largement comme un site de violence contemporaine, malheureusement vastement répandue. Placée dans la bouche de Za, « la langue » n’est pas seulement un medium, l’instrument d’une expression : c’est une matière, un corps travaillé du dedans et qui n’en ressort par indemne. De même que les « zébus sans peau » rencontrés dans le livre, « la langue » a perdu sa membrane protectrice – et les instances d’énonciation semblent elles-mêmes privées de leurs contours familiers de « sujets ». La question, dès lors, n’est plus de savoir si ce roman est écrit en français mais plus radicalement si le français existe encore… et ce que nous avons à gagner à transformer notre imaginaire de « la langue ». Mieux que toute introduction, le préambule du roman donne le « la » (ou faudrait-il dire le « Za » ?) :
« Excuses et dires liminaires de Za » :
« Eskuza-moi. Za m’eskuse. À vous déranzément n’est pas mon vouloir, défouloir de zens malaizés, mélanzés dans la tête, mélanzés dans la mélasse démoniacale et folique. Eskuza-moi. Za m’eskuse. Si ma parole à vous de travers danse vertize nauzéabond, tango maloya, zouk collé serré, zetez-la s’al vous plaît, zetez-la ma pérole, évidez-la de ses tripes, cœur, bile et rancœur, zetez-la ma parole mais ne zetez pas ma personne, triste parsonne des tristes trop piqués, triste parsone des à fric à bingo, bongo, grotesque elfade qui s’égaie dans les congolaises, longue langue foursue sur les mangues mûres de la vie. Eskuza-moi. Za m’eskuse. »
Aux sources de l’écriture de Za
1J’aimerais commencer par évoquer le moment où la langue de Za s’est imposée dans mon écriture. Je sortais d’une expérience très pénible, c’est à dire l’arrestation et la torture de mon père en 2002 suite aux événements qui ont suivi les élections présidentielles de 2001. Je ne reconnaissais plus la voix de mon père, il avait été torturé au niveau de la bouche. On lui avait enfoncé le viseur de l’arme dans la bouche et avec ça, ses tortureurs lui ont ravagé les dents et le palais. Le lendemain, nous avons réussi à l’arracher de là où il était, je l’ai eu au téléphone, je reconnaissais juste le timbre de sa voix mais son débit était tellement lent, ses mots tellement torturés. Et puis le père s’est mis à rassurer le fils, qu’il allait très bien, il m’a appelé par mon surnom d’enfant « tête dure » et il s’est mis à rire ! Un rire intact. Un rire qui lui ressemblait tellement. Tant de liberté et de foi en ses actes ! J’ai revécu sa vie dans ce seul rire, tout ce qu’il avait traversé, son enfance orpheline et errante, ses combats politiques, ses multiples arrestations, la situation du pays sur le moment – Madagascar était pratiquement en guerre civile. J’étais rassuré, je me suis occupé de choses urgentes. Mais quelques jours plus tard, les militaires ont brûlé notre maison et ont fait un autodafé de la bibliothèque de mon père, ils ont mis les livres au milieu de la cour, les ont arrosés d’essence et mis le feu. Quand mon père l’a su – deviné, des mois plus tard, juste avant son procès, il m’a dit : « ce n’est pas grave mon fils, nous allons recommencer, continuer à écrire et à parler ». C’est là qu’il faut chercher l’origine de la langue de Za. Dans ce rire intact, et dans ce feu qui a ravagé les livres. Et dans cette autodérision contre la torture. La torture est une créature impuissante en réalité, la lâcheté parfaite, qui veut vous rabaisser à son niveau. Souvent elle y arrive, à rendre sa victime aussi lâche qu’elle, mais au fond, personne n’est dupe de sa nature. Face à elle, le rire devient naturel. J’ai ri. J’ai beaucoup ri pendant cette période. Ce rire m’a porté jusqu’à l’écriture de Za.
Généalogies textuelles
2Le personnage de Za apparaît dans une petite pièce de théâtre écrite peu de temps après, une farce plus exactement, Barrages, inédit jusqu’à maintenant. C’est une commande d’écriture du metteur en scène Raphaël Simonet, du Théâtre du Lac (Annecy) : s’inspirer d’une farce du Moyen-Âge pour dire nos farces d’aujourd’hui. C’est une petite compagnie qui fait de petites choses intéressantes. J’ai écrit la pièce. Robin Frédéric, du théâtre des Bambous, à Saint Benoît, La Réunion s’est emparé de la mise en scène. Le personnage apparaît vers la fin de la pièce. J’ai retravaillé l’ancien français, forgé le texte à la limite de la faute grammaticale, puis ai commencé à faire zozoter le personnage, ça fonctionnait. Mais il me manquait son rire. Za gémissait, faisait pitié mais il n’était pas ce rire intact que je cherchais. J’ai laissé la farce en l’état et j’ai essayé de passer à autre chose, mais je n’y suis pas arrivé. C’est là qu’une autre proposition était venue, une proposition de Kangni Alem, d’écrire sur le « Huitième péché ». J’ai écrit les « Excuses et dires liminaires de Za » qui constituent le préambule du roman. En réalité, je n’avais rien à faire du thème du huitième péché mais la proposition avait le mérite de me pousser à aller au bout du projet.
La question de « la langue », une piste fausse et potentiellement dangereuse
3Avec Za, je n’avais plus rien à faire non plus du beau français. Ce n’était pas une révolte contre la langue française ou contre la colonisation, ou contre tout ce que vous voulez d’oppression d’une langue dominante, etc., c’était juste une émancipation d’un auteur sur la notion de belle écriture. À la limite, la langue n’avait pas d’importance, que ce soit du français, ou du chinois, ce n’était pas contre une langue précise, c’était juste l’affaire d’un poète avec la matière dont il dispose. Il se trouve que ma matière, c’est le français, et à côté, un burin, le malagasy. Écrire ce roman, c’est comme s’atteler à la sculpture sur pierre. La pierre, c’est la langue française, toute la langue française, de l’ancien français au français classique, du français classique à l’argot. Le burin et le marteau, c’est le malagasy. J’acceptais les imperfections quand le geste du tailleur devenait moins précis, quand d’autres coups découvraient des failles ou des aspérités. Parfois je polissais, parfois je caressais, mais pendant tout ce temps, je riais. Mais il ne fallait pas non plus que je reproduise dans le français le « beau malagasy », car le malagasy peut être d’un très grand raffinement d’écriture, notamment par le biais du kabary et du hainteny.
4La langue de Za n’est pas non plus une langue en traduction, car je ne suis pas parti du malagasy ni d’aucune autre langue pour traduire en français. Je suis bel et bien parti du français, mais j’ai placé ce français sous d’autres cultures. Je l’ai façonnée sous d’autres références, polie sous d’autres rythmes, sous d’autres systèmes de ponctuation, sous d’autres imaginaires. Je suis d’accord avec Xavier Garnier quand il parle d’un écart de la langue elle-même1. La langue comme l’identité ne sont que des constructions de l’histoire. Mais l’homme est prêt à massacrer son voisin et semblable pour simplement dire passe-moi le sel dans sa propre langue. Je simplifie bien sûr, mais je ne suis pas sûr que j’aie tort…
5Je voulais créer une langue dont les frontières sont impossibles à fixer, une langue qui échappe à une définition, une langue tellement libre qu’elle peut butiner dans toute culture, dans toute identité…
Intertextualités malgaches
6Pour cela, il me fallait ce rire qui défie les tortures et les laideurs, il me fallait replonger dans cette sorte d’innocence et de candeur qui précède l’acquisition de la langue, de détourner donc, à la manière des mots d’enfants, les expressions toutes faites, les formules classiques, jouer entre le sens littéral et le sens figuré, jouer entre le convenu et l’original, flirter avec la faute d’expression… J’ai repris alors le sôva, un autre genre de la poésie orale malagasy. Cela tombait très bien car c’est un genre prisé des Tsimihety, l’ethnie de mon père. Et j’avais aussi l’habitude d’entendre cette manière de parler car les Tsimihety sont des parents par plaisanteries des Betsirebaka (mots pour désigner l’ensemble des gens du Sud-Est). Mon père a beaucoup côtoyé les Antandroy, les Antemoro, les Antesaka… et enfant, j’étais toujours abasourdi de voir qu’avant d’engager la conversation, ils avaient toujours ces préliminaires de plaisanteries et d’insultes. Au moment où je croyais qu’ils allaient se battre, ils riaient d’un coup, redevenaient tout à fait normaux et discutaient de choses bien plus graves… Le sôva rentre dans ce cadre, c’est un genre de poésie par l’absurde, par l’insulte. Le mpisova, assisté d’un chœur de femme, doit donner l’air ivre, ou fou, et se moquer de tout et de tous, se moquer du chien qui tire la langue sans avoir soif comme se moquer du roi qui veut rivaliser avec les habits du caméléon… un regard libre des codes du langage et du consensus du signifié, une parole qui part d’une observation minutieuse et crue des choses pour déraper dans la dérision.
7Pour le chapitre d’introduction, « Excuses et dires liminaires de Za », j’ai suivi scrupuleusement la structure du kabary traditionnel, c’est un genre très codé qui ne supporte aucun écart, mais j’ai introduit à l’intérieur l’insolence du sôva. Comme tout kabary, j’ai commencé par les excuses, car il y a toujours un aîné qui mérite mieux que vous de prendre la parole, car il y a toujours un ancêtre qui porte mieux que les aînés la parole, c’est le tsiny qui accompagne tout être humain, tout acte est susceptible de faire du tort ; agir, c’est forcément changer le cours des choses, ce qui ne manquerait pas de bouleverser ce qui existe déjà, il convient alors de s’excuser, de dire que ce n’est pas pour déranger le destin, mais pour mieux se conformer aux désirs de tous. J’ai continué en citant les personnes ou catégories de personnes qui méritent mieux que le narrateur à porter cette parole, etc. mais à la fin, c’est juste pour dire « Za vous emmerde », en empruntant le sillon creusé par Aimé Césaire : « Nègre vous m’appelez, et bien oui, nègre je suis. N’allez pas le répéter mais le nègre vous emmerde », c’est une parole libre et qui s’assume comme telle.
Quelques procédés d’écriture
8Je ne m’interdisais rien. De l’indécent à la poésie. De la grossièreté au raffinement. Des truismes à la philosophie. Je sortais des jeux de mots débiles à côté d’autres plus recherchés. Le travail sur brouillon a été monumental, j’écrivais sans m’arrêter avant de faire un travail d’élimination jubilatoire. À la fin, je ne maîtrisais plus rien, je ne pouvais plus m’arrêter car la langue a débordé le cadre de l’écriture ; d’où ces épilogues avortées ou ces chapitres jetés en vrac à la fin du roman. La langue de Za est carrément devenue ma langue quotidienne, même quand je n’écrivais pas. C’était assez facile, il suffisait d’oublier l’apprentissage du français et de me remettre dans ma peau d’enfant qui ne savait pas prononcer les chuintants, car en malagasy, à part quelques particularités régionales, les chuintants n’existent pas. C’est juste une position de la mâchoire à adopter. Il suffisait d’oublier le « bon usage » et de se permettre de dire « n’importe quoi » comme avoir la tête en l’air bizarre…
9Je m’étais seulement posé trois consignes majeures, à la manière des oulipiens : 1. remplacer « Je » par « Za », 2. conjuguer les verbes du sujet « za » à la troisième personne, sauf pour les verbes pronominaux, à mettre à la première personne, 3. remplacer tous les chuintants par le zozotement, et s’il fallait gommer le zozotement, écrire plutôt les passages en éliminant les chuintants comme c’est le cas du chapitre 8 bis.
Remplacer « Je » par « Za », implications
10Dans le bon usage du malagasy, le pronom de première personne du singulier se dit « izaho »2. On peut être tenté de voir dans la troncation de « izaho » en « za » une identité inachevée, ou une nature de personnage ne pouvant pas accéder à la totalité du Moi, mais aujourd’hui, la prononciation « za » est passée dans l’usage courant et ne renvoie plus à une prononciation d’enfant à l’identité encore inachevée ou à un usage argotique et familier. On doit écrire bien sur izaho pour respecter l’orthographe, mais majoritairement aujourd’hui, on prononce « za ». C’est la graphie « za » qui peut choquer et non la prononciation.
11L’ellipse du sujet est courante dans la syntaxe malagasy, il arrive fréquemment que le sujet ne soit pas présent dans la phrase, et plus encore le pronom « izaho », plus proche du moi que du je, la syntaxe a tendance à préférer l’autre pronom de la première personne « aho » qui doit être placé après le verbe (généralement, le sujet est placé après le verbe dans la syntaxe malagasy). Or « izaho » demande à être placé devant le verbe et met donc en avant le sujet parlant, la phrase devient précieuse, sinon hautaine. La troncation de izaho saborde cet aspect précieux et familiarise bien plus la phrase, le procédé devient ainsi un acte de parole qui va à l’encontre du bon usage, de la culture dominante. Commencer sa phrase par « za » n’est pas l’expression d’une identité incomplète, au contraire, c’est l’affirmation d’une identité hautement contestataire, ce n’est pas pour rien que za « vous emmerde » ! Le personnage affirme ici son identité et l’assume.
12Si l’ellipse du sujet, et notamment du « je », est la marque du raffinement dans la pratique écrite et orale du malagasy, l’utilisation systématique de la forme tronquée « za » peut être interprétée comme un signe d’individualisme ou de mauvaise éducation, c’est revendiquer une identité individuelle au détriment de l’identité collective. Car oui, dans la langue malagasy, le « nous », isika, passe mieux que le « je », izaho, alors adopter en plus la graphie « za », c’est exacerber encore plus l’individualisme. Le personnage de Za se place ainsi en marge de la collectivité. Cela ne veut pas dire que son identité est tronquée. Au contraire, tout le roman est un hymne à sa force et à sa résilience, il ne faut pas confondre classe sociale et identité, ce n’est pas parce que vous appartenez à une classe sociale qui n’impose pas son identité que vous en manquez. Mais je concède que l’utilisation de « za » est largement majoritaire chez les jeunes et les enfants, chez les pauvres et les classes défavorisées, c’est à dire un groupe d’âge et une catégorie de personnes qui ont besoin d’affirmer leurs identités, qui peuvent donner l’impression de ne pas détenir une identité totale. Mais ce n’est pas le cas de notre personnage. Mais bon, ce n’est que l’avis de la personne qui a écrit ce livre… Il paraît que l’auteur est souvent dépassé par son texte, c’est peut-être le cas ici non ?
Interroger la réception et la posture critique dite « postcoloniale »
13Le lecteur francophone corrigera bien sûr automatiquement la phrase « Za m’excuse » en « Je m’excuse ». J’en suis parfaitement conscient et c’est voulu, pour que le lecteur francophone adopte « za » comme première personne du singulier, c’est la même chose pour « za m’assois », « za m’en fous », tous les verbes pronominaux… pour que ce lecteur intègre l’idée que za, c’est je, ce que le lecteur malgachophone fera sans même y penser, mais ce dernier n’aura pas une lecture schizophrénique, contrairement au lecteur francophone à qui cela risque d’arriver. Je voulais m’amuser voyez-vous à inverser les rôles. On dit souvent que les auteurs francophones que nous sommes, entre deux langues, entre deux cultures ont une lecture schizophrénique du monde. En brouillant la désignation du pronom personnel (za est-il un je ou un il ?), je voulais rendre possible dans la tête du lecteur le fait que les langues s’interpénètrent, que le français peut vivre avec d’autres références, peut porter d’autres identités, que vivre deux identités est possible sans que ce soit de l’ordre de la folie. La langue ne coïncide pas seulement avec une identité unique. C’est le péché mignon de la critique française sur la littérature africaine d’expression française : toujours croire que l’auteur africain est en quête de son identité, marqué qu’il est par la colonisation et l’aliénation qui s’ensuivit, marqué qu’il est par l’opposition de la modernité et de la traditions, par la perte des us et coutumes, la postcolonie difficile…
14Sûrement, à une étape de mon écriture, je la cherchais cette identité, mais je crois que ce serait à se pendre si au bout d’une vingtaine d’œuvres je ne l’aurai toujours pas trouvée… Za n’est absolument pas le roman d’une quête d’identité.
15Bref, montrer que parler et écrire le français ne signifie pas adopter l’identité française.
« La langue », fondamentalement métamorphique et en mouvement perpétuel
16Je ne voulais absolument pas faire du petit nègre, ni faire croire que les Malagasy parlent le français de cette manière. On ne peut pas parler de quête du vraisemblable ou de performance mimétique car je n’ai pas voulu rendre ni mimer une langue existante. La langue de Za n’existe pas dans la réalité, contrairement à la langue parlée par les enfants soldats par exemple.C’est une langue parlée par le seul narrateur du livre – d’ailleurs, il n’y a que le personnage de Za qui parle comme cela, les autres s’expriment « normalement », c’est à dire selon les normes admises du français – et accessoirement par l’auteur et le lecteur. Car l’écriture et la lecture de cette langue vous obligent bien sûr à la parler. Ainsi, j’amène à reconsidérer l’idée que la langue est immuable, la langue n’est que la vérité du présent, elle change sans cesse. C’est cela la première caractéristique de la langue de Za : faire comprendre qu’une langue est sans cesse en mouvement, que les règles ne sont que conventions. Certaines règles durent plus que d’autres, la grammaire par exemple, d’autres sont plus souples, plus qu’on ne le croit, comme la construction des mots ou la syntaxe.
17Za est dans une construction/déconstruction permanente. Lui-même se moque de sa propre langue, il sait très bien que sa langue, éphémère, n’est parlée que par lui-même, qu’après lui, cette langue n’existera pas, ne sera donc pas institutionnalisée. Il n’est pas dans une démarche d’intégrer ou d’établir une institution, il ne veut pas faire partie de ce monde. Pour lui, il n’y a pas de défaite à ce niveau, au contraire, il est libre. Sa victoire, c’est d’être hors de l’institution. Sa seule défaite, c’est de ne pas mourir et retrouver ainsi son fils mort. A la fin du roman d’ailleurs, rien ne le fait bouger, ni les chars ni les balles des immolards et autres militaires. Comme Solibo Magnifique de Chamoiseau, son corps pèse des tonnes. Comme les insurgés malgaches en 1947, les balles coulent sur sa peau, comme de l’eau…
18Parfois, on me demande la source originaire de la langue de Za, mais qu’est-ce qu’une source originaire ? Quel peuple au monde peut se targuer d’avoir une source originaire ? Qu’est-ce qu’un sujet plein et entier ? La source de la sagesse, la source de l’identité, le rêve de l’Un et de l’Unique… À quel moment de sa vie le sujet peut-il être plein et entier ? Est-ce bien possible ? Quête de la Plénitude… Moi, je suis de ceux qui pensent que nous êtres humains ne pouvons pas accéder à la plénitude, nous rêvons de nous en approcher, mais jusqu’à notre mort, nous ne serions jamais pleins sinon nous serions des dieux… ou bouddha. C’est bien pour cela que l’humanité a créé les dieux non ? L’utopie dans toute sa splendeur…
19La plupart des sociétés ont juste érigé la réussite ou l’accession au pouvoir comme équivalentes à la plénitude, c’est une convention, tout comme on dit que le bonheur équivaut à la plénitude, et Za sait très bien qu’être plein ou entier est éphémère sinon illusoire, lui qui a perdu son enfant, l’enfant comme on dit en malagasy, silak’aina, un éclat de vie, une part de nos vies… Si Za n’est pas un être entier, ce n’est pas parce qu’il n’est pas reconnu par la société mais bien parce qu’il a perdu son enfant…
De « la langue » à la voix – de l’oralité à l’écriture
20Le zozotement, par le biais de la compréhension sonore déplaçait aussi la signification, et j’allais dans ce sens, c’est à dire que je prenais la liberté d’amener le sens par le son tout en gardant la signification originelle, il est alors possible de comprendre le texte de deux manières, quand vous restez sur la graphie, et quand vous vous laissez entrainer par le son, comme c’est le cas par exemple de la phrase : « Za suçote » pour Je chuchote. C’est un texte qui demande la lecture à haute voix. La complicité avec le lecteur qui accepte ce jeu devient alors réellement jubilatoire, le rire peut surgir à tout instant.
21Ainsi, il y a eu une période du brouillon où le personnage ne zozotait pas, où sa langue revenait dans la norme, mais c’était l’auteur qui avait peur à ce moment là, le personnage exigeait tout le long cette langue. À partir du moment où j’ai accepté cela, c’était très facile d’écrire ce livre car la langue de Za allait de soi, c’était comme si j’avais juste à parler. Mais ce n’est pas une langue simplement orale, elle est très écrite, très travaillée. Ce n’est pas du français « pourri »3, elle n’est pas issue de la méconnaissance de la langue française, au contraire il fallait parfaitement maîtriser le français pour s’en écarter et rester compréhensible pour tout francophone, peut-être que l’adjectif est à chercher là ? C’est une langue francophone, au sens strict du mot francophone, sans les références politiques et idéologique, d’expression française…
22J’ai travaillé et retravaillé le texte pour que cette langue soit la plus musicale possible, Za n’est pas un roman d’improvisation ou de débit langagier spontané, il y a un travail d’écriture et de cisèlement important pour que les mots se prêtent à la voix. Je ne visais pas forcément l’idée qu’un texte africain soit près de l’oralité, non, je voulais faire en sorte de rendre à la langue française sa part d’oralité, rendre à la langue française sa part de musicalité. C’est toujours la question de l’artiste face à sa matière, je voulais faire sonner la langue, la langue est mon instrument de musique. Je savais en finissant le manuscrit que les musiciens et les théâtreux allaient comprendre mon texte bien plus vite que d’autres lecteurs, ça n’a pas loupé bien sûr, un des premiers lecteurs du manuscrit, Thierry Bedard, metteur en scène, a voulu faire venir de Madagascar un groupe d’une dizaine de musiciens pour adapter le livre à la scène. Il n’a pas pu le faire dans cette forme là, je crois que ça restera comme un léger regret au fond de lui…
Retour sur le personnage de Za, par-delà le vraisemblable
23Mis à part sa particularité linguistique, Za n’est pas un personnage qui sort de nulle part ou seulement de ma créativité, je me suis directement inspiré du personnage de Ratsiafabahiny, personnage de conte betsileo que Lucien Xavier Michel Andrianarahinjaka a analysé magistralement dans son œuvre « Le système littéraire betsileo » (Editions Ambozontany, 1987). Ratsiafabahiny est une longue épopée qui raconte l’histoire d’un homme qui après une grande défaite à la guerre se promène nu de royaume en royaume, la vue de sa nudité provoquant alors la remise en cause des systèmes de pouvoir, les idéologies en place, les mémoires tues… Certaines versions des contes de Zatovo reprennent ce motif de la nudité exhibée. J’ai fondu les deux personnages en un seul que j’ai renommé Ratovoantanitsitonjanahary. Zatovo (ou Ratovo ou Ratovoana, etc) est un personnage que je travaille depuis longtemps, il est présent déjà dans certaines nouvelles de « Lucarne » et de « Rêves sous le linceul », présent dans « Nour, 1947z, je le reprends ici. C’est un personnage qui dit que personne ne l’a créé, ni dieu ni roi – on pourrait même emprunter la formule anarchiste ni dieu ni maître, il renie également la création de son père et de sa mère. Seulement, dans Za, je reprends une version proche de Ratsiafabahiny, un version qui porte sur sa rencontre avec une autre figure de conte une femme cette fois-ci, Isarotrolahy, renommée Soandzara dans mon roman, qui refuse d’épouser ses prétendants, seul Zatovo y parviendra. Malheureusement pour lui, ses rivaux vont le piéger et le blesser dans ses parties intimes, touchant toute sa virilité. Zatovo s’enfuit à l’insu de la femme et erre nu de par le monde, exhibant sa blessure qui ne se cicatrice jamais, refusant les soins. Sa femme va alors suivre sa trace pour le retrouver. De village en village, la vue de la blessure de Zatovo va réveiller les propres blessures des gens. C’est cette structure transversale que j’ai adoptée pour tout le roman. Za a vécu une déchéance, d’ancien instituteur, il vit dans la rue après avoir perdu son emploi, il a été torturé, il a une blessure à la jambe, son fils est mort, il refuse de le reconnaître et fuit sa femme qui le poursuit dans toute la ville. Za marche sans cesse, va de quartier en quartier et réveille les blessures de toute l’île, jusqu’à arriver dans ce champ ouvert où les ancêtres se mêlent aux vivants, où les plaies du passé se confondent avec les plaies du présent, où les plaies du futur s’annoncent…
24Tout ça pour vous dire que la langue n’a pas engendré le personnage, le personnage était là déjà. Seule cette langue pouvait me permettre d’affronter cet absurde, me mener dans la transe et dans la vision hallucinatoire de Za. C’est son rire qui me permettait d’aller aussi loin. Les chants de Soandzara permettaient d’entrer dans cette résistance, sa quête sans relâche et la poésie qu’elle apportait donnait une ossature à la structure fragile du roman. Et dans tout cela, je pose toujours la même question, comment aimer dans une situation d’extrême misère, comment être homme ou femme dans un pays pauvre. Car souvent on a tendance à ne voir que les aspects « engagés » ou « politiques » de mes textes.