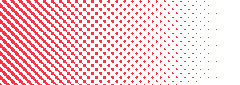Journal d’un poète : Les Calepins bleus, de Jean-Joseph Rabearivelo
1Hors de Madagascar, l’œuvre de Rabearivelo1n’a pas encore franchi le seuil de la notoriété d’une manière décisive.
2Né en 1903 à Tananarive, où il se suicida en 1937, c’est là que de son vivant furent publiés tous ses recueils de poèmes, à l’exception de Traduit de la nuit, édité à Tunis. Il fallut attendre 1967 pour que lui soit consacrée en France une anthologie. D’autres publications suivirent, mais il n’obtint pas l’espèce de consécration conférée par les « Poètes d’aujourd’hui », de Seghers, ou par Poésie/Gallimard.
3Le vent tourne, quand il n’est pas un alizé. Nous voici en possession de deux tomes de ses Œuvres complètes2.Les célèbres Calepins bleus constituent la partie essentielle du premier. Rabearivelo ayant détruit ses carnets antérieurs, ce journal d’un millier de pages ne couvre que les années 1933 à 1937. Longtemps prétendu impubliable, sous prétexte qu’il mettait en cause des personnages vivants, on n’en connaissait que la fin, en particulier les mots ultimes tracés sous l’empire du cyanure : « J’avale un peu de sucre. Je suffoque. Je vais m’étendre. » Paroles qui font penser aux dernières lignes du Métier de vivre de Cesare Pavese.
4On savait Rabearivelo exilé dans son propre pays. Les Calepins bleus nous renseignent sur la nature de cet exil et révèlent de plus nombreuses fêlures, ainsi qu’un prosateur que l’on ne soupçonnait pas.
5Les repères chronologiques annexés au volume nous le signalent enfant naturel d’une Hova (terme qu’il préférait à celui de Merina pour désigner l’ethnie dominante des hauts plateaux). Sa mère, par sa caste, était « apparentée à la plupart des notables de la capitale (cette ascendance avérée justifiera les constantes revendications d’aristocratie du poète) ». Dans « Un Coup d’œil sur le Passé de Madagascar », qu’il écrivit, et que Samuel Beckett traduisit, pour Negro, an Anthology, la compilation de Nancy Cunard3, il raconte qu’à Mananjary des familles de sang royal lui témoignèrent grande amabilité quand elles apprirent son appartenance aux andriana, c’est-à-dire aux nobles. Sans ses attaches aristocratiques, on comprendrait mal son goût pour l’Espagne qui l’entraîna à maîtriser l’espagnol au point de souvent le manier dans son Journal, à traduire Góngora, à se passionner pour Alfonso Reyes ; on s’expliquerait mal aussi les influences douteuses sous lesquelles il débuta en poésie.
6Celle, en premier lieu, de Pierre Camo, juriste et poète natif de Céret, en poste à Tananarive. Ce magistrat se satisfaisait d’écrire : « Au temps de mon premier voyage, / la coque du navire était peinte de blanc, / qui faisait un effet charmant / au milieu des autres navires au mouillage, / et mon cœur, gai comme un oiseau, / voguait légèrement sur l’eau. » Camo est l’écrivain dont le nom revient le plus souvent dans les Calepins bleus ; le second, c’est Baudelaire. Une querelle au moment où Camo va rentrer en France (celui-ci, méprisant la presse de Madagascar, a refusé que son ami écrive sur lui dans un journal de Tananarive) apporte au lecteur attentif une sorte de soulagement.
7Les Calepins bleus montrent en effet à quel point il était difficile à Rabearivelo de s’extirper du piège politique et littéraire où il se trouvait pris. Camo, un ancien de l’école naturiste qui préconisait « l’exaltation panthéiste de l’Homme dans la Nature », avait signé en 1921 avec, entre autres, Anna de Noailles, Fernand Mazade, le provençal Xavier de Magallon et Paul Valéry (que son biographe Michel Jarrety montre embarqué là par faiblesse), une anthologie, La Pléiade, dont la préface affirmait : « l’art seul étreint [la vérité] ». Les amis de Camo, en France, le comparaient, sur son île, à du Bellay au bord du Tibre, le décrivaient composant à Tananarive des vers aussi beaux que ceux de Ronsard. Il inculqua à Rabearivelo les mythes quelque peu défraîchis de la Pléiade originale. Parcourant « Jusqu’à l’aurore », on se demande si l’on vogue bien par 18° latitude sud (titre d’une revue fondée par Camo), tant il est curieux qu’évoquant l’Olive de Du Bellay, l’Hélène et la Marie de Ronsard, ainsi qu’Hermione et Athalie, Rabearivelo se réjouisse « d’étreindre en Iarive [nom poétique de Tananarive], / muses que la Muse couronne, / ces femmes d’un grand siècle et de la Renaissance... »
8Magallon était royaliste et antisémite. Camo de même, et Rabearivelo aussi, hélas, qui revendique en présence du Gouverneur général Cayla son appartenance à l’Action Française. À la différence d’une poignée d’étudiants malgaches de France, il s’y est rallié à Tananarive : « [J’] ai donné mon adhésion à Maurras et à Daudet [...] au nom de l’Esprit (qui ignore ou dédaigne la Lettre) et du Sang (qui se moque de la Couleur). Une adhésion morale, en somme. [...] Une nation forte ne l’est que par ses aristos et jamais par son demos. L’Esprit, le Sang. Rien qu’eux. Mais seulement quand l’un et l’autre se valent. » La Monarchie, pour Rabearivelo, « n’est pas un parti ». Cette certitude a le mérite de le dispenser d’agir. Son royalisme français, chimère aussi inoffensive que l’Atlantide méridionale, baptisée Lémurie, en laquelle on le surprend tenté de croire, l’aide à se complaire dans le rôle d’archange déchu. Transposé dans la lointaine colonie, où des rumeurs indépendantistes se font entendre, c’est le nord fallacieux d’un écrivain aussi hautain sur son île que déboussolé lorsqu’il regarde au-delà des mers.
9Impressionné par Mussolini, il observe un jeûne complet (« sauf un peu d’eau ») en faveur des Abyssins menacés par le Duce. Leur reprochant de n’avoir pas levé le petit doigt en faveur des Malgaches en 1895, il ne tarde pas à railler l’armée de ces « pseudo descendants de Salomon ». Ami de Fernand Mazade, il lit Seule en Éthiopie de sa fille Simone Mazade-Roussan, qui vient de s’installer à Tananarive, et aussitôt exprime sa sympathie envers « les Abyssins – cette race fière et malheureuse, mais inconsciente autant qu’enfantine et que suffisante [...] ces derniers hommes de couleur libres ». En octobre 1936, persuadé que Franco va facilement s’emparer de Madrid, il projette de lui adresser un télégramme de félicitation, puis se ravise. Ne dépense-t-il pas déjà trop d’argent en timbres-poste, en livres, en alcool et en drogues ? Ses invectives, dans Les Calepins bleus, contre des Juifs français de Tananarive relèvent en partie du mimétisme qui, selon lui, caractérise « l’Oriental ». Elles sont heureusement sans commune mesure avec celles que provoque, dans le journal du parti communiste de la région de Madagascar, l’annonce d’une mission polonaise qui, avec l’accord du gouvernement français, étudiera la possibilité d’installer en masse des Juifs polonais sur laGrande Île4.Ou avec ces propos de Camo dans le numéro d’hommage à Maurras de la Revue universelle, en janvier 1937 : « Quand l’Internationale de l’ordre aura triomphé, il s’agira de dégager la France du monceau de décombres qu’auront entassés sur elle les Juifs, les Moscovites, les Métèques et la canaille de toute espèce. »
10Rabearivelo n’aurait peut-être pas plus acquiescé à la notion de négritude que René Maran (premier écrivain noir couronné par le prix Goncourt, auquel le liait une admiration réciproque5), mais sur ce plan-là aussi, on le voit hésiter. Il définit Negro, l’anthologie de Nancy Cunard : « recueil de documents contre les exactions européennes dans les colonies extra-continentales [...] florilège de littérature non blanche ». Il ne ménage pas ses éloges à Claude McKay, « ce Malgache exilé de temps immémorial en Amérique [...]. Ce grand cœur en désarroi qui a dicté Banjo, un livre aussi beau et déconcertant que le premier Céline, un livre rempli de balbutiements déchirants, et long, et interminable, comme une nuit blanche6... »Il conseille ce roman d’un docker musicien de Marseille aux lecteurs des Cahiers du Sud.
11Son « Coup d’œil sur le Passé de Madagascar » fait supposer son antisémitisme également issu de l’antipathie qu’il éprouve envers les populations d’origine arabe de Madagascar. On y lit entre les lignes que les royalistes français méritent qu’on s’attache à eux, car ils ne sont pas responsables d’une conquête effectuée par la République : en 1896, conclut-il, « le royaume hova, sa dynastie de 25 souverains, étaient choses du passé. L’affaire avait coûté à la France plusieurs millions, et à nous... plus de victimes qu’on pourra jamais en oublier. »
12Dans la mesure où il exprime sa supériorité de Hova, le monarchisme français de Rabearivelo s’inscrit dans un univers gouverné par la traduction, et c’est par celle-ci que s’opère chez lui, non sans douleur, un revirement qui, littérairement du moins, l’écarte de son encombrant protecteur.
13Depuis ses débuts, en même temps qu’il écrivait en français, il traduisait en français des textes malgaches. En 1931, les Cahiers du Sud publient sa version d’un « vieux discours des pays d’Imerina ». Ce texte témoigne d’une fondamentale rupture : Rabearivelo, désormais, ne compose plus directement en français, ce qui installe la traduction au cœur de son œuvre. Par là, il rompt, sans le crier sur les toits, avec Camo et les siens. Tandis que ses poèmes des années vingt, de La Coupe de cendres ou de Sylves, conçus en français, portaient la marque des derniers élégiaques, fort essoufflés, de la métropole (« Je ne vous connais pas, ô mon soupir passé ! », « Vainement je tairai les sanglots de mon âme »), dans ceux qu’il destine à Presque-Songes et à Traduit de la nuit, sa voix récuse le sentimentalisme : « Une étoile pourpre / évolue dans la profondeur du ciel », « Lapidaire moribonde, la nuit... » À juste titre, Léon-Gabriel Gros fait l’éloge d’une poésie échappant « aux marécages de l’élégie », d’une expression « nette, précise, dessinant l’objet qui se dégage toujours des ondulantes fumées de la rêverie... » Le critique des Cahiers du Sud s’accorde ainsi avec la définition par Rabearivelo de la poésie comme un métier, « mais dans le sens qu’a ce mot [...] quand les yeux regardent et l’arbre fleurit – et pour dire ce que font, ce qu’ils sont appelés à faire, ces yeux et cet arbre ». Les deux recueils paraissent deux à trois ans avant sa mort. Parallèlement, comme avant lui Jean Paulhan, il transpose en français des hain-teny, poésies populaires émaillées de proverbes. Ces Vieilles chansons des pays d’Imerina ne paraîtront en volume qu’après sa mort.
14En associant création poétique et traduction, en composant en malgache pour publier en français, Rabearivelo fait mieux que se retremper dans « la vertu traditionnelle de son peuple » comme le préconisait Magallon : il se mesure avec lui-même. Il le signale en intitulant Gouffre intérieur un recueil de dix poèmes de Valéry qu’il a traduits (ou transcrits, comme il aime à dire en insistant sur le sens musical de ce terme). Rien dans ces textes («La Pythie» ne figurant pas parmi eux) ne justifiait ce titre.
15Traduit de la nuit ne fait toutefois entendre que des échos estompés de l’abîme. Rabearivelo n’y révèle pas sa propre nuit. C’estce qui fait le prix des Calepins bleus, où il note : « À force de plonger [...] dans ma propre opacité [...], n’est-ce pas ma transparence intérieure que j’explore ? »
16Laissons de côté les indications, fort utiles à l’historien et au futur biographe, sur la vie d’un poète correcteur d’épreuves pour un quotidien de Tananarive, les intrigues locales, les discussions de café et les visites de célébrités littéraires de la métropole, pour mieux cerner le personnage orgueilleux et blessé, qui avoue sa vie « entièrement tissée de contradictions ».
17La pire de ses blessures lui est infligée en France, où sa poésie n’est pas appréciée comme il l’espérait. André Fontainas, le critique du Mercure, retient de Presque-Songes des « poèmes odorants et rares », « un précieux album d’images inconnues ».
18En 1935, Léon-Gabriel Gros a beau relever dans ce recueil des « notations hallucinantes », Rabearivelo se désole, semble-t-il, d’être comparé aux jeunes poètes occidentaux ou associé à un « monde de fleurs et d’oiseaux ».
*
19La même année, Paul Valéry, sur sa demande, lui adresse, pour une préface à un numéro spécial de la Revue des Jeunes de Madagascar, ces quelques mots : « Monsieur J.-J. Rabearivelo a fait œuvre sérieuse, dévouée et courageuse pour les Lettres Françaises dans la grande Île. » Commentaire de l’intéressé: « ... les trois épithètes choisies ne me plaisent guère... »
20Quant à Maurice Martin du Gard, bien que reconnaissant d’avoir vu grâce à Rabearivelo la cérémonie du retournement des morts, il ne tient pas sa promesse de placer à Paris son Anthologie de la poésie hova.
21Toutes ces réticences contrarient celui qui se dit « malade de gloire au point d’en pleurer parfois comme un gosse et d’en gémir comme un moribond ».
22Si au moins Fontainas, Martin du Gard, Valéry, avaient su à qui vraiment ils avaient affaire ! S’ils avaient décelé que Rabearivelo n’était pas seulement un prometteur poète des colonies à faire valoir comme tel ! Presque rien malheureusement ne perce, dans les poèmes qu’ils ont lus, du personnage que nous révèle son Journal: un opiomane, un drogué de littérature, un émule compliqué de Casanova, qui emprunte aux Liaisons dangereuses, en l’adaptant, le pseudonyme de Valmond.
23Autodidacte insatiable, il accède à des monceaux de livres. Impatient que parvienne à Tananarive le courrier transporté de Marseille à Tamatave par les paquebots des Messageries Maritimes, il est ravi lorsqu’il reçoit un roman dédicacé par Julien Green ou par Fernand Fleuret, un mot de Gide, une lettre de Larbaud ou d’Armand Guibert ; fort irrité lorsqu’il lui semble qu’en France on ne s’intéresse pas à lui.
24Il se veut, comme Picasso, un arlequin. Il est cet étrange écorché qu’il dessine, figurant le cerveau par un « triangle hermétique » (Mallarmé, Góngora, Marini), les muscles par les versets claudéliens, la région du cœur par « les élégiaques purs » (Musset, Lamartine), l’ouïe (à laquelle il rattache «le mysticisme onirique») par « les Instrumentistes et autres aventuriers » (Ghil, Lautréamont, Dada) ; « le Système Digestif et Urinaire par les poètes pour sous- préfets » (dont il ne nomme aucun, mais la place de Camo est là).
25Il ne serait pas invraisemblable qu’en Rabearivelo, ce soit l’arlequin qui fume, pour la raison avancée par Baudelaire que « l’opium semble toujours apaiser ce qui a été agité et concentrer ce qui a été disséminé ». Bien que son maigre salaire suffise à peine à entretenir sa femme, Mary, et leurs enfants, il boit, il joue et perd, il mâche du haschich, il fréquente la fumerie d’opium de Thong, le Chinois, « savant résurrecteur du sang mort des pavots », comme il le présente en un fragment du Bijou rose et noir7. Léon-Gabriel Gros ne manquait pas d’intuition (en ce numéro des Cahiers du Sud de 1935 contenant « Haschich à Marseille », de Walter Benjamin) lorsque, lisant Presque-songes, il y soupçonnait quelques fumées. Dans la cabine de toile aux tentures rouges, Rabearivelo s’installe sur le divan. « Le roseau aux lèvres », il pratique, sans en être dupe, « l’art de diviniser ce qui est ». Il se présente chez Thong avec un volume de Thomas de Quincey.
26Ce n’est pas seulement la langue française qui est pour lui un autre opium, c’est toute la littérature. Elle le rassemble et l’éparpille. Ce Hova de culture française, qui ne sort jamais de son île, qui n’a vu que deux ou trois fois la mer, qui n’aura connu que Madagascar colonisé, ce solitaire familier de tous ses « frères dispersés dans nos îlots de poésie » (comme Robert-Edward Hart sur l’île Maurice), qui se plaint, parmi les Béotiens français ou malgaches, de n’avoir pas de Vendredi, s’échappe de Tananarive quelquefois, des papotages qui excitent sa verve, de l’imprimerie où il travaille, des journaux où il écrit et qu’il corrige – et comme il en remontre (avec une pointe de purisme) à certains scribouillards français ! S’éloignant, « au pays de la poussière rouge », d’un village qui, « sous la pluie, ne pourrait qu’avoir l’air d’être en sang », il distingue une petite colline, « semée de rochers et de blocs de pierres tombales », où un de ses meilleurs amis, un poète, repose « terrassé [...] par la peste » : « comme Scève le fut jadis », ne peut-il s’empêcher de préciser.
27Sa poésie est prude, à peine influencée par son intense vie érotique, mais son Journal ne l’est pas. (Ses introuvables Calepins rouges l’étaient, paraît-il, encore moins). Il a des rapports amoureux fort compliqués avec Apolline Rabenja (Paula), puis avec une Française prénommée Franzia, qui comme lui fréquente un « cercle arétin ». Il se flatte un jour, après une bringue « dans un bar qui est aussi un bordel », d’avoir culbuté sa « cinq centième Ève ».
28Cherchant à se persuader, à propos de Paula qui lui résiste, qu’une fleur cueillie est une fleur morte, il se sermonne : elle ne mérite pas d’être abandonnée aussitôt conquise, comme le fut, par Baudelaire, Mme Sabatier (qui portait curieusement le même prénom : Apollonie). Se traitant de « faux moine de la Thébaïde », il se représente donc Paula en la plus prometteuse amie de Baudelaire, et plus proche de lui par ses origines, la « Vénus noire » Jeanne Duval. Mme Rabenja ne lui cède pas pour autant. Hébété par la « plus que septuple possession illusoire » d’une récente nuit, il se torture du vers d’Anna de Noailles : «Jamais la volupté n’achève le désir ! » C’est chez le « préparateur de paradis artificiels » qu’en imagination il possède Paula ou qu’il se contente « de boire à sa bouche comme à une source fraîche celée par de hautes herbes en temps torride ». De Casanova, il veut lui faire partager le goût des huîtres. Il se déclare un « vicieux de la volupté » parce qu’il sent « un délicieux frisson de création à travers tout son être en aspirant la bête à perle ». Tombé inopinément, à l’intersection de deux rues, sur Paula qui circulait dans un pousse, et l’ayant trouvée belle « comme l’amande d’une cacahuète munie encore de sa peau rose », il prétend avoir murmuré les vers de Saint-Amant : « Et quand je songe à tout le demeurant / Que sous sa robe... »
29Sa rencontre avec Franzia est une historiette fort leste. Comme cette dame n’est pas « la forte “hongroise tétonnière et fessue” d’Apollinaire », mais une « Messaline lettrée », elle exige, insolent personnage manœuvrant l’auteur du conte, d’être nommée Javotte (prénom venu des Mémoires de Casanova, qu’elle aurait pu aussi emprunter à Mirabeau) ; et son amant, comme au cercle arétin, sera Érasme.
30Voahangy, fille de Rabearivelo, meurt à l’âge de trois ans : il imprime au bas du faire-part de décès quatre vers des Fleurs du Mal. C’est à la mendiante rousse de ce recueil, qu’il identifie sa voisine adolescente, « sale et haillonneuse », dans le creux des seins de laquelle il glisse « des doigts indiscrets ». Le jour de son suicide, le 22 juin 1937, il invoque, entre autres, O. V. de L. Milosz, Léon Deubel (qui se noya après avoir brûlé ses manuscrits) et Arthur Rimbaud. Avant d’ingurgiter le poison, il écrit qu’il embrasse l’album familial et qu’il envoie « un baiser aux livres de Baudelaire ».
31Des causes, immédiates ou lointaines, qui pourraient expliquer son suicide : sa pauvreté, l’emploi de fonctionnaire qu’on lui refuse, les vexations qu’il subit, son abus des stupéfiants, sa vue qui faiblit, les effets pervers de la drogue littéraire, la déception de ne pas être assez reconnu en France, le silence qui le menace depuis qu’il écrit en français au plus près du hova, la mort de Voahangy, la dispersion de sa vie amoureuse – Les Calepins bleus ne permettent de privilégier aucune.
32Ce millier de pages refermé, qui invite à relectures et explorations multiples, une certitude néanmoins se fait jour : octroyant à son Journal le point final de sa vie, Rabearivelo le désigne comme son œuvre maîtresse.