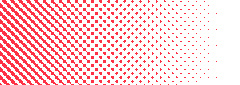Consignes de rédaction
Soumission d'un article
- S’assurer qu’il s’agit bien d’une version définitive, notamment nettoyée des coquilles.
- S'assurer de bien respecter toutes les normes listées ci-dessous, en particulier :
- S'assurer que toutes les références citées dans votre texte (y compris dans les notes) figurent bien dans votre bibliographie finale.
- S'assurer qu'il est d'une taille inférieure à 2 Mo (sans perdre la qualité des éventuelles images qu'il contient).
- Transmette un fichier au format .doc ou .docx.
- Dans le cas d'une proposition d'article pour publication en varia, envoyer votre texte à lht@fabula.org, si possible en deux versions : l'une anonyme (y compris dans votre texte), l'autre avec votre nom.
*
Présentation du document (ne s'applique pas aux proposition de réponse à un appel, mais uniquement aux articles terminés)
Métadonnées
- En tête de votre article figurent, dans l’ordre suivant :
- le titre de votre article,
- vos prénom et nom (nom en majuscule),
- votre affiliation, suivie sur la même ligne de votre courriel (qui sera visible sur le site),
- la langue du document, abrégée ainsi : fr, en, …,
- un résumé de 5 à 10 lignes en français,
- des mots clefs (de trois à six) en français – pour les noms de personne sur ce modèle : Beauvoir (Simone de)
- le titre de votre article en anglais, en respectant l'usage des majuscules,
- un résumé de 5 à 10 lignes en anglais,
- des mots clefs (de trois à six) en anglais – pour les noms de personne sur ce modèle : Beauvoir (Simone de).
Structuration de l'article
- Utilisation d'intertitres (un seul niveau admis).
- Attention aux paragraphes trop longs (pour l'affichage web) ou trop courts (chaque § sera numéroté).
- Présence d'une bibliographie finale qui doit comporter toutes les références complètes des textes cités (y.c. de ceux uniquement mobilisés en note de bas de page).
Longueur
- 15 000 signes au minimum.
- 40 000 signes au maximum (espaces et notes comprises, mais sans les métadonnées initiales ni la bibliographie finale). Dans le cas où l'objet imposerait le dépassement de la limite supérieure des 40 000 signes, merci de l'annoncer au préalable en le justifiant (p.ex. dans le cas où le texte comporterait beaucoup de traductions). Dans ce cas, il est possible d'envisager une extension de la limite supérieure à 45 000 signes.
*
Conventions typographiques
Alinéas
- Aucun alinéa au début d'un paragraphe.
Majuscules et caractères spéciaux
- Les capitales sont accentuées : À, É, È.
- Pour les titres d'ouvrage (cela ne s'applique pas aux parties d'ouvrage), majuscule uniquement au premier mot, sauf dans le cas où il s'agit d'un groupe nominal défini, auquel cas il faut une majuscule au premier substantif et à tout ce qui précède : Un cœur simple, À la recherche du temps perdu ou Si le soleil ne revenait pas, mais Le Dernier Jour d'un condamné.
- Dans le cas où un titre consiste en deux substantifs coordonnés par « et », on peut aussi mettre la majuscule au second, p.ex. : Le Rouge et le Noir.
- Siècles en chiffres romains et en petites capitales, suivi de « e » en exposant.
- Utiliser les lettres soudées æ, œ, Æ, Œ.
Espaces insécables (alt+esp)
- Avant tous les signes de ponctuation doubles comme : (deux-points), ; (point-virgule), ! (point d’exclamation) et ? (point d’interrogation).
- Après toutes les abréviations, en particulier : p., t., vol., fol., n°, chap., fig., coll., trad., éd., dir.
- Après l'abréviation des prénoms, par exemple : A.
- À l'intérieur de guillemets français (« … ») et à l'intérieur d'une incise signalée par deux tirets moyens ou demi-cadratins (– … –), càd. après le guillemet ou le demi-cadratin ouvrant une incise et avant le guillemet ou demi-cadratin fermant.
*
Images
Légende
-
Toute image doit être légendée avec soin.
Droits d'auteur et identification
- Merci de respecter les droits d'auteur, en particulier en vous assurant que l'image est libre de droits ou que son ayant-droit vous accorde le droit de la publier. Il convient d'informer les ayant-droits que le contenu de notre revue est en libre accès sur Internet.
- Nous n'avons pas de budget pour acheter les droits. Notre revue est gratuite (aucun revenu) et ne salarie personne.
- Dans le cas où une autorisation de publication est accordée par un ayant-droit, inclure une mention explicite de celle-ci en rappelant l'attribution, sur ce modèle : Légende © Prénom Nom, avec son aimable autorisation.
Transmission
- Toutes les images sont insérées dans le corps de l'article, à l'emplacement voulu.
- Chaque image doit en outre nous parvenir séparément par mail.
Taille et format
- Aucun article ne pouvant excéder 2 Mo, veiller à la taille des images en les retravaillant (sans perte excessive de qualité) avant leur inclusion dans le texte.
- Les images doivent être au format .jpeg.
*
Citations
Principes généraux
- Sauf rares exceptions, aucune référence ne doit être signalée en note de bas de page (voir plus bas la section « Référencement »).
- Toujours respecter les retours à la ligne, y compris en note de bas de page (pas de barre oblique pour traduire un retour à la ligne).
- Citations de plus de trois lignes sorties du texte : retour à la ligne et introduction d'une marge importante à gauche.
Guillemets
- Guillemets français (avec espaces insécables à l'intérieur) pour toutes les citations.
- Guillemets anglais, sans espace, pour les citations dans une citation, sur ce modèle : « citation première : “citation seconde” ».
- Pas de guillemet pour les citations mises en évidence.
Appels de note
- Si la note fournit l'original d'une traduction citée ou donne le cotexte immédiat de la citation, l'appel se trouve avant la ponctuation finale de la citation et dans tous les cas à l'intérieur des guillemets.
- Si la note fournit un commentaire, alors l'appel se trouve après l'élément commenté : s'il s'agit d'une citation commentée, l'appel se trouve donc après les guillemets.
Citation de vers ou de dialogues
- Pas d'alinéa ou de retrait à gauche (impossible de les afficher), même dans le cas de la citation de vers.
- Pour retranscrire un tiret marquant le début d'une prise de parole, utiliser un tiret long ou cadratin (opt+maj+tiret). Réserver les tirets moyens ou demi-cadratins (opt+tiret) aux incises. Préférer, en somme, — pour les répliques, et – pour les incises.
- Pour les didascalies d'attribution, mettre le nom du locuteur en petites majuscules, suivi d'un point ; sauf contre-indication, la réplique commence ensuite par un tiret, sur ce modèle : NOM. — Réplique.
*
Langues et traductions
- Signaler en italique les mots d'une autre langue que celle de l'article, y compris les locutions latines si elles ne sont pas couramment employées.
- Afin de ne pas introduire de rupture linguistique, le texte cite en français. L'original est introduit entre crochets et en italique dans les guillemets, sur ce modèle : votre texte « citation en français [citation en langue originale] ». Dans le cas où les traductions sont trop longues ou trop nombreuses et, dès lors, alourdissent trop le texte, préférer l’introduction d’une note de bas de page (voir section suivante) qui contiendra le texte original en italique et entre guillemets français. Si la citation ne commence pas par une majuscule, introduire des points de suspension entre crochets, sur ce modèle : « […] citation ». Veiller à l'existence d'une ponctuation finale.
- Dans tous les cas, la référence de la traduction est demandée, y compris lorsqu'elle est de vous (à signaler par la mention « je traduis », « ma traduction » ou autre).
*
Référencement
Principes généraux
- Toutes les références complètes sont listées en bibliographie (voir section dédiée ci-dessous).
- Les références sont abrégées dans des parenthèses, directement après la citation correspondante (voir ci-dessous pour une explication plus détaillée).
- Sauf rares exceptions, aucune référence complète ne doit être signalée en note de bas de page. Ces exceptions sont celles qui concernent les références de textes mentionnés ou cités dans l'une de vos propres citations (mention ou citation au second degré) et dont vous voudriez donner la référence complète pour une raison ou une autre.
- Les notes sont utiles pour accueillir, le cas échéant et si besoin, des précisions sur l'histoire des textes mobilisés (écriture, diffusion, éditions, lectures publiques, spectacles, etc.) qui ne figureraient pas déjà en bibliographie.
- Pour garantir la compréhension des lecteur·ice·s non familiers des corpus traités, préciser au moins une fois le prénom de tous les auteur·ice·s mentionnés, ainsi que les dates des ouvrages, en particulier celles des œuvres littéraires. Cela peut se faire dans le texte (« paru en 2014 ») ou par de simples parenthèses à la suite du titre, p.ex. : Titre (2014).
- Éviter toutefois de faire figurer une même information deux fois dans la même phrase : choisir entre « Titre, paru en 2014 » et « Titre (2014) », et en aucun cas « Titre (2014), paru en 2014 ».
Références abrégées entre parenthèses
- Les références des citations sont données de manière abrégée et entre parenthèses, à la suite immédiate de la citation correspondante, sur ce modèle :
- « Citation » (Nom de famille sans particule ou Pseudonyme, [année de l'édition originale, le cas échéant] année de l'édition utilisée, p. 1 ou § 1)
- p.ex. (Saint-Gelais, 2011, p. 180).
- « Citation » (Nom de famille sans particule ou Pseudonyme, [année de l'édition originale, le cas échéant] année de l'édition utilisée, p. 1 ou § 1)
- Aucune autre information n'y figure.
- S'il n'existe pas de nom d'auteur, utiliser le titre à la place (qui peut être abrégé à condition de pouvoir identifier facilement le titre complet dans la bibliographie finale), sur ce modèle :
- (Titre, [année de l'éd. originale, le cas échéant] année de l'éd. utilisée, p. 1).
- De manière générale, il convient d'adapter le texte aux parenthèses de référencement et réciproquement. En particulier, votre texte peut donner des informations manquantes dans les parenthèses et celles-ci doivent éviter de répéter des informations déjà données, p.ex. (deux variantes) :
- « Dans Fictions transfuges (2011), Richard Saint-Gelais relève que “le lecteur peut […] se demander […] s'il n'y [a] pas anguille sous roche” (p. 180). »
- « Dans Fictions transfuges, Richard Saint-Gelais relève que “le lecteur peut […] se demander […] s'il n'y [a] pas anguille sous roche” (2011, p. 180). »
- Si plusieurs noms sont mentionnés dans une même phrase et qu'il existe une ambiguïté sur l'attribution de la citation, merci de laisser le nom de l'auteur·rice cité dans la parenthèse, quitte à redoubler cette information.
- S'il n'existe aucune ambiguïté possible sur l'attribution de la citation, abréger le contenu de la parenthèse et ne spécifier que le numéro de page – « citation » (p. 30). Il est possible de mettre plusieurs numéros de pages dans la même parenthèse, à la suite d'une énumération de citations : « citation 1 » et « citation 2 » (p. 30 et 42).
- Si l'édition utilisée est une seconde édition ou une traduction, on veillera à inclure entre crochets la date de première édition avant la date de l'édition utilsée, afin de garantir une compréhension maximale de tous les lecteur·ice·s, p.ex. :
- (Goodman, [1968] 2011, p. 121), pour citer la référence suivante (présente dans la bibliographie finale) :
- GOODMAN Nelson, Langages de l’art. Une approche de la théorie des symboles (1968, 1976), trad. Jacques Morizot, Paris, Arthème Fayard, coll. « Pluriel », 2011, p. 121.
On peut, pour insister sur le fait que c'est la seconde édition en anglais qui a été traduite en français, indiquer dans les parenthèses les deux dates des deux éditions :
- (Goodman, [1968, 1976] 2011, p. 121). - Si l'édition utilisée dans votre texte est l'édition originale, on ne met donc pas de crochet :
- (Goodman, 1968, p. 40). - Dans tous les cas, bien mettre en bibliographie les références de l'édition utilisée ou des éditions utilisées (dans le cas de textes originaux et traduits qui seraient tous cités, par exemple).
- (Goodman, [1968] 2011, p. 121), pour citer la référence suivante (présente dans la bibliographie finale) :
- Lorsque deux entrées bibliographiques d'un même auteur·rice partagent les mêmes dates, adjoindre une lettre à la suite de la date, p.ex :
- (Thomasseau, 1984a) et (Thomasseau, 1984b), qui renvoient respectivement à :
- THOMASSEAU Jean-Marie, « Pour une analyse du para-texte théâtral : quelques éléments du para-texte hugolien », dans Littérature, n° 53, Le Lieu / La scène, 1984 (a), p. 79-103 ;
- THOMASSEAU Jean-Marie, « Les différents états du texte théâtral », dans Pratiques, n° 41, L'Écriture théâtrale, 1984 (b), p. 99-121.
- (Thomasseau, 1984a) et (Thomasseau, 1984b), qui renvoient respectivement à :
*
Bibliographie finale
Quel que soit le type d'article soumis, une bibliographie finale est obligatoire.
Organisation
- La bibliographie finale donne toutes les références complètes des citations. Elle peut également contenir certaines références des travaux mentionnés, mais non cités.
- Les références complètes à lister sont celles des éditions utilisées et non celles des éditions de référence du texte (dont les dates sont à indiquer selon le modèle défini plus bas)
- La bibliographie ne peut pas être organisée en sous-sections. Elle est classée par ordre alphabétique des noms des auteur·rice·s. Dans le cas où il n'y a pas d'auteur, la première lettre du titre est déterminante.
- Classer les publications d'une même personne de la plus récente à la plus ancienne, en prenant pour repère la date de l'édition utilisée (et non celle de la première édition).
- Répéter le nom d'un auteur ou d'une autrice dans le cas où deux entrées sont rédigées par une même personne.
- Elle donne obligatoirement tous les DOI des références listées.
Présentation des entrées
- Suivre cet ordre :
- NOM Prénom,
- Titre (année de la première parution si différente de celle utilisée),
- précision éventuelle comme éd. ou trad., suivi du prénom et nom des personnes concernées et (année) si celle-ci est différente de l'édition utilisée,
- Lieu,
- Maison,
- coll. « Collection »,
- Année,
- p. 1.
- DOI (toujours sous forme d'URL) : https://doi.org/….
- Si un élément manque, l'indiquer : s.l, s.d., etc.
Nom des auteur·rice·s
- S'il s'agit d'un document sans auteur·rice, classer la référence sous la première lettre de son titre ou sous « Anonyme » (à faire figurer donc à la place réservée habituellement au nom de l'auteur·rice).
- Le prénom des auteur·rice·s n'est jamais abrégé en bibliographie.
- Le nom est donné en premier et en petites capitales (première lettre en majuscule simple). S'il y a des accents, penser à mettre la langue du document en Français (Suisse) pour que ceux-ci s'affichent sur les majuscules.
- Le nom et le prénom ne sont jamais séparés par une virgule.
- Si plusieurs auteurs signent un texte, donner tous les noms par ordre alphabétique et séparés par une virgule, avec « et » pour coordonner les deux derniers, sur ce modèle : NOM Prénom, NOM Prénom et NOM Prénom.
Direction d'ouvrages ou de dossiers
- On fera attention à donner non seulement le nom des directeur·rice·s d'ouvrages collectifs, mais encore celui des directeur·rice·s d'un numéro ou dossier de revue.
- Le nom des directeur·rice·s d'ouvrages précède le titre, sur ce modèle :
- NOM Prénom (dir.), Titre (date originale), Lieu, Maison d'édition, coll. « Collection », Année.
- Le nom des directeur·rice·s de numéros de revue suit le titre du volume ou du dossier en question, sur ce modèle :
- Titre de la revue, vol., n°, Titre du numéro ou « Titre du dossier », dir. Prénom Nom, Année.
Attention : pas de petites majuscules dans ce cas.
On peut, pour des raisons de commodité, écrire NOM Prénom (dir.), Titre du numéro ou « Titre du dossier », Titre de la revue, vol., n°, Année.
- Titre de la revue, vol., n°, Titre du numéro ou « Titre du dossier », dir. Prénom Nom, Année.
- Ne pas oublier les URL et les DOI le cas échéant (voir ci-dessous section « En ligne »).
Numéros et dossiers de revue
- Les renseignements concernant les volumes et numéros de revue doivent comprendre le volume et le numéro de la revue et, le cas échéant, le titre du numéro ou du dossier, avec le nom des directeur·rice·s de ce numéro ou de ce dossier. Le titre de la revue se met en italique, de même que celui du numéro ; le titre d'un dossier thématique de ce numéro se met entre guillemets, sur ce modèle :
- Titre de la revue, vol., n°, Titre du numéro, dir. Prénom Nom des directeur·rice·s, Année,
- ou Titre de la revue, vol., n°, « Titre du dossier », dir. Prénom Nom des directeur·rice·s, Année,
- ou NOM Prénom des directeur·rice·s (dir.), Titre du numéro ou « Titre du dossier », Titre de la revue, vol., n°, Année.
- Dans la mesure du possible et sans introduire d'erreur, désambiguïser les formats compacts du type Année-Chiffre ou Nombre-Nombre, p.ex. 2010-3 ou 82-4, en identifiant le mieux possible ce qui correspond d'une part à l'année de parution, d'autre part au volume et au numéro, voire au dossier, en se fiant aux sommaires des revues concernées.
- S'il n'y a pas de volume, comme dans le cas de Fabula-LhT, ne pas le noter.
- Ne pas oublier les URL et les DOI le cas échéant (voir ci-dessous section « En ligne »).
Lieu, maison d'édition et collection
- Se passer du terme Éditions, y compris pour : Amsterdam, Minuit, Seuil, Théâtrales.
- Abréger Presses Universitaires en PU, p.ex : PU Blaise Pascal ou PU de Vincennes.
- Pour les PU de France, écrire PUF.
- Si la ville est précisée avant, abréger entièrement, p.ex. : Rennes, PUR.
- Abréger collection en « coll. » et mettre le titre entre guillemets, ainsi : coll. « Poétique ».
En ligne
- Si la publication est en ligne, remplacer le lieu et la maison par la mention « en ligne », sur ce modèle :
- Fabula-LhT, n° 8, Le Partage des disciplines, dir. Nathalie Kremer, en ligne, 2011 : www.fabula.org/lht/8. DOI : https://doi.org/10.58282/lht.216.
- La mention du DOI, s'il en existe un, intervient après le point final, ainsi : DOI : https://doi.org/10.58282/lht. Cette mention est obligatoire.
- Quand une référence papier est disponible en ligne, le signaler à la suite de la référence, après l'année, ainsi « ; disponible en ligne : www.référence. »
Dates
- Préciser l'année de publication originale après le titre entre parenthèses. Les jours et mois peuvent être conservés dans le cas d'articles d'abord parus dans la presse.
- Préciser l'année de la traduction après le nom du traducteur ou de la traductrice si elle est différente de la date de l'édition.
- Préciser l'année de l'édition après la mention de l'édition si elle est différente de celle d'impression (voir premier exemple ci-dessous).
- Dans le cas du théâtre, préciser également l'année de création scénique à la suite de la notice (voir exemple ci-dessous).
- Si plusieurs entrées d'un même auteur·rice datent de la même année, inclure entre parenthèses une lettre qui permettra de distinguer ces entrées dans votre texte lorsque vous en citez une : Année (a).
Traductions et éditions
- Donner le nom des éditeur·rice·s et des traducteur·rice·s, précédé de la mention «éd.» ou «trad.», sur ce modèle :
- Nom de l'auteur, Titre (date originale), trad. Nom du/de la traducteur·rice (date de la traduction si différente de la date d'édition), éd. Nom de l'éditeur·ice (date de l'édition si différente de la date d'impression), Lieu, Maison d'édition, coll. « Collection », Année.
On peut ajouter juste après cette référence une phrase pour préciser le titre original, l'existence d'une traduction française ou toute autre information importante.
- Nom de l'auteur, Titre (date originale), trad. Nom du/de la traducteur·rice (date de la traduction si différente de la date d'édition), éd. Nom de l'éditeur·ice (date de l'édition si différente de la date d'impression), Lieu, Maison d'édition, coll. « Collection », Année.
- Dans le cas d'une seconde édition, donner la date de parution originale entre parenthèses après le titre et mentionner la réédition, sur ce modèle :
- Nom de l'auteur, Titre (date originale), 2nde éd. (date de cette édition si diff. de la date d'impression), Lieu, Maison d'édition, coll. « Collection », Année.
- Dans le cas où deux éditions d'un même texte sont citées, prévoir deux entrées bibliographiques.
Pages et paragraphes
- En bibliographie, on fera attention à donner toutes les pages d’un article (précédées d’un simple « p. », par exemple « p. 320-345 »), tandis que seule la page citée est répertoriée dans la référence dans le texte ou en note.
- Les publications en ligne sont citées selon leur numéro de paragraphe : « § numéro », par exemple « § 3 ».
*
Modèles
Le référencement en bibliographie suivra donc les modèles suivants (noms en petites capitales et non en majuscules comme ci-dessous).
Livres
- PAVIS Patrice, Dictionnaire du théâtre (1980), 2nde éd. (1996), Paris, Armand Colin, 2014.
Numéros de revue
- COnTEXTES, n° 1, Discours en contexte, dir. Jean-Michel Adam, Panayota Badinou et Jérôme Meizoz, en ligne, 2006 : http://journals.openedition.org/contextes/229, consulté le 23 mars 2017. DOI : https://doi.org/10.4000/contextes.229.
Chapitre (même auteur, même statut)
- GENETTE Gérard, « Discours du récit. Essai de méthode », Figures III, Paris, Seuil, 1972, p. 65-273.
Chapitre (même auteur, statut différent)
- REICHLER Claude, « La littérature comme interprétation symbolique », dans Claude Reichler (dir.), L'Interprétation des textes, Paris, Minuit, 1989, p. 81-114.
Chapitre (auteur différent)
- CHARTIER Roger et JOUHAUD Christian, « Pratiques historiennes des textes », dans Claude Reichler (dir.), L’Interprétation des textes, Paris, Minuit, 1989, p. 53-79.
Article
- CHARLES Michel, « Trois hypothèses pour l’analyse, avec un exemple », Poétique, n° 164, 2010, p. 387‑417 ; également en ligne : https://www.cairn.info/revue-poetique-2010-4-p-387.htm, consulté le 23 mars 2017. DOI : https://doi.org/10.3917/poeti.164.0387.
Édition
- MOLIÈRE, Le Festin de Pierre [Don Juan] (1682, 1683), dans Molière, Œuvres complètes, t. II, éd. Georges Forestier et Claude Bourqui, Paris, Gallimard, 2010, p. 845-902. La pièce a été créée en 1665.
Traduction
- GOODMAN Nelson, Langages de l’art. Une approche de la théorie des symboles (1968, 1976), trad. Jacques Morizot, Paris, Arthème Fayard, 2011.
Toute référence ne rentrant pas dans ce cadre (en particulier les textes anciens voire très anciens) est rédigée aussi complètement que possible, avec la conformité la plus grande possible aux modèles présentés ci-dessus.
***
SUBMISSION OF AN ARTICLE (after selection of a proposal on call or spontaneous proposal of article in varia)
- Please ensure that this is a definitive version (cleaned up of typos), as no post-publication modifications are possible.
- Make sure you comply with all the standards listed below.
- Send attached file by e-mail in ".doc" or ".docx" format to lht@fabula.org.
DOCUMENT PRESENTATION
Metadata :
- At the top of your article you will find, in the following order :
- the title of your article in French,
- the title of your article in English,
- your first and last name (in upper case),
- your affiliation,
- your e-mail address (it will be visible on the site),
- the language of the document, abbreviated as follows: fr, en, ...,
- a 5-10 line summary in French,
- keywords (three to six) in French,
- a 5-10 line summary in English,
- keywords (from three to six) in English.
Structuring :
- Use headings in the course of your text (sub-section not allowed).
- End with a final bibliography. It must include all references to texts cited in the text or in the notes.
Length:
- The article must be at least 15,000 characters long and may not exceed a total of 40,000 characters (including spaces and notes, but excluding bibliography). If the purpose of the article requires that the upper limit be exceeded, please give prior notice and justification (e.g. if the text contains a large number of translations). In some cases, a new limit of 45,000 characters can be set.
TYPOGRAPHICAL CONVENTIONS
Spaces :
- A non-breaking space (alt+esp) must precede all double punctuation marks: colon, semicolon, exclamation mark, question mark.
- It must follow all abbreviations, in particular: p., t., vol., fol., no., chap., fig., coll., trad., ed., dir.
- Similarly, it follows the abbreviation of first names, for example: A.
- In the case of an incise marked by two semi-cadratine hyphens ("Sentence - incise - continuation of sentence."), a non-breaking space must follow the opening semi-cadratine, and precede the closing semi-cadratine.
Quotations:
- Use French quotation marks (they must be accompanied by a non-breaking space inside); inside a quotation, use English quotation marks, without spaces, on this model: "citation première : "citation seconde"".
- Outgoing quotations (without quotation marks) from a three-line passage.
Capital letters, titles, centuries, special characters :
- Capital letters are accented: À, É, È.
- Titles of works (not parts of works) are capitalized, as are the first noun and all that precedes it when it is a definite nominal group (Le Dernier Jour d'un condamné), possibly both nouns when they are coordinated by an "et" (Le Rouge et le Noir), and the first word in other cases (À la recherche du temps perdu or Un cœur simple).
- Centuries appear in Roman numerals and small capitals, followed by the superscript "e".
- Use welded letters æ, œ, Æ, Œ, in roman and italics.
Languages and translations :
- Foreign-language quotations in italics.
- The text quotes in French and is immediately followed by the original language, on this model: "citation en français [citation en langue originale]". If there are a large number of translations, making the text too unwieldy, it is preferable to introduce a footnote containing the original text in italics and in quotation marks.
- In all cases, the translation reference is requested (including when it is your own: in this case, please indicate "I translate" or "my translation").
IMAGES
Copyright :
- If you add images to your article, please respect copyright, in particular by ensuring that the image is free of rights or that its copyright holder grants you the right to publish it (copyright holders are reminded that our magazine is free and freely accessible on the Internet, and that it does not pay any salaries). We have no budget to purchase rights.
- Each image must contain a caption with the mention of © and be inserted in the body of the article, in the desired location.
Size and format:
- The total size of the file you send us may not exceed 2 megabytes.
REFERENCES
General principles :
- Fabula-LhT no longer references quoted texts in footnotes, but only in the bibliography (see dedicated section below).
- Quotations are followed directely by references, so: « quotation » (Name, date, p. numbers).
- The notes are useful for clarifying the history of the texts in question (writing, distribution, editions, public readings, performances, etc.).
- To ensure comprehension by readers unfamiliar with the corpus treated, wherever possible, we try to specify at least once the first names of all the authors mentioned, as well as the dates of the works mentioned, particularly those of literary works. This can be done with a simple parenthesis: Title (original date). This applies to both text and notes.
In text and notes :
- In the text and in the notes, references to quotations are given abbreviated and in brackets, immediately following the corresponding quotation, on this model: "quotation" (Name, date of edition used, p. number or § number). For example, write "citation" (Saint-Gelais, 2011, p. 180).
- If there is no author's name, replace the name with the first words of the abbreviated title, the full version of which is easy to find in the bibliography, on this model: "citation" (Title, date, p. number).
- If the title of the work is important to the understanding of your subject, it may be useful to specify it in your text. For example: "In Fictions transfuges, Richard Saint-Gelais notes that "the reader may [...] wonder [...] if there isn't [a] fish in a barrel" (2011, p. 180)." In this example, the name R. Saint-Gelais has been removed from the parenthesis, as it is already given in the same sentence. If several names are mentioned in the same sentence and there is any ambiguity about the attribution of the quotation, please leave the name of the person quoted in the parenthesis.
- If there is no possible ambiguity as to the attribution of the quotation, for example when the same reference is used twice in succession and in the same paragraph, or if the name of the author or work is repeated in the sentence, the contents of the parenthesis can be abbreviated and only the page number specified - "citation" (p. 30). It is possible to include several page numbers in the same parenthesis, following a list of quotations: "quotation 1" and "quotation 2" (p. 30 and 42).
- If the edition used is a second edition or a translation, be sure to include the date of the first edition in square brackets before the date of the edition used, to ensure maximum comprehension by readers who may not be able to situate the quoted text precisely in time. For example, we would write (Goodman, [1968] 2011, p. 121) to quote GOODMAN Nelson, Langages de l'art. An Approach to Symbol Theory (1968, 1976), trans. Jacques Morizot, Paris, Arthème Fayard, coll. "Pluriel", 2011, p. 121. To emphasize that it was the 2nd edition in English that was translated into French, the two dates of the two "original" editions are given in brackets (Goodman, [1968, 1976] 2011, p. 121).
- If the edition used in your text is the original edition, do not put a check mark: (Goodman, 1968, p. 40). Where applicable, be sure to include in the bibliography the references to the edition used, i.e. in this case the references to the original edition.
- When two bibliographical entries by the same author share the same dates, add a letter after the date. For example: (Thomasseau, 1984a) and (Thomasseau, 1984b), which refer respectively to THOMASSEAU Jean-Marie, "Pour une analyse du para-texte théâtral : quelques éléments du para-texte hugolien", in Littérature, n° 53, Le Lieu / La scène, 1984a, p. 79-103, and to THOMASSEAU Jean-Marie, "Les différents états du texte théâtral", in Pratiques, n° 41, L'Écriture théâtrale, 1984b, p. 99-121.
BIBLIOGRAPHY
Regardless of the type of article submitted, a final bibliography is mandatory.
Organization of the bibliography :
- The bibliography gives full references for all citations. It may also contain some references to works mentioned but not cited.
- The complete references to be listed are those of the editions used, not those of the reference editions of the text.
- No sub-section.
- It is arranged in alphabetical order of authors' names. If there is no author, the first letter of the title is decisive.
- Classify publications by the same person from the most recent to the oldest, using the date of the edition used (not the date of the first edition) as a reference.
- Repeat the author's name when two entries are written by the same person.
- All DOI of listed references must be given.
Presentation of entries:
- Follow this order: LAST NAME First name (no comma between first and last name), Title (date of first ed.), Details if any (ed., trans., ..., followed by the names of the persons concerned), Place, House, coll. "Collection", Date, Pages: URL. DOI.
- If missing, indicate: s.l, s.d., etc.
Name of author(s) :
- If the document has no author, write "Anonymous" or nothing, as appropriate.
- Authors' first names are never abbreviated in the bibliography.
- The author's first name is never abbreviated in the bibliography.
- First and last names are not separated by commas.
- If several authors sign a text, give all names in alphabetical order and separated by a comma, with the coordinator "et" to coordinate the last two, on this model: NAME First Name, NAME First Name et NAME First Name.
Editors of books or dossiers :
- Care should be taken to include not only the names of editors of collective works, but also those of editors of journal issues or dossiers.
- The names of editors should precede the title, as follows: LAST NAME First name (dir.), Title (original date), Place, Publisher, Series, Year.
- The names of editors of journal issues follow the title of the volume or dossier in question, on this model: Title of journal, vol., n°, Title of issue or "Titre du dossier", dir. First name Last name, Year. Please note: no small caps in this case. For convenience, you can write NAME First Name (dir.), Title of issue or "Title of dossier", Title of journal, vol., no., Year.
- Don't forget URLs and DOIs where applicable (see "Online" section below).
Journal issues and dossiers:
- Information concerning journal volumes and issues should include the journal volume and number and, where appropriate, the title of the issue or dossier, with the names of the editors of the issue or dossier. The journal title should be italicized, as should the issue title; the title of a thematic dossier in this issue should be enclosed in quotation marks, as follows:
- Journal title, vol. n°, Issue title, dir. First name Last name of editors, Year,
- or Title of journal, vol. n°, "Title of issue", dir. First name Last name of editors, Year,
- or NAME First name of directors (dir.), Issue title or "Dossier title", Journal title, vol., n°., Year.
- As far as possible, and without introducing errors, disambiguate compact formats of the Year-Number or Number-Number type, e.g. 2010-3 or 82-4, by identifying as best as possible what corresponds to the year of publication on the one hand, and to the volume and issue, or even the dossier, on the other, by relying on the summaries of the journals concerned.
- If there is no volume, as in the case of Fabula-LhT, leave it blank.
- Don't forget URLs and DOIs where applicable (see "Online" section below).
Place, publishing house and collection:
- Do without the term "Éditions", including for: Amsterdam, Minuit, Seuil, Théâtrales.
- Abbreviate "Presses Universitaires" to "PU", e.g. PU Blaise Pascal or PU de Vincennes.
- For PU de France, write PUF.
- If the city is specified before, abbreviate entirely, e.g.: Rennes, PUR.
- Abbreviate collection as "coll." and enclose title in quotation marks, e.g.: coll. "Poétique".
Online:
- If the publication is online, replace the place and house with "online", on this model: Fabula-LhT, n° 8, Le Partage des disciplines, dir. Nathalie Kremer, online, 2011: www.fabula.org/lht/8. DOI : https://doi.org/10.58282/lht.216.
- The DOI, if any, is mentioned after the period, as follows: DOI : https://doi.org/10.58282/lht. This reference is mandatory.
- When a paper reference is available online, indicate this after the year of the reference, e.g. " ; disponible en ligne : www.référence. ".
Dates:
- Specify the original publication date after the title in brackets.
- Specify the translation date after the translator's name if different from the edition date.
- Specify the date of the edition after the name of the edition if different from the date of printing (see first example below).
- In the case of theater, please also specify the date of the stage premiere after the entry (see example below).
Translations and editions :
- Please give the names of the publishers and translators, preceded by the words "éd." or "trad.", as follows:
- Author's name, Title (original date), trans. Name of translator (date of translation if different from date of edition), ed. Name of publisher (date of edition if different from date of printing), Place, Publishing house, Collection, Year.
- Just after this reference, a sentence can be added to specify the original title (sometimes very different from the French) or, on the contrary, the existence of a French translation (if the original text is used), or any other important information.
- In the case of a second edition, give the original publication date in brackets after the title and mention the reprint, as follows: Author's name, Title (original date), 2nd ed. (date of this edition if different from the printing date), Place, Publishing house, "Collection", Year.
- If two editions of the same text are cited, provide two bibliographic entries.
Pages and paragraphs:
- In the bibliography, care should be taken to give all the pages of an article (preceded by a simple "p.", e.g. "p. 320-345"), while only the page cited is listed in the reference in the text or in a note.
- Online publications are cited by paragraph number: "§ number", e.g. "§ 3".
TEMPLATES
Bibliographic referencing will follow the following models (names in small capitals, not capitalized as below).
Books:
PAVIS Patrice, Dictionnaire du théâtre (1980), 2nde éd. (1996), Paris, Armand Colin, 2014.
Journal issues:
COnTEXTES, n° 1, Discours en contexte, dir. Jean-Michel Adam, Panayota Badinou et Jérôme Meizoz, en ligne, 2006 : http://journals.openedition.org/contextes/229, consulté le 23 mars 2017. DOI : https://doi.org/10.4000/contextes.229.
Chapter (same author, same status):
GENETTE Gérard, « Discours du récit. Essai de méthode », Figures III, Paris, Seuil, 1972, p. 65-273.
Chapter (same author, different status):
REICHLER Claude, « La littérature comme interprétation symbolique », dans Claude Reichler (dir.), L'Interprétation des textes, Paris, Minuit, 1989, p. 81-114.
Chapter (different authors):
CHARTIER Roger et JOUHAUD Christian, « Pratiques historiennes des textes », dans Claude Reichler (dir.), L’Interprétation des textes, Paris, Minuit, 1989, p. 53-79.
Article:
CHARLES Michel, « Trois hypothèses pour l’analyse, avec un exemple », Poétique, n° 164, 2010, p. 387‑417 ; également en ligne : https://www.cairn.info/revue-poetique-2010-4-p-387.htm, consulté le 23 mars 2017. DOI : https://doi.org/10.3917/poeti.164.0387.
Edition:
MOLIÈRE, Le Festin de Pierre [Don Juan] (1682, 1683), dans Molière, Œuvres complètes, t. II, éd. Georges Forestier et Claude Bourqui, Paris, Gallimard, 2010, p. 845-902. La pièce a été créée en 1665.
Translation:
GOODMAN Nelson, Langages de l’art. Une approche de la théorie des symboles (1968, 1976), trad. Jacques Morizot, Paris, Arthème Fayard, 2011.
Any reference that does not fit into this framework (particularly old or very old texts) is written as completely as possible, with the greatest possible conformity to the models presented above.