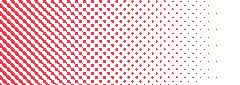Savoir faire consonner : Clément Rosset et sa manière de procéder
1À Sébastien Charles qui lui demande si c’est une « volonté d’écrire entre littérature et philosophie » qui le pousse à « émailler [ses] textes de références autres que philosophiques », Clément Rosset donne la réponse suivante :
Il est vrai que je n’hésite pas à recourir à des références musicales, plastiques ou littéraires (romans, théâtre, bandes dessinées, etc.). Mon atelier comprend tout. J’aime musarder et mettre ensemble des citations ou des faits d’art qu’on n’aurait pas tendance à rapprocher et à éclairer d’une même luminosité. J’aime mettre en valeur deux éléments qui paraissent en apparence lointains et qui, en fait, consonnent quand on sait les faire consonner. C’est un plaisir et en même temps une manière de faire de la philosophie qui donne une profondeur à des notions en montrant comment elles peuvent scintiller en convergence avec d’autres qui leur paraissent très opposées1.
2Puis, Sébastien Charles remarque que Rosset ne fait « pas de différence réelle et essentielle entre philosophie et littérature » et que la différence entre philosophie et littérature, toujours selon Rosset, « se situe principalement au niveau de l’objet et non de la méthode », ce à quoi Rosset répond :
Effectivement, dans la mesure où tout est affaire de mots. Et c’est pourquoi j’aime faire un montage provenant de casiers hétéroclites. Une critique qui pourrait m’être faite et qui ne me causerait aucun déplaisir, puisqu’elle montrerait que la personne a compris, sinon le message, du moins ma manière de procéder, serait de dire que mes livres ne sont que des citations mises bout à bout et agrémentées d’un propos personnel. Mes livres sont effectivement courts et la plupart du temps ce n’est pas moi qui parle… J’aime beaucoup imiter Luciano Berio qui fait en musique des collages de partitions différentes. Mais n’y voyez pas là une provocation ! Certains pensent qu’entre deux citations de Heidegger faire intervenir un mot d’un album de Tintin et Milou est une manière de se moquer du monde, et de Heidegger en particulier. Au contraire, je ne vois pas en quoi ce serait amoindrir Heidegger que de le faire succéder ou précéder par Hergé. Je pense en outre qu’il y a une profonde pertinence dans ce rapprochement qui me sert à éclairer ce que je veux dire2.
3Il m’apparaissait essentiel de citer ces longs passages parce que s’y trouvent juxtaposés les éléments qui constituent le noyau du présent article. Clément Rosset le reconnaît lui-même, ses livres ne sont que des « citations mises bout à bout et agrémentées d’un propos personnel ». Bien entendu, cela constitue une hyperbole, dans la mesure où les livres de Rosset sont loin de se réduire à des citations mises bout à bout. D’ailleurs, mettre des citations bout à bout n’implique pas seulement l’addition légère d’un petit « propos personnel » qui serait à la fois l’ingrédient liant et le condiment. Toujours est-il que la citation est, en effet, l’une des manières de procéder de Rosset. Simplement, il convient de se demander si c’est vraiment l’autre qui parle quand l’autre est cité. Plus fondamentalement, il s’agira de déterminer les fonctions de ce recours à l’autre. Car, que ce soit véritablement l’autre qui parle ou que l’autre soit l’occasion d’une voix qui ne peut être que celle de Rosset, ce recours à l’autre n’est pas indifférent, en particulier dans le cadre d’une philosophie qui s’applique, à chacun de ses moments, à « rendre le réel à l’insignifiance3 », c’est-à-dire à montrer comment le double – l’autre – n’est pas le réel. Autrement dit, il faut interroger cette « manière de procéder » de Rosset pour comprendre en quoi elle interfère avec son projet philosophique : il y aurait peut-être un fossé entre le « message » et la « manière de procéder ». Car il n’est pas évident que cette esthétique qui établit des correspondances s’articule au constat d’insignifiance du réel si cher à Rosset. Le simple fait de mettre en valeur des éléments du réel sort immédiatement celui-ci de son insignifiance, même quand c’est cette insignifiance qui est visée par le propos. Ainsi, le projet philosophique de Rosset serait en tension entre deux pôles irréconciliables, à savoir celui de l’insignifiance du réel et celui de la promotion de cette insignifiance, promotion qui passe par la plus extrême des signifiances : faire consonner l’un et l’autre, l’un par l’autre. Or peut-être cette « signifiance » n’est-elle possible que sur un fond d’insignifiance. Si tout peut être mis en consonance avec tout, c’est peut-être parce que tout est singulier.
4J’examinerai donc quelques « recours à l’autre » de Clément Rosset, en supposant que cet autre est essentiellement littéraire (alors qu’il aurait été possible de le poser comme philosophique, et que la littérature n’est pas nécessairement l’autre de la philosophie). Je m’attarderai à une seule œuvre de Rosset, soit Le Réel et son double, et à une seule partie de celle-ci, soit son « Avant-propos », pour tenter de comprendre pas à pas les modes de rapport à l’œuvre littéraire en jeu et les opérations qui font du texte littéraire un élément de la réflexion. Cela me conduira moins à poser un « propre » de la littérature qu’à constater à quel point la philosophie de Rosset est construite sur un paradoxe qui, loin d’en réduire la portée, me paraît au contraire pouvoir être considéré comme une sorte d’extension intérieure, extension qui concerne aussi la littérature : c’est précisément parce que le réel est insignifiant que nous avons la possibilité du sens, parce qu’aucune transcendance n’est effective que nous sommes effectivement dans la transcendance et parce que tout est non-sens que nous sommes condamnés au sens et que les mots signifient à plaisir.
Épigraphe
5Clément Rosset commence son livre Le Réel et son double par un « Avant-propos » intitulé « L’illusion et le double ». Pourquoi parler ici d’un « Avant-propos » alors que la problématique du livre est abordée d’entrée de jeu, comme en témoigne la première phrase : « Rien de plus fragile que la faculté humaine d’admettre la réalité, d’accepter sans réserves l’impérieuse prérogative du réel4 » ? Le livre ne sera qu’une démonstration de cette difficulté d’accepter la singularité du réel. L’avant-propos n’est donc pas véritablement un avant-propos. Certes, il situe ce qui est à venir, élargit d’avance la perspective, mais nous sommes dès le départ au cœur même de l’argumentation. Ce terme d’avant-propos n’est pas pour autant mal placé ou indifférent. Il produit une certaine séquence dans le texte. Que cette séquence soit artificielle ne change rien. Le texte se constitue lui-même comme autre, ce qui vient ajouter de la valeur à ce qui va suivre, que nous contemplons à l’avance comme un tout unifié.
6J’insiste sur cet aspect structurel du texte de Rosset qui serait sans doute susceptible d’être rapporté à tout texte, avec certaines nuances. Le texte se produit lui-même comme valeur, comme unité, et pour ce faire, il doit en quelque sorte inventer l’autre, se placer sous le signe de l’autre ou, à tout le moins, produire en son sein une sorte de surplomb, un point d’élévation d’où le reste peut être envisagé ou réenvisagé. L’avant-propos est en quelque sorte le prototype de tous ces points d’élévation qui viennent, de par leur différence (l’avant-propos n’est pas tout à fait le propos), matérialiser à l’avance une certaine cohérence, un certain découpage du réel.
7Il en va de même pour le premier recours littéraire de Rosset dans son livre, soit l’épigraphe de cet avant-propos. Or l’épigraphe indique l’esprit de tout le livre en plus d’indiquer celui de l’avant-propos. C’est en partie ce qui m’a autorisé à dire que l’avant-propos n’était en substance que le propos qui commençait, doublé d’un effet que l’on pourrait qualifier de tautologique, un peu comme si un livre s’intitulait Un livre : pourquoi parler d’un avant-propos si tout propos a nécessairement un avant-propos ? L’épigraphe donne le ton, indique les chemins qui seront suivis. Mais pourquoi l’œuvre a-t-elle besoin de se placer sous le signe de l’autre pour trouver sa cohérence ? Poser la question ainsi revient à donner la réponse. Il n’y a de cohérence que sous le signe de l’autre – c’est vrai pour la société, qui se doit de poser une transcendance, ou risquer de se disloquer ; c’est vrai pour toute œuvre, bien que les modalités de ce rapport à l’autre soient loin d’être toutes semblables.
8L’épigraphe cite une phrase tirée du « Double assassinat dans la rue Morgue » de Poe : « Je veux parler de sa manie de nier ce qui est, et d’expliquer ce qui n’est pas. » Certes, cela annonce merveilleusement bien le propos de Rosset qui s’évertue, jusqu’à en faire une manie, à montrer comment les humains sont inévitablement portés à « nier ce qui est » et à « expliquer ce qui n’est pas ». En outre, cela situe le propos de Rosset dans une communauté intellectuelle : Rosset nous prouve en quelque sorte qu’il n’est pas le seul à avancer cela et qu’il est de concert avec Poe, figure comme une autre d’une autorité intellectuelle. De fait, le recours à l’autre suppose qu’une autorité est reconnue à cet autre, qui en retour autorisera l’auteur à poursuivre sur sa propre voie, qui n’est que le prolongement de la précédente. Par ailleurs, la phrase de Poe s’applique non seulement au projet manifeste de Rosset, soit démontrer que nous ne pouvons admettre le réel tel qu’il est, mais aussi à une attitude moins consciente de ses textes : la manie n’est pas seulement du côté de l’objet d’étude, soit l’attitude des humains à l’égard du réel, elle est aussi du côté de celui qui écrit, qui voudrait bien reconnaître et expliquer ce qui est, mais qui finit par regretter que l’acceptation inconditionnelle du réel ne soit pas généralisable.
Croire par exemple
9Le deuxième recours à la littérature dans Le Réel et son double survient alors que Rosset expose les différentes techniques de refus du réel. Il examine le cas du suicide, qui consiste selon lui à « anéantir le réel en m’anéantissant moi-même5 ». Le problème, pour les suicidaires, est qu’il reste toujours « un coefficient d’incertitude » : comment savoir que la mort sera mieux que la vie ? Mais ce qui permet à Rosset d’introduire ce coefficient d’incertitude dans son équation est une remarque de Hamlet. Il faut citer le passage plus longuement pour bien comprendre comment la citation s’insère dans la réflexion jusqu’à en constituer le corps :
Je puis anéantir le réel en m’anéantissant moi-même : formule du suicide, qui paraît la plus sûre de toutes, encore qu’un minuscule coefficient d’incertitude lui semble malgré tout attaché, si l’on en croit par exemple Hamlet : « Qui voudrait porter ces fardeaux, grogner et suer sous une vie accablante, si la crainte de quelque chose après la mort, de cette région inexplorée, d’où nul voyageur ne revient, ne troublait la volonté et ne nous faisait supporter les maux que nous avons par peur de nous lancer dans ceux que nous ne connaissons pas6 ? »
10La citation ne vient pas éclairer ce que Rosset veut dire, comme le suppose Rosset lorsqu’il parle de sa « manière de procéder » (voir plus haut l’extrait d’entretien). Ce sont plutôt les propos de Rosset qui éclairent à l’avance le passage de Shakespeare. Le passage de Shakespeare contient plus de nuances, plus de contenu que la synthèse qu’en fait Rosset – Rosset ne développe pas plus que cela cette technique de refus du réel qui est, il est vrai, insérée dans un ensemble plus vaste. Sans la phrase de Hamlet, il ne serait pas possible de comprendre ce « coefficient d’incertitude ». Quoi qu’il en soit, l’essentiel me semble toujours être la valorisation des thèses de Rosset, valorisation qui est démultipliée par ce recours à l’une des plus grandes figures de la littérature. Détaché du recours à Shakespeare, le cas du suicide aurait eu beaucoup moins d’impact. Comment, en effet, pourrions-nous ne pas croire Hamlet ? Cet exemple n’est pas un exemple parmi d’autres, contrairement à ce que peut laisser penser la formulation de Rosset. C’est l’exemple par excellence – il est vrai que tout exemple vaut comme singularité qui institue un groupe avant de valoir comme élément d’un groupe tiré de ce groupe ; l’exemple masque l’hétérogénéité de ce qu’il regroupe. Néanmoins, culturellement, tout contribue à instituer l’œuvre de Shakespeare comme un découpage idéal de l’expérience humaine. Il est difficile de ne pas croire ce qu’il avance par le biais de ses personnages. Or dire que nous ne pouvons pas ne pas croire implique précisément que nous pouvons ne pas croire. Nous avons toujours cette possibilité de ne pas adhérer à ce qui nous est exposé. Le texte de Rosset travaille constamment, comme beaucoup de textes sans doute, à prévenir cette défection possible du lecteur. Le recours à la littérature est une arme parmi d’autres dans ce combat qui vise à créer ou à maintenir une convergence des points de vue. À partir de là, il y a lieu de s’interroger sur le verbe qui est employé par Rosset pour articuler sa pensée aux phrases de Hamlet : croire. Comme si le trajet qui mène de la philosophie à la littérature impliquait un passage par la croyance. Comme si la littérature était le lieu du croire, le lieu qui fait appel au croire. Comme si la philosophie se devait de faire appel à la littérature pour accéder à ce croire, parce qu’elle a besoin de ce croire, mais qu’elle ne peut y accéder directement.
11Or la littérature n’est pas nécessairement plus que la philosophie le lieu du croire. Un texte philosophique peut très bien faire appel à ce registre du croire pour s’approprier un autre texte philosophique. Le registre du croire n’est sans doute que l’un des modes de recours à l’autre. Mais en même temps, la littérature repose peut-être plus que la philosophie sur le registre du croire, ne serait-ce que parce qu’elle ne se préoccupe pas directement de vérité. La littérature cherche d’abord à installer du vraisemblable – la vérité vient de surcroît –, alors que la philosophie ne se préoccupe de vraisemblable que dans la mesure où il correspond à une certaine vérité. Ainsi Rosset ne convoque pas Hamlet parce que son discours est vraisemblable. Il le convoque parce que son discours correspond à la vérité qu’il veut mettre en lumière. Le problème de la philosophie est que la vérité ne se dit jamais toute et qu’elle doit donc se compromettre dans le vraisemblable. Ce n’est que par le vraisemblable qu’une partie de la vérité se trouve formulée. De là découle la nécessité du recours à l’autre, puisque le vraisemblable se construit justement par une entente entre les uns et les autres. De là découle aussi la pertinence du recours à la littérature, puisque celle-ci maîtrise plutôt bien le vraisemblable et qu’en définitive elle donne accès à une part de vérité de manière assez efficace. De plus, l’utilisation philosophique de la littérature déplace en quelque sorte le regard que nous avons sur le texte littéraire. En lisant Shakespeare, nous avons avant tout conscience de la cohérence de l’ensemble et de la vraisemblance du propos. En nous rappelant Shakespeare à travers Rosset, nous sommes avant tout interpellés par ce possible contenu de vérité de l’extrait qui nous est donné. La philosophie tire la vraisemblance du côté de la vérité (il y a une vérité derrière la vraisemblance), alors que la littérature a plutôt tendance à tirer la vérité du côté de la vraisemblance (il n’y a pas d’autre vérité que la vraisemblance).
12Il n’en demeure pas moins que Rosset demande à être cru, non pas directement, mais par le biais de Shakespeare. Il nous dit en quelque sorte : vous n’avez pas besoin de me croire moi, mais êtes-vous capables de ne pas croire Hamlet ou Shakespeare ? Vous n’avez pas besoin d’accepter la vérité que je vous indique telle quelle, mais pouvez-vous résister au vraisemblable ? L’exemple littéraire est en quelque sorte l’appât qui va attirer le lecteur sur le territoire de Rosset.
Ce que symbolise le geste
13Bien qu’il soit dans leur prolongement, le troisième recours littéraire de Rosset n’a pas tout à fait la même configuration que les deux premiers. Rosset passe en revue les formes radicales de refus du réel – suicide, folie et « aveuglement volontaire7 » – qu’il opposera plus loin à une attitude plus commune de refus du réel. Pour mieux faire comprendre en quoi consiste l’aveuglement volontaire, Rosset ne se contente pas de dire assez simplement ce que c’est – « décider de ne pas voir un réel dont je reconnais l’existence8 » –, il donne encore une fois un exemple tiré de la littérature. Cet exemple lui permet, sans développer son propos, d’ouvrir la réflexion à un ensemble très vaste de considérations. En renvoyant à ce texte, il rappelle tous les « débats », toutes les analyses dont ce texte a été l’objet au fil des siècles : « attitude d’aveuglement volontaire, que symbolise le geste d’Œdipe se crevant les yeux, à la fin d’Œdipe roi, et qui trouve des applications plus ordinaires dans l’usage immodéré de l’alcool ou de la drogue9. »
14Encore une fois, le littéraire atteste le découpage, la vérité du discours philosophique. L’autre – ici la littérature – est le garant du vraisemblable susceptible de conduire à la vérité. Si Rosset peut trouver des exemples littéraires, c’est que son découpage correspond à la réalité. Le problème est que cette réalité mise ici de l’avant n’a probablement plus grand-chose à voir avec le réel généralement promulgué par Rosset, réel qui n’est dans son cas que l’une des faces de la vérité. Le verbe utilisé par Rosset pour introduire Œdipe – symboliser – n’a donc rien d’innocent. Le réel, par définition, échappe à la prise en charge par le symbolique. Or toute médiation entre l’un et l’autre passe nécessairement par le symbolique et ses dispositifs de valeur qui rendent la singularité de l’expérience accessible en la délestant paradoxalement de cette singularité. C’est donc dire que convaincre l’autre de la prééminence du réel revient nécessairement à sortir du réel et à passer du côté du symbolique. Cette aporie de la démarche de Rosset devient particulièrement manifeste avec ses recours au littéraire, puisque le littéraire se trouve mis en position de médiateur (à tout le moins) entre le destinateur et le destinataire. Le littéraire n’est pas seulement le lieu même du symbolique, il est un des points à partir duquel il devient manifeste que le discours de Rosset, qui s’est donné pour tâche de remettre le réel à l’honneur ou de montrer quelles sont les stratégies d’évitement du réel, est lui-même complètement dans le symbolique.
15Par ailleurs, cette fois-ci, l’exemple littéraire se trouve aussi donner plus de valeur aux exemples qui restent de l’ordre de la vie de tous les jours : faire un usage immodéré d’alcool ou de drogue, c’est être comme Œdipe, ni plus ni moins. Cela a bien entendu un double effet. Le contemporain, ou l’ordinaire, se trouve placé dans un contexte humain à la fois global et extraordinaire. Tout alcoolique participe à sa manière à l’humanité, tout alcoolique est pris dans une histoire qui n’est pas moins extraordinaire que celle d’Œdipe. Du même coup, il y a une sorte d’opération inverse, comme si le littéraire devenait plus concret, plus réel, du fait d’être lié à des exemples de la vie quotidienne. Œdipe, en somme, pourrait bien être mon voisin, ou moi – je suis, en tant qu’aveuglé volontaire potentiel, dans une situation qui n’est pas différente de celle d’Œdipe.
16À partir de là, ce que symbolise véritablement le geste de Rosset (recourir au littéraire) est justement cette portée du symbolique : comme Rosset le remarque lui-même à la suite de Lacan, le symbolique désigne « cette aptitude qu’a toute chose, et en particulier toute parole, d’être signifiante non par la simple manifestation d’elle-même mais par l’allusion à une autre chose par rapport à laquelle la chose prend son sens et sa valeur10. » La philosophie prend son sens et sa valeur par allusion à la littérature. L’ordinaire prend son sens et sa valeur du fait d’être rapproché de l’extraordinaire, et vice-versa (ici la valeur provient d’une diminution de la valeur d’opposition communément admise).
Le devenir sensible de la vérité
17Les quatrième et cinquième recours, toujours dans « L’avant-propos », surviennent alors que Rosset aborde la « forme la plus courante de mise à l’écart du réel11 », soit l’illusion, qui ne consiste pas, selon lui, en un refus de la perception, mais en un déplacement de la perception. L’illusionné voit parfaitement ce qu’il en est du réel. Simplement, il n’agit pas conformément à cette perception, comme si, dans la perspective de Rosset, il n’y avait qu’une manière d’agir devant telle perception.
Cette vérité apparemment paradoxale devient sensible dès que l’on songe à ce qui se passe chez l’aveuglé, tel que nous le montre l’expérience concrète et quotidienne, ou encore le roman et le théâtre. Alceste par exemple, dans Le Misanthrope, voit bien, parfaitement et totalement, que Célimène est une cocotte : cette perception, qu’il accueille chaque jour sans broncher, n’est jamais remise en question. Et pourtant Alceste est aveugle : non de ne pas voir, mais de ne pas accorder ses actes à sa perception12.
18Alceste n’accorde pas ses actes à sa perception. Soit. Mais pourquoi faudrait-il accorder nos actes à notre perception ? La question peut paraître idiote, mais elle renvoie néanmoins à une évidence qui n’est pas si évidente que cela et que Rosset évite soigneusement de questionner. Être véritablement dans le symbolique – et l’assumer – c’est nécessairement, parfois, ne pas accorder nos actes à notre perception. Pourquoi le désaccord entre les actes et la perception ne pourrait-il pas être valorisé ? Néanmoins, l’essentiel est de remarquer que l’exemple de Molière donne non seulement du crédit aux thèses de Rosset, mais occulte aussi certaines dimensions du problème : pouvons-nous envisager un instant qu’Alceste ait raison de ne pas accorder ses actes à sa perception ? Par ailleurs, il faut remarquer le glissement qui se fait de la « vérité » au « sensible » grâce à la littérature (roman et théâtre) qui est encore une fois mise sur le même pied que « l’expérience concrète et quotidienne ». Ainsi, tout l’art de Rosset se situe dans une aptitude à faire consonner une vérité supposée mais abstraite et une vraisemblance sensible qui maintient la vérité en la reportant.
19Le sixième recours continue le même mouvement. Il s’agit pour Rosset de rendre sensible cette vérité de l’illusion qu’il a d’abord posée : « L’expression littéraire la plus parfaite du refus de la réalité est peut-être celle offerte par Georges Courteline dans sa célèbre pièce Boubouroche (1893)13. » Le littéraire « exprime » la vérité philosophique14. Les termes « la plus parfaite » indiquent qu’il y a des degrés de qualité dans cette expression de la vérité15. Mais en quoi cette expression est-elle « parfaite » ? Quelle est sa qualité ? Il me semble que sa principale qualité est de ne pas dépasser le propos de Rosset. Il y aurait une correspondance parfaite entre le propos philosophique de Rosset et ce que rend sensible cette pièce. Rosset poursuit donc avec un résumé de la pièce16 et insiste sur son caractère singulier : « la dupe n’a pas besoin d’être trompée, il lui suffit bien d’être dupe17 ». Cela permet à Rosset de révéler la « structure fondamentale de l’illusion » : « art de percevoir juste mais de tomber à côté dans la conséquence18 ». Autrement dit, c’est le littéraire lui-même qui conduit à la « structure fondamentale ». Je vais plus loin. Nous aurions peut-être été plus réticents devant la démonstration de Rosset si celle-ci n’était pas passée par un exemple littéraire dès l’abord posé comme « parfait ». Et peut-être cet exemple n’est-il pas aussi parfait que le suppose Rosset. Peut-être la dupe est-elle quand même un peu trompée. Quoi qu’il en soit, la véritable dupe est le spectateur qui se trouve mis en position de croire que lui ne commettrait pas la même erreur que ce Boubouroche, que lui ne serait pas dans l’illusion, ou qu’il suffit de très peu de volonté pour ne pas être dans l’illusion. Par ailleurs, la pertinence qu’il y a à accorder la « conséquence » à la « perception » n’est jamais questionnée (mais seulement posée comme difficile). Encore une fois, la perfection de l’expression occulte certains aspects du problème : ce qui est visé, c’est la consonance de l’un avec l’autre, du philosophique et du littéraire.
20Rosset effectue la même opération avec Un amour de Swann19. Swann est pour Rosset le parfait illusionné, puisqu’il n’accorde pas ses gestes à sa perception et sépare en deux ce qui ne fait qu’un : il y a la « femme payée » et la « femme aimée ». En cela, Swann serait victime d’une « paresse d’esprit » « congénitale » – Rosset reprend les mots de Proust – paresse qui ne serait pas l’apanage du seul Swann, mais de tout le genre humain. Le recours au littéraire permet donc un passage du singulier-littéraire à l’universel-humain, puisque Swann et sa posture dans le roman sont supposées parfaitement caractéristiques de la posture humaine à l’égard du réel. Encore une fois, la littérature semble faire ici le travail que la philosophie hésite à faire elle-même (déduire l’universel du particulier), pour des raisons qui ont sans doute trait au statut et à la portée de son discours (en modernité avancée, toute prise de parole est a priori suspecte). Comme si la démonstration avait plus de valeur quand c’est l’autre qui la mène, comme si parler en donnant la parole à l’autre c’était rendre sa propre prise de parole moins suspecte.
21Rosset en vient lui-même à questionner ce passage du littéraire à l’universel dans les pages qui suivent, mais d’un tout autre point de vue. Il remarque que les thèmes de l’illusion et du double sont surtout associés à la psychologie (dédoublement de personnalité) et à une certaine littérature, moderne et romantique. Il s’empresse de corriger ce point de vue, susceptible de miner sa démonstration20. En effet, si ses conclusions proviennent seulement d’une certaine littérature (romantique et moderne), leur portée universelle se trouve largement remise en question. Une bonne partie de son livre s’attardera à faire la preuve que ce thème du double n’est pas un phénomène isolé de la psychologie ou de la littérature, mais qu’il traverse au contraire tout l’espace culturel, qu’il soit littéraire ou philosophique.
22Ainsi, Rosset perçoit un risque lié à son utilisation de la littérature. Que le double soit présent en littérature pourrait nous faire croire qu’il n’est pas universel, que c’est un thème ou un problème situé. Rosset cherchera alors à montrer que c’est tout le contraire et la littérature elle-même servira à cette démonstration : en ce qui concerne la propension humaine à l’illusion, Rosset montrera que les mêmes conclusions peuvent être tirées d’à peu près n’importe quelle littérature. L’inscription du thème du double dans la littérature aurait pu être le signe d’un champ d’application restreint de la thèse de Rosset – un signe que l’harmonie n’est pas généralisée. Or Rosset réussit à produire l’effet contraire et à montrer deux fois plutôt qu’une le caractère universel de sa thèse : tout entre en consonance, rien n’est désagréable à l’oreille. Certes, sa démonstration s’avère assez convaincante, mais en même temps, elle oublie, met de coté ou masque certains facteurs. D’une part, la recrudescence du thème du double à certaines époques (romantique, par exemple) reste encore à être expliquée. D’autre part, il y aurait vraisemblablement des contre-exemples littéraires, tout aussi distribués dans le temps, qui permettraient de montrer le caractère positif de l’illusion21.
C’est en ce sens que
23Les sept recours au littéraire dans « L’avant-propos » de Rosset permettent de dresser un portrait assez complet des enjeux de l’utilisation de la littérature chez Rosset, voire dans la philosophie en général. J’ai d’abord remarqué que c’est sous le signe de l’autre que se trouve une certaine cohérence, même lorsqu’il s’agit de rendre compte du même (du réel). Ensuite, j’ai montré comment « l’autre », le littéraire, du simple fait d’être posé comme exemplaire, pouvait se trouver utilisé comme mercenaire dans une lutte pour l’adhésion du lecteur. Ce mercenaire a, comme par hasard, des moyens que le combattant régulier ne se permet pas d’utiliser : le philosophique ne se permet pas de recourir directement au croire, il passe par le littéraire pour se donner cette arme – de ce fait, il recourt directement au croire, puisqu’il nous dit en quelque sorte : je ne me permettrais pas de vous enjoindre moi-même à croire, mais vous pouvez croire cet autre qui vous donne à croire… Par ailleurs, il m’a semblé que ces opérations pouvaient se ramener à la dimension du symbolique, comme si les textes de Rosset se trouvaient réaliser ce qu’ils cherchent à dénoncer. Certes, Rosset reconnaît à de nombreuses reprises l’impossibilité d’un rapport direct avec le réel et le caractère inévitable du symbolique, mais sa philosophie reste profondément structurée par une valorisation (toute symbolique) du réel au détriment du symbolique (élément bien réel de la vie humaine), comme si le réel était mieux que le symbolique. Enfin, j’ai supposé que la principale fonction du littéraire, pour le philosophique, était de rendre sensible une certaine vérité qui reste toujours à dire. C’est d’ailleurs sans doute la fonction de tout symbolique : rendre possible un vivre ensemble autour d’absences. Mais la consonance mise en avant par Rosset s’avère un véritable tour de force (comme toute consonance et tout symbolique) dans la mesure où l’ordre du monde à laquelle elle renvoie est en définitive inexistant, ou chaotique – et reconnu comme tel.
24Tous les recours au littéraire, dans le livre de Rosset, renvoient plus ou moins aux mêmes enjeux. Je ne vois pas vraiment la pertinence de les passer tous en revue, même si chacun amènerait vraisemblablement du nouveau à la réflexion. Néanmoins, en parcourant rapidement ces recours, je ne peux m’empêcher de remarquer la posture de Rosset à l’égard de ces fragments de littérature qui émaillent son propos. Ceux-ci sont toujours des « illustrations », des moyens de rendre sensible une vérité que le philosophe cherche à cerner. Mais au-delà de cette capacité à l’illustration, Rosset doit interpréter les morceaux qu’il donne à lire, leur donner une orientation. Pour le dire autrement, il découpe les morceaux de réel (les signes sont bien réels) qu’il nous donne à lire, il oriente notre lecture (pourrait-il faire autrement ?) – il cherche le véritable sens, plus singulier, plus profond, derrière ces manifestations somme toute incontrôlables. Du sens d’une fable, il va dire : « C’est bien là, on l’a toujours justement dit, le sens le plus manifeste de ce genre de fables. Mais il y a sans doute au-delà de ce sens premier, un autre sens, plus riche et plus général22. » Voilà, me semble-t-il, une attitude qui s’apparente à l’illusion que Rosset dénonce dans son livre. Rosset scinde le sens en deux. Il y a le sens commun, manifeste, que tous perçoivent. Mais il y a aussi un autre sens, plus vrai, plus susceptible de consonance, pourrait-on dire, et Rosset aura l’honneur de nous le restituer. Mon intention n’est pas de dénoncer cette tension vers l’ailleurs qui donne un sens à l’ici, mais bien de montrer à quel point cette attitude dénoncée par Rosset (recourir à l’autre pour donner un sens au même) est inévitable. Le problème est justement celui de la « vérité » dont les fables sont, aux dires de Rosset, « l’écho23 » : celle-ci n’est jamais vraiment là, entre nos mains. Nous la sentons seulement par ailleurs, à travers autre chose ; nous la supposons derrière la « consonance ». Tout le problème du « sens » est dans cette dynamique de l’illusion qu’expose Rosset. Comme il le dit lui-même : « Quelque chose, semble-t-il, se dit dans ces histoires24. » Quelque chose se dit, mais nous ne savons pas quoi. À partir de là, Rosset procède par délimitation progressive du possible du sens. En apparence, cela veut dire cela, mais si on y regarde de plus près, cela veut dire ceci…
25Or ce n’est pas seulement le littéraire qui se trouve réduit jusqu’à correspondre à la démonstration de Rosset, c’est aussi la démonstration de Rosset qui rejoint le littéraire et s’arrime à lui. Après des considérations sur l’impression que nous laisse le réel, à savoir que les événements qui arrivent effectivement sont une caricature de la réalité, parce que nous attendons toujours autre chose, Rosset affirme : « C’est en ce sens que la vie n’est qu’un songe, une fable mensongère, ou encore une histoire racontée par un idiot, comme le dit Macbeth25. » Tout est dans le « c’est en ce sens26 ». La philosophie de Rosset prétend réaliser la parole littéraire, celle qui est la plus vraie, puisque « telle est bien la réalité27 »… Cela devient même une antithèse au regard de ce que Rosset tente de démontrer, à savoir que le réel n’est jamais tel qu’on l’attend : « L’événement réel, au sens courant du terme, est […] toujours “l’autre du bon”28. » Sur le plan du sens, cependant, il n’y a pas de bon qui tienne, il n’y a que de l’autre, même si tout locuteur cherche à faire croire le contraire. Si « c’est le sort de toute réalité que de se situer en dehors du jeu du possible29 », pour reprendre une formulation que Rosset emprunte aux philosophes de Mégare, c’est au contraire le sort de tout sens que de se situer dans le jeu du sens. Le problème, c’est qu’il n’y a pas moyen de toucher à la réalité, au réel ou au possible sans passer par le sens. Cela en revient à ce qui peut être dit de la réflexion sur la tautologie par Rosset30 : la tautologie parle du réel parce qu’elle cerne le singulier (A est A, et pas autre chose). « Ce qui est est et ne peut pas ne pas être. C’est à peu près ce que dit Lady Macbeth31 ». Mais le pouvoir de la tautologie est peut-être à situer du côté du caractère nécessaire du sens. La tautologie montre que le sens ne peut être que le sens. Négativement, elle renvoie néanmoins au non-sens, d’une manière particulièrement efficace, puisque le jeu du sens est comme épuisé à l’avance. C’est un peu comme de dire, avant une partie d’échecs : cette partie d’échecs sera nécessairement une partie d’échecs, ni plus ni moins – à quoi bon, dès lors, la mener à terme ? Justement parce qu’il n’y a pas autre chose que ce jeu, que cette aventure de la consonance.
2614 Plus loin dans Le Réel et son double, Rosset écrit : « Un roman de Robbe-Grillet, Les Gommes, […] exprime très précisément ce rejet du présent et son dédoublement erratique (p. 67, je souligne) ». Ou encore, p. 79 : « C’est ce qu’exprime très clairement Magdelon, dans Molière »…
2715 De l’un des « Contes indiens » de Mallarmé, Rosset dira qu’il est « l’illustration la plus parfaite qui soit de la structure oraculaire (p. 103) ».
2820 Voir ibid., p. 19. Rosset refera le même genre de précisions en fin de parcours (p. 87). Il supposera alors que le double a une origine très ancienne en littérature (qu’il est loin d’être cantonné au xixe siècle) et, qu’en plus, il concerne la peinture et la musique.
2926 Cette opération, qui ramène la réflexion de Rosset au littéraire, ou plus simplement à l’autre, est si fréquente que la formulation « c’est en ce sens » revient sous la plume de Rosset (Ibid., p. 68) : « Et c’est toujours en ce sens que Montaigne décrit le caractère à jamais indigeste du réel, qui fait le bénéfice des souvenirs comme des prévisions : “Notable exemple de la forcenée curiosité de notre nature, s’amusant à préoccuper les choses futures, comme si elle n’avait pas assez à faire à digérer les présentes [Essais, I, chap. XI, Des prognostications.]. »