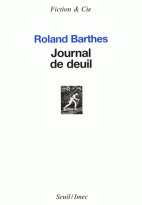
Écrire le deuil
1La publication en 2009 du Journal de deuil de Roland Barthes a suscité une brève polémique : fallait‑il publier ce paquet de fiches, de notations intimes, rédigées pour lui‑même après la mort de sa mère en octobre 1977, et non destinées aux autres, traces de chagrin, bribes d’émotion menant peu à peu à La Chambre claire, monument élevé à sa mère ? Je ne sais pas, mais j’ai lu ces pages avec trouble. En 1977 et 1978, en ce temps‑là, nous nous voyions régulièrement. Découvrir ce texte a été une épreuve : je n’ignorais pas sa dépression, mais n’avais pas vu, ou pas voulu voir, qu’elle était aussi grave. Non seulement ces pages sont poignantes — c’est l’auto‑analyse d’un deuil, aussi intense que dans Albertine disparue —, mais cet écrit de deuil vérifie, en quelque sorte par l’absurde, le lien essentiel du récit et de la vie, constitutif de l’identité narrative telle que Paul Ricœur la définissait : l’écrit de deuil, refusant la vie, ne peut accéder au récit.
2Beyle, ou Henry Brulard, perdit sa mère à l’âge de sept ans, Barthes à plus de soixante ans : peu d’expériences semblent plus éloignées, et pourtant le choc est le même. Ici commence ma vie morale, disait Brulard. Ici commence ma mortalité, suggère Barthes, comme si sa « propre mort » avait été impensable jusque‑là. La mort de la mère rend possible, annonce la mort du fils qui n’a jamais quitté sa mère, a toujours vécu auprès d’elle, l’a soignée durant sa maladie, l’a accompagnée dans la mort : « Pour la première fois depuis deux jours, idée acceptable de ma propre mort », écrit‑il aussitôt (p. 22). Dans le deuil, « la solitude définitive est là, mate, n’ayant désormais d’autre terme que ma propre mort » (p. 45). C’est le premier motif insistant repérable dans ces fragments : l’assomption de la mortalité, l’entrée dans le chemin de sa « propre mort ».
Penser, savoir que mam. est morte à jamais, complètement […], c’est penser que moi aussi je mourrai à jamais et complètement. (p. 130)
3Ou encore :
La vérité du deuil est toute simple : maintenant que mam. est morte, je suis acculé à la mort (rien ne m’en sépare plus que le temps). (p. 141)
Quant à la mort, la mort de mam. me donnait la certitude (jusque‑là abstraite) que tous les hommes sont mortels. (p. 219)
4Le deuxième motif qui traverse ces pages, c’est justement le refus du récit. Céder au récit, à la littérature, cela reviendrait à réfuter, éviter, nier le deuil. Barthes multiplie les remarques sur la contradiction du deuil et du récit, ou même du deuil et du discours, sur leur incompatibilité profonde : « Je ne veux pas en parler par peur de faire de la littérature — ou sans être sûr que c’en ne sera pas — bien qu’en fait la littérature s’origine dans ces vérités » (p. 33). Car raconter, « en parler », ce serait composer, accepter le passage du temps, faire le deuil, expliquer, rationaliser. En négatif, le deuil est l’illustration parfaite du lien entre le récit et le temps. Dans le deuil, refuser le récit, c’est refuser le temps — le temps de vivre.
5La fiche, la notation, l’émotion se présentent ici comme pure répétition de l’instant. Elles résistent à s’inscrire dans la durée. Le Journal de deuil manifeste à chaque page la volonté d’arrêter le temps, de rester sur place, de ne pas bouger. Mais Barthes sait bien — c’est sa contradiction, d’où les redans de sa phrase — que « la littérature s’origine dans ces vérités », autrement dit que c’est avec de telles expériences que l’on écrit, que l’on fait de la littérature, mais cela, on ne peut pas se le dire, le reconnaître. Contradiction : le deuil refuse la littérature, mais il n’est pas de plus grande littérature que celle du deuil.
6Ainsi, le deuil, l’expérience du deuil, puisqu’elle ne peut pas faire l’objet d’un récit, se présente comme une suite de hasards, une succession de moments, d’intermittences, d’éclairs de mémoire, de traits qui rendent à Barthes sa mère. C’est le comble du régime épisodique de l’écrit de vie. Par exemple :
Chez le pâtissier (futilité) j’achète un financier. Servant une cliente, la petite serveuse dit Voilà. C’était le mot que je disais en apportant quelque chose à maman quand je la soignais. […] Ce mot de la serveuse me fait venir les larmes aux yeux. Je pleure longtemps (rentré dans l’appartement insonore) (p. 47).
7Le financier, petit trait de gourmandise, de vie, puis un mot, un simple cri phatique, Voilà, provoquant l’émoi. Le journal reproduit une série d’émotions : « […] mon deuil se réduit à une émotivité » (p. 53). Le deuil est le règne de l’émotivité, ou l’empire des émotions. L’empire du deuil : « Le deuil empire, s’approfondit » (p. 95).
8Hors récit, le deuil présente tous les traits de l’écriture épisodique. Dans le deuil, on touche au fond du Moi erratique, et Barthes insiste sur son aspect « chaotique » (p. 41), ou « cahin‑caha » (p. 50) :
M’effraie absolument le caractère discontinu du deuil. (p. 77)
Deuil : j’ai appris qu’il était immuable et sporadique : il ne s’use pas, parce qu’il n’est pas continu. (p. 105)
9Discontinue, sporadique, répétitive, c’est l’expérience même de l’éternel retour : « Non, le Temps ne fait rien passer ; il fait passer seulement l’émotivité du deuil », non le chagrin (p. 111).
10Le deuil, le chagrin du deuil, pure répétition, échappe par là à toute mise en intrigue, car il est déni de la temporalité. La moindre suggestion de temporalité est intolérable parce qu’elle contient l’idée que le deuil pourrait baisser d’intensité, s’atténuer, s’achever. Barthes qualifie son expérience d’« autre durée, tassée, insignifiante, non narrée, morne, sans recours : vrai deuil insusceptible d’aucune dialectique narrative » (p. 60).
11S’opposant à l’idéologie dominante de la vie comme récit, le Journal de deuil est un écrit de vie paradoxal qui peut servir pour ainsi dire de « raisonnement par l’absurde », ou plutôt de « preuve par neuf », vérifiant la thèse du lien essentiel du récit et de la vie : pas de vie, en tout cas pas de vie bonne, sans récit de vie. Toutes les notations émues de Barthes répètent son refus du temps, c’est‑à‑dire du récit, qui voudrait dire l’atténuation du deuil, et sa volonté de rester dans la répétition, « immuable et sporadique », comme il dit. Le temps du deuil n’est pas accessible à la narration, ou s’oppose de toute sa force, ou de toute l’énergie du désespoir, à la narration qui le nierait, le relèverait, le dépasserait, dans une dialectique associée à la fois au récit et à la vie, à la signification, à la continuité de la vie. Envers du récit, le deuil est l’espace et le temps de l’immobilité et de la répétition.
12Barthes insiste sur le « pays plat, morne » qui l’entoure (p. 63). Le deuil est décrit comme une conscience plate de l’espace et du temps, une platitude perpétuelle du paysage sans horizon, comme celui qui entoure le poète dans de nombreuses pièces mélancoliques des Fleurs du mal ou du Spleen de Paris. Le premier leitmotiv de ce Journal de deuil, c’était la mortalité du fils révélée par la mort de la mère, son installation dans l’attente de la mort, mais cette mort, ou l’attente de cette mort, est plate, perpétuelle, comme Jean Starobinski a parlé de la condamnation à vie à perpétuité pour qualifier la mélancolie de Baudelaire, ou la mélancolie en général. L’éternel baudelairien — ce présent indéfiniment répété — appartient de plain‑pied à ce monde‑ci, comme éternel présent de la damnation : « […] je me sens malheureusement condamné à vivre […] depuis des années qui pour moi ont été des siècles », confiait Baudelaire à sa mère en 1860.
13« Pleine mer de chagrin — quitté les rivages, rien en vue » (p. 224) : image de tant de poèmes de Baudelaire, cet horizon vide retrouvé par Barthes. « En fait, au fond, toujours ceci : comme si j’étais comme mort » (p. 119). Pour le sujet en deuil, toute tentative pour donner du sens, pour narrer, pour dialectiser, pour sortir de la répétition erratique, serait scandaleuse et sacrilège, impie, profanatoire, car elle dénaturerait le deuil, trouverait une issue. Barthes est ému — de manière proustienne, si l’on veut : celle des « intermittences » — par la moindre sensation qui lui rappelle sa mère, et il est ému entièrement, dans une sorte d’envahissement complet, toujours comme au premier jour :
À chaque « moment » de chagrin, je crois que c’est celui‑là même où pour la première fois je réalise mon deuil. / Cela veut dire : totalité d’intensité (p. 85).
14Ces émotions ou ces retrouvailles sont à chaque fois absolues : « Le Moi ne vieillit pas », écrit Barthes à propos d’une boîte à poudre de riz entraperçue dans un film de Bette Davis : « Toute ma petite enfance me revient » (p. 123). (La poudre de riz comme déclic de la mémoire involontaire sera encore évoquée dans La Chambre claire.) Ou, dans un autre « film stupide et grossier », One Two Two (1978), « tout d’un coup, un détail de décor me bouleverse », « une lampe à abat‑jour plissé, cordelière pendant. Mam. en faisait […] Tout elle me saute au visage » (p. 136). Ou encore Ingrid Bergman dans Les Amants du Capricorne de Hitchcock, « quelque chose qui me rappelle mam. », la carnation, les mains (p. 184). N’importe quoi, un détail kitsch, déclenche l’envahissement.
15Curieusement, ces réminiscences intégrales sont provoquées dans le Journal de deuil par des films au cours desquels Barthes tombe sur ce genre de détail saillant qu’il nommera punctum dans La Chambre claire, mais qu’il attribuera alors à la photo, tout en niant que le film détienne cette propriété d’émotion (même si, à la fin de La Chambre claire, une émotion est encore associée au Casanova de Fellini). Si ces émotions totales sont liées à des films dans le Journal de deuil, c’est en raison de l’état de disponibilité dans lequel on se trouve au cinéma — « j’étais triste, le film m’ennuyait » (La Chambre claire, p. 177‑8) —, disponibilité qui accentue l’attente mélancolique, rendant possibles ces moments privilégiés de remémoration.
16Dans le deuil, le Moi reste intact, prêt à être intégralement réveillé au hasard d’un punctum, ressuscité en entier dans une sensation, comme dans Albertine disparue. Barthes, comme le héros de Proust, vit l’angoisse — la culpabilité — de l’atténuation de l’émotion : « Voir avec horreur comme simplement possible le moment où le souvenir de ces mots qu’elle m’a dit ne me ferait plus pleurer… » (p. 67), mots qui avaient été les derniers de sa mère : « Mon R, mon R » (p. 50). Le sujet en deuil lutte de tout son être contre la projection de soi dans le temps. La mort d’une personne proche impose des démarches de survie, administratives, pratiques : « Dès qu’un être est mort, construction affolée de l’avenir (changements de meubles, etc.) : aveniromanie » (p. 16). Tout le reste du monde, tous les autres vous semblent « aveniromanes », maniaques, obsédés de l’avenir, alors que vous vivez dans un présent immobile et vénérez l’éternel retour. Par exemple, lors du tri des photos de la mère huit mois après sa mort : « Un deuil atroce recommence (mais n’avait cessé). Recommencer sans repos. Sisyphe » (p. 151). Barthes se voit comme le héros même de la répétition, condamné à rouler éternellement un rocher jusqu’en haut d’une colline dont il redescendait chaque fois avant de parvenir à son sommet. Le deuil est inénarrable. Commencer de le raconter, sortir du cercle du retour du même, ce serait le nier en son essence d’immobilité. C’est pourquoi le Journal de deuil vérifie négativement, confirme la liaison essentielle du récit et de la vie, du temps de la vie.
17Or, irrémédiablement, le deuil se fait, malgré le déni du temps qui le caractérise. Des étapes sont notées, par exemple la disjonction de l’émotivité, laquelle s’apaise (moins de larmes), et du chagrin, lequel est toujours là (comme une pierre). Changeant de rythme, Barthes constate que « le deuil prend son régime de croisière » (p. 112). Même si « l’émotivité revient » par à‑coups (p. 118) — mais c’est par exemple en relisant le journal (p. 163), ce qui atteste malgré tout une distance, un journal qu’on relit n’étant déjà plus un journal immédiat, confiné à la notation instantanée de l’émotion —, le deuil s’inscrit peu à peu dans une histoire, dans un récit. Barthes observe des phases : il entre dans le « second deuil » (p. 157), comprend qu’alors « le vrai deuil commence » (p. 159), et la lecture de Proust, après huit mois, le transforme (p. 168).
18Bon gré, mal gré, le journal devient ainsi le récit du travail d’un deuil, il annonce un livre à venir, qui mêlera la photo et maman : « Hâte […] de me mettre au livre sur la Photo, c’est‑à‑dire d’intégrer mon chagrin à une écriture. […] Croyance […] que l’écriture dialectise les crises » (p. 114). Revoilà l’écriture. Elle revient avec sa dialectique, naguère honnie : par elle, il s’agit d’intégrer, de dialectiser ; écrire, c’est toujours dialectiser. Barthes ne se refuse plus à prononcer ces mots, allant même jusqu’à concéder que le travail du deuil ne pourra s’accomplir que comme un travail d’écriture :
Je transforme « Travail » au sens analytique (Travail du Deuil, du Rêve) en « Travail » réel — d’écriture. […] pour moi il n’est accompli que dans et par l’écriture (p. 143).
19L’idée d’offrir à sa mère un monument dans un livre donne un but à son deuil : « Nécessité du “Monument” » (p. 125) ; « il m’est nécessaire […] de faire ce livre autour de mam. » (p. 144)
20Ainsi, le chagrin passera d’un « état statique », celui de l’éternel retour, de la répétition indéfinie, à un « état fluide », donc marqué par l’écoulement, le mouvement, le développement (p. 154). C’est ce que Barthes note le jour même de juin 1978 (ce sera en novembre dans La Chambre claire, pour la Toussaint) où il tombe sur la Photo du Jardin d’Hiver, qu’il placera au cœur de La Chambre claire, et où il en est « bouleversé » (p. 155), comme le narrateur de Proust parlait du « bouleversement de toute [sa] personne » lors de sa deuxième arrivée à Balbec, quand il découvrait la réalité de la mort de sa grand‑mère. Barthes a dès lors un but : « écrire le texte sur mam. : le départ actif du Chagrin : l’accession du Chagrin à l’Actif » (p. 217).
21Voilà donc un écrit de vie paradoxal, parce que deuil et récit sont antinomiques. Le récit suppose le mouvement, la projection, la protension ; le deuil réclame le retrait, l’immobilité. Le récit tend à la résolution ; le deuil prétend à la répétition. Et pourtant le journal — genre de la pure répétition : « Je ne fais rien ; j’écris que je ne fais rien », disait Blanchot — est emporté inexorablement par le temps, par le cours des jours, par la vie quotidienne. Barthes, se réclamant du Nietzsche de Deleuze, l’un de ses livres fétiches, consent à ou même recherche ce qu’il appelle « l’accession du Chagrin à l’Actif », c’est‑à‑dire la transformation de l’Éternel retour comme retour du même — le deuil comme émotivité —, en l’Éternel retour comme assomption d’une nouvelle vie, Vita Nova, dans la tristesse et la mélancolie, dans le passage du deuil comme phase à la mélancolie comme état.
En moi, luttent la mort et la vie (discontinu et comme ambiguïté du deuil) (qui l’emportera ?) […]. Le problème dialectique, est que la lutte débouche sur une vie intelligente, et non une vie‑écran (p. 162).
22La dialectique fait ainsi retour ; d’abord honnie comme issue et donc négation du deuil, elle est maintenant décrite comme une lutte entre la mort et la vie, avec une relève qui ne serait pas la négation du deuil, mais sa transformation en vie dans le deuil.
23Qu’on le veuille ou non — mais Barthes envisage ouvertement ce qu’on pourrait appeler avec Nietzsche une transvaluation volontaire du deuil —, le deuil semble en voie de se faire dans cette évocation d’une autre vie, intelligente et non pas écran (souvenir du souvenir‑écran). Barthes décrit ainsi des moments d’oubli passager du deuil — non pas ceux du retour de la vie ou du désir, comme ambiguïté du deuil, mais ceux de l’épuisement, du tarissement, de l’abandon — moments auxquels il donne les noms savants ou exotiques de vacillation, vide, fading, emprunté à la radio (chute temporaire de l’intensité du son) et à Lacan (immobilisation du cours de la pensée, évacuation du sujet), ou satori (emprunté au zen), et qui lui procurent le sentiment du « passage de l’aile du Définitif » (p. 127). Le deuil devient une stase assumée, un état permanent. Barthes parle plus loin d’« une sorte d’aile noire (du définitif) [qui] passe sur moi et me coupe le souffle » (p. 192). Tel ce satori du week‑end du 15 août, dans la vacuité de Paris abandonné, « comme si mon deuil s’apaisait, […] comme si “je me retrouvais” » (p. 201). Le silence, la vacance, la disponibilité, la fatigue blanche au fond du marasme. « J’écris de moins en moins mon chagrin mais en un sens il est plus fort, passé au rang de l’éternel, depuis que je ne l’écris plus » (p. 226). Après le deuil émotif, c’est l’installation dans l’éternité atone, dans l’acédie sempiternelle des moines (p. 238).
24La transvaluation du vide en amor fati se veut une ascèse, l’affirmation d’une Vita Nova. Le deuil entre dans le discours et même dans le récit : Barthes parle d’habiter son chagrin : « J’habite mon chagrin et cela me rend heureux. / Tout m’est insupportable qui m’empêche d’habiter mon chagrin » (p. 185). Il veut « le parler, le phraser », avec l’aide de Proust, grâce à la Recherche du temps perdu, mais aussi avec les lettres et la vie de Painter (p. 187). Le langage, naguère honni pour son pouvoir réducteur et généralisateur, se présente désormais comme un remède :
Ma culture, mon goût de l’écriture me donne ce pouvoir apotropaïque, ou d’intégration : j’intègre, par le langage. / Mon chagrin est inexprimable mais tout de même dicible. Le fait même que la langue me fournit le mot « intolérable » accomplit immédiatement une certaine tolérance(p. 187).
25Ce qui était intolérable quand un interlocuteur nommait deuil son chagrin, devient acceptable sous sa plume, par le miracle de l’écriture : l’écriture est toujours de vie, même dans le deuil. Comme le sphinx mélancolique qui chante encore aux rayons du soleil qui se couche dans le deuxième « Spleen », le but de la littérature de deuil n’est pas la cure, la guérison, ou l’élégie, mais le monument élevé au mort, dans l’assomption d’une autre vie sans trahison. Écrire, ou survivre sans trahir, dans le deuil définitif.
26Ainsi les notes du Journal de deuil se raréfient au moment d’entrer dans La Chambre claire : « Sans doute je serai mal, tant que je n’aurai pas écrit quelque chose à partir d’elle (Photo, ou autre chose) » (p. 227). L’entrée en littérature, et La Chambre claire sera bien un récit, se fera dans l’acceptation de « l’épaisseur du temps » :
Ce qui me sépare de mam. (du deuil qui était mon identification à elle), c’est l’épaisseur (grandissante, progressivement accumulée) du temps où, depuis sa mort, j’ai pu vivre sans elle, habiter l’appartement, travailler, sortir, etc. (p. 239).
27Dans La Chambre claire, toute cette expérience du temps propre au deuil sera déplacée sur la photo. La photo hérite des qualités du deuil, notamment l’antinomie au récit. La photo, comme le deuil, c’est l’anti‑récit. C’est ce qui la distingue du cinéma où
il y a toujours du référent photographique, mais ce référent glisse, il ne revendique pas en faveur de sa réalité, il ne proteste pas de son ancienne existence ; il ne s’accroche pas à moi : ce n’est pas un spectre. Comme le monde réel, le monde filmique est soutenu par la présomption « que l’expérience continuera constamment à s’écouler dans le même style constitutif » ; mais la Photographie, elle, rompt « le style constitutif » (c’est là son étonnement) ; elle est sans avenir (c’est là son pathétique, sa mélancolie) ; en elle, aucune protension, alors que le cinéma, lui, est protensif, et dès lors nullement mélancolique (qu’est‑il donc, alors ? — Eh bien il est tout simplement « normal », comme la vie). Immobile, la Photographie reflue de la présentation à la rétention (CC, p. 140).
28Barthes oppose alors la photo au cinéma (alors que les résurrections de la mère, on l’a vu, avaient lieu au cinéma). Le cinéma est du côté de la vie, de la normalité, de l’avenir, de la protension, de la confiance, de la narration, du « style constitutif » : Barthes cite Husserl, de seconde main, via la psychanalyse — dont ses textes sont imbibés —, et sa définition du monde réel comme « présomption constamment prescrite que l’expérience continuera constamment de se dérouler selon le même style constitutif », confiance première dans la continuité du monde comme condition du récit, mais que refusent le deuil et la photographie. La photo serait quelque chose comme la stabilisation, la perpétuation du deuil, et donc l’envers du récit. Alors que le deuil passe, la photo reste, comme le deuil définitif.
29À nouveau, aucune dialectique possible :
Je puis le dire autrement. Voici de nouveau la Photo du Jardin d’Hiver. Je suis seul devant elle, avec elle. La boucle est fermée, il n’y a pas d’issue […] je ne puis transformer mon chagrin, je ne puis laisser dériver mon regard ; aucune culture ne vient m’aider à parler de cette souffrance que je vis entièrement à même la finitude de l’image. […] la Photographie — ma Photographie — est sans culture : lorsqu’elle est douloureuse, rien, en elle, ne peut transformer le chagrin en deuil. Et si la dialectique est cette pensée qui maîtrise le corruptible et convertit la négation de la mort en puissance de travail, alors, la Photographie est indialectique […] elle exclut toute purification, toute catharsis (CC, p. 140‑141).
30Donc toute poétique — la catharsis au sens de la Poétique d’Aristote —, toute narratologie.
31Barthes attribuera à la Photo, qui immobilise le temps à jamais, toutes les qualités du deuil, ou du chagrin, comme antinomie du récit. Si le récit et le film sont liés à la vie, Barthes insiste sur « le lien anthropologique de la Mort et de la nouvelle image » (CC, p. 144). Dans la Photo comme « Mort plate », on retrouve cette morne plaine : « elle ne m’apprend rien » (CC, p. 165), et il n’y a rien à interpréter dans une photo. À sa surface, l’immobilisation du temps et l’arrêt de l’interprétation vont ensemble.

