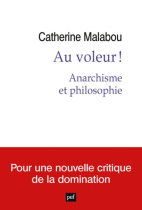
Anarchie radicale & anarchisme méthodique
1« Au voleur ! », le livre de Catherine Malabou se lit comme une géographie critique du concept d’anarchie. Six leçons dédiées à six philosophes rattachés à la tradition dite continentale se succèdent et s’enchaînent (Schürmann, Levinas, Derrida, Foucault, Agamben, Rancière), formant l’archipel d’une pensée en chemin, plutôt qu’un exposé synthétique. Un choix en partie dicté par le sujet de l’essai, intotalisable par essence. La perspective est herméneutique, au sens large. L’objectif : montrer les apories où s’enferment les philosophes examinés, puis interpréter, de manière globale, ces impasses comme un impensé collectif. De l’anarchisme historique, il ne sera (presque) pas question.
2En raccourcissant à l’extrême, on dira que C. Malabou opère un partage. D’un côté, elle distingue les penseurs qui, comme Schürmann, Levinas ou Derrida, buttent sur une limite conceptuelle : la difficulté à déborder le pouvoir par quelque chose qui ne soit pas du pouvoir, à concevoir ne serait‑ce que les contours d’un « État qui soit garant d’anarchie » (p. 147). Dans ce cas‑ci, c’est le « concept » d’anarchie qui ne se laisse ni transcender ni déconstruire sans violents paradoxes. De l’autre, ceux qui, comme Foucault, Agamben ou Rancière, achoppent sur l’anarchie au moment de mettre la dernière main à leur critique de la souveraineté, car « personne ne croit que les hommes peuvent vivre sans gouvernement » [souligné par l’auteure] (p. 373). Dans ce cas‑là, c’est la « forme » politique de cette absence qui confine à l’impensable : l’anarchie est impuissante à s’illustrer par ses œuvres. Pour sortir de ce double bind, la solution de C. Malabou consiste alors à relier le concept d’anarchie à la pulsion de mort freudienne, à son « énergie » (p. 391) de destruction libératrice. Cela revient à envisager l’anarchie comme une sorte de cancer conceptuel et/ou social, vivant aux dépends de cela même qui le fait vivre.
3Mais quel gain de compréhension ce déplacement permet‑il ? Tout au long de l’ouvrage, l’anarchie est tenue pour une notion stratiforme, opacifiée par de nombreuses couches de sens et de contresens qu’il convient de décaper pour faire apparaître, dans ses contradictions mêmes, la scène informulée : un geste familier à la tradition à laquelle appartiennent les philosophes examinés. Cependant la visée ultime de l’ouvrage n’est pas archéologique, mais politique. C’est toute l’ambiguïté du positionnement de C. Malabou : comment (re)penser les rapports de domination à la lumière de leur négativité, si l’examen de cette négativité aboutit à la conclusion qu’il est impossible de le faire, parce que celle‑ci n’est jamais assez négative ?
4Reprenons. Les deux prémisses du problème posé par C. Malabou se laissent reformuler ainsi. Prémisse majeure : la notion d’anarchie, articulée autour de la dyade commandement/commencement, a gagné ses quartiers de noblesse au cours du xxe siècle, à la faveur de la déconstruction de « théories politiques plus établies » (p. 19), comme le marxisme. C’est cette dyade, que C. Malabou nomme aussi « principe archique », contre laquelle s’érige l’anarchie : le surgissement injustifié et injustifiable d’un pli qui vient séparer « commander » et « obéir ». Prémisse mineure : l’anarchisme politique échoue à mettre en œuvre une tactique anti‑hégémonique sans devenir elle‑même hégémonique ; si ce n’est sporadiquement, et encore.
5Ces deux prémisses permettent à C. Malabou de formuler la conjecture suivante, qui constitue le fil rouge de l’ouvrage : les penseurs de l’anarchie refusent systématiquement de se regarder au miroir de l’anarchisme. Ce refus forme, pour elle, le symptôme d’un déni majuscule. Pourquoi ce refus ? Ce n’est pas tant par crainte d’être assimilés aux partisans des doctrines anarchistes qui historiquement ont partie liée avec la violence : violence des bombes ou violence ultralibérale. Mais plutôt que ces philosophes, face au constat de l’impossibilité de contourner le problème de l’origine de la domination, évitent la question du « provenir » (p. 94) de l’autorité. En fait, ils ne la démantèlent jamais assez. Si bien qu’aucun d’entre eux n’atteint le point où la vie reste purement étrangère à l’obéissance. Ils se contentent de produire une critique de la gouvernementalité, non de l’exploitation. C. Malabou insiste de manière énergique sur ce « vol » philosophique qui laisse entière la question de savoir ce que l’anarchiste fait de son propre pouvoir.
Radicalité ou insatiabilité ?
6Par un tour propre à la tradition herméneutique, la langue contient toujours, au moins en puissance, la possibilité de son inversion : une thèse peut être posée, niée, dépassée, inversée sans cesser de signifier. Le langage a en effet la propriété de pouvoir s’excéder lui‑même et, contrairement à la logique propositionnelle, de se sursignifier à l’infini, prospérant gaiement dans l’ambivalence. Ainsi, sans souffrir de contradiction, l’obéissance peut‑elle « précéder le commandement », la souveraineté peut‑elle « inclure par exclusion », etc. Les signifiants deviennent flottants, ils déplacent la signification des termes, les séparent de leurs signifiés pour les conduire à un point où, C. Malabou l’admet elle‑même, ils disent « tout — et rien » (p. 323).
7Si « l’impensé » de la philosophie (continentale) se lit dans son incapacité à déborder le concept d’anarchie par la pensée d’un agir anarchiste vraiment anarchiste, alors « l’impensé » de la réflexion de C. Malabou tient, elle, à ce qu’elle se condamne à réitérer la radicalité du geste qu’elle prétend condamner. On ne peut imposer la terreur dans les concepts sans s’exposer soi‑même à être débordée par une terreur plus radicale encore. C’est, à notre sens, toute la difficulté de faire usage d’un mode de parole indifférent au vrai et au faux : on peut poser le problème, mais non proposer des « solutions » (p. 397).
8Oui, l’herméneutique a tendance à s’exprimer par hyperboles, dans le but d’atteindre un surcroît de sens, une exceptionnalité (s’exceptant de toute signification antérieure), une radicalité de l’expression, commune aux mystiques et aux révolutionnaires. Mais c’est oublier un peu vite que la radicalité se mue en terreur sitôt qu’elle fait usage de son pouvoir de différenciation (puisqu’on peut toujours être plus excessif et facilement ne pas l’être assez). En l’occurrence, l’anarchisme n’est jamais assez anarchiste, et son enveloppe reste, hélas, vide de tout contenu propositionnel. L’ultime reversement opéré par l’auteure, qui consiste à faire de cette impossible thématisation le propre de l’anarchisme, ressemble d’ailleurs fort à une esquive.
9C’est le deuxième « impensé ». Une fois l’anarchisme identifié à ce qui est résolument « étranger » (p. 52) à la volonté d’être commandé, une fois désarticulés les divers modes du pouvoir (ontologiques, politiques) pour faire reluire le fonds inexpugnable de pouvoir qui hante encore les débris de cette déconstruction, pourquoi retenir son élan ? Pourquoi ne pas aller au bout de la critique en s’attaquant aussi au pouvoir (linguistique) de la rhétorique ? Pourquoi ne pas admettre que le destin de l’anarchisme est miné — « toujours déjà », pour parler de manière hyperbolique — par les effets de pouvoir inhérents à l’usage, même le plus innocent, de la langue ? Pourquoi refuser de penser que le langage aussi est « voleur » ? Cette pensée ne renvoie ni à l’analyse du différend de Lyotard, ni à celle du mécompte de Rancière. Elle est très simple. Elle se limite à observer que les énoncés ne sont pas seulement assertés, mais indexés (ce qui est passé sous silence) à l’énonciateur qui se donne le droit de dire ce qu’il dit. En d’autres termes, délibérer, parler, indépendamment du « dissensus » (p. 337) qui fait l’objet de la délibération, renvoie automatiquement à la valeur sociale de l’énonciateur, c’est‑à‑dire au pouvoir que, à tort ou à raison, il s’attribue.
10S’il est vrai que la parole, le discours se distribuent toujours à l’intérieur de schémas de pouvoir en compétition pour l’occupation d’une place, démasquer ce « vol » supposerait, chaque fois, de déposer intégralement la structure de pouvoir qui autorise quiconque à parler. Aussi, tout anarchisme digne de ce nom devrait s’atteler à inventer un mode indifférencié d’énonciation où les énoncés seraient pris en compte pour eux‑mêmes, sans égard pour la qualité, réelle ou supposée, de l’émetteur. Retour à l’envoyeur : comment ne pas dominer le sujet de la non‑domination ? Mais cette piste, qui ne fait relancer paresseusement l’insatiable roue herméneutique, égare (et s’expose elle‑même à être débordée). Faisons un pas de côté.
Brisure de symétrie
11Vraisemblablement, il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que le problème du « principe archique » reçoive une explication — une explication de type causale. Ce genre de problème paraît voué à rester énigmatique. La naissance de l’autorité, du pouvoir, in fine de la domination, repose, comme l’écrit Montaigne, sur un fondement « mystique ». L’auteur des Essais ne dit pas mystérieux, il dit : mystique. Pour lui, comme pour les auteurs lus par C. Malabou, ce socle – ou son absence – nécessite, au plan humain, un acte de croyance qui supplée le défaut de la logique. C’est un aspect qui paraît indépassable : le pouvoir, au commencement, n’a ni justification ni source.
12Tentons une analogie. Lorsqu’un matériau peu élastique comme le verre est soumis à une tension, il rompt. Il est alors possible de connaître précisément les conditions de la rupture, mais pas de prédire où, ni quand, la rupture aura lieu. Peut‑être la naissance de l’autorité s’apparente‑t‑elle à un phénomène de ce type : à une brisure de symétrie. Un individu se met à commander, l’autre à obéir parce qu’à certaines conditions inhérentes au matériau qu’est la vie, par exemple l’individuation (être né tel) ou la spécialisation (avoir du talent pour), l’un se sentira autorisé à tirer profit du dire ou de l’agir de l’autre. Celui qui prend l’ascendant jugera légitime d’exploiter pour son compte un avantage qu’il se figure, à tort ou à raison, détenir. Son pouvoir naît d’une emprise sur la sincérité d’autrui à laquelle il répond de manière insincère. Comment ? En payant de fiction, c’est‑à‑dire de vacuité, son dire‑vrai ou son savoir‑faire.
13L’idée de « fracture anarchique » (p. 291) figure une fois dans les pages de C. Malabou. L’expression désigne alors le hiatus que vient combler dans l’après‑coup politique l’usage de symboles. La fracture, dit C. Malabou, précède les symboles, dont la fonction est de masquer l’asymétrie originelle. On peut regretter qu’un aspect aussi décisif ne soit traité qu’en passant. Pour le dire vite, les symboles entrent dans la catégorie, plus vaste, des fictions, dont ils sont une sorte. En ce sens, « fictif » est tout système de valeurs qui repose sur le principe qu’adhérer à ces valeurs est souhaitable/détestable, et que dès lors ces valeurs existent : la monnaie, le prestige, l’identité nationale, etc. La liste est très hétérogène.
14Les symboles sont les plus évidentes fictions qui gouvernent les hommes. Ils appartiennent au régime du visible parce qu’ils donnent à voir — c’est leur fonction — la prétendue légitimité du gouvernement qui les emploie. Ils sont brandis comme preuve ou étendard de cette légitimité (ce que bien entendu ils ne sont pas). Le régime visible des symboles, aussi bien que les fictions qui les sous‑tendent, supplée en fait l’impossibilité, pour quiconque, d’administrer, dans le régime du dicible, la preuve de son autorité1. Autrement dit, le pouvoir est toujours obligé de faire un détour par la fiction pour fonder le principe de son action.
15Ce dont convient C. Malabou, c’est que le surgissement du pouvoir est antérieur à la naissance de la politique. Antérieur à tout ordre du partage du commun. Ce trauma de l’origine condamne ainsi la politique à chercher un ordre — ou un non‑ordre — dans un monde où non seulement les places ne sont pas distribuées de manière égale, mais où cette inégalité est exploitée à des fins égoïstes. À bien y penser, seule une société parfaitement vertueuse, où chacun s’acquitterait spontanément, sincèrement, à tour de rôle, des diverses tâches productives, mériterait être appelée « anarchiste ». Au détour d’un commentaire de Foucault qui cite le physiocrate Quesnay, C. Malabou laisse entendre qu’en effet de tels hommes éprouveraient l’inutilité de la « logique de gouvernement » (p. 232), et esquisse, sans le dire ouvertement, ce que serait pour elle les contours — utopiques — d’une vie commune non gouvernée.
Maison versus navire
16À travers la série d’exemples qui ponctuent l’ouvrage, le lecteur parvient à reconstituer partiellement ce que pourrait être l’essence de l’anarchisme politique. Mais en creux, « en négatif » (p. 54), puisque l’auteure s’interdit d’en fixer le programme. On retrouve ainsi pêle‑mêle des expérimentations politiques (les ZAD, le hacking), des occasions historiques (la Commune) et des récits ethnographiques (sur les Inuits). Des agencements sociaux plutôt convenus qui, pour C. Malabou, manifestent par éclipse « l’indifférence » (p. 392) au pouvoir et la tentative de restauration d’un lien — vital, biologique, écologique — entre la politique et l’ontologie, entre les formes de vie et l’Être, le vrai, le seul anarchiste, qui « se fout du pouvoir » [souligné par l’auteure] (p. 385).
17L’anarchisme de ces sociétés s’organise effectivement contre la structure hiérarchique du commandement, mais leur caractère prototypique n’est pas si évident. D’abord, le refus de l’autorité — qui n’est pas l’indifférence de l’anarchisme véritable (mais alors que valent ces exemples ?) — ne signifie pas l’abolition de la violence et des rapports de domination. Ici, le jeu de la guerre remplace la servitude volontaire ; là, la terreur révolutionnaire donne la chasse aux tièdes. Ensuite, c’est assez frappant, aucune de ces expérimentations ne se confronte jamais au problème de la production. L’anarchisme empirique est un parasitisme qui (sur)vit aux dépens d’un système de production existant. En effet, théoriquement sans rapports de domination, ces expériences d’horizontalité ne peuvent se maintenir que sur les forces actives, préexistantes, d’un système d’exploitation économique. C’est, sans jugement de valeur, une cancérisation de la société qui, pour être indifférente au pouvoir, se fout de la société. Et les Inuits ? Et les Tupinambas ? En vérité, eux aussi ont un chef, « planificateur des activités économiques et cérémonielles du groupe2 », dont l’autorité s’exprime pleinement chaque fois que fait irruption une « crise destructrice3 ». Le pouvoir revient, là encore, par où on l’avait chassé. Nécessité de produire et nécessité de commander — peut‑il en être autrement ? — marchent de conserve.
18Si le pouvoir vient avant la politique, c’est que la gestion des modes de production commande les principales options de gouvernance. Logiquement, la question « qui fait quoi » vient avant celle de savoir comment organiser « qui fait quoi ». La division du travail requise par la production distribue des rôles qui doivent être remplis : cela peut être à tour de rôle, indifféremment de la répartition des aptitudes et des talents ; cela peut aussi se faire selon un ajustement aux aptitudes et aux talents. En fait, n’importe quelle position intermédiaire entre ces deux pôles est apte à constituer une politique.
19C. Malabou rappelle au début de son livre qu’Aristote passe de la description de l’économie domestique de la « maison » (oikos) à celle, politique, de la cité en usant d’une métaphore, celle du navire. Le philosophe compare l’ordre des citoyens à un « navire », structuré de part en part par la spécialisation technique. Chacun y occupe une fonction propre. La lecture de C. Malabou invite alors à lire l’analyse politique du Stagirite comme une aporie. Le capitaine du navire et le chef de maison, en réalité, ne font qu’un : l’un et l’autre commandent sans avoir à obéir. Implicitement, être gouverné, c’est être « naturellement destiné à obéir » (p. 76).
20On trouve chez Melville une analogie similaire entre maison et navire. À cette différence pourtant que l’auteur de Moby‑Dick les oppose : le navire est une sorte maison flottante, et pour cette raison le contraire d’une maison. D’un point de vue constitutif, dit Melville, la maison cache son principe d’organisation intérieur, tandis qu’à l’inverse le navire est réduit à son existence propre4. Le navire est un monde totalitaire, fait de règles et de hiérarchies, de chaîne de commandements, d’obéissance aveugle. Un monde sans exception, structuré en vertu du principe égalitaire de la règle (la même pour tous). La maison, comme le capitalisme, naturalise l’obéissance (en cachant son principe, absent par principe). Le navire, comme le marxisme d’État, transforme le principe d’égalité en régime d’oppression. Maison et navire ne figurent pas seulement la métaphore du « bluff » au fondement du contrat social, mais aussi, dans un horizon élargi, les deux pôles du champ politique : repoussants l’un comme l’autre.
De la méthode
21L’anarchisme a un air de parenté patent avec le scepticisme. Les deux paradigmes — politique, logique — ont en commun d’assigner une tâche illimitée au travail du négatif. Travail jamais achevé, jamais assez excessif. À force d’être sceptique, on devient paranoïaque. À force d’être anarchiste, on devient terroriste (au moins à l’échelle des idées). L’anarchisme comme le scepticisme en tant que fin font basculer la pensée dans une spirale, précisément, sans fin. Dans une belle page, C. Malabou décline, en les récapitulant, toutes les raisons pour lesquels « on ne peut pas être anarchiste » (p. 382). Le motif est partout identique : l’anarchisme se tient toujours au‑delà de la « subversion de la légitimité de l’anarchisme » (p. 384).
22Or, telle est la structure de l’au‑delà : faire entendre l’excès du sens dans une surenchère interminable. Il y a toujours un au‑delà de l’au‑delà, à l’infini. Dans un régime non poétique du discours, il faut combattre cette dérive, cette production de surplus transcendantal. Faute de quoi, la pensée se voue à une radicalité vaine : pour aller au‑delà, plus loin, extrémiser, purifier, il faut nier — tout en prétendant que l’on affirme — toutes les déterminations précédentes et l’articulation entre ses déterminations : dépasser le pour, le contre, dépasser la dialectique du pour et du contre, dépasser le dépassement, dépasser la contradiction qu’il y a à dépasser le dépassement, etc.
23L’inflation rhétorique paie par son audace — son pouvoir — verbale, mais, faute d’établir les critères d’évaluation et de validation de son objet, reste vide, évidemment. De la même manière qu’il faut imposer une limite raisonnable au doute, il faut mettre un frein à la dérive transcendantale de l’anarchisme. Si l’anarchisme est, en effet, comme le martèle fort justement Catherine Malabou, l’unique instrument critique dont la philosophie dispose pour déconstruire les architectures pourries — maison, navire — des structures qui nous gouvernent, il serait bon, comme d’un pied‑de‑biche, d’en faire un usage méthodique.

