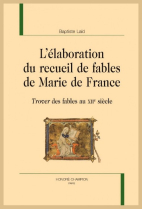
Une rose-des-vents dans la littérature française du XIIe siècle : Marie de France & ses Fables
1Si nombre de médiévistes se sont évertués à découvrir qui se cachait derrière la mystérieuse Marie de France, active à la cour anglo-normande d’Henri II Plantagenêt durant ce qu’on appelle la Renaissance du xiie siècle (p. 13-14), les chercheurs prétendent aujourd’hui renouveler le regard sur l’écriture de Marie plutôt que de s’adonner à de nouvelles enquêtes biographiques. Si l’attention a longtemps été portée sur ses Lais, une place est désormais systématiquement ménagée aux Fables, qui ont surtout retenu jusqu’ici la critique anglophone. L’ouvrage publié par Baptiste Laïd se veut une analyse des conditions d’élaboration, de transformation et de circulation des Fables tout à fait innovantes à cette époque et jusqu’au xive siècle au moins.
Un nouvel éclairage sur les Fables
2L’approche se propose de « dépasser le cadre de l’œuvre et du genre, tant son auteur s’est montrée sensible à de multiples courants littéraires et culturels et s’est positionnée au croisement des histoires de la littérature didactique, du récit court comme de la vie politique de son temps. » (p. 13) On saluera par conséquent la grande richesse de cet ouvrage qui adopte une double perspective, à la fois celle de l’organisation propre aux fables de Marie, mais aussi celle de tous les textes qui ont pu être éventuellement en sa possession, qu’elle a pu traduire, simplement consulter ou même entendre afin de s’en inspirer. Par ailleurs, B. Laïd ne se limite pas au recueil de Marie, mais examine le paysage littéraire au sein duquel elle a écrit, donnant ainsi une idée assez précise des différentes veines littéraires qu’elle a pu exploiter ou influencer et dressant le portrait d’une écrivaine au carrefour de plusieurs traditions et plusieurs civilisations, somme toute, une véritable « rose-des-vents » littéraire. Ce travail se justifie pleinement et l’auteur n’omet pas de rappeler ceux qui l’ont précédé et de préciser les lacunes qu’il souhaite combler : l’objectif est de compléter les travaux déjà constitués, notamment à la suite de Léopold Hervieux, Eduard Mall1, Karl Warnke2 ou encore récemment Mohan Halgrain3, mais aussi et surtout d’étudier la place que Marie occupe dans la famille des fabulistes, de Phèdre jusqu’à La Fontaine. C’est en adoptant cette perspective plurielle, difficile à tenir et qui demande une lecture attentive mais soutenue par le très rigoureux appareil stemmatique et intertextuel en annexe (p. 360-433), que B. Laïd fait le pari de confronter les textes de Marie et leurs sources avec une rigueur philologique remarquable visant à « faire voir la poétique manifestée par la structure d’ensemble et tout autant [se] pencher sur l’élaboration de chaque fable » (p. 17).
La bibliothèque de Marie ou le labyrinthe de Dédale
3L’ouvrage, en repartant des hypothèses et suggestions de K. Warnke, éditeur et commentateur des Fables, commence par faire un état des lieux très précieux des textes avec lesquels Marie a pu être en contact et se concentre sur la postérité de la fable de la fin de l’Antiquité jusqu’au xiie siècle. L’auteur entend bien se concentrer sur la « patte » de Marie, comme il le dit : « le verbe trover, trois fois répété dans le prologue de Marie, apparaître comme le maître-mot du labur, le « travail » dont elle assume fièrement la maternité dans son épilogue. » (p. 12)
Marie latiniste
4Un premier ensemble de sources latines, dont B. Laïd est un vrai spécialiste4 et auxquelles il a consacré d’autres travaux, peut être considéré, selon deux directions. Un important nombre de fables phédriennes a été mis en prose par un certain Romulus, mais leur qualité poétique est relativement médiocre, tandis que se développe parallèlement un remaniement des mêmes fables, en vers cette fois, attribué à un certain Avianus. De ces deux traditions complexes naissent d’une part le Romulus de Nilant, remaniement en prose de la première tradition, entre la France et l’Angleterre, et d’autre part, deux recueils réalisés à partir d’une version perdue de celui-ci qu’on appelle le Romulus anglo-latin : le Romulus hexamétrique, en latin, vers le xe siècle, et les Fables, de Marie, au xiie siècle. Dans ce dédale manuscriptologique, on observe un grand nombre de fables de Phèdre et de ses continuateurs, comme Avianus, poète qui aurait vécu au ve siècle, dont on conserve quarante-deux fables dans un manuscrit du ixe siècle et qui est le recueil le plus populaire à l’époque de Marie, car Avianus vise surtout le raffinement poétique qu’il peut atteindre en réécrivant les fables, en s’intéressant aux métaphores complexes et aux particularités lexicales (p. 33). Son recueil sera d’ailleurs repris à la fin du xie siècle par un auteur anonyme appelé le poète d’Asti. Un manuscrit du xe siècle, conservé à Londres, contient quatre-vingt-cinq fables en prose écrites par un certain Romulus qui présente son travail comme une traduction du grec vers le latin. Marie le cite, tandis qu’elle ignore Avianus, ce qui révèle une popularité qui ne doit pas être ignorée. Le recueil de Romulus aura quant à lui été exploité par un moine du monastère de Saint-Martial-de-Limoges, au début du xie siècle, un certain Adémar de Chabannes, qui en modifie cependant profondément la structure. En revanche, les recueils d’Avianus et de Romulus, bien que très différents, « représentent à eux seuls […] l’essentiel de la tradition occidentale, et ce qu’était la « fable », le genre ésopique, pour Marie et ses contemporains » (p. 41). L’auteur insiste toutefois sur deux de ces textes qu’il juge primordiaux pour « comprendre l’histoire textuelle du recueil de Marie », le Romulus de Nilant et le Romulus hexamétrique. Le premier recueil est le fait d’un rédacteur qui a visiblement souhaité étoffer le texte dégradé dont il s’est emparé, dont l’objectif apparaît davantage pragmatique que littéraire, comme une « entreprise essentiellement restaurative et pédagogique » (p. 43), dans un milieu scolaire et monastique, ainsi que l’a identifié Jeanne-Marie Boivin5. En revanche, le second recueil adopte une perspective bien plus littéraire, en utilisant le vers caractérisé par un certain nombre d’archaïsmes, en inventant des personnages et en mentionnant des dieux païens, même si l’entourage codicologique de ce recueil reste orienté vers une lecture scolaire puisque le manuscrit qui le renferme contient également les Disticha Catonis, un recueil de proverbes pour apprendre la langue latine, ainsi que l’Ilias latine, un résumé de l’épopée homérique en mille hexamètres dactyliques, ainsi que par les fables d’Avianus, en distiques. Ce dernier recueil et les Fables de Marie seraient en définitive, selon plusieurs critiques, des dérivations d’un manuscrit lui-même dérivé du Romulus de Nilant, le Romulus anglo-latin (p. 48).
Le trompe-l’œil des fables d’Alfred
5Un autre ensemble de textes doit être considéré dans la mesure où Marie les mentionne dans son épilogue, perturbant ainsi l’annonce du prologue qui présentait son recueil comme une traduction de fables ésopiques : il s’agit d’un mystérieux recueil de fables anglaises, qui serait l’œuvre du roi saxon Alfred, mais dont aucun manuscrit n’a été retrouvé. Si K. Warnke a longtemps supposé une source anglophone perdue, B. Laïd repousse, à l’instar d’autres spécialistes comme R. T. Pickens6 l’obsession philologique du manuscrit perdu et penche plutôt pour une attitude traditionnelle dans les prologues médiévaux, celle de l’évocation d’une source factice (p. 50-55).
Le « mirage oriental »
6Enfin, il s’agit de réexaminer l’hypothèse d’un hypotexte oriental, que B. Laïd admet pour deux fables uniquement. Il faut considérer d’une part la traduction grecque du recueil arabe de fables indiennes Kalila wa Dimna, sans doute transmise en Sicile par Syméon Seth, vers le xie siècle, et un recueil en latin qui propose, en Aragon, au xie siècle, des contes et récits moraux venus du monde arabe. Les deux recueils les plus fréquemment rapprochés de celui de Marie sont le Pañcatantra, qui relate comment le sage Visnusarman est chargé par un raja d’éduquer ses trois fils, il invente pour ce faire des contes moraux mettant en scène deux personnages de chacals et constitue ainsi un miroir des princes, et Sindbad, dont le texte est arrivé en Occident dès le xiie siècle, sous la forme célèbre du Roman des Sept Sages de Rome. Cette activité prolifique de traduction des textes orientaux rend plausible l’idée que Marie ait pu en prendre connaissance. La fable 73 (« Le mulot qui cherchait à se marier ») est une des seules qui prouve la parenté entre le texte de Marie et ceux de la tradition du Pañcatantra, même si Marie supprime et opère des transformations. Par ailleurs, l’auteur s’appuie par exemple sur la démonstration de J. Merceron pour montrer que la fable 53 (L’ermite) est en fait un exemplum déjà présent dans la tradition hagiographique soufie du xe siècle. La « moisson orientale » (p. 76) de Marie est donc en définitive bien maigre, même si elle a sans doute eu un accès oral à un grand nombre de textes arabes et orientaux. Dans tous les cas, cette vaste cartographie des sources nous indique que Marie est avant tout une grande lectrice, qui travaille son matériau, mais pas uniquement dans la direction pédagogique vers laquelle bon nombre de ses sources ont été composées. Troverece, elle est aussi et surtout une écrivaine dont les textes prennent une dimension résolument éthique, civique et politique. Rimer a pour elle un intérêt bien supérieur à l’apprentissage de la langue.
Marie, lectrice & troveresse : une écrivaine politique
Une écrivaine de son temps
7En effet, si Marie ouvre son recueil par l’adaptation d’une quarantaine de fables tirées du Romulus de Nilant, son entreprise ne saurait être considérée comme une simple copie car elle réoriente totalement la direction philosophique des textes dont elle s’inspire, et souhaite actualiser ses sources en vue de les adapter aux relations sociales du monde féodal. Sa méthode consiste surtout à « exploiter les rapports de force décrits par les récits des fables pour les mettre au service d’une nouvelle intention didactique et politique » (p. 79). Marie vise d’abord une efficacité stylistique, en réduisant considérablement le nombre de mots par fable par rapport à ses prédécesseurs, elle favorise la concision et l’exposition en début de fable. En revanche, ce qui semble l’intéresser davantage est l’importance des moralités qui gagnent en épaisseur. Par ailleurs, Marie pratique une narrativisation des textes qu’elle exploite en déployant et en transformant les contextes de départ des fables, comme dans Le renard et l’aigle (fable 10), « le récit, désormais présenté en trois étapes, connaît une progression claire : il introduit d’abord le protagoniste et sa situation, puis le personnage secondaire puis l’élément perturbateur » (p. 99). On voit donc peu à peu se dessiner chez Marie une méthode de construction poétique, « le point de départ du récit prend place dans un contexte et non plus ex abrupto » (p. 99). C’est donc précisément à ce niveau que son travail est lisible puisque le matériau latin est constamment refondu, et l’auteure, dans ses incipit, « s’attache ainsi à établir un contexte, une histoire préalable aux événements de la fable latine, avant de commencer le récit » (p. 102), comme l’avait déjà remarqué Charles Brucker7. Elle progresse également vers une humanisation des personnages qui composent ses fables, en accordant la parole aux animaux, caractéristique typique de la fable, en alternant le discours direct et indirect, ou en exploitant la multitude des registres pour renforcer l’intensité dramatique de ses récits : toutes ces techniques ont pour objectif d’accentuer l’anthropomorphisation à l’œuvre, et « la sympathie ou l’antipathie que le lecteur peut ressentir à son égard » (p. 106). D’ailleurs, l’auteur aurait éventuellement pu se livrer ici à une petite comparaison avec les Lais où la parole féminine est aussi un vecteur important de la sympathie ou de la solidarité du lecteur : le clerc anglais de la cour d’Henri II, dans sa Vie seint Edmund le rei, nous explique sur un ton volontiers agacé à quel point les Lais et leurs personnages humains, mais surtout féminins, plaisent aux dames :
Kar mut l’aiment, si l’unt mut cher
Cunte, barun e chivaler
E si en aiment mut l’escrit
E lire le funt, si unt delit,
E si les funt sovent retraire.
Les lais solent as dames pleire :
De joie les oient e de gré,
K’il sunt sulum lur volenté8.
Transformations & adaptations : la marque d’une auteure
8Évoquer la modification du ou des hypotextes qu’a utilisés Marie implique d’étudier bien sûr les transformations formelles qu’elle a engagées, mais aussi les transformations thématiques auxquelles elle s’emploie. Marie, comme l’insistance sur le travail, le labur littéraire auquel elle se livre dans ses prologues nous invite à le penser, est une femme de son temps et elle écrit aussi pour lui. Il semble qu’on puisse voir chez elle une forme d’historicisation ou du moins une féodalisation de la fable, comme dans « Le milan malade » (86) ainsi qu’une politisation, grâce à l’anthropomorphisation des figures animales puisque ce qui intéresse surtout Marie, c’est la transformation des « confrontations horizontales » mises en scène dans la tradition latine, c’est-à-dire le fort contre le faible, l’intelligent comme le benêt, l’injuste contre l’innocent, et les conséquences des actions négatives du felun. En effet, et au contraire de ces types de conflits, elle invite à une lecture politique et sociétale de ses textes en se focalisant sur les « oppositions verticales hiérarchiques », c’est-à-dire en étudiant les rapports sociaux de pouvoir, en observant par exemple les actions du seigneur (fables 2, 6, 7, 15, 20, 22, 25, 27) face au vilein, qui traduit le terme homo dans la fable 37. Un autre rapport concerne l’opposition entre le riche et le povre, comme dans les fables 4, 7, 10, 11, 16 et 38, et se substitue souvent à l’axe fort-faible présent dans le Romulus de Nilant. Enfin, la transformation intervient chez les personnages eux-mêmes puisqu’on observe bon nombre d’animaux motivés à l’idée de changer de statut social, d’habitat ou de nature comme les lièvres de la fable 22, ou les grenouilles de la fable 18, les fables de « L’hirondelle » (17) et du « mariage du Soleil » (6) montrent par exemple des vassaux en lutte avec un seigneur au mauvais comportement. Parmi ces nombreux exemples finement analysés par B. Laïd, on retiendra que « cette relation intime qu’entretiennent termes sociaux et éthiques suggère bien que, pour Marie, la traduction des fables en termes féodaux n’est pas un simple déplacement anachronique qui aurait pour but de rendre accessibles à un lecteur moderne des préceptes déjà présents dans le Romulus de Nilant qui lui seraient devenus incompréhensibles. Au contraire des maximes générales de la fable latine, elle fait table rase pour proposer les leçons d’une politique strictement moderne » (p. 124). Enfin, et plus qu’une description de ces rapports sociétaux, Marie, à travers ce procédé généralisé de transmotivation, est aussi à lire dans une perspective éthique comme l’a bien remarqué R. H. Bloch en disant que « l’éthique prônée par les Fables s’érige contre la verticalité et la personnalisation de la féodalité »9. Elle manifeste cette capacité que reconnaît Jacqueline Cerquiglini-Toulet à la littérature médiévale, à savoir celle d’encourager le lecteur à entendre ces conceptions éthiques, et même de lui en imposer le devoir10, sans toutefois adopter le ton prescriptif du Romulus de Nilant. B. Laïd, adroitement, parle moins de morale que d’une « éthique en négatif » (p. 150) pour signaler à quel point l’auteure préserve la coopération intellectuelle du lecteur, faisant ainsi de l’écriture de Marie une écriture participative et civique : « à l’instar de la fable grecque placée sous le patronage d’un Ésope volontiers railleur et de la fable latine phédrienne souvent proche de la satire, le programme didactique des Fables est composé en grande partie d’une éthique en négatif. Elle prend la forme d’une galerie de contre-modèles constamment repris, retravaillés, complétés par des morales qui saisissent à chaque récit une nuance inédite » (p. 150).
Le mystère & la passion d’une écrivaine : au-delà de la fable
9La dernière partie de ce travail prend aussi le parti d’observer l’organisme littéraire qui se constitue autour de Marie qui apparaît à bien des égards comme une matrice, nourricière ou réceptrice de l’influence d’une multitude de genres littéraires, dont B. Laïd s’emploie à repérer chaque trace comme lorsqu’il est question de la fable 58, « Le renard et le reflet de la lune », dont la trame narrative se trouve dans les fables grecques anonymes, chez Phèdre, mais aussi dans la copie d’Adémar pour finir dans le recueil de Marie. L’étude adopte ainsi une perspective dérivationnelle et permet l’observation du réseau dans lequel l’écriture de Marie s’invente.
Un comique protéiforme
10Le premier genre dont la portée est réévaluée est celui du fabliau, et en particulier la veine comique qui le caractérise. C’est la présence des fables humaines, dans la section 41-57, qui motive ce choix. Si P. Nykrog avait assimilé quelques fables de Marie à des fabliaux, selon la définition que Joseph Bédier, dans son étude de 189311, en donne, la critique est revenue depuis sur ce choix, notamment en invoquant le critère de la mise en recueil qui suppose une subordination des fables les unes aux autres. En revanche, « la plupart des critiques ont cependant été d’accord pour voir dans le recueil de Marie un prédécesseur immédiat du fabliau » (p. 189), notamment parce qu’il a été remarqué qu’un certain nombre d’entre eux possédait une morale mais ce critère ne doit pas être systématiquement convoqué dans la mesure où un bon nombre de morales restent dominées par une veine humoristique ou parodique. Sur un plan thématique, des similitudes sont bien sûr identifiables comme les thèmes de l’échange entre marchands ou du jugement que Marie hérite directement de la comédie latine ; ou bien encore, ceux de la femme adultère ou contrariante. Le fabliau célèbre Les tresces, par exemple, suit de près le schéma de la fable 44 de Marie. Malgré ces traits communs, des différences discriminantes entre les deux genres se trouvent dans le traitement des motifs thématiques puisque l’orientation de Marie reste morale, strictement, et que les comportements susceptibles de faire rire ont toujours une valeur illustrative mais aussi interventionnelle dans une direction éthique et politique. D’autres formes de littérature plaisante ont aussi eu un éventuel rôle à jouer dans le développement conjoint du fabliau et de la fable, comme la chanson et un certain nombre de poèmes latins à sujets grivois, véhiculant des clichés misogynes et une certaine paillardise, pour lesquels d’ailleurs il aurait peut-être été intéressant de parler aussi de l’écriture des Goliards, en plus d’évoquer l’influence de la lyrique occitane, dont certaines pièces peuvent user d’un registre comique. Musicale, ou au moins souvent orale, la poésie des Goliards, notamment celle des Carmina Burana, a mis en scène des personnages féminins souvent audacieux, en même temps que maltraités, mais constituant souvent une lutte des sexes entre masculin et féminin, dont la vivacité d’action n’est pas loin des fables de la femme contrariante de Marie12, et surtout, leurs pastourelles n’ont pas d’inclination anti-religieuse comme l’a rappelé Michel Zink13. Par ailleurs, l’un des goliards les plus prolifiques, Pierre de Blois, a laissé une œuvre importante et a été en contact avec la cour d’Angleterre dont il a instruit de nombreux princes aux alentours des années 1150-1180. Marie a pu en entendre parler peut-être plus facilement que des pièces lyriques de Guillaume d’Aquitaine, notamment parce qu’elle lisait le latin, ce qui a pu faciliter l’accès à ces textes, même sur un mode aural. Aurait pu aussi être envisagé un petit détour par le genre spécifiquement occitan du sirventes, dont la fortune a pu nourrir certaines pièces satiriques des trouvères dans la lyrique du nord14, même si globalement la veine satirico-politique d’un Bertrand de Born ou quelque peu misogyne d’un Marcabru en début d’activité n’a pas été très suivie par les trouvères du xiiie siècle. Un dernier ensemble, selon B. Laïd, a pu nourrir conjointement la tradition de la fable et du fabliau, c’est celui du conte comique, représenté à la fois par le recueil de la Disciplina clericalis, de Pierre Alphonse, après sa conversion au christianisme au début du xiie siècle, et par les pièces-poèmes comiques écrites en latin à la même époque. C’est surtout l’intention morale de l’auteur de la Disciplina clericalis qui peut le rapprocher des objectifs de Marie, car comme chez elle, l’écriture littéraire est présentée – c’est là l’enseignement de Lucrèce, puis d’Horace – comme un miel poétique destiné à faire passer les idées philosophiques, l’exercitatione philosophiae mollienda et dulcificanda est, comme Pierre Alphonse le dit dans son prologue. Par ailleurs, ce recueil a été sensible à la tradition littéraire arabo-perse et indienne. B. Laïd en fait cette fois un partenaire essentiel dans l’élaboration du recueil de Marie (p. 208), mais aussi le lieu du « premier exemple littéraire » du fabliau (p. 209). En ce qui concerne la comédie latine, la comœdia, qui renvoie aux textes latins de la fin du xiie siècle, les liens avec Marie sont plus ténus car la méthode de l’auteure ne consiste jamais « en l’extraction d’épisodes à partir d’ensembles plus importants » (p. 214). En revanche, la culture cléricale s’en est sans doute inspirée et Marie a pu avoir accès aux motifs thématiques utilisés. Plus précisément, il est pertinent de retenir que l’œuvre de Marie et celle de Jean Bodel ont joué un rôle important dans la constitution du fabliau comme genre littéraire, en cela que tous deux ont formalisé un matériau comique d’origine extrêmement variée. Marie apparaît dans ce paysage littéraire comme une rose-des-vents, elle reçoit un matériau littéraire qu’elle intègre, en même temps qu’elle en crée un nouveau et qu’elle indique de nouvelles voies, et en particulier philosophiques et morales, pour l’utilisation de ce matériau comique. « L’aire d’influence anglo-normande, que Marie a contribué à enrichir, a peut-être ainsi été à l’avant-garde du phénomène de basculement en français des récits comiques latins, écrits ou oraux » (p. 238).
Loups & renards : les prémices de la littérature animalière
11Un certain nombre de fables animales, celles qui suivent la section 41-57 du recueil, mettent enfin en scène les personnages du loup et du renard, car Marie a probablement hérité du même ensemble de sources qui ont donné naissance au roman épique animalier, l’Ecbasis captiui au xie siècle, puis Ysengrimus et le Roman de Renart, au xiie siècle, étant entendu que les multiples branches de ce dernier récit ont profondément contribué au développement du genre, aux côtés des bestiaires et de fables ésopiques protéiformes. L’anthropomorphisation des animaux est pourtant un critère discriminant entre la fable et l’épopée, qui accorde une vocation souvent satirique ou parodique à l’animal. Les liens entre ces deux épopées et le recueil de Marie restent pourtant difficiles à établir, en dépit d’une identification d’un ensemble de textes carolingiens (p. 249 et 306) qui attestent de la circulation d’un certain nombre de thèmes lupo-renardiens dès le xe siècle : l’auteur pense au De gallo, le poème d’Alcuin, dans lequel le coq est capturé par le loup, situation que Marie réutilise dans la fable 60, à ceci près que c’est cette fois le renard qui est dupé. Si l’on peut écarter l’hypothèse d’une dérivation de l’Ysengrimus aux Fables, ou inversement, Marie se révèle en tout cas être la plus proche des sources anciennes (p. 305), parmi lesquelles on compte aussi un certain nombre de chansons plaisantes comme les Carmina centulanensia, où le moine utilisant le dos du loup pour quitter sa fosse est celui revient dans la branche xviii du Roman de Renart. Dans tous les cas, l’activité de Marie et celle de ses pairs nous renseignent sur la fécondité de la littérature animalière à cette époque, à la différence essentielle que le divertissement n’est pas suffisant pour Marie qui affirme dans le prologue des Fables : « mes n’i ad fable de folie / u il n’e ait philosophie ».
Une écriture chrétienne
12De manière plus subtile mais néanmoins visible, Marie dissémine dans son recueil une dimension chrétienne incontestable (cf. fables 48, 52-55, 72), qui passe par la féminisation d’un certain personnel divin pouvant avoir trait peut-être au développement de la poésie mariale dans laquelle la figure de la Vierge se substitue progressivement à celle de la domna courtoise, notamment chez les troubadours de la fin du xiie siècle et chez les trouvères. En effet, il aurait pu être intéressant de se souvenir que le xiie siècle est aussi la période d’activité de saint Anselme de Cantorbéry ou de Fulbert de Chartres, le grand précurseur marial de l’époque. Certains troubadours voient déjà dans la femme la figure de la Vierge15. En féminisant les figures divines, Marie semble assez proche de cette tendance, comme dans la fable 48, celle du voleur et de la sorcière, qui rejoue les épisodes biblique et évangélique de la tentation diabolique. La sorcière, bien qu’étant une figure négative, mais aussi une figure du savoir, offre au voleur, comme la Vierge, l’occasion de se racheter. En outre, les puissances divines du paganisme antique sont remplacées par le crieür unique, la sepande, la destinee, termes qui rappellent l’idée de la Providence chrétienne. Les formes du proverbe et de l’exemplum sont en lien direct avec les fables, qui peuvent constituer un étoffement narratif des premiers, quand ceux-là peuvent concentrer sous une forme percutante la quintessence morale d’un récit plus développé. De nombreux manuscrits contiennent souvent à la fois des formes brèves et des narrations, comme la construction du recueil scolaire de la Fecunda ratis, par Egbert de Liège, en atteste : la partie prora (proue) contient les sentences et les proverbes populaires, la partie puppa (poupe) concentre les récits, bien qu’elle ne se livre pas à la compilation d’exempla. Au contraire, Marie n’oublie jamais le plaisir de ses lecteurs qu’elle veut surprendre autant qu’instruire (p. 352), entreprise qui justifie pour elle la narration.
Conclusion
13Cette étude conséquente et de grande qualité a ainsi le mérite de livrer une analyse précise des processus de composition du recueil de Marie, qui fait œuvre d’une imposante conjointure, sans toutefois chercher à lever tous les mystères qui entourent son auteure et ses sources, comme nos suggestions supplémentaires de sources éventuelles ont tenté de le montrer. D’une grande rigueur philologique, l’auteur éloigne pourtant l’approche dépassée de l’obsession de la source fixe et favorise au contraire une lecture dynamique du recueil de Marie, proposant des hypothèses stimulantes d’interprétation qui permettent d’envisager le paysage littéraire dans lequel la fabuliste du xiie siècle s’inscrit, mais aussi celui qu’elle nourrit et prépare pour les siècles à venir, en composant finalement son recueil « comme un reliquaire de tous les genres brefs, animaux et humains, antiques et médiévaux, comiques et philosophiques » (p. 351). C’est là respecter l’esprit dans lequel Marie a constitué son œuvre, celui d’une écriture généreuse, mais dont le mystère reste indispensable16 pour fasciner et faire participer le lecteur à l’élaboration du sens, leçon qu’elle retient du grammairien du vie siècle, Priscien, comme elle l’explique dans le prologue de ses Lais :
Ceo testimoine Precïens,
Es livres ke jadis feseient
Assez oscurement diseient
Pur ceus ki a venir esteient
E ki apprendre les deveient,
K’i peüssent gloser la lettre
E de lur sen le surplus mettre17.
14Cet ouvrage ne manque pas sa cible en insistant sur cette part de mystère irréductible qu’il a toutefois tenté de réduire. Il réussit le tour de force d’éclairer la mémoire du texte de Marie, sans pour autant nier que toujours, l’écrivaine du xiie siècle exploite « la profondeur et le velouté de l’antérieur18 », nous faisant toujours glisser, sur des fables qui, près de huit-cents cinquante ans après avoir été écrites, n’ont pas encore révélé tous leurs secrets.

