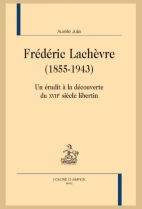
À la rencontre d’un bibliographe
1C’est un ouvrage surprenant que nous livre Aurélie Julia avec cette monographie sur Frédéric Lachèvre (1855‑1943), bibliographe de renom auquel nous devons la redécouverte de nombreux auteurs — notamment libertins — du XVIIe siècle : outre une édition des Œuvres libertines de Cyrano de Bergerac, parisien (1619‑1655) publiée chez Honoré Champion en 1921, on lui doit la publication de textes de Théophile de Viau, de Jacques Vallée des Barreaux ou de Claude Le Petit, entre autres, auxquels s’ajoutent plusieurs recueils collectifs de poésie. La surprise ne vient pas tant toutefois de ces noms et ces œuvres exhumés, ni même du lien de parenté.
2 La surprise ne vient pas du lien de parenté qui unit ici l’auteur et son sujet — Aurélie Julia est l’arrière‑petite‑fille de l’érudit, lien de parenté qu’elle assume pleinement sans pour autant renoncer à tout souci d’objectivité ; la surprise vient plutôt de la richesse historique de ce parcours à travers la vie et l’œuvre d’un homme passionné de livres. De livres, entendons‑nous bien, bien plus que de littérature : c’est là un point important sur lequel nous reviendrons.
3Richesse historique : de fait, c’est toute la fin du XIXe siècle et le début du XXe qui se rappellent à nos yeux par le biais du regard porté par la recherche, et plus précisément la bibliophilie, sur les temps passés. Ce faisant, l’ouvrage d’Aurélie Julia interroge la notion même de recherche mais aussi les fondations qui président à l’élaboration de toute construction intellectuelle. Tels sont du moins les enjeux que nous retiendrons de notre lecture.
Un esprit en clair‑obscur
4Présentons tout d’abord plus précisément l’ouvrage d’Aurélie Julia ; après un court avant‑propos dans lequel l’auteur explique sa démarche qu’elle présente comme l’effort de replacer la contribution de Frédéric Lachèvre à sa juste place, une introduction revient sur le statut particulier qu’occupait l’érudit : relu encore aujourd’hui par certains étudiants en lettres, même si c’est avec un regard critique, Frédéric Lachèvre se défendait d’appartenir au monde des enseignants et de l’Université avec lesquels il fut d’ailleurs souvent en désaccord ; il se rattachait plutôt lui‑même à la communauté des bibliophiles, ou, plus précisément encore, des bibliographes. « Amateur fantaisiste » donc, se demande Aurélie Julia, ou « scientifique impeccable » ? Car s’il rejette le milieu universitaire, il ne se réclame pas moins d’une rigueur et d’une précision qui n’ont rien à envier à l’objectivité scientifique. Telle est la première mais non la seule ambiguïté du personnage.
5Le premier chapitre tente ensuite de dresser un portrait de celui qu’Aurélie Julia qualifie d’» esprit en clair‑obscur ». De fait, les quelques éléments biographiques proposés, tout comme la présentation globale du travail mené par Frédéric Lachèvre, justifient un tel qualificatif : l’homme a sans nul doute, a fortiori pour nous lecteurs du XXIe siècle, quelque chose de fascinant, dans la mesure où il semble à la fois représentatif d’une époque et d’un mode de vie passé — celui de la riche bourgeoisie d’avant‑guerre — et original pour son époque même ; homme d’affaires devenu riche, il se passionne pour l’exhumation des livres anciens et des manuscrits qu’il glane au fil de ses recherches et qu’il se donne pour mission de publier. Son édition des textes reste toutefois celle d’un amateur, aussi passionné soit‑il : comme le souligne A. Julia, la présentation des textes obéit toujours au même plan unique, et aucun réel travail d’édition critique n’est réalisé, ce qui n’empêche pas le souci du détail.
6Frédéric Lachèvre œuvre ainsi pour la réimpression de nombreux ouvrages, y compris licencieux, alors même que la question de la censure fait débat en son temps ; il va jusqu’à assumer ses choix en publiant certains de ces textes à compte d’auteur. Audacieux ? Peut‑être. « Courageux », « travailleur » sont des termes qui le caractérisent sans nul doute : Aurélie Julia fait, à plusieurs reprises, la démonstration de la constance de l’érudit, dans ses convictions comme dans ses combats (par exemple face à ses principaux détracteurs, évoqués dans les dernières pages de l’ouvrage), ou encore dans son amitié avec Pierre Loüys qui partage son amour pour la bibliographie, amitié sur laquelle l’auteur s’attarde à la fin du second chapitre. Fidèle donc, Frédéric Lachèvre, l’est aussi dans ses opinions politiques : homme attaché à la tradition et l’autorité, il assumera sa préférence pour les idées monarchistes et nationalistes de son temps. Voici encore une contradiction apparente qui fera l’objet du troisième et dernier chapitre de l’ouvrage : comment expliquer dès lors, en effet, l’intérêt que porte Frédéric Lachèvre au libertinage ?
Un spécialiste du libertinage ?
7Un esprit en clair‑obscur donc, sans nul doute. Mais d’abord et avant tout : un bibliophile passionné, un bibliographe consciencieux. Le second chapitre est l’occasion pour Aurélie Julia de revenir longuement sur l’émergence et la constitution de ces communautés des « fervents du livre » : là réside l’une de ces richesses historiques de l’ouvrage. L’auteur revient en effet sur les enjeux, notamment politiques, de cette pratique nouvelle qui consiste à collectionner des livres anciens, c’est‑à‑dire d’avant la révolution et qui sont souvent le symbole de l’Ancien Régime, autant dans leur contenu que dans leur matérialité même, nombre de ces livres ayant appartenu à l’aristocratie exilée. L’auteur nous rappelle notamment comment le bibliophile devient même une figure sociale perçue très différemment par les uns et les autres. Elle insiste également sur le rôle que jouera Fernand Vandérem dans le renouveau de la bibliophilie, contribuant en particulier à en préciser les règles. Quant au travail du bibliographe, il est également remis en perspective face notamment à celui d’historien de la littérature avec lequel il a partie liée tout en en étant bien distinct : ainsi il ne s’agit pas pour Frédéric Lachèvre de se livrer à un travail de recontextualisation des textes en vue de les interpréter — même s’il se livrera aussi à cet exercice, au fil de ses publications, du Prince des Libertins, Jacques Vallée Des Barreaux (1907) à Les Derniers libertins (1924) en passant notamment par Le Libertinage devant le Parlement de Paris : le procès de Théophile de Viau (1910) — mais plutôt à une recherche d’attribution des textes, et ce faisant à une réhabilitation des auteurs « introuvables » et des « négligés de l’histoire » : citons, entre autres, Claude de Chouvigny, Jean Dehénault, Robert Angot de L’Eperonnière ou encore Pierre‑Corneille Blessebois, surnommé dans l’ouvrage éponyme qui lui est consacré en 1927 « le Casanova du XVIIe siècle ».
8Il convient toutefois de s’entendre sur les enjeux de cette réhabilitation, notamment à l’égard des œuvres libertines exhumées par l’érudit : tel est de fait l’objet du dernier chapitre de l’ouvrage d’Aurélie Julia, consacré plus précisément au rapport entretenu par Frédéric Lachèvre avec ce XVIIe siècle auquel il s’est majoritairement consacré, lui qui semblait peu sensible à la littérature de son temps. Cette réflexion est là encore l’objet d’une remise en contexte historique tout à fait intéressante : non seulement l’auteur revient sur la naissance du concept de libertinage, mais elle montre que c’est plus largement l’image même du XVIIe siècle, perçu comme pivot de notre histoire et emblématique de notre culture — n’est‑ce pas après tout le siècle du classicisme ? — qui est en jeu. Rappelons à sa suite que c’est le romantisme qui, le premier, va chercher dans les « grotesques » du XVIIe chers à Théophile Gautier la source d’un génie national… Mais au‑delà, c’est toute l’image d’un XVIIe siècle « classique » précisément, ordonné, rationnel, qui se craquèle, et avec lui tout un modèle social et politique de référence qui tremble sur ses fondations. La question qui se pose alors aux littérateurs est reformulée en ces termes par Aurélie Julia : comment étudier les poètes de l’Ancien Régime sans abîmer la grandeur du siècle ? (p. 142). Or le travail bibliographique de Frédéric Lachèvre constitue une réponse pour le moins originale à cette question. L’auteur montre ainsi, au fil d’un exposé très structuré, que loin de se laisser séduire par les sirènes de la pensée libertine, l’érudit s’est efforcé d’en dévoiler les limites et les dangers.
9En effet, il s’agissait tout d’abord de « substituer au récit merveilleux » qui était en train de naître à propos des libertins du XVIIe, « une analyse incontestable » (p. 144). Publier les textes de ces derniers, c’est en réalité donner raison à leurs détracteurs, et en premier lieu au père Garasse, dont Frédéric Lachèvre a lu attentivement La Doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps et auquel il se réfère régulièrement. De fait, Aurélie Julia montre là encore la constance du bibliographe dans son appréciation des auteurs libertins, ce dernier se faisant même d’ouvrage en ouvrage de plus en plus « inquisiteur ». Ainsi écrit‑elle « “l’esprit fort” et “débauché” de 1907 [dans Le Prince des Libertins] est devenu, en 1924 [dans Les Derniers libertins], un ennemi de l’Église et de l’État, un être désaxé dangereux et destructeur » (p. 149).
10Ainsi se résout la contradiction — qui n’était donc qu’apparente — entre un attachement à la tradition et à un certain ordre moral et une curiosité pour le libertinage : il s’agit en fait d’analyser et de montrer comment le second a pu, par le passé, mettre en danger le premier. On le voit, Frédéric Lachèvre aborde les libertins selon une perspective d’histoire des mœurs et des idées, bien plus que littéraire : nulle considération n’est de fait accordée au style de ces auteurs, tel n’est pas le propos. Les livres comptent plus que les lettres. En revanche, la prédominance du « moi » dont témoignent ces ouvrages et que Frédéric Lachèvre rattache notamment à l’influence protestante, et la critique de l’Église qu’on y trouve en font des textes dangereux.
Les enjeux d’une monographie
11Ce parcours dans la généalogie d’une œuvre — comprenons ici l’héritage bibliographique que nous a laissé l’érudit — constitue à nos yeux l’un des enjeux les plus intéressants de l’ouvrage. Au‑delà des faits qu’il permet de rétablir et des interprétations historiques et culturelles qui s’en dégagent, il nous semble en effet riche de questionnements épistémologiques sur la recherche elle‑même.
12Le choix de la monographie, en lui‑même, est à souligner. S’il s’inscrit dans une tradition bien établie, il n’en paraît pas moins légitime d’en interroger la pertinence : or, l’ouvrage d’Aurélie Julia, de ce point de vue, semble lui donner tout son sens. Relevant d’une forme de micro‑histoire telle qu’a pu la définir Carlo Ginzburg, le genre fonctionne comme un prisme grossissant qui permet d’appréhender une époque dans sa complexité à la fois historique, politique et culturelle. L’éclairage qu’apporte les choix et le parcours de Frédéric Lachèvre sur les valeurs et les enjeux de cette fin du XIXe et du début du XXe est particulièrement convaincant. Le détour nécessaire par l’histoire de la bibliophilie — aussi étroite cette entrée peut‑elle sembler a priori — participe pleinement de cette appréhension du contexte. Par ailleurs, les contradictions inhérentes à ce parcours — dès lors que l’auteur cherche à les mettre en perspective — restituent toute la complexité du contexte, complexité que toute recherche doit s’efforcer d’approcher, évitant ainsi les écueils de la simplification et de la caricature.
13De ce point de vue, l’objet même de la monographie mérite également un commentaire : retracer le parcours d’un intellectuel redouble, nous semble‑t‑il, cette approche de la complexité du réel. Ce récit d’une généalogie de la pensée est en soi matière à réflexion sur les modalités et les enjeux même de toute recherche : quelles en sont les objectifs ? les méthodes ? les présupposés intellectuels ? Mais s’intéresser à une figure aussi atypique que Frédéric Lachèvre permet également d’interroger les cadres de la réflexion intellectuelle aujourd’hui : la question se pose en effet des espaces où celle‑ci s’exerce, en dehors de la seule institution universitaire. À cette question des espaces, au sens sinon institutionnels et sociaux mais symboliques, s’en ajoutent deux autres : celle, d’une part, des conditions matérielles dans lesquelles elle se pratique, et celle, d’autre part, de sa légitimité. Rappelons en effet que Frédéric Lachèvre n’aurait pu réaliser son travail bibliographique s’il n’y avait consacré une grande partie de sa fortune personnelle. La question du financement de tout travail intellectuel, notamment en dehors des cadres institutionnels, se pose aujourd’hui. Elle est, bien sûr, immédiatement corrélée à notre seconde question : quelle est en effet la légitimité d’une telle recherche d’» amateur » (au sens où elle serait menée en dehors de toute reconnaissance professionnelle, c’est‑à‑dire institutionnelle) ? La question se posait déjà pour Frédéric Lachèvre, comme le rappelle Aurélie Julia en évoquant les réactions suscitées par ses ouvrages au sein du monde universitaire. Elle semble accrue aujourd’hui. Ainsi, au‑delà de ces questionnements actuels, il semble pertinent que la recherche revienne parfois sur ses propres modalités de fonctionnement, passés et actuels afin de rester consciente d’elle‑même : tel est, selon nous, l’un des intérêts implicites de la monographie d’Aurélie Julia.

