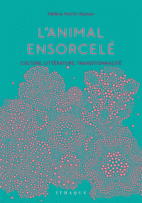
Pour une théorie (et une meilleure pratique) de la transmission littéraire
1L’Animal ensorcelé s’appuie sur deux propositions fortes dont Hélène Merlin‑Kajman nous invite à tirer, ou plutôt à choisir, les conséquences quant à l’avenir de la transmission de la littérature.
2L’animal humain, d’une part, n’est pas un « animal littéraire1 » par essence, mais il est éminemment « ensorcelant » et « ensorcelable », hypnotisable, « traumatisable2 » et toujours d’abord en liens avec d’autres, qui l’accueillent dans le monde et le lui transmettent dans des « styles » différents, défiance ou confiance, nostalgie de l’« un » ou ouverture à l’altérité et à la conflictualité, par exemple. D’autre part, si la littérature est bien de ces objets « sacrés » que les sociétés humaines se transmettent afin d’assurer leur propre continuité3, ces dernières peuvent conférer une telle fonction à d’autres pratiques langagières ou « propositions de culture » (p. 470). Or, ces différents objets « sacrés » ou sacra, ainsi que les façons qu’ont les hommes de les partager et d’en hériter, n’instituent pas tous les mêmes types de liens entre les hommes, ne rendent pas possibles les mêmes propositions politiques, ne répondent pas de la même manière aux menaces de destruction auxquelles toutes les sociétés humaines sont confrontées, et, enfin, « n’avoisinent » pas les hommes avec la présence de leurs morts ou leur propre condition mortelle dans les mêmes termes.
3L’Animal ensorcelé apparaît ainsi à la fois comme une réflexion anthropologique qui s’attache à cerner la spécificité de la littérature et de son partage actuel en permettant au lecteur de l’envisager en regard d’autres « propositions de culture », mais aussi comme une invitation à la défendre4. Précisons d’emblée toutefois : « non comme caractéristique arrogante d’une civilisation ou d’une culture particulières, mais en raison des promesses démocratiques qu’elle contient. » (p. 442)
4Si donc H. Merlin‑Kajman prend à revers la proposition de J. Rancière quant à « l’animal littéraire » que serait l’homme, ce n’est pas pour nier les virtualités démocratiques qu’il attribue à la « lettre muette‑bavarde5 » et à sa (trop) libre circulation à partir du xixe siècle, mais pour contester la césure historique que le philosophe instaure à ce titre entre « Belles‑Lettres » et « littérature ». L’auteure s’appuie sur de nombreux exemples prouvant que la circulation erratique des « beaux textes » préoccupait déjà le xviie siècle et, plus largement, que l’axe chronologique sur lequel se fonde la majeure partie des théories de l’Histoire manque le régime d’historicité propre à la littérature, soit l’énigme de sa transhistoricité. D’où vient, en effet, que l’homme se montre si sensible aux sortilèges des beaux textes ? H. Merlin‑Kajman se tourne vers cette « zone de contact » (p. 314) définie par François Roustang qui, présente en tout homme, le rend perméable aux embrasements de l’imagination, lui dictera de se dresser contre des moulins à vents ou de bâtir des châteaux à Yonville, zone où se jouent également dès le premier jour les liens aux autres et les voies de la transmission, que cette dernière soit traumatique ou littéraire (c’est‑à‑dire transitionnelle, comme on le verra).
5On l’aura compris, l’objet de L’Animal ensorcelé est « la question de la transmission elle‑même » (p. 27), fidèle en cela à la définition de la littérature comme « nom d’un partage6 » donnée par l’auteure dans Lire dans la gueule du loup. Ce nouveau livre examine plus précisément ses rapports avec les désastres auxquels sont confrontées de façon récurrente les sociétés humaines :
Il y aurait une histoire spécifique, une histoire culturelle, de la transmission traumatique, une histoire culturelle des multiples façons de faire face (plus ou moins heureusement) aux ruptures symboliques désastreuses : telle est l’hypothèse de ce livre. Il y aurait une histoire des formes culturelles en prise récurrente avec ce qui détruit la culture. (p. 162)
6L’Animal ensorcelé rencontre ainsi deux préoccupations de la critique littéraire actuelle : celle des potentielles vertus thérapeutiques de la littérature et celle du traumatisme, « nouveau langage de l’événement7 » des victimes et de leurs plaintes, des politiques de la réparation, de la mémoire ou de l’oubli et, sur un versant plus directement politique, des « sans‑voix » ou « sans‑parts8 ».
7Une telle anthropologie de la culture bouleverse, surtout, l’histoire elle‑même et d’abord l’histoire littéraire telle que l’envisagent le plus souvent les perspectives historiennes, sociologiques, contextuelles, voire marchandes. Bouleversement qui tient à la logique de la transmission elle‑même et plus particulièrement à la logique de la transmission traumatique qui occupe ici l’auteure. En témoignent deux choix formels importants, par quoi elle donne à voir ce que la littérature fait au temps et en quoi elle est d’abord don et partage.
8D’abord, H. Merlin‑Kajman adopte une « perspective trans‑temporelle » (p. 452) qui se manifeste dans le découpage en trois parties de l’ouvrage et dans leur articulation. Une première partie pose la question de la crise actuelle de la transmission de la littérature et interroge notre héritage le plus récent : celui de la modernité critique et littéraire des années 1960‑70. Cette dernière a proposé ses propres réponses aux désastres de l’histoire. La deuxième partie examine, en somme, les « propositions de culture » d’un siècle ancien, le xviie siècle, et établit, pour les opposer, un parallèle audacieux entre sorcellerie, démonologie et catharsis, devenue quasi‑synonyme de littérarité et/ou de transitionnalité. La troisième partie expose avec clarté les enjeux esthétiques, éthiques et politiques d’une définition transitionnelle de la littérature, qui s’éclaire de la convocation des théories de l’hypnose de François Roustang, des anthropologies du don de Marcel Mauss et Maurice Godelier et des théories psychanalytiques de Donald W. Winnicott.
9Comme dans Lire dans la gueule du loup, l’auteure interroge en outre son propre « souvenir d’enfance », ses expériences d’enseignante, de chercheuse et de lectrice (lector et lectrice « au premier degré9 »), tirant toutes les conséquences de l’affirmation que la littérature « n’existe pas sans des situations de lecture, de commentaire, d’enseignement, de partage », et prenant le parti de préserver « l’expérience », au sens de Walter Benjamin, « contre le règne intimidant de l’information et de l’expertise » (p. 28). Entrer dans L’Animal ensorcelé, c’est ainsi entrer soi‑même dans une constellation de textes et se l’approprier, c’est‑à‑dire se trouver d’emblée dans une situation de partage littéraire, et se laisser fasciner par Le Comte de Monte‑Cristo, par exemple, qu’on l’ait lu ou non, en étant accompagné par l’auteure, ensorcelé et désensorcelé, en somme.
10Disons‑le tout net : dans L’Animal ensorcelé, H. Merlin‑Kajman propose rien moins que de poursuivre (reprendre ?) la sacralisation de la littérature, terme cher aux approches sociologiques de la littérature10, mais dans une perspective en tout point opposée à celles des « démythificateurs11 » comme à celle des tenants d’un nouvel humanisme12 : ici, ni « évidence de la littérature » ni « patrimoine littéraire tranquille » (p. 451), il s’agit de promouvoir une sacralisation au sens strictement anthropologique du terme, adossée à une « profanation » telle que le xviie siècle en a, non sans remous, fait l’expérience, soit : « la sacralisation d’une zone de profanation permanente du sacré » (p. 461).
Mesurer de quoi est fait notre « souvenir d’enfance » actuel
11Dans « Réflexions sur un manuel13 », Roland Barthes se demandait si la littérature pouvait « être pour nous autre chose qu’un souvenir d’enfance14 », celle‑ci étant par la suite définie comme « ce qui s’enseigne, un point c’est tout15 ». Il s’agissait alors pour Barthes et plus largement pour l’avant‑garde critique des années 1960‑70 de s’opposer à la sacralisation ou à la mythification de la littérature telle qu’une histoire littéraire nationaliste, colonialiste et bourgeoise en avait fixé les traits. Dans L’Animal ensorcelé, c’est notre propre souvenir d’enfance qu’H. Merlin‑Kajman commence par interroger, celui que nous, enseignants, étudiants, parents, sommes en train de transmettre (ou de ne pas transmettre). Elle met notamment en question l’impératif catégorique de faire essentiellement de la littérature le meilleur adjuvant du développement de l’esprit critique ou de l’émancipation des élèves, et plus largement des enfants. Ainsi, les premières pages de l’ouvrage nous rendent‑elles témoins de deux situations actuelles de transmission de la littérature, en mettant en scène l’explication de texte d’une candidate au CAPES de littérature en 2002, puis celle de deux enseignantes en classes de Seconde, en 2007. Dans l’une, il est question de démasquer « l’idéologie répressive » (p. 15) qui passerait en contrebande avec les dernières recommandations de Mme de Chartres à sa fille, la Princesse de Clèves. Dans l’autre, de rassembler la classe autour de la révélation des « pouvoirs critiques et enchanteurs » (p. 17) de la littérature, par le biais de la lecture du « Dormeur du val » d’Arthur Rimbaud.
Mais, dans les deux cas, le texte est le support d’une parole missionnaire : le commentaire doit arracher les lecteurs au sens immédiat pour les faire adhérer à un noyau de vérité irradiant et les réunir dans une nouvelle conscience d’eux‑mêmes – sous le sens se jouerait quelque chose d’essentiel, prescription mortifère dans un cas, extase verbale vivifiante dans l’autre. Dans les deux cas, la révélation est à la fois rassembleuse et salvatrice.
Ces points communs paradoxaux, d’où viennent‑ils ? Que nous disent‑ils sur la situation de la littérature aujourd’hui, et au‑delà d’elle, sur la culture ? (p. 18)
12Le « souvenir d’enfance » des enseignants, celui qu’ils transmettent aux élèves, semble largement constitué des impératifs de la modernité : autotélisme du texte, refus d’une lecture référentielle ou « naïve », dévoilement des « pièges » de tout discours et préséance du signifiant – un « souvenir » dont la transmission s’avère pour le moins paradoxale, puisqu’il s’agirait de transmettre « l’élan de rupture » (p. 80) de la Nouvelle Critique ainsi que sa volonté de faire « table rase », c’est‑à‑dire de ne rien transmettre ou, comme l’écrit Marie Depussé : « ne rien faire apprendre, sinon l’inquiétude partagée du sens »16.
13Si H. Merlin‑Kajman fait partie de ceux qui interrogent cette « culture du soupçon17 » ou du « second degré18 » dans laquelle semble prise la transmission actuelle de la littérature, ce n’est ni pour déplorer une forme de « dessèchement formaliste » (p. 157) que nous aurait légué la Nouvelle Critique, ni pour célébrer un nouvel humanisme ou un « tournant rhétorique » réunificateur. À la question « Qu’est‑ce qu’on garde ? » que l’auteure reprend à Marie Depussé19, on pourrait répondre sans trop craindre de se tromper qu’H. Merlin‑Kajman « garde », en plus de l’ambition théorique qui a animé la modernité, la « passion et l’espoir » (p. 42) des enseignants et la conviction que « la modernité a voulu, de toutes ses forces voulu, inaugurer un mode de transmission culturel (littéraire) qui s’attache aux opprimés et à la “souffrance parmi les hommes”, plutôt qu’aux vainqueurs passés ou aux maîtres du moment. » (p. 156) Ce que l’auteure identifie, en fait, c’est un « schème de la transmission » (p. 72) : celui d’une « pétrification » suivie a priori d’une « libération » (p. 71) dont il n’est pas certain qu’elle soit émancipatrice, ce qui la conduit à poser la question suivante : quel est « l’occupant » (p. 73) qu’il faudrait traquer et chasser des textes, quel « héritage invisible » nous aurait légué la modernité ?
« L’holocauste comme culture »20
14La première partie de L’Animal ensorcelé met au jour cet apparent paradoxe : du réel a circulé avec l’écriture « blanche » de la modernité et ses impératifs d’autotélicité, d’autoréférentialité et de « table rase » : celui d’Auschwitz, dont Patrice Loraux fait le paradigme du « disparaître traumatique21 » auquel sont confrontées les sociétés humaines de manière récurrente22.
15Si donc H. Merlin‑Kajman entreprend bien de réinsuffler du référent dans le mot d’ordre moderne de la non‑référentialité – ou une manière de contexte –, ce n’est pas d’après une logique socio‑historique externe qui méconnaîtrait la façon dont la mémoire traumatique circule, mais en examinant avec précision les voies empruntées par cette dernière au sein d’une configuration littéraire singulière : celle de la « communauté inavouable23 » formée par Marguerite Duras, Robert Antelme, Dionys Mascolo et Maurice Blanchot.
16L’auteure prend l’exemple d’Autour d’un effort de mémoire. Sur une lettre de Robert Antelme, livre de Mascolo qui se donnerait pour « un témoignage plus authentique » (p. 89) de la Shoah qu’une lettre écrite par Antelme lui‑même, de retour des camps, et surtout que le roman de ce dernier, L’Espèce humaine. Mascolo, dans son ouvrage, relèguerait le sens historique de L’Espèce humaine pour un sens allégorique, « l’enfer » littéral vécu par Antelme au profit d’un sens eschatologique (soit le scénario de la grande réparation chrétienne), jusqu’à rejeter, enfin, « l’écriture littérale elle‑même », par quoi l’on retrouve le refus de la modernité du « régime référentiel de la représentation » (p. 98). Ainsi l’auteure donne‑t‑elle à percevoir sous « l’écriture du désastre » (p. 98)« le soubassement traumatique qui a de la sorte animé l’énergie littéraire de la modernité et semble, au‑delà d’elle, se transmettre encore jusqu’à nous » (p. 146).
17À l’heure d’autres menaces de destruction, morts « en masse » (p. 454) sur la Méditerranée, urgence écologique ou fondamentalisme religieux24, l’articulation entre xxe siècle et période « early modern » établie par les première et deuxième parties de l’ouvrage s’éclaire de la volonté salutaire de « se rendre attentif à des ressemblances et à des différences que les récits chronologiquement orientés laissent dans l’ombre » (p. 161), en se souvenant, par exemple, que le siècle du « classicisme » a aussi été celui de la fin des guerres civiles de Religion, des troubles de la Fronde ou encore le second de deux siècles de chasse aux sorcières.
18Il ne s’agit pas ici de mettre ces phénomènes historiques sur un même plan ni d’en appeler à une universalité de la nature humaine : c’est un « temps » qui revient, celui du « disparaître traumatique » ou du trauma, face auquel plusieurs réponses culturelles sont possibles et parfois concomitantes, réponses qui permettraient, dans le meilleur des cas, une « articulation symbolique » (p. 243) ou encore de restaurer l’affectivité, la sensibilité commune, d’après les termes de Loraux25, ce lien « entre‑passible » premier, frappé par ces phénomènes.
19Pour cerner ce que serait un « bon dispositif26 » face aux différentes formes du « disparaître » auxquelles s’affrontent les sociétés humaines, L’Animal ensorcelé s’attache donc à « jete[r] des ponts anthropologiques » (p. 164) entre des siècles éloignés : les fonctions qu’a pu remplir la littérature au xviie siècle, par exemple, invitent l’auteure à se demander « ce que nous voulons qu’elle soit, quelle fonction nous voulons lui confier – et même, si nous voulons seulement qu’elle soit quelque chose, c’est‑à‑dire qu’elle remplisse une fonction quelconque, au‑delà du simple loisir » (p. 26).
Methexis versus catharsis : partage des textes « comme mythe » et partage des textes « comme littérature »
20Repartons de la modernité et de son usage du concept de mythe, ou plutôt de ses exigences de démythification et de démystification, que l’on retrouve sous d’autres espèces dans les démarches bourdieusiennes de dévoilement et de « désenchantement27 » et plus largement dans un certain type de discours médiatique qui vise à dénoncer les mythes28. En se fondant sur la définition que Philippe Lacoue‑Labarthe et Jean‑Luc Nancy donnent du mythe, soit « une fonction et un effet spécifiques de la parole » qui, dans le mythe, est « supposée générer le “nous” soudé pour lequel elle est prononcée et dont elle raconte, sur un mode plus ou moins transparent, l’origine ou l’essence » (p. 129), H. Merlin‑Kajman met au jour l’ambiguïté de la modernité à l’égard de ce dernier :
Car elle hérite de la « nostalgie poético‑ethnologique » née au XIXe siècle et encore très prégnante chez les anthropologues. Mais parallèlement (et contradictoirement), elle appelle souvent « mythes » tous les récits ou les scènes qu’elle veut combattre. Or, son exigence de démythification est souvent un désir de retrouver une scène plus pure, désaliénée : plus authentiquement performative et participative, en somme. (p. 132)
21C’est surtout le « mythe du mythe » (p. 132), soit la « croyance dans la possibilité d’un récit ou d’une scène qui révèlerait une communauté à elle‑même ou la ferait advenir en lui donnant sa forme propre », qui retient son attention, croyance qui tend cette fois à valoriser le mythe et à faire de la littérature, par exemple, un quasi‑mythe ou de « pâles réminiscences des mythes » (p. 230), de la transe, une expérience des limites salutairement plus efficace que celle de la lecture, ou encore d’accorder à la figure du sorcier un rôle social et symbolique plus structurant que celui de l’État.
22De tels décentrements du regard ou une telle « déhiérarchisation des expériences » (p. 364), auxquels l’anthropologie a contribué de façon décisive, ont été et demeurent indispensables, mais la démarche d’une histoire culturelle telle que l’envisage L’Animal ensorcelé, qui réinterroge ces expériences à l’aune du relativisme multiculturaliste actuel pour en examiner les effets sur les formes de communautés humaines et les rapports qu’elles favorisent entre l’individu et le collectif, ne nous semble pas moins nécessaire.
23Ce que Lacoue‑Labarthe et Nancy ajoutent d’essentiel à la définition qu’ils proposent du mythe, c’est son lien paradoxal à la démocratie, soit le « désir de mythe » (p. 131) insistant qui caractérise cette dernière du fait de son défaut d’une « forme de figuration collective douée d’une force d’identification » (p. 131). Ce qui n’est pas une mince aporie puisque, comme on l’a vu, le mythe a pour horizon la « pureté » de l’un. Comme le souligne l’auteure, « la question nous ramène en effet aux enjeux de la démocratie, c’est‑à‑dire de la communauté reconnue comme divisée, où la mésentente est représentable » (p. 136). Et le choix que nous soumet L’Animal ensorcelé, face au « cas historique29 » identifié par l’auteure, devient celui du partage des textes « comme mythe » ou du partage des textes « comme littérature », soit, pour ce dernier, comme ce qui permettra, entre autres, la « conflictualité » (p. 441).
24Ainsi, si H. Merlin‑Kajman consacre la deuxième partie de sa réflexion à des textes d’Ancien Régime, ce n’est pas pour rouvrir le vieux dossier de la « mythification » du « classicisme » – qu’elle a d’ailleurs proposé de renommer « classico‑baroque30 » –, mais parce qu’au sortir des guerres civiles de Religion, notamment, le XVIIe siècle traverse « un moment de formidable hésitation sur la définition de la société » (p. 166), qu’il doit faire face aux morts que les familles ont infligées aux familles – et que les bûchers pour sorcellerie y brûlent leurs derniers feux, en même temps que les « beaux textes » de plaisir prennent peu à peu une place inédite.
25Interroger les effets des œuvres littéraires sur le public et les lecteurs d’alors, de même que nos propres recatégorisations critiques de ces textes, permet ainsi de poser avec acuité la question du type d’articulation symbolique que peut opérer la littérature, des défenses qu’elle peut opposer au désastre, et de sa pragmatique très particulière, la catharsis ou représentation, qu’H. Merlin‑Kajman oppose ici à la methexis ou participation, propre au partage « comme mythe ». Rejetant l’opposition que trace Florence Dupont entre efficacité du théâtre comme « fête collective identitaire » et texte imprimé comme « résidu avili du spectacle » (p. 192), l’auteure montre comment le théâtre de Corneille, par exemple, et la place inédite qu’y tiennent une Sabine ou une Chimène – soit la sphère privée, l’amour entre particuliers ou le différentiel féminin – ont pu constituer pour un public ayant fait l’expérience d’une désincorporation « une sorte de laboratoire de la scission du public et du particulier » (p. 198). Et ce, notamment, grâce à la séparation entre scène et salle, qui laisse du jeu.
26De la personnalisation du moi que Montaigne oppose à « l’impersonnalisation zélée qui exige sacrifice du moi au public », au corps à corps imaginaire que Le Malade imaginaire autorise avec la mort, permettant à son personnage comme au public de jouer avec l’énoncé en première personne « Je suis mort » sans que cet énoncé agisse littéralement à la façon d’un mauvais sort, en passant par la quasi‑impersonnalisation de l’énonciation du poète Théophile de Viau ou l’essai inouï d’une « éloquence privée » par Guez de Balzac, l’Ancien Régime fait ainsi l’expérience de textes qui « brisent l’induction sublime des schèmes mythiques, des exemples héroïques, diffractent les représentations de la communauté, la divisent », qualités que l’auteure propose de mettre « à l’épreuve de leur partage actuel » (p. 184‑185).
27Mais le xviie siècle n’est pas parvenu à théoriser la catharsis. Telle qu’H. Merlin‑Kajman en définit les enjeux, celle‑ci devient le nom d’un partage proprement littéraire (ou transitionnel), définissant, comme l’écrit Marie‑José Mondzain, « l’espace du passage de l’enduré (pathos) à son partage symbolique (logos)31 » et s’opposant au partage mythique qui, dans son rêve d’une communauté « pure », repose sur le rejet d’une ou de plusieurs figures de « l’ennemi ».
La littérature est « proprement un charme32 » (ou « l’animal ensorcelé »)
28À partir des débats qui agitent le xviie siècle sur la mimésis et ses effets de contagion, et en s’appuyant sur les figures de lecteurs tant fictifs que réels que sont Dom Quichotte, Emma Bovary, Madame de Sévigné ou elle‑même, littéralement ravie par la lecture du Comte de Monte-Cristo, H. Merlin‑Kajman prend le parti de :
[…] prendre à la lettre toutes les comparaisons, sur le long terme de la culture lettrée, qui identifient telle ou telle réalisation langagière (pas seulement l’incantation ou le sort, pas seulement le discours des sophistes ou le chant des sirènes, mais aussi la poésie, le roman, le théâtre) à un charme ou un sortilège qui « fascinent » ou ensorcellent… (p. 309)
29Ainsi de La Fontaine écrivant à propos de ses fables : « C’est proprement un charme ». Le titre de l’ouvrage, L’Animal ensorcelé, s’éclaire. Pour comprendre ce qui distingue le plaisir propre aux textes littéraires et les périls qui ont pu y être associés, mais également pour déterminer en quoi ces mêmes textes n’ensorcellent pas exactement comme d’autres pratiques langagières, l’auteure s’intéresse au lieu même de l’homme où se joue la transmission, lieu qui fait de tout lecteur d’abord ou aussi un lecteur « naïf » ou captif, un « suppôt de l’imaginaire33 » : un être que l’on peut hypnotiser. Elle convoque ici les théories de François Roustang sur l’expérience de l’hypnose que les humains feraient quotidiennement (lire… ou compter les moutons pour trouver le sommeil) et que connaîtraient également les animaux. Cet état « serait rattaché à une zone de nous‑mêmes où se sont inscrites non seulement les sensations, mais encore les relations premières surgies dès notre naissance, zone de contact qui constitue donc la condition de possibilité de toute espèce de communication ultérieure » (p. 324). « Zone de contact », enfin, de l’ordre d’une enfance jamais tout à fait passée :
Pour Roustang, première dans l’ordre chronologique de la vie d’un individu, cette zone de contact n’en est pas moins toujours actuelle, toujours active. Si elle est primitive, ce n’est pas parce qu’elle serait destinée à être dépassée : elle n’appartient pas au passé de l’individu, mais à sa permanence infra‑subjective et infra‑discursive. Sa voix peut-être, sa phoné, non son logos ? (p. 314)
30De nouveau, les distinctions maintes fois débattues entre ce qu’il conviendrait de désigner par le nom de « Belles‑Lettres » ou par celui de « littérature » perdent de leur pertinence – la « zone de contact » et « l’étrangeté presque magique de certains effets textuels ou théâtraux » appartiennent à l’énigme de la transhistoricité de la littérature –, tandis que les contours se troublent entre les divers avatars d’un antagonisme entre lecteur « éduqué » et lecteur « naïf », « lecture instituée » et « lecture captive » ou encore « texte de plaisir » et « texte de jouissance ».
31La « zone de contact » est donc celle où se joue le plaisir des textes et par où se font les liens aux autres, au monde extérieur, dès le premier jour. Mais elle est aussi le lieu où ces mêmes liens peuvent se délier et par où l’homme se rendra sensible aux imprécations zélées ou aux sortilèges qui lui feront reconnaître dans tout dissemblable un ennemi. C’est enfin par où peut advenir la catharsis : le remède est dans le mal. L’auteure donne ainsi l’exemple de la fable de La Fontaine « Le Renard et les Poulets d’Inde », dans laquelle un renard fascine (ou hypnotise) des dindons qui ont trouvé refuge en haut d’un arbre, afin qu’un à un ils finissent par tomber. Il est question d’une mise en sommeil, mais la fable n’en use pas avec le lecteur comme le renard avec les dindons : le « sommeil » s’accompagne ici d’un « réveil », assuré par le dispositif de la représentation – et les lecteurs ne sont pas menés à la mort. La description de ce « détour qui capture et libère tout à la fois » (p. 312) conduit l’auteure à redéfinir ainsi les rapports du « plaire » et de « l’instruire » en lien avec une catharsis :
Le plaisir placé dans la dépendance de l’instruire ne conduisait pas nécessairement à un redressement moral : il pouvait produire une simple articulation, frayer le passage de la zone ensorcelante du langage à sa zone intelligible, passage ou jeu où s’ouvre une possibilité de subjectivation aérée, quand le sujet devient capable d’exercer son jugement sans devoir perdre pour autant le contact avec ses constituants primordiaux et informes. (p. 313)
32L’« animal » du titre s’éclaire également de la sorte. H. Merlin‑Kajman associe la « zone de contact » à la phoné, que l’être humain a en partage avec les animaux. À ce titre, d’après l’auteure, « c’est aussi à cette partie animale, cette partie d’enfance, que les fables s’adressent d’abord. » (p. 310) On retrouve par un biais inattendu les théories de la modernité et l’importance qu’elle a, par exemple, accordée au signifiant, à la voix ou phoné ou à la littérature comme cri, suivant, d’après l’auteure :
[…] la conviction, radicale, selon laquelle les animaux humains pourraient se rassembler, sinon tout à fait en‑dehors, du moins à partir d’un dehors de la société – à partir d’un hors de soi transindividuel. […] nous pourrions refuser les divisions constitutives des sociétés humaines et, par un « dire » dont la poésie (ou la littérature) fournirait le modèle, instituer l’unité de l’espèce humaine. […] C’est bien l’économie du partage mythique qui est mobilisée ici, partage selon un méta‑mythe même, puisqu’il doit court‑circuiter tous les dispositifs, toutes les cultures. (p. 382)
33L’Animal ensorcelé rencontre également les réflexions actuelles sur la littérature comme potentiel « passage vers les “mondes animaux”34 » (p. 375). Si H. Merlin‑Kajman accorde le plus grand sérieux à la question de notre part animale, sa réflexion ne laisse pas d’interroger cette « sensibilité d’époque35 » qu’Étienne Bimbenet nomme « zoocentrisme36 » – et l’on pourrait dire, d’après les termes de ce dernier, qu’elle « rouvr(e) le dossier anthropologique37 », parvenant à la conclusion que « mesurer l’homme à sa limite animale se révèle finalement aussi insuffisant que de le mesurer à la limite de la mort. » (p. 388)
34Ce faisant, c’est le dossier littéraire lui‑même que l’auteure rouvre sur l’horizon du social, en proposant une nouvelle définition de la littérature « classique » entée sur les exemples qui ont été donnés dans la deuxième partie et sur la définition de la catharsis qui s’en est dégagée :
La littérature « classique » ne serait‑elle pas celle qui greffe, sur la zone participative et hypnotique du psychisme humain, un édifice de formes et de catégorisations de façon à ramener le lecteur, avec bienveillance et souci mondain (voire politique), à l’horizon du social, c’est‑à‑dire à la vie en commun avec ses divisions, ses limites, ses devoirs, ses révoltes ? (p. 319)
« L’acceptation de la réalité est une tâche sans fin » (Winnicott) : le choix culturel d’un espace transitionnel
35Un bref détour éditorial met en lumière l’apport majeur de L’Animal ensorcelé quant à l’approche transitionnelle de la littérature qu’est celle d’H. Merlin‑Kajman. Son précédent ouvrage, Lire dans la gueule du loup, a paru en 2016, et l’auteure y insistait déjà sur les différents types de partage des textes et sur le fait que la transitionnalité n’était pas de l’ordre d’une qualité intrinsèque propre à un canon établi. Comme elle le signale cependant au sein des « Remerciements » (p. 11), L’Animal ensorcelé a été conçu dans la foulée de La Langue est‑elle fasciste ?38, paru en 2003, qui faisait le choix d’une perspective transhistorique en mettant en regard xxe, xvie et xviie siècles. Ainsi L’Animal ensorcelé, dont Lire dans la gueule du loup constituerait comme l’une des multiples ramifications possibles, se présente‑t‑il comme l’aboutissement de deux décennies de réflexions tissant patiemment des liens entre transhistoricité, transmission et transitionnalité39 de la littérature et, plus généralement, des phénomènes culturels.
36Soulignons encore que, si les réflexions d’H. Merlin‑Kajman ne sont pas étrangères aux questions des vertus éthiques et/ou thérapeutiques de la littérature, en débat en France depuis plusieurs années ainsi qu’au sein de ce que l’on a nommé le « tournant éthique » anglo‑saxon, il n’est pas question dans cet ouvrage de « moraliser » de façon simple la littérature ni de lui accorder des vertus intrinsèquement éthiques40. Pas davantage que de faire de la littérature un « doudou » pour adultes, comme le rappelle Adrien Chassain dans son compte rendu de Lire dans la gueule du loup41. Du reste, si le doudou constitue un paradigme efficace de l’objet transitionnel tel que l’a défini Winnicott42, l’auteure de L’Animal ensorcelé rappelle que tout doudou n’est pas nécessairement transitionnel – tout dépend de la manière dont il est transmis puis investi par les adultes – et lui préfère au sein de sa démonstration la berceuse, qui prend en charge le « corps relationnel43 » du nourrisson en liant indissociablement phoné et logos, phénomène de pure adresse, mélodie et paroles indissociables, plus proche en cela, peut‑être, de la poésie. Enfin, l’auteure insiste utilement sur « la dimension immédiatement relationnelle et même culturelle des objets transitionnels : ils sont “donnés” au bébé, ne serait‑ce que sous la forme d’un “laisser”. » (p. 408)
37Pour étendre les phénomènes transitionnels au‑delà des premiers âges de la vie, H. Merlin‑Kajman s’appuie sur cette affirmation de l’auteur de Jeu et réalité :
Nous supposons ici que l’acceptation de la réalité est une tâche sans fin et que nul être humain ne parvient à se libérer de la tension suscitée par la mise en relation de la réalité du dedans et de la réalité du dehors, nous supposons aussi que cette tension peut être soulagée par l’aire intermédiaire d’expérience, qui n’est pas contestée (arts, religion, etc.).44
38Ce qu’établit alors L’Animal ensorcelé, c’est que si la « zone intermédiaire » ou « aire intermédiaire d’expérience », proche de ce que Roustang a nommé « zone de contact », est commune à tout individu et à toute société, il faudra néanmoins distinguer entre les phénomènes qui s’y « répandent », « voire […] réserver la transitionnalité à certains d’entre eux seulement » – et que la transitionnalité n’est « pas un fait de structure » (p. 412) : « rien n’indique que cette aire intermédiaire d’expérience soit toujours configurée selon l’économie des phénomènes transitionnels, ni que tous les phénomènes culturels répondent aux critères de la transitionnalité tels que Winnicott les présente. » (p. 407)
39Ainsi l’espace transitionnel constitue‑t‑il une « proposition de culture45 », la transitionnalité un choix qui nous est soumis – ainsi qu’un critère de littérarité, ayant pour horizon un certain type de tissu relationnel, privilégiant des subjectivations « aérées », une certaine scène politique, conflictuelle, démocratique, et une forme singulière d’articulation symbolique, notamment quant au non‑symbolisable qu’est la mort :
Seront littéraires les textes qui se livrent à des articulations symboliques sans qu’elles constituent des prisons. Sacraliser ce régime‑ci de la textualité, […] c’est donc privilégier ces textes précisément en raison de la valeur qu’ils donnent au monde interne et à son opacité ; autrement dit, c’est ménager, dans la zone de pondération du rapport je-nous, une plasticité, une indétermination, une liberté imaginaire qui autorise l’activité interprétative individuelle. (p. 420)
40Si H. Merlin‑Kajman inscrit bel et bien son approche transitionnelle de la littérature dans une « perspective thérapeutique » – sous‑titre de l’un des chapitres de l’ouvrage, qui prend cependant la forme d’une interrogation (p. 429) – ou plutôt « quasi thérapeutique » (p. 31), c’est en somme dans un horizon collectif, voire anthropologique, plus que psychanalytique. S’appuyant sur les analyses de Lévi‑Strauss quant au défaut d’« articulation symbolique » auquel les hommes, du fait de l’existence du langage46, sont confrontés, c’est à la réparation du « symbolique » ou, d’après les termes de Depussé, « du tissu qu’on dit social47 », ou à la restauration de « l’entre‑passibilité entre les hommes » (p. 431), d’après Loraux, que le partage transitionnel des textes peut quelque chose.
41Or, il n’est pas évident que toute autre proposition culturelle concoure au même type de « réparation » que la littérature – l’exemple du sorcier, d’après les analyses de James Siegel48 reprises par l’auteure, tend au contraire à prouver que la sorcellerie, lorsqu’elle prend en charge « les états frontaliers de l’homme » (p. 245), ne produit aucune articulation symbolique ; quant au mythe, il participe, on l’a vu, d’une « induction communautaire » (p. 245).
Pour une sacralisation paradoxale de la littérature
42L’apparent paradoxe que constitue le fait que, comme l’écrit l’auteure, « toute la littérature n’est pas nécessairement littéraire » (p. 427) et qu’à l’inverse la transitionnalité d’un texte « peut très bien ne pas être actualisée » (p. 428) nous invite à conclure ce bref aperçu des propositions théoriques de L’Animal ensorcelé par une mise au point sur le type de transmission et surtout la singulière sacralisation de la littérature qu’il promeut.
43H. Merlin‑Kajman insiste à la fois sur le rôle de ceux qui transmettent les textes littéraires dans l’actualisation des effets démocratiques de ces derniers (ainsi met‑elle en doute le fait que « laisser aller la parole muette‑bavarde, […] la laisser circuler librement sans père légitime et sans destinataire autorisé » (p. 422) ou encore la transmettre sous l’égide du soupçon y suffisent), et sur l’impératif absolu, notamment pour les critiques et les enseignants, de ne pas « écras(er) l’équivocité du langage » en « présent(ant) leur interprétation comme la seule vérité du texte à laquelle il faudrait que le lecteur adhère » (p. 429), c’est‑à‑dire de respecter la disponibilité à la libre appropriation qui devrait caractériser le partage des textes « comme littérature ».
44C’est, en partie, ce qui fait d’elle un objet « sacré » tout à fait singulier. L’auteure s’appuie ici sur la distinction qu’établit Godelier entre marchandises, biens « aliénables et aliénés », objets de don, « inaliénables et aliénés » et sacra ou objets sacrés, « choses inaliénables et inaliénées », « biens nécessaires à la reproduction de toutes les sociétés » (p. 354‑355) : « Ces choses sacrées contiennent quelque chose que les membres de la société tiennent pour “indispensable à leur existence et qui doit circuler pour que tous et chacun puissent continuer d’exister”, quelque chose par quoi “s’affirme une identité historique qu’il faut transmettre” »49 (p. 355).
45La sacralisation dont il est ici question est donc de nature anthropologique. De plus, H. Merlin‑Kajman lui adosse une nécessaire « profanation » telle que la définit Giorgio Agamben, soit le fait de « rendre [les sacra] à cet usage commun auquel leur sacralisation les avait soustraits » (p. 360), sans pour autant que ceux‑ci ne rejoignent intégralement le régime des biens marchands.
46Or, ce qu’a permis d’établir les réflexions que consacre L’Animal ensorcelé à la littérature de l’Ancien Régime, c’est l’extraordinaire nouveauté que constitue le « don au public » des textes qui la caractérise alors : en donnant leurs textes au public, c’est‑à‑dire à la sphère du public opposée à celle du simple particulier, les auteurs les donnent « pour des biens sacrés » (p. 356), ce qui vient perturber durablement le régime des biens sacrés que constituent, par exemple, les livres saints. En effet, tout en devenant « sacrés », les textes littéraires n’en demeurent pas moins aussi des biens marchands, et des objets de don. De plus, et c’est là sans doute le point le plus important, ils proviennent de simples particuliers et sont ouverts à l’interprétation, aux querelles – querelles publiques à propos de textes émanant d’individus, le plus souvent en langue vernaculaire. La littérature n’est donc pas un sacra comme les autres, pas plus qu’elle ne devrait être, d’après H. Merlin‑Kajman, exclusivement analysée en termes de marché :
Et c’est peut‑être là, dans cette étrange tension, que l’on rencontre le mieux la définition que la littérature a prise pendant quelques siècles dans la culture occidentale. Une définition qu’elle court le risque de perdre à force d’être définie exclusivement par les « archivistes » que nous sommes devenus […] en termes d’intérêts, de stratégie et de marché – bref, de consommation : définition pratique et définition théorique qui, en aplatissant la chose littéraire sur le temps court, contextuel, des simples rapports sociaux, détruisent les liens sociétaux ou méta‑sociaux, transgénérationnels, qu’elle a eu pour vocation de tisser. (p. 361)
47Il y a là, répétons‑le, un choix pratique qui nous est soumis, à nous, adultes, enseignants, critiques, quant aux types d’objets ou de pratiques culturelles sur lesquels nous désirons faire « reposer la pérennité sociale » (p. 434). Laissons, à ce titre, le dernier mot à l’auteure de L’Animal ensorcelé :
L’animal humain n’est pas un animal littéraire et l’espèce humaine n’est ni une ni indestructible. Face à ces vérités, la littérature constitue plutôt un « bon dispositif » – une meilleure res sacra que d’autres. Il vaut la peine de convertir cette conclusion en proposition culturelle indispensable à l’avenir de la démocratie. » (p. 434)
48.

