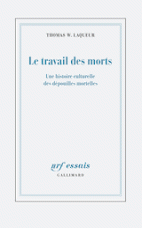
L’avenir de la mort n’aura pas un goût de cendres
Diogène en Patagonie
1Voyageant à l’autre bout du globe, le poète Roger Caillois découvrit un jour en Patagonie une plage immense, abandonnée, sur laquelle étaient venus s’échouer les représentants de différentes espèces. Les os d’un phoque ou d’une baleine viennent confondre leur blancheur avec celle d’une mouette. Ainsi, la mort voue les différents règnes à une indistinction finale. Au milieu de cet immense cimetière marin, le poète s’étonne. Il constate qu’il y a un absent. Quelqu’un manque dans ce vaste inventaire du règne du vivant : l’homme. Préfigurant quelque peu en négatif le constat que Foucault lance dans les dernières lignes de Les Mots et les Choses, où la disparition de l’homme se laisse deviner comme un visage qui s’efface sur le sable d’une plage, la démonstration de Caillois était une grande leçon d’humilité. Elle lui montrait que même dans une des contrées les plus rudes et les plus reculées du globe, là où le vent souffle si fortement que l’on peine à se tenir debout et où l’idée de culture semble une préoccupation lointaine, l’homme prend grand soin de mettre le corps de ses semblables à l’écart des autres espèces. La dépouille de ses semblables ne vient pas se confondre dans ce grand ossuaire marin. Ce geste simple est pourtant fondamental. Il atteste combien l’homme désire se tenir à part des autres espèces. Comme être de culture, la mort est pour lui un passage et un évènement qui appelle différents rites et pratiques cherchant à conserver et à isoler le corps de son prochain. Parfois, l’homme met un soin extrême à préfigurer le passage vers la mort, comme le montra Erwin Panofsky dans son étude sur la sculpture funéraire. Le paradoxe est que Caillois créera quelques années plus tard une revue culturelle intitulée Diogène, du nom du philosophe qui demanda à ses disciples, à sa mort, de jeter son corps de l’autre côté du mur de la Cité, afin que les bêtes dévorent son cadavre.
2C’est par cette figure provocante du philosophe cynique que Thomas Laqueur ouvre son livre Le Travail des morts. Philosophe très tôt converti à l’histoire, Th. Laqueur a enseigné cette discipline à l’université de Berkeley durant plusieurs années, s’inscrivant dans la lignée de Foucault. Il est connu pour ses études sur l’histoire de la sexualité. Après avoir arpenté les territoires d’Éros, ne convenait‑il pas de se tourner vers ceux de Thanatos ? À moins que ce ne soit l’inverse, comme le propose la préface, dans laquelle l’auteur rappelle que son père était pathologiste et que, durant les repas de famille, il était régulièrement appelé pour réaliser en urgence une autopsie. C’est ainsi que la mort et plus encore le cadavre viennent hanter son enfance. Mais, selon l’auteur, ce livre prend naissance sur une table de dissection, le jour où il pratique sa première autopsie avec trois autres étudiants en médecine. C’est là, en manipulant un corps de mort et en apprenant le nom des différents muscles, que s’établit la relation entre la matérialité d’une dépouille et la Mort comme fait de culture. Quelques années plus tard, il se lance dans une enquête sur « Le sens de la mort dans la Grande‑Bretagne réformiste » où ses idées se précisent. Il retrouve à nouveau, condensé dans ce « sens de la mort », aussi bien la dimension existentielle du fait de mourir que sa portée sociale, son enracinement ou son inscription dans le monde culturel, son fait le plus intime et sa trace la plus visible. Ainsi, l’auteur touchait à une histoire de l’émotion qui s’éloignait des bureaux de statistiques et du cabinet de médecin pour aller faire un tour du côté de l’histoire des idées et des théologiens afin de cerner cette expérience intime. Il se tourne également vers l’anthropologie médicale et la littérature pour sonder l’histoire de cette terreur si particulière. Car il ne cherche pas à écrire l’histoire de ceux qui pleurent les morts, mais bien une histoire de l’émotion de ceux qui sont en train de mourir. Il est intéressant de constater combien une telle entreprise est d’emblée vouée à une impasse. Parler de la mort comme d’une expérience vécue relève de sa propre impossibilité. Les philosophes qui parlent de la mort ont souvent invoqué cette disposition limite de l’expérience de la mort. Non seulement les témoins et les vivants ne parlent pas volontiers de cette expérience, mais Th. Laqueur consacre une page entière à Heidegger qui, dans Sein und Zeit, évoque cette difficulté réflexive comme une impossibilité de représenter la mort de l’être au moment où celle‑ci a lieu. Le paradoxe est qu’il est impossible de faire échapper l’autre à la mort et que la mort dans l’intimité de l’expérience est toujours ma propre mort, et donc une expérience qui ne se partage pas.
3L’échec d’une telle approche aura rendu ce livre nécessaire, car d’emblée elle trace une limite interne, une ligne qu’il est impossible de passer, et qui maintient le travail de Th. Laqueur dans cette zone dangereuse dont il est impossible de rendre compte. Ni la parole des mourants ni les archives ne pourront nous éclairer sur cette expérience intime du mourir. Ainsi, il restait comme seule alternative de se tourner entièrement vers la seconde dimension pressentie par l’auteur, à savoir la dimension sociale et culturelle de la mort. Ici, les données sont accessibles, consultables. Il y a moyen de rechercher la meilleure manière de vivre la mort, de décrire et étudier les faits et gestes devant la mort, la manière dont les actes du mourir sont en accord avec l’ordre social et politique. Il y a aussi la dimension plus noire que l’auteur aurait aimé développer comme l’histoire des exécutions, de la peine capitale et de son étrange politique du meurtre judiciaire, ou encore l’histoire du glas et des festins funéraires, ce geste d’écouter la souffrance d’un mourant à travers l’écho d’un clocher ou le fait de boire et de manger à l’ombre d’un mort, non plus à sa santé mais à sa mémoire. Et puis, certains de ces repas post mortem sont organisés jusque dans les moindres détails par le mort lui‑même, infligeant un démenti à l’argument de Diogène, à savoir qu’après notre mort, l’homme peut encore se soucier de ce qui arrive. C’est ainsi que dès les premières pages de The Work of the Dead, qui est paru en 2015 aux Presses Universitaires de Princeton et dont les éditions Gallimard proposent aujourd’hui une traduction française d’Hélène Borraz, cette histoire culturelle des dépouilles reconnait cette limite de la mort comme une limitation interne. Impossible de parler de la mort dans tous les lieux et dans tous les temps. En même temps l’omniprésence de la mort fait que nous perdons rapidement pied, amenant l’auteur à se demander si nous ne finissons pas par écrire un livre sur le tout de la vie, alors que cette mort toujours nous échappe. Ceci nous vaut cette mise en garde de l’auteur au seuil d’un livre de près de 800 pages sur le sujet :« Mais la mort est demeurée pour moi un sujet insaisissable : bien trop grand, bien trop enchevêtré avec presque tout ce qui donne sens à nos vies pour être écrit avec un semblant de clarté » (p. 15). De fait, ce livre ne parle pas de la mort (comment en parler ?), mais plutôt des morts, de l’histoire sociale et culturelle qui décrit les faits et gestes que les hommes font autour de la mort pour ensuite comprendre ce que signifient ces gestes, et comment ils travaillent la dépouille. En effet, à travers ce livre, on découvre que le travail des morts est bien plus nécessaire pour les vivants car les corps des morts travaillent notre imaginaire : ils sont à l’origine des mondes sociaux.
Le souci du mort
4La mort a toujours préoccupé l’homme. Mais pourquoi ce souci pour les morts, pour leur corps ? D’une part, l’anthropologie nous montre qu’une telle question se pose dans la longue durée et qu’elle s’attache à développer une vue cosmique qui définit la place de l’homme dans le monde. À cela vient se coupler une perspective historique qui questionne le sens des gestes qui définissent le rapport que nous entretenons avec le mort, avec la dépouille, ce que la mort laisse derrière elle dans sa plus grande matérialité. Il y a donc un glissement qui s’opère ici entre la mort et le corps du mort, son cadavre, qui consiste à passer de la question de la finitude de l’homme à ce que la mort laisse derrière elle. Si la mort est insaisissable pour l’auteur, voici que le corps du mort est placé sous le signe du passage immédiat de la décomposition et de la disparition. Dès que l’historien porte son attention sur l’aspect le plus tangible et le plus matériel du corps du mort, celui‑ci est déjà en pleine décomposition. Il est soumis à une rapide transformation, soulignant la difficulté de l’historien à saisir un objet évanescent. D’où la fascination devant les techniques de préservation, momification, de dessèchement en tout genre. Si la mort est évanescente, la dépouille ne l’est pas moins. Elle n’offre que trop rarement la durabilité de l’archive.
5Face à cette suite de dénégation, Th. Laqueur tente néanmoins de répondre à la question du souci devant la mort, afin de contredire Diogène selon lequel nous ne devrions pas nous préoccuper de la mort d’une manière abyssale, puisque tant que nous sommes vivants, il n’y a pas lieu de se soucier de ce qui nous arrivera, et le jour où la mort nous emporte, le problème se posera encore moins puisque nous ne serons plus là. D’où la demande de disposer de son corps en le jetant de l’autre côté du mur de la cité. Ce geste est intéressant puisqu’il pousse la dénégation bien au‑delà de la difficulté de saisir le corps du mort comme objet d’étude. Il déplace la mort comme le concept philosophique de ma mort, puisque, comme l’a rappelé Heidegger, parler de la mort revient toujours à parler de ma mort. Mais ce geste relève d’un partage de l’espace, car en abandonnant le cadavre hors de la délimitation des murs de la cité, c’est‑à‑dire hors de la limite de l’espace public et visible de la polis, on ne fait pas disparaître le cadavre. On a retiré le corps de la vue car c’est toujours à travers la vue du cadavre que l’homme prend conscience de sa mort. Dès lors, il y a quelque chose de scandaleux à abonner un corps à la dissolution des éléments, et pourtant le cadavre demeure « un corps, au bord de l’abîme » (p. 20) qui participe au grand cycle de la vie et de la mort. Cet argument, qui traverse la pensée d’Héraclite jusqu’à la conscience écologique contemporaine, repose sur une pensée du corps désenchanté, alors qu’il existe également une pensée du corps enchanté, ce corps qui est craint, célébré, puissant, dangereux et préservé tout à la fois, celui qui passe par le cycle des rituels et pour lequel les hommes décorent l’intérieur des tombeaux ou déposent des offrandes et des objets précieux pour accompagner le défunt lors de son passage dans l’autre monde. Ainsi, malgré la radicalité de l’argument cynique, il est difficile de considérer le cadavre comme un déchet parmi d’autres. Même à considérer la pratique anthropophage, Montaigne soulignait déjà comment le cannibalisme amérindien s’inscrivait dans une suite de rituels précis où le corps de la victime n’est jamais perçu comme un simple magasin ou une réserve de protéines, mais est traité avec respect et soin. Ainsi, le cannibalisme amérindien forme à sa manière un des plus extrêmes démentis de l’argument de Diogène.
6Le livre de Th. Laqueur ne fait qu’affiner cet argument de base, élaborant un refus ou une réfutation progressive de Diogène. Contredire l’argument cynique s’opère sur deux plans qui vont structurer l’ensemble du livre : le plan anthropologique et le plan historique. En effet, prendre soin des morts s’inscrit dans la longue durée, où les pratiques, bien que variables, changent très peu ou très lentement. Face aux réflexions philosophiques sur la mort ou encore plus récemment d’une anthropologie de la mort, en traitant du corps du mort, on s’ouvre au domaine peu étudié de l’échange avec les morts, du travail du vivant et des raisons de l’affection pour ce corps sans vie. De fait, si on peut être choqué d’entendre parler métaphoriquement les morts, la vérité est que les morts ne parlent pas. Ils restent silencieux dans le noir le plus profond de leur tombe. Mais il existe de nombreuses cultures où l’on parle aux morts. À travers le corps mort, c’est tout le passé humain qui nous revient et qui nous parle. Une grande part de la magie de la littérature se trouve là, dans cette parole remplie d’absence, dans ce silence dans lequel les mots des morts viennent se loger.
7En cherchant à dégager une vision anthropologique de longue durée, Th. Laqueur veut répondre à Diogène par des vérités intemporelles qui ne relèvent ni de la géographie ni d’un moment historiquement déterminé. Ici, l’auteur nous confronte à ce sentiment partagé de la secrète attraction et d’horrible répulsion devant la souillure d’un cadavre en décomposition. D’une part, il y a quelque chose de profond en nous qui nous pousse à prendre soin du corps d’un mort, tout simplement parce que l’on touche à la fragilité même de la vie. Le cadavre du mort est démuni face aux éléments, tandis qu’il est déjà soumis à une rapide altération qui appelle l’attention et les gestes des vivants pour le préserver, le préparer et le mettre à part. Et pourtant, se mêle dans ce geste une part de crainte, une hantise du vivant devant ce corps du mort qui dérange. C’est alors que ce sentiment de soin et de fragilité cède la place à la chute du cadavre, le « cadere » de ce qui tombe et qui touche au comble de l’abjection, la hantise devant le corps mort qui, selon Julia Kristeva, est la mort infestant la vie pour la détruire. Le corps du mort est ce déchet qu’il faut écarter pour vivre. Face à cette antinomie, Th. Laqueur nous invite à considérer Lévi‑Strauss et la manière structurale de lever l’opposition entre nature et culture pour montrer que ce souci des morts et le soin que nous portons aux cadavres est le signe de notre émergence hors de la nature et notre inscription dans l’ordre de la culture. L’inhumation des morts est un phénomène fondamental de notre humanisation, argument que Caillois développa lors de son excursion sur les littoraux de Patagonie1. Ce séjour auprès des morts nécessite une prodigieuse dépense de travail humain, une autre dimension vitale qui atteste notre extraction hors du règne de la nature. Il en va de même lorsque nous séjournons auprès des morts, lorsque nous les lavons, les embaumons, les incinérons avant de disperser leurs cendres. Le livre entend rendre compte de tous ces gestes, de tous ces actes visibles avec lesquels nous vivons avec les morts. Th. Laqueur ne veut pas donner de limites historiques à son approche, mais propose une heuristique anthropologique pour nous aider à penser les fondements de l’ordre symbolique. Évidemment, de tels gestes posent le problème de la datation : à partir de quand nos ancêtres ont‑ils commencé à s’occuper des morts ? Ensuite vient la dimension significative de ce geste, qui permet de marquer une frontière cognitive entre la préhistoire et l’histoire.
8La longue durée permet d’argumenter contre Diogène. Tout d’abord, l’approche anthropologique montre que les morts ont deux vies. La première relève de la nature, tandis que la seconde trouve sa place au cœur de la culture. Il y a la mort comme un corps naturel qui est voué à la décomposition et à la disparition, puis il y a la mort comme être social, c’est‑à‑dire des êtres que nous devons méticuleusement retirer de ce monde afin de les préparer pour le suivant et pour la mémoire des vivants. La mort biologique est instantanée tandis que la mort sociale demande du temps, nécessaire pour raccommoder le tissu social en permettant aux morts de faire un travail de création. C’est justement cette dimension qui permet aux lieux où reposent les os des morts, aux cendres et aux noms d’entamer ce travail, selon les trois dimensions qui vont structurer l’ensemble de cette histoire culturelle du cadavre. Si les corps des morts nous travaillent, nous remuent, nous occupent, la dépouille requiert en effet un lieu où reposer, un site qui possède sa propre histoire et dont les luttes modifient la configuration des cimetières entre l’Ancien et le Nouveau Régime. Elle requiert également un nom pour pouvoir nommer les morts. Enfin la crémation, pratiquée depuis toujours sans provoquer de scandale, devient à partir de la Révolution française un enjeu politique important, avant qu’une pratique inquiétante à la fin du xixe siècle vise à industrialiser son processus, aboutissant à ce que Fritz Schumacher nomme « une lutte esthétique contre les cheminées ».
9Ayant défini son champ d’étude autour de ce triple geste (donner un lieu, donner un nom et brûler un corps), Th. Laqueur choisit pour terrains d’étude l’Amérique du Nord, la France, l’Allemagne et la Grande‑Bretagne. Bref, il retient le monde occidental dans une limite chronologique qui part du point de basculement entre les représentations et les pratiques du siècle des Lumières pour se terminer à la fin du xxe siècle. Et s’il s’agit toujours de faire glisser la perspective anthropologique autour de l’approche historique, c’est‑à‑dire faire jouer la longue durée pour mieux mettre en perspective les transformations ou mutations historiques, il n’hésite pas à mêler métaphysique, littérature et poésie à son argumentaire, citant Nabokov, Dickens, Cicéron, Marx, Freud, Rousseau ou encore Homère, car après tout si les morts habitent le vivant, c’est qu’ils travaillent tant la société que notre imaginaire.
Nécrogéographie, nécronymie & la cendre
10Le cimetière paroissial (« churchyard ») a été utilisé par l’Église en Occident à partir du viie siècle pour assigner un lieu de repos aux morts. À cette époque, l’Église avait la mainmise sur les enterrements ou les processions, et contre un honoraire échangeant des prières pour les morts, ceux‑ci trouvaient leur lieu pour une inhumation ad sancto. Cette proximité du lieu des morts avec un lieu sacré aurait été à l’origine du cimetière paroissial. Très rapidement, ce lieu va trouver une nécrogéographie, une nécrobotanique (avec le Taxus baccata, un if à la longévité exceptionnelle que l’on appelle plus couramment l’arbre des morts) et une nécrotopologie qui restera relativement stable pendant des siècles. Elle possède même son courant littéraire, avec « les poètes des cimetières » qui produisent des méditations mélancoliques au ton préromantique, voire pré‑gothique, dont les vers seront rassemblés au fil des ans sous forme d’anthologies qui fleurissent au cours du xviiie siècle. Mais très rapidement, un ordre et une hiérarchie se mettent en place dans le cimetière paroissial. Celui‑ci relève d’un « très ancien enchantement des morts » (p. 287) qui va être bouleversé au cours du siècle des Lumières. Deux morts entameront le désenchantement de l’ordre de l’ancien régime. Avec l’inhumation de Voltaire et de Hume, on assiste à un véritable scandale de l’ordre cosmologique de la présence des morts. L’un et l’autre sont morts hors de l’Église, dans le sillage d’une ancienne tradition socratique où une vie se juge à « l’aune de sa fin », placée sous le signe stoïcien de la bonne mort. L’anticléricalisme des deux auteurs souleva des débats autour du droit à la sépulture, mettant en évidence les tensions créées par la fermeture ou l’interdiction des cimetières paroissiaux aux non‑chrétiens. Si Voltaire ne désirait pas être inhumé par l’Église, voici qu’après de longs débats, il entrera comme par « Apothéose » dans un grand temple séculier dédié à Sainte‑Geneviève qui sera transformé par enchantement en un Panthéon où la nation française célèbrera ses grands esprits. Si la crainte de l’Église était de voir ainsi s’ériger une nouvelle religion dédiée à l’homme avec ses temples et ses processions, de l’autre côté de la Manche, ce sera James Boswell, l’ami et biographe de Samuel Johnson, qui demeurera intrigué par la position sereine de Hume face la mort. Confiant dans ses journaux ce qu’il nommera l’entretien sur le lit de mort de Hume2, il est intrigué par la possibilité de surmonter la crainte devant la mort. Boswell poursuivra avec Samuel Johnson ces discussions sur le bien mourir, lui qui, à l’opposé du philosophe écossais, est tétanisé par la mort. Johnson finit par déclarer à son biographe que Hume est mort ignorant puisqu’il a accordé peu d’intérêt aux écritures saintes. En effet, les derniers instants de Hume furent vivement commentés à l’époque, tandis que le philosophe laissa la somme de cent Livres pour la construction de son tombeau dans une concession d’un cimetière laïque sur les hauteurs d’Édimbourg.
11Comme le note Th. Laqueur, ces deux morts lancent un défi à l’enchantement de la mort dans l’Ancien Régime. Elles déplacent le débat de la métaphysique vers le politique. Ces deux morts préparent l’émergence de nouveaux cimetières qui prennent une forme différente. Aux alentours de 1800, un régime des morts presque millénaire commence à se désagréger. L’historien anglais Edward Gibbon fait « remonter ce régime au milieu du ive siècle, au moment où le corps de saint Babylas fut transporté dans le bosquet d’Apollon à Antioche et l’oracle de l’ancien dieu cessa à jamais de parler ». Voici comment l’auteur de l’Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain, en bon voltairien qu’il fut, espérait probablement que ce nouveau régime de la mort allait tenir sous silence les dieux de l’ancien régime. Ainsi, la transformation se prépare. Les grands « cimetières jardins » apparaîtront en bordure des villes. Ils relèvent d’une autre organisation de l’espace des morts, avec de grandes allées qui invitent à des promenades mélancoliques à travers des jardins conçus comme une sorte d’avatar de l’Élysée païen, tandis que ses sections ouvrent le lieu des morts aux non‑chrétiens. Ces nouveaux cimetières opèrent une séparation radicale entre le lieu des morts et celui du temple ou de l’église. Une des grandes justifications du cimetière‑jardin était l’argument hygiéniste. La croissance de la population au début de l’ère industrielle nécessitait le déplacement de ce lieu des morts vers la périphérie des villes. Le Père Lachaise construit en 1804 deviendra un modèle pour ces nouveaux cimetières‑jardins. Il fut conçu par Brongniart, mais puisque peu de gens souhaitaient y être enterrés, il fallut y déplacer les ossements de Molière et de La Fontaine en 1817 afin de rendre l’inhumation dans ce lieu plus attirante.
12Le second geste qui va retenir l’attention de Th. Laqueur est la nécronymie, cette relation qui se tisse entre le mort et son nom. Tout comme pour la mort, il existe deux naissances pour l’homme. La naissance biologique, lorsque le nouveau‑né sort du ventre de sa mère, et la naissance sociale. L’homme ne reçoit véritablement son nom qu’au moment de son entrée dans la communauté humaine, au point que les sociétés qui ne donnent pas de nom à leurs membres relèvent de la barbarie, comme le rappelle Hérodote. Or, c’est ce lien indissoluble entre la personne et son nom, rapport juridique fondamental depuis le xive siècle, qu’il faut préserver au moment de la mort. Plus précisément, c’est le rapport entre un corps et son nom qui préoccupe tant, au point que mourir sans nom est un scandale, d’où naît avec la Grande guerre le monument au soldat inconnu. La mort anonyme relève de ce qui est indigne pour la mémoire, alors que cette même guerre voit la profusion de listes des morts. En effet, Th. Laqueur distingue la constitution des listes de noms par temps de guerre et par temps de paix dans la longue durée, en rappelant comment le cimetière national de Gettysburg fut érigé selon les mêmes principes que le tertre funéraire de Marathon où quatre‑vingt‑douze soldats athéniens ont péri et pour lesquels furent érigées des stèles sur lesquelles était inscrit leur nom. La lecture de ce genre de registres, lors de discours ou d’allocutions deviennent de véritables oraisons funèbres, car la prononciation du nom des défunts est une manière de reconstituer la communauté des vivants autour des morts. De telles listes permettent de créer un pont entre la mort et la vie. Tel est la fonction du mémorial, qu’il soit érigé au cours d’un guerre ou pour remémorer un événement civil. C’est surtout l’évolution du mémorial et de la liste des noms durant la Première Guerre mondiale qui retient l’attention de Th. Laqueur, qui souligne que ce fut d’abord la bataille de Waterloo qui souleva pour la première fois une émotion à propos du soldat perdu, alors que la Grande guerre vit des centaines de milliers de soldats tomber au front sans possibilité d’inhumation. Certains témoignages rapportent la proximité de cet abominable spectacle, où le cadavre d’un mort « vit » pour ainsi dire dans la présence des vivants. Cette impossibilité de donner une sépulture transmet toute son importance à la liste des noms. Mais ce nécronominalisme prendra différentes formes, comme les noms au‑dessus des morts, les noms sans corps, le nom d’un corps présent/absent comme le mémorial de la Grande Guerre ou les corps jetés en mer, ou encore les listes des soldats disparus donc présumés morts. Ici, la liste du mémorial indique une proximité puisqu’elle rassemble les soldats morts durant un même combat. Il y a la figure inverse, celle du soldat inconnu qui est un corps amputé de son nom. Enfin, il y a le nom des morts donnés à des monuments ou des espaces publics (comme une rue ou une place) et qui constituent selon Th. Laqueur une manière d’explorer le monde.
13Le troisième geste est celui auquel sont consacrés les derniers chapitres du Travail des morts, à savoir le geste de brûler les morts. Le feu et la cendre sont une pratique ancestrale. Ce geste est immémorial. Il remonte à la nuit des temps et fut une pratique qui traversa les âges et les cultures, alternant par périodes avec l’enterrement. Par exemple, les Romains enterraient leurs morts, avant que ceux de la République tardive ne les incinèrent. Au iie siècle de l’Empire, l’enterrement redevient la norme, et lorsque les premiers chrétiens deviennent menaçants, l’acte de les détruire par le feu devint une terreur d’état visant à effacer leur passage sur terre. On brûle les premiers chrétiens pour s’assurer qu’ils ne laissent pas de traces. La crémation devient une source de conflits, avant qu’elle ne soit interdite par Charlemagne comme pratique païenne. Vers l’an 1000, l’ensemble de la chrétienté enterre ses morts, alors que l’Église a la mainmise sur l’enterrement. À l’exception de certains cas, comme pour les reliques des saints dont on fait bouillir les corps pour transporter plus facilement leurs os à travers l’Europe, il faudra attendre la Révolution française pour que la crémation ne revienne à l’ordre du jour. Elle s’impose comme le nouvel ordre et devient une figure du néo‑classicisme anticlérical. Mais ce n’est qu’à la fin du xixe siècle, avec l’industrialisation des hauts fourneaux qui permettent de brûler rapidement les corps, que s’impose avec plus de force et d’insistance la crémation. Le passage du cadavre aux cendres n’est plus un processus lent, incomplet et coûteux. Th. Laqueur voit en cette application du progrès technique« un exercice de désenchantement inouï » qui alarme une partie de la population, mais qui s’impose au fur et à mesure que la technique est mise au point. Selon Th. Laqueur, cette crémation industrielle signe la victoire de Diogène en séparant le corps humain de toute considération matérielle pour le réduire à un tas de cendres. Dès lors, tout le travail sur le corps du mort semblait être remis en question.
Le visage des morts
14Articulant son étude autour de trois gestes, celui de donner un lieu aux morts, d’inscrire leurs noms ou encore de brûler leurs dépouilles, on se rend compte qu’il existe d’autres gestes qui s’inscrivent comme une suite à cette investigation approfondie. Selon nous, un quatrième geste pourrait être le fait de restituer un visage aux morts, le geste de peindre et de représenter le visage du mort qui possède une longue histoire qui transite en Occident avec l’art du portrait qui apparaît au xve siècle. Comme l’ont montré Starobinski et Hans Belting3, ce geste n’est pas de simple représentation, c’est‑à‑dire de production de l’image pour rendre présent ce mort qui n’est plus, mais transite par la relation profonde que la mort entretient avec le masque. Du masque funéraire jusqu’à la prise en plâtre d’un masque mortuaire, il y a un geste qui consiste ici à prendre le visage, à le détacher du cadavre avant qu’il ne disparaisse avec lui. Cette dimension picturale ou plastique de l’image des morts est centrale lorsque nous savons que la grande tradition du portrait en Occident naît dans le sillage de l’art mortuaire. C’est ainsi que le portrait conteste un rite funéraire qui consiste à exposer le cadavre d’un défunt en public. L’Occident a perdu cette habitude de regarder les morts, qui ont décisivement disparu de l’espace public. Et lorsque l’actualité invoque la disparition d’une personne publique, ce sont toujours des images de la personne vivante qui sont montrées. Pourtant, ce déni de mort rend celle‑ci omniprésente. Cette dimension picturale est d’autant plus importante que l’édition française du Travail des morts ne reproduit pas l’ensemble de l’iconographie rassemblée par l’auteur dans l’édition américaine, dans laquelle on trouve le masque mortuaire de Luther, une scène du lit de mort de Voltaire en cire, le masque mortuaire de Jeremy Bentham ou les funérailles de Shelley peintes par Louis Fournier en 1889. Contrairement au livre de Philippe Ariès, Images de l’homme devant la mort (Seuil, 1989), qui nous montre des représentations de la mort, le masque mortuaire, le portrait ou le memento mori forment un travail que nous accomplissons sur le corps du mort.
***
15Thomas Laqueur affirme qu’il y a une continuité quant au souci que nous portons aux morts, là où d’autres insistent sur la rupture du monde moderne et la perte de la tradition. Selon lui, cette attention aux dépouilles des morts se poursuit dans notre monde « prétendument désenchanté». Décrivant comment nous pouvons de nos jours commander en ligne une incinération et recevoir les cendres du défunt en retour par la poste, sans cérémonie ou protocole, l’auteur préfère considérer ces cas comme marginaux et minoritaires. Cet optimisme se fonde sur le fait que nous ne cessons d’inventer de nouveaux moyens pour laisser les morts travailler notre monde, et que « l’avenir sera riche en enchantements itératifs ». Ainsi, ce n’est pas le souci que nous portons au monde qui est en train de changer, mais la manière dont nous mourons. Là se situe la véritable rupture pour l’historien. De nos jours, nous trouvons au chevet du lit de mort, la technique, les avocats, les travailleurs sociaux, qui sont comme autant de manière d’échapper à la mort naturelle. Signe plus singulier de cette rupture : le droit de mourir, qui pourrait être perçu comme la revendication pour une personne de retourner vers une mort naturelle, le droit à une bonne mort oscillant ici entre le droit à l’euthanasie et le refus de l’acharnement thérapeutique, alors que l’emprise de la biomédecine, revendications de liberté individuelle et d’un droit d’autonomie devant la mort montre comment l’individualisation de la mort se transforme en une négociation de plus en plus complexe. Là où Foucault, après avoir mis en évidence comment le regard médical a profondément changé le regard clinique que nous posons sur le corps malade, aurait vu dans cette individualisation un ultime champ dans lequel pratiquer notre liberté. Car au fond le souci de soi est un souci du bien mourir. Ce souci que nous portons au corps des morts relève d’une bonne gouvernance éthique du vivant. Tel est le sens que Th. Laqueur donne lorsqu’il affirme que la mort doit retourner « dans la sphère des diverses communautés humaines et redevienne intimement sociale ». En entrant dans ce domaine plus intime, le mort rejoint les pratiques de soi et les modèles de gouvernance qui s’appliquent au corps mourant face au dernier instant.

