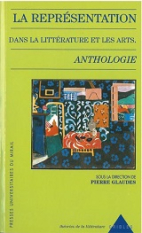
Crises de la représentation
1Les ambitions et apories de la représentation esthétique du monde sont choses fort courues, multiples, variées et ancestrales. L’homme imite, fabrique, sculpte, peint, écrit, danse, joue, chante le réel sans que jamais l’opération soit totalement satisfaisante : les critiques aussitôt fusent, les rectificatifs successifs des artistes et penseurs de l’art se superposent bientôt en un feuilleté théorique et pratique dénonçant l’écart irréductible (lui‑même objet de pensée) qui sépare l’homme du réel. Les enjeux de la représentation traversent absolument toute la culture occidentale : il fallait oser se confronter au gigantisme et avec modestie. C’est pourquoi sans doute le spectre notionnel couvert par l’anthologie des textes réunis par Pierre Glaudes, professeur à l’Université de Toulouse‑Le‑Mirail sous le titre La Représentation dans la littérature et les arts atteste d’une démarche qui se veut plus encyclopédique que philosophique, et sans doute plus didactique qu’essentiellement théorique. L’ouvrage est à la fois conçu comme une somme de textes fondamentaux et d’une utilité pédagogique évidente dans des domaines aussi divers que, pour la littérature, la « rhétorique » (Jean‑François Louette), le « théâtre » (Annick Brillant‑Annequin et Pierre Pasquier), le « récit » (Daniel Sangsue et Michel Vanoosthuyse), la « poésie » (Chistian Doumet et Hervé Nicolet), « littérature et société » (Henri Leroux, Alain Pessin et Lise Quéffélec) et, pour les arts, la « représentation picturale » (Jean‑Charles Gateau), la « photographie » (Daniel Bougnoux, Fabian Da Costa, Pierre Glaudes), le « cinéma » (Jean‑Pierre Bertin‑Maghit), « Musique et opéra » (Bertrand Vibert, Christian Doumet). Bien sûr, le découpage générique s’avère quelque peu arbitraire, comme l’attestent de nombreux recoupements d’un chapitre à l’autre. Reste qu’on circule agréablement entre les textes anthologiques, reliés entre eux par un fil conducteur dont a essayé ci-dessous de rendre compte.
La littérature
La rhétorique : donner à voir
2Jean‑François Louette inaugure l’ouvrage par une présentation de la rhétorique représentative dont l’objectif premier est de « mettre devant les yeux ce dont elle parle ». À ce titre, J‑F Louette montre à quel point l’idée de représentation a partie liée avec l’inventio et la narratio dès qu’il s’agit d’atteindre l’hypotypose. La réflexion de l’auteur sur ce sujet, qui s’appuie sur des textes d’Aristote mais aussi de Bernard Lamy ou de Francis A. Yates, s’attarde sur cet effet spécial de l’art du discours qui pose le problème de la correspondance non entre le réel et l’auditeur‑lecteur mais entre ce que pense l’auteur des figures et ce que voit mentalement celui qui l’écoute. Selon B. Lamy en effet « la parole est un tableau de nos pensées. Avant que de parler, il faut former dans notre esprit le dessein de ce tableau ». Le jeu de mots (dessein/dessin) porte en lui toute l’ambition d’un art de la parole adressée qui tend vers le déclenchement d’une peinture mentale chez l’autre. Cet idéal de transmission d’esprit à esprit, ce rêve de « transparence », qu’on pourrait en outre rattacher aux scènes de la révélation faite à Jean dans l’Apocalypse, trouve sur son chemin une incoercible suspicion qui concerne l’ornement du discours, coquetterie inutile et frein à la transmission de l’image. D’autres auteurs rappellent que la transparence en question reste limitée par le fait que la rhétorique est d’abord un repli du langage sur lui‑même et sur sa puissance d’illusion, d’où sa condamnation par Platon qui désire lui substituer un discours susceptible de mener les âmes à la vérité. Il arrive également qu’on dénie à la rhétorique son pouvoir originel, celui de la représentation : Lessing, combattant dans son Lacoon (1766) l’idée reçue de l’« ut pictura poesis » montre justement que le langage ne peut donner à voir, la poésie étant art du rêve, du sentiment, des effets, non des tableaux, des images et des faits. Parler, ce n’est pas peindre. Hegel confirme : le « ceci » est inaccessible au langage. On aboutit donc à un retournement, souligné par J.‑F. Louette : « bien loin que la rhétorique soit la représentation, c’est la représentation qui est rhétorique ; par là‑même, elle s’écarte de la chose en soi, de la vérité, de tout tableau adéquat ». Nietzsche radicalise ce point de vue dans Le Livre du philosophe (1872‑1875) en affirmant que la rhétorique, en « travaillant de l’intérieur nos représentations » nous éloigne irrémédiablement du vrai. Dès lors, où et comment fonder en légitimité l’ancestrale rhétorique ? Il faut aller chercher du côté du philosophe Alain, chez qui la rhétorique trouve sa consistance dans le corps. Laurent Jenny suggère quant à lui que « chaque figure [de rhétorique] représente virtuellement le tout de la forme de la langue », ce qui revient à sauver la rhétorique en la ramenant non sur le terrain de la représentation mais de la suggestion. Cela nous entraîne vers une rhétorique repensée sur le fond d’une discontinuité entre le langage et le réel et accessoirement vers une rhétorique de l’invocation et du mysticisme. Mais fallait‑il tout ce chemin anthologique pour parvenir à la conclusion via Sartre et Bonnefoy que la représentation n’est qu’un voile qui cache le réel ?
Le théâtre ou la double représentation
3Une progression similaire est proposée pour la représentation au théâtre et semble correspondre à un cahier des charges fixée à l’avance. La polysémie du mot « représentation », en matière théâtrale, constitue en elle‑même une problématique intéressante, qui est ici progressivement abordée. Aristote, encore une fois, sert de point de départ aux distinctions fondamentales et aux codes premiers de la représentation de la tragédie, ainsi qu’à l’examen de leurs prolongements « classiques » et de leurs contestations « baroques ». Du côté des théoriciens classiques, comme l’Abbé d’Aubignac, « l’image dramatique [est] comme un représentant doué d’une véracité indiscutable et d’un degré de réalité aussi fort, quoique dans un autre ordre, que celui de son modèle ». À cette tendance classique s’oppose la mimesis baroque dont les rares théoriciens, selon les auteurs de ce chapitre, « s’évertuent à rendre manifeste la fictivité de l’image dramatique ». La scène et l’acte théâtral se font alors métaphore du monde et de l’existence, comme chez Calderon, avec la prétention sous‑jacente de représenter tout ce qui est possible et non seulement ce qui est vraisemblable comme dans le théâtre classique. Il n’empêche que la question du réalisme théâtral se pose à nouveau au xviiie siècle où apparaît une forme de drame bourgeois difficile à mettre en place dans la mesure où il doit à la fois émouvoir le spectateur et l’inciter à la vertu, comme le suggère Diderot. Il y a ensuite au xixe siècle un dépassement hugolien particulièrement vigoureux de la dichotomie du beau et du laid, tous deux englobés, dans la préface de Cromwell, dans un genre souhaité comme l’alliance du sublime et du grotesque. Plus tard Zola tenta de radicaliser la mimesis et de l’étendre au théâtre, en transformant le drame en « compte‑rendu d’expérience dressé par un observateur objectif », transférant ainsi les concepts du roman expérimental à la création théâtrale : des auteurs comme Ibsen, Stringberg et Hauptmann s’y essaieront. Mais là aussi apparaît, du côté des théoriciens en tout cas, un doute radical sur les possibilités mimétiques du théâtre au moment même où il prétend représenter le plus fidèlement le réel. Au xxe siècle, qui apparaît comme le siècle des prises de conscience, des dépassements ont lieu qui conduisent les dramaturges vers la psychanalyse, le psychodrame, la dimension rituelle du théâtre (Artaud) et l’invention de codes symboliques propres, mais aussi vers une distanciation systématique des scènes représentées, impliquant la participation intellectuelle du spectateur (Brecht), autant de tentatives pour refuser et dépasser la prétention du théâtre à refléter la vie et lui rendre sa liberté d’action et de sens.
Frictions du récit
4On n’est donc pas surpris de retrouver Aristote comme homme ressource de la réflexion sur la représentation dans le récit, puis Platon qui, selon Genette, finissent tous deux par s’accorder sur l’essentiel, à savoir que le dramatique est plus « pleinement imitatif » que le narratif. Goethe et Laclos, et, dans le domaine philosophique Hegel et Lukacs, s’interrogent de même sur les compétences respectives de la « mimesis narrative » et de la « mimesis dramatique ». Une autre distinction apparaît entre l’historiographie et la fiction narrative, la première détenant un moment le privilège de la vérité. De fait, l’histoire de la fiction narrative est liée à ce type de distinction et à la recherche d’une spécificité susceptible de faire poids face au narratif non fictionnel. Dans le domaine du roman (qui est privilégié ici par rapport aux autres genres narratifs), véritable « laboratoire du récit » (Butor), on trouve d’abord des auteurs qui le rattachent, comme Hegel, au genre noble de l’épopée. Mais des théoriciens comme Bakhtine viennent rappeler qu’il est aussi attaché aux « genres bas » et populaires, qui existent depuis l’Antiquité. Pourtant, les premiers romans qui prétendent à la représentation réaliste s’oppose aux romans héroïques et pastoraux et l’on trouve chez Furetière comme chez Sorel une préoccupation réelle à l’égard d’une certaine correspondance entre le roman et l’expérience. Au xviiie siècle, la fidélité au réel et à la Nature deviendra une exigence fondamentale du plaisir de lire. De fait, au xviiie siècle, les objets naturels de la « mimesis romanesque » sont originellement liés à la représentation de l’individu et du « cœur humain », comme le soulignent Sade et de Staël, roman dont Milan Kundera dira les limites et la rupture introduite à cet égard par Kafka. Au xixe siècle, le compas s’élargit à la représentation sociale, de Balzac à Zola, ce qui conduit naturellement les romanciers les théoriciens du roman à se confronter aux critères profondément humains du vraisemblable, de l’effet de réel (ce qui donne lieu à un vaste tour d’horizon théorique) et du narrateur (un seul texte, original, de Paul Bourget sur le narrateur‑témoin), décrits ici comme les trois « opérateurs » incontournables de la mimesis. L’une des grandes crises (encore) que traverse la notion de représentation dans le roman est liée à l’opposition d’un roman de la totalité (Hegel, Lukacs), appelé « monologique » par Bakhtine à un roman « polyphonique » qui conteste une représentation univoque du monde. C’est un des coins les plus puissants enfoncés dans le socle représentatif du roman. D’autres, comme Musil, ou Adorno, contesteront la capacité du roman à représenter le monde moderne. Le Nouveau Roman apporte des réponses à cette crise et privilégie les signes sur les choses, se repliant souvent sur son propre processus (auto‑représentation), condamnant l’inanité du monde réel pour mieux revendiquer sa réalité, ce qui, selon les auteurs de ce chapitre, « amène les romanciers modernes à réenvisager la représentation non plus de point de vue d’une mimesis, mais d’une poiesis ». Enfin, sous le titre « Le Mentir‑vrai » où l’on s’étonne de ne trouver aucun texte d’Aragon, la réflexion s’engage du « je sais bien mais quand même », c’est‑à‑dire sur l’effet de fiction, indéniable, lui‑même vérifiable, et sur les frontières fragiles entre le réel et l’imaginaire. Le lecteur connaît l’écart entre ce qu’il lit et le monde réel mais cela ne l’empêche pas de se perdre dans la fiction, c’est‑à‑dire d’y croire, tout en retournant au réel qui advient aussi par différence avec elle. La nature du roman est donc inévitablement contradictoire : par nature totalement faux, il ne peut être écrit et lu que dans sa prétention au vrai et continue de créer des liens puissants avec l’action et la connaissance.
La poésie : de l’expérience du manque à la vocation de la présence
5Pour les auteurs du chapitre consacré à la poésie, « c’est bien la représentation verbale qui reconnaît sa défaillance dans l’acte de poésie ». Elle est essentiellement réparation et réconciliation avec un monde dont le langage courant nous sépare et donc avec le langage lui‑même. C’est pourquoi la théorie sur la poésie couvre en général les deux faces de cette mission : la face ontologique et la face rhétorique. Originellement associée chez Aristote à l’ambition d’une « perfection mimétique », elle l’est encore au xvie siècle chez Pelletier du Mans et Colletet, plus tard au xviie siècle chez Boileau qui souligne la puissance de surprise de l’image poétique. Bien plus récemment, Riffaterre rappelle que la représentation poétique pointe essentiellement non vers le référent mais vers les « signifiants », dont Kristeva veut faire, en 1969, un pont vers la « révolution sociale » et dont elle souligne la capacité à rejouer, à transposer, le trajet énonciatif de l’être vers le réel. Du coup, la métaphore se trouve souvent au centre des préoccupations des théoriciens (Riffaterre, Jenny), comme est au cœur du système de nomination poétique mais aussi cœur de sa capacité à voir au delà du visible, tel que l’entend, par exemple, Rimbaud mais aussi, avant lui, Baudelaire. Du reste, la poésie est souvent considérée dans sa « métaphysique », dans ce qu’elle dégage « au‑delà » d’elle‑même et dont parle si longuement Platon dans La République, ce qui peut aboutir au repérage une nature à la fois matérielle et spirituelle de la poésie (Hölderlin, Claudel). La prétention du langage poétique au sacré va jusqu’à l’utopie du cratylisme, où le principe mimétique est poussé au point que les mots sont les choses, alors que Mallarmé continue de rappeler la « fleur absente de tout bouquet » et que la poésie contemporaine (Bonnefoy) préfère rappeler que la poésie produit son propre « lieu » et sa propre " présence ". Dans la lignée du romantisme allemand, d’autres théoriciens soulignent dans la poésie la force de « l’analogie suprême » et du monde rêvé par le poème, la place donnée à l’imagination (re)créatrice du monde. Cependant, cette tendance peut apparaître limitée, comme est limitée l’efficacité de « l’épanchement du songe dans le réel » (Nerval) et l’on se tourne dès lors aujourd’hui davantage vers une saisie de la « rugueuse réalité » et la refondation du dire poétique dans le monde réel, sans que l’intériorité soit totalement oubliée. C’est ainsi qu’on peut rêver d’une réconciliation du sujet et du monde.
Sociologie de la représentation littéraire
6Le terme de « représentation », en sociologie, recouvre des notions qui n’émanent pas directement de la littérature mais davantage des médiations réflexives – et par conséquent la sociologie elle‑même – crées par les groupes sociaux dans leur quête identitaire ou idéologique : « Une société, écrivent les auteurs de ce chapitre, est toujours à la recherche de la représentation qui lui manque pour transformer tout ce qu’elle subit en manifestation la plus forte et la plus signifiante de soi et du réel. » À ce titre, la société constitue, notamment à partir du xviiie siècle, un objet particulier de la littérature dans la mesure aussi où celle‑ci détermine et est déterminée par la société dans laquelle elle advient. On repère ainsi des « objets sociaux » récurrents de la littérature, dont « l’homme » par exemple et plus particulièrement « l’homme social », qui sera l’objet central d’écrivain de vastes fresques comme chez Balzac, Jules Romains, ou Zola. Simultanément s’est développée au cours des siècle une réflexion sur la « fonction sociale » de la littérature (Sartre, Robbe‑Grillet) et sur le lien entre les formes de la représentation et les transformations sociales. On reste un peu sur sa fin pour un chapitre qui commençait de manière amitieuse.
L’art
L’homme & l’icône
7En comparaison de ce qui se dit sur le récit ou la rhétorique, la pensée de la représentation semble infiniment plus développée et précise (plus complexe aussi) dans le domaine de l’image peinte, sans doute parce qu’elle est en quelque sorte l’archétype fondateur de la représentation du monde et son origine fantasmatique. Jean‑Charles Gateau, auteur de ce chapitre dont le propos tend à se centrer sur le statut évolutif de l’icône, nous propose du reste logiquement (une fois posés des concepts essentiels de l’analyse du statut de l’image, de l’indice, de l’icône et du symbole) de remonter vers quelques textes d’approche des représentations connues du monde (dessins pariétaux de l’ère magdalénienne notamment) puis vers ceux qui traitent de l’univers « mixte » des hiéroglyphes égyptiens ou des pictogrammes sumériens, en un temps ou écrire et peindre pouvait être dit par le même mot. En se détachant du langage écrit, l’image conserve son statut problématique et critique d’accès au métaphysique et au spirituel dans la mesure où elle prétend représenter l’irreprésentable : tel est par exemple le statut de l’icône dont se méfie à des degrés divers les religions mais qu’on peut également aduler. Sa prétention générale à représenter sera de même condamnée – au profit du langage – par Platon : la représentation picturale n’est que simulacre. J.‑C. Gateau propose alors un grand nombre de textes consacrés aux débats religieux sur le statut de la représentation divine, de la naissance du Christianisme à nos jours. Pour l’auteur de ce chapitre volumineux, la rupture dans la conception de la représentation picturale se fait à la Renaissance. Cette bascule où l’on voit apparaître des pensées et des systèmes esthétiques, est explorée à travers des textes importants de Diderot, Kant, Hegel et Jean‑François Lyotard. C’est au xixe siècle qu’intervient (nous la retrouvons donc) une « crise de la représentation », dans la mesure où l’image superpose à sa volonté de représenter son désir de « présenter » le monde, ce qui semble se réaliser à travers les peintres et sculpteurs du xxe siècle dans un mouvement qui ramène l’homme, d’après Caillois, vers les gestes de ses origines. En outre, et selon la même dynamique que l’on a pu suivre pour certains genres littéraires, la dimension réflexive de la représentation picturale devient l’indice d’une crise dépassée et d’une attention au signe non plus pour ce qu’il représente ou pointe mais pour ce qu’il dit sur lui-même en tant qu’objet du monde, objet pourtant jouissivement tendu vers lui, comme le rappelle un texte final…de J.‑C. Gateau.
Le choc des photos
8L’invention de la photographie à la fin du xixe siècle, comparable en importance et en « choc » à celle de l’imprimerie, constitue, une fois n’est pas coutume, un repère particulièrement lumineux dans le monde mouvant des dates, des origines et de l’histoire des idées et marque une rupture franche dans la pratique et la pensée de la représentation. Les auteurs rappellent pourtant, de manière assez audacieuse, les « intuitions » qui ont précédé l’invention de la technologie photographique elle-même, comme le « mythe de la caverne » (ombres et lumières) chez Platon, dans le développement du Christianisme (l’imitation de Jésus‑Christ étant parfois considérée comme « l’impression lumineuse de sa propre image sur notre âme »), ou encore, plus logiquement, dans les fantasmes de Charles‑François Tiphaigne de la Roche, auteur visionnaire du xviiie siècle. Une fois apparue, la photographie bouleverse les repères et « transforme l’acte même de voir » et provoque un débat d’idées intense dont les textes proposés rendent assez bien compte et notamment la confrontation des avis de Nadar et de Lamartine autour de l’existence d’un « art » photographique que le premier revendique et dont le second rejette (momentanément) la possibilité au profit de la peinture. Ainsi nous rappelle‑t‑on l’opinion d’Alexander von Humboldt, de Baudelaire, d’Arago ou de Robert de la Sizeranne. L’approche sémiologique de la photographie, qui s’ancre symboliquement si l’on veut dans l’impression du visage du Christ sur le Saint‑Suaire (empreinte, impression, révélation, vérité, etc.) nous conduit vers les textes‑références de Walter Benjamin et de Barthes, en rappelant que la photographie, porteuse de charges symboliques ou directement signifiantes, entretient avec le réel des rapports ambigus par lesquels on peut vivre « à la fois l’expérience de la présence réelle » et celle d’une séparation radicale d’avec le monde. Le débat, qui dépasse depuis l’origine le cercle des photographes professionnels, se joue aussi entre les tenants d’une exploitation rigoureuse des possibilités réalistes de la photographie et des expériences décalées proposant comme Stieglitz l’image comme « métaphore ou équivalent du monde invisible intérieur ». L’un des problèmes essentiels posés par la photographie est par ailleurs que « la représentation autovalidante » propre à cet art « tient d’abord en ceci, qu’en elle le détail (le réel) déborde », contrairement à la peinture ou tout est construit et maîtrisé. Au‑delà de la photographie, se pose le nouveau problème aujourd’hui de « l’image des synthèse », comme le souligne Régis Debray. En outre, la « machination photographique », avec sa capacité à se reproduire infiniment en maintenant sa revendication du statut artistique, défie les arts anciens, marqué par l’œuvre unique. On trouvera en annexe de ce chapitre un tableau synthétique des inventions et des mouvements d’idées liées à la photographie.
Au grand écran
9Les spectateurs des premiers films ont eu l’impression que le réel entrait en eux, ce qui plaçait le cinéma au cœur du débat sur la représentation, avec la complexité ajoutée d’une réalité captée puis projetée et des débats renouvelés sur la mimesis du vivant. Ici, comme pour la photographie, le caractère technologique du film freine son entrée dans la sphère étroite de l’art. Mieux, il capte le réel au‑delà de ce que les yeux humains perçoivent. Très vite, dans l’histoire des idées sur le cinéma, des « écoles » s’affrontent : d’une côté ceux qui veulent s’en tenir à une analyse, un décomposition‑recomposition du réel et ceux qui s’inspirent plus nettement des grands mouvements esthétiques contemporains, et qui tendent davantage peut‑être vers la recherche de la transposition d’une vision subjective voire d’une exploration de l’inconscient (Artaud, Buñuel). D’autres tendances se dégagent, politiques notamment, qui tentent d’articuler le cinéma avec l’éducation du peuple à l’art de voir. On peut lire alors certains textes de théoriciens soviétiques du cinéma comme Eisenstein. Se distingue également, après la seconde guerre mondiale, la dimension documentariste du cinéma, sa dimension réaliste‑critique, par exemple dans le cinéma italien de l’après‑guerre. Du coup, selon André Bazin, la frontière passe entre les cinéastes qui croient au réel (filmer le quotidien, la réalité brute, sans montage, la caméra œil ethnographique) et ceux qui croient à l’image. D’un point de vue idéologique, certains lui assignent une fonction précise (notamment la déconstruction de l’art bourgeois) d’autres le considèrent comme idéologiquement neutre. D’une manière ou d’une autre, le débat finit par s’instaurer entre ceux qui réclament un cinéma où le spectateur se trouve à distance, devant une certaine réalité et ceux qui veulent le faire entrer dans la fiction des images, Marc Ferro le plaçant au cœur du système de communication sociale
L’opéra de la représentation
10La musique, moins que les autres arts, ne se réclame pas immédiatement de la représentation du réel, aussi est‑il intéressant de l’envisager dans ses rapports avec la représentation théâtrale et lyrique. Dans l’Antiquité, c’est moins la mimesis que l’effet moral de la musique qui suscite l’intérêt des philosophes. Chez Saint‑Augustin, la musique permet l’élévation plaisante de l’âme et constitue un accès immatériel à la spiritualité. C’est à partir du xviie siècle semble‑t‑il que s’élabore une conception moderne de la musique, avec des esprits comme Descartes, qui constate sa dimension sensorielle mais insiste sur les rapports mathématiques qu’elle exprime, et surtout avec le développement des opéras en Italie et en France, qui réussissent l’exploit de réunir parole et musique, hétérogénéité esthétique qui faisait débat à l’époque. C’est vers le xviiie siècle que des penseurs comme d’Alembert affirment que la musique est certes imitation de la nature mais aussi représentation des émotions que cette imitation produit. Rousseau, dont on connaît l’ampleur de vue sur l’opéra, souligne à quel point la musique s’adresse aussi à l’imagination par le pouvoir de stimulation auditive de la vision : « par un prestige presque inconcevable, écrit Rousseau, elle semble mettre l’œil dans l’oreille ». Elle a également le pouvoir de dépasser la simple description des phénomènes. Un autre théoricien, Michel de Chabanon, veut détacher la musique du sacro‑saint principe de l’imitation, encore respecté malgré tout par Rousseau Des ruptures franches apparaissent dès le xixe siècle contre l’idée que la musique n’aurait pour vocation que d’exprimer des sentiments ou d’imiter la nature : des musicologues comme Hanslick y voit davantage l’occasion d’une pure contemplation des formes, contre Rousseau, Glück et Wagner. Selon Hanslick, l’idée de représentation en musique est aussi absurde que celle d’expression. Seule compte sa dynamique. Pour Hegel, la musique reste cependant l’expression de l’intériorité du sentiment (la perception de l’âme par elle‑même) mais se révèle inapte à l’objectivation et demeure donc inférieure à la poésie. Selon Kierkegaard, la musique est d’abord l’expression adéquate de la « génialité sensuelle ». Nietsche, à la fin du xixe siècle, demeure l’un des grands penseurs de l’essence même de l’art de l’opéra et apparaît comme un précurseur de la réunion de la musique et de la poésie telle que l’a tentée Wagner dans la représentation symbolique et mythologique. La pensée moderne fait davantage apparaître l’absurdité d’une hiérarchie entre les arts en soulignant la part d’infini et d’ineffable de l’expression musicale, d’autant plus difficile à penser qu’elle se combine dans l’opéra au donner à voir et aux problématiques spécifiques de la « représentation » théâtrale (voir plus haut), l’opéra tendant toujours non vers la représentation du réel mais finalement vers l’expression de fusion conflictuelle des paroles et de la musique, laissant souvent l’affect dominer le concept.
La présentation de Pierre‑Glaudes : synthèse d’une synthèse
11Après ou avant un tel déluge de textes fondateurs, les esprits synthétiques apprécieront également la très belle présentation de Pierre Glaudes, (et qui se sort plutôt bien d’une entreprise impossible) en tête d’ouvrage, qui balaye avec une grande clarté et le souci du retour à une approche plus nettement chronologique, une bonne part des problématiques liées à l’idée de la représentation, soulignant notamment la densité des écueils dans le rapport de l’homme au réel absent que la diversité de ses réalisations révèle. Car la représentation, quel que soit l’art qui prétende se faire le substitut du réel (avant qu’il ne s’inscrive plus modestement dans un statut de passage et d’accès à celui‑ci), évidemment, trompe et trompe d’autant plus que l’homme lui donne valeur d’équivalence, au prix de toutes les illusions. Chez Platon, la représentation, trop jouissive pour être honnête, traître en vérité, obscure dans son fonctionnement, apparaît dans son ambiguïté et son mensonge fondamental, soupçon dont P. Glaudes souligne l’influence sur les religions qui a leur tour vont faire de la représentation de l’irreprésentable un enjeu majeur, l’Islam et le Christianisme ayant fait des choix radicalement opposés. Soupçonnée, la représentation du métaphysique à travers la présence terrestre du divin (empereurs, religieux, saints…) comble cependant un manque lié à la sensation universelle de l’absence des signes divins, ce qui en retour lui confère une puissance particulièrement dangereuse, lisible dans la condamnation des « idoles » et des « simulacres ». P. Glaudes suit ainsi, passant un peu rapidement sans doute de l’histoire des religions à celle de la philosophie et de la pensée de la représentation à l’âge classique à la théorie du sublime chez Kant, les étapes d’une dévalorisation et pour tout dire d’une méfiance radicale à l’égard de l’illusoire et séduisante reproduction du réel dissimulant le vrai, pas nécessairement atteignable à travers les sens. C’est bien cette confusion (car c’en est une et il serait peut‑être bon qu’on s’interroge sur les origines de cette méprise dont il semble bien qu’on l’ait constamment entretenue) entre la reproduction et le vrai qui conditionne toutes les condamnations, les doutes et les dépassements froids des réflexions les plus contemporaines. En opposition à cette évolution de l’idée de représentation vers l’ère du soupçon, Aristote, qui prend aussi source dans Platon, établit la légitimité de la mimesis dans le domaine artistique et construit patiemment l’idée d’une représentation conçue comme processus mimétique inséré dans l’ordre universel, légitimant la stylisation mais réduisant aussi les prétentions de la mimesis au vraisemblable, lié dans la tragédie non seulement au phénomène de la reconnaissance mais aussi au principe organisateur de la pièce, à la capacité de persuasion de l’œuvre et à son insertion dans les attentes du public. L’héritage aristotélicien lui‑même est complexe et P. Glaudes tente de suivre de siècle en siècle les avatars de cette notion‑source qui sert de point de départ à la plupart des interventions de l’anthologie. C’est au xviiie siècle que l’auteur voit apparaître un véritable rupture avec l’idée classique de la représentation, avec l’introduction de l’idée que la littérature et les arts sont aussi « expression de la société ». On assiste alors, selon P. Glaudes à « une redéfinition de la visée sociale de la représentation » (XIV). C’est au xixe siècle qu’on voit apparaître, notamment à travers le Naturalisme de Zola une conception de la représentation liée à des modélisations scientifiques. L’une des conclusions de l’auteur de cette introduction est que « les principes sur lesquels repose la mimesis évoluent donc sans cesse, au gré des conventions esthétiques qui dominent, à un certain moment, une société, selon un système flexible d’attentes et de réponses liant par contacts tacite les artistes et leur public » (XV). C’est bien la fragilité de ces « contacts tacites » et de ces « pactes de lecture » (Philippe Hamon) qui déclenche, au xxe siècle une véritable « crise de la représentation », à travers, par exemple, Antonin Artaud qui inaugure une ère où l’on découvre plus clairement peut‑être « le triomphe des codes et la conscience de leur arbitraire » des arts « traditionnels », les nouvelles technologies que sont la photographie puis le cinéma s’appropriant le label réaliste, introduisant une « perturbation du régime traditionnel de la représentation ». Au xxe siècle, cette critique de l’arbitraire se lit dans la spécularité affichée du roman et de la peinture, deux arts dénonçant allègrement leurs propres codes « réalistes » et revendiquant une autonomie plus grande à l’égard de l’exigence référentielle, ce qui ne va pas sans une part d’auto‑représentation et, en littérature, de « fétichisme textuel », créant d’autre part ce que P. Glaudes appelle de manière fort intéressante le goût de la « présentation », visant à rétablir les liens de la conscience avec le monde, avec par exemple Rimbaud et Ségalen qui donnent corps à l’irreprésentable, les signes ainsi lâchés témoignant davantage des rapports du psychique avec le réel. En somme, explique P. Glaudes, ce qui est intéressant dans cette « affaire » de la représentation, c’est que l’homme conçoit essentiellement le réel à travers l’idée de représentation comme si celui‑ci n’était pas séparable de sa figuration, comme si le réel était toujours déjà représenté, représentable, représentation, ce qui ne serait pas pour déplaire à Schopenhauer. Mais le don de l’artiste reste de dépasser cette représentation immanente et commune pour en quelque sorte la refonder et lui redonner du sens. L’intervention de l’écrivain dans ce domaine serait alors une tentative de revalorisation du lien au réel.
Panorama messianique ?
12Annoncé par son directeur comme « un panorama forcément lacunaire des théories de la représentation esthétique » (Introduction, I) , ce collectif tente donc de relier entre elles, autant que faire se peut et à l’intérieur de catégories esthétiques franches, qui admet la séparation en genres, les pages les plus marquantes d’une réflexion contemporaine de la naissance de l’écriture, de la peinture, de la sculpture et de la musique sur leur capacité à représenter le monde. On ne peut qu’être frappé cependant, à la lecture de ces chapitres volumineux et très riches, par la dramatisation systématique et historicisée (principe du reste repris par P. Glaudes dans son introduction) de l’évolution des idées sur la représentation : naissance sereine, théorie, crise de la représentation, dépassement et bascule vers une théorie seconde souvent spéculaire, voire vers l’abandon de toute théorie. Tout semble, inconsciemment peut‑être, orienté vers une « messianisation » du xxe siècle souvent présenté comme le siècle du dépassement définitif des problématiques antérieures. La perspective chronologique tend ainsi à annuler la qualité intrinsèque d’une anthologie qui peut naturellement présenter sur un même plan des penseurs du xviie siècle et xxe. Il ne s’agit pas de nier ici la spécificité des réflexions sur la littérature et sur l’art qui ont suivi notamment les deux grandes guerres mondiales mais l’on s’étonne que l’impression générale de lecture d’un chapitre soit celle d’une avancée ou d’un progrès conceptuel, les théoriciens du xxe possédant l’avantage du recul, au détriment d’une perception et d’une véritable confrontation des fragments théoriques sur la représentation. Reste que ce travail constitue un excellent point de départ pour une réflexion trans‑esthétique pour les étudiants, réflexion que la qualité des textes sélectionnés incitera certainement à poursuivre par eux‑mêmes.

