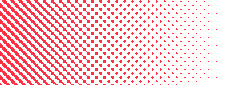Traduit de l’anglais par Malika Combes, avec le concours de Marielle Macé
11
2Parler du récit : voilà qui est très à la mode dans un grand nombre de disciplines – aussi bien en philosophie et en psychologie, qu’en théologie, en anthropologie, en sociologie, mais également en théorie politique, en littérature, dans les études religieuses, la psychothérapie, la médecine ou encore le droit… Aujourd’hui en effet, beaucoup s’accordent à dire que les êtres humains perçoivent leurs vies comme des récits, comme des histoires, ou du moins comme des rassemblements ou des recueils d’histoires. J’appellerai cette idée, qui fait actuellement consensus, « thèse de la “narrativité” psychologique » (en mettant la « narrativité » entre guillemets pour indiquer une propriété ou une conception spécifiquement psychologiques) : si l’on est « narratif » [N] c’est que l’on voit, ou l’on vit, ou l’on perçoit sa vie comme un récit ou une histoire, ou du moins comme un ensemble d’histoires.
3Ainsi présentée, la « thèse de la “narrativité” psychologique » est descriptive, empirique, et porte sur la façon ordinaire dont les êtres humains ordinaires, ou normaux, perçoivent leur propre vie. Nous sommes ainsi faits, semble-t-elle dire, voilà notre nature. Mais cette idée est souvent associée à une thèse normative, que j’appellerai « thèse de la “narrativité” éthique », selon laquelle il serait essentiel, pour bien vivre et pour acquérir une personnalité vraie ou entière, de se faire une conception narrative (et narrativement riche) de sa propre vie.
4Thèse descriptive et thèse normative présentent quatre articulations principales. On peut, d’abord, penser que la thèse descriptive est juste et la thèse normative fausse. Cela revient à considérer que nous sommes en effet profondément « narratifs » dans nos conceptions de la vie, mais que ce n’est pas une bonne chose ; le héros de La Nausée défendrait un point de vue de cet ordre1, souvent attribué également aux Stoïciens – en particulier à Marc Aurèle.
5Ensuite, et à l’inverse, on peut penser que la thèse descriptive est fausse alors que la thèse normative est juste. On reconnaît alors que nous ne sommes pas tous naturellement « narratifs » dans notre façon de nous représenter les choses, mais on insiste sur le fait que nous devrions l’être, et que nous en avons besoin pour vivre une bonne vie – on trouverait des versions de ce point de vue chez Plutarque2, et dans une multitude d’écrits actuels.
6On peut également penser que ces thèses sont toutes deux justes : que tous les êtres humains normaux, qui ne présentent aucune pathologie, sont naturellement « narratifs » dans leur représentation d’eux-mêmes et que la « narrativité » est en outre déterminante pour vivre une bonne vie. C’est aujourd’hui l’opinion la plus répandue dans le milieu universitaire (celle que j’ai présentée juste auparavant l’est presque autant). Ce qui ne veut pas dire que tout soit ainsi pour le mieux ; car cette conception laisse une grande latitude à l’idée que beaucoup d’entre nous gagneraient à être plus « narratifs » qu’ils ne le sont, et à la possibilité que les récits que nous faisons de nous-mêmes soient, d’une façon ou d’une autre, faux.
7Enfin, on peut penser que ces thèses sont toutes deux erronées ; c’est mon point de vue. Je crois que la conception courante et même dominante que je viens de décrire pose beaucoup de problèmes. Il n’est tout simplement pas vrai qu’il n’y ait qu’une seule bonne façon pour les êtres humains de percevoir leur existence dans le temps. Il existe des personnes profondément « non-narratives » et il existe de bonnes façons de vivre qui sont profondément « non-narratives ». Je dirais même que la normativité narrative peut entraver la compréhension de soi, condamner d’importantes pistes de pensée, appauvrir nos prises de responsabilités éthiques, inquiéter inutilement et injustement ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce modèle narratif, et s’avérer potentiellement destructive dans des contextes psychothérapeutiques.
82
9La première chose que j’aimerais mettre en place est une distinction entre deux façons de se rapporter à soi-même : l’une où l’on se considère principalement comme un être vivant, un être vivant pris comme un tout ; et l’autre où l’on se considère principalement comme une entité mentale intérieure, c’est-à-dire comme un « sujet » ou un « soi » – appelons cela « expérience-de-soi » (self-experience). Quand Henry James écrit, à propos de l’une de ses premières œuvres : « Je considère… l’œuvre en question… comme le travail d’une toute autre personne que moi-même… un riche… parent, dirais-je, qui… me supporterait toujours… en prétendant être un vague cousin au quatrième degré »3, James n’a aucun doute sur le fait d’être le même être que l’auteur de ce livre, mais il n’a pas l’impression d’être le même « soi » ou la même « personne » que l’auteur de ce livre. C’est ce phénomène, qui consiste à faire l’expérience de soi comme « sujet », qui m’intéresse ici. Comment les gens ont-ils le plus souvent tendance à se représenter eux-mêmes (indépendamment de toute croyance religieuse) ? Comme des entités dont les conditions de persistance ne sont pas forcément (ou pas automatiquement) les mêmes que celles d’un être humain pris dans sa globalité. Pétrarque, Proust, Parfit, et bien d’autres écrivains ont donné à cette idée une expression saisissante. Tenons sa viabilité pour acquise, afin d’établir une autre distinction, entre une expérience-de-soi « diachronique » et une expérience-de-soi « épisodique ».
103
11Voici la forme élémentaire d’une façon « diachronique » [D] de se percevoir : l’on se représente naturellement soi-même comme quelque chose qui était là (plus avant) dans le passé et qui sera là (plus loin) dans le futur ; quelque chose, donc, qui a une continuité diachronique sur un terme relativement étendu, quelque chose qui persiste sur un temps long, peut-être pour toute la vie. Je crois que beaucoup de personnes sont naturellement « diachroniques » et que beaucoup de ceux qui sont « diachroniques » sont également « narratifs » dans leur conception de la vie.
12Si l’on est « épisodique » [E], en revanche, c’est que l’on ne se représente pas soi-même, en tant que sujet, comme quelque chose qui était là (plus avant) dans le passé et qui sera là dans le futur. Dans ce cas, on a peu ou pas du tout le sentiment que l’on était là dans le passé et que l’on sera là dans le futur, même si l’on est parfaitement conscient d’avoir une continuité sur le long terme, en tant qu’être vivant. Ceux que j’appellerai les individus « épisodiques » ne tendent manifestement pas à percevoir leur vie en des termes narratifs4.
13Ces deux façons d’être dans le temps, épisodique et diachronique, sont radicalement opposées, mais elles ne sont pas absolues, ni dépourvues de jeu intérieur. La plupart des individus « épisodiques » peuvent appréhender des événements importants de leur passé en ayant le sentiment que ces événements leur sont arrivés (les souvenirs embarrassants en sont une bonne illustration) et anticiper les événements de leur futur en ayant le sentiment que ces événements vont leur arriver (les pensées touchant à leur mort à venir en sont un bon exemple) ; tout comme, pour la plupart, les individus « diachroniques » peuvent parfois ressentir un manque de lien épisodique entre des parties de leur passé dont ils se souviennent bien. Il est possible que le tempérament épisodique soit moins courant chez les êtres humains que le tempérament diachronique. Je soupçonne que les principes fondamentaux de dispositions à l’égard du temps sont « génétiquement » déterminés, et que nous ayons ici affaire à une profonde « variable de différence individuelle » – pour utiliser le langage de la psychologie expérimentale. Si cela est vrai, on retrouvera les variantes individuelles des styles temporels, épisodique ou diachronique, narratif ou non-narratif, dans toutes les cultures ; les mêmes divisions se manifesteront aussi bien dans une « culture de la vengeance », avec ses accents essentiellement « diachroniques », que dans une culture moins tragique5. Dans la même logique, la disposition exacte d’un individu par rapport à ces distinctions peut varier significativement dans le temps, suivant ce qu’il est en train de faire ou ce qu’il projette, suivant son état de santé, etc. ; et elle peut sensiblement changer avec l’âge.
14Précisons que la question de la pauvreté en mémoire n’a certainement rien à voir avec celle de l’épisodicité. Dans son autobiographie, John Updike – qui a manifestement une excellente mémoire, et un caractère tout à fait constant – dit de lui-même : « J’ai la sensation persistante, dans ma vie et dans mon art, que je commence à peine6… » J’éprouve la même sensation, et je pense qu’Updike décrit avec justesse la façon dont de nombreuses personnes se représentent leur propre vie, quand cette sensation rencontre leur expérience d’être dans le temps, et, en particulier, leur sentiment d’être des sujets. Mais il montre, à travers son propre exemple, que cette sensation d’être toujours au commencent de la vie n’a par essence aucun rapport avec le fait d’avoir une mémoire autobiographique pauvre, encore moins pour celui qui ne s’est encore jamais spontanément interrogé sur le cours de sa vie7.
15À cet égard, je crois que le sentiment d’être toujours au commencement de la vie n’est ni plus ni moins qu’une représentation de bon sens, une prise de conscience de la nature véritable de tout rapport au temps, du moins au temps humain. Je crois aussi que c’est l’une des expériences les plus présentes dans la vie ordinaire, accessible à chacun au quotidien, bien que l’on y soit rarement attentif8. Peut-être aussi ce point de vue ne reflète-t-il que mon expérience personnelle. Mais si le fait s’éprouver au début des choses est vraiment universel, alors il ne peut pas faire partie de ce qui distingue les « épisodiques » des « diachroniques ». Disons que le sentiment d’un commencement perpétuel est simplement plus saillant ou plus vif chez les « épisodiques » ; mais il n’est pas constitutif de l’une ou l’autre disposition. Une personne « épisodique », considérant la nature de son expérience présente, peut se représenter sa propre conscience comme un flux qui s’écoule sans éprouver pour autant un sentiment de recommencement perpétuel, puisque le sentiment particulier d’avoir été là dans le passé et d’être promis à l’être dans le futur lui fait défaut. Et une personne « diachronique » peut percevoir sa conscience comme quelque chose de toujours réengagé (toujours en train de débuter), sans pour autant éprouver de contradiction entre cela et le sentiment qu’elle était là dans le passé et qu’elle sera là (plus loin) dans le futur. Les « épisodiques » ont sans doute, en effet, tendance à vivre les choses d’une manière plutôt que d’une autre, et il en est de même pour les « diachroniques », mais il n’y a peut-être pas de lien nécessaire entre les tempéraments ou les dispositions épisodique et diachronique, et ces particularités phénoménologiques. La différence-clé – et par conséquent la possibilité de définition –s’établit plus simplement comme ceci : il s’agit d’une différence entre ceux qui se représentent ou se vivent naturellement eux-mêmes comme des « soi », des sujets, qui étaient là (plus avant) dans le passé et seront là (plus loin) dans le futur, et les autres9.
16Il est probable que « diachroniques » et « épisodiques » se comprennent très mal les uns les autres. Les individus « diachroniques » peuvent penser qu’il y a quelque chose d’effrayant, de vide et d’insuffisant dans la vie épisodique. Ils ont sans doute peur de cette représentation de la vie – bien qu’elle ne soit pas moins pleine ou émotionnellement structurée que l’autre, pas moins profonde ou sensible, pas moins ouverte à l’amitié, à l’amour et à la loyauté. Les deux genres de vie diffèrent à l’évidence beaucoup dans leur forme éthique et émotionnelle. Mais ce serait une grossière erreur de penser que la vie épisodique est forcément moins vivante, ou de quelque façon moins occupée, moins humaine, ou moins humainement remplie. Si les heideggériens pensent que les « épisodiques » sont forcément « inauthentiques » dans leur façon d’être dans le temps, et bien tant pis pour l’idée d’authenticité10 ! Et si les « épisodiques » tendent à caricaturer la vie diachronique – qu’ils trouvent stagnante, obstruée, excessivement tournée sur elle-même, peu authentique –, ils se trompent tout autant. Il n’y a pas à classer les formes de vie humaine a priori.
17On peut dire que les « épisodiques » situent leur expérience-de-soi dans le présent plus que ne le font les « diachroniques ». Mais il ne s’ensuit pas (et il n’est pas vrai) que les « diachroniques » soient moins « présents au présent » que les « épisodiques », ou que le présent soit en quelque sorte moins informé par le passé, moins responsable à l’égard du passé dans la vie épisodique que dans la vie diachronique. En revanche, cette dépendance et cette responsabilité présentent, dans les deux cas, des caractéristiques différentes, et ont des conséquences concrètes différentes. Confrontés au scepticisme des « diachroniques », qui les accuseraient volontiers de mal se rapporter à leur propre passé, les « épisodiques » répliqueront que le passé peut être présent ou vivant dans le présent sans y être présent ou vivant en tant que passé. Le passé peut être vivant dans le présent – et même plus authentiquement vivant – simplement du fait qu’il a contribué à façonner la manière d’être présente de tout un chacun, tout comme le jeu d’un musicien peut intégrer et incarner ses exercices passés sans qu’il en ait le souvenir explicite. Ce qui est vrai du développement musical l’est aussi du développement éthique, et les remarques de Rilke au sujet de la poésie et de la mémoire, qui pourraient s’étendre assez naturellement au domaine éthique, autorisent à penser que le rapport au passé des « épisodiques » présente peut-être un avantage sur celui des « diachroniques » : « Pour un seul vers », posait Rilke, il faut avoir beaucoup de souvenirs, et « il ne suffit même pas d’avoir des souvenirs […]. Car les souvenirs eux-mêmes ne sont pas l’essentiel ». Ils donnent naissance à un beau poème seulement quand « ils se transforment en sang à l’intérieur de nous, en regard et en geste, qu’ils sont sans nom et ne se distinguent plus de nous »11.
18S’il fallait nommer une série d’écrivains dont l’œuvre révèle un rapport épisodique au temps, je citerais volontiers Montaigne, le comte de Shaftesbury, Laurence Sterne, Coleridge, Stendhal, Hazlitt, Ford Madox Ford, Virginia Woolf, Jorge-Luis Borges, Fernando Pessoa, Iris Murdoch (voilà un être fortement « épisodique », et pourtant aussi une conteuse née), Freddie Ayer, ou Bob Dylan. Proust viendrait aussi à l’esprit, pour sa pratique du souvenir (qui pourrait bien être liée à une disposition épisodique primordiale), tout comme Emily Dickinson. La disposition diachronique se distingue moins clairement, parce qu’elle constitue, il faut bien l’admettre, la norme (autrement dit la « position non marquée »), mais on pourrait convoquer ici Platon, saint Augustin, Heidegger, Wordsworth, Dostoïevski, Graham Greene, Evelyn Waugh et tous les « champions » de la narrativité éthique dans le débat actuel. Je trouve même qu’il est facile de classer mes amis : beaucoup d’entre eux sont intensément « diachroniques », contrairement à mes parents, qui se situent du côté épisodique12…
194
20De quelle manière la représentation épisodique et la représentation diachronique de soi sont-elles liées à la question de la narrativité en tant que telle ? Supposons qu’être « diachronique » est au minimum nécessaire pour être « narratif ». Puisque la disposition diachronique et la disposition épisodique s’excluent mutuellement, alors la disposition épisodique exclut également que l’on se perçoive de façon narrative. Je pense néanmoins qu’une vie fortement « épisodique » est une vie normale, une forme de vie non pathologique pour les êtres humains, et même une bonne forme de vie pour les êtres humains, et par conséquent une voie à faire fructifier. Si donc la « diachronicité » est nécessaire pour être « narratif » (voir plus loin le § 9), alors je rejette à la fois la thèse de la narrativité psychologique et la thèse normative de la narrativité éthique.
21Il me faut à présent en dire un peu plus au sujet de la vie épisodique ; et comme il me semble que je suis moi-même plutôt épisodique, je me permettrai de m’appuyer sur ma propre expérience. J’ai un passé, comme tout être humain, et j’ai parfaitement conscience d’avoir ce passé. Je dispose d’une quantité suffisante de connaissances factuelles qui l’établissent, et je me souviens également de certaines de mes expériences passées « de l’intérieur », comme disent les philosophes. Et pourtant, je ne perçois absolument pas ma vie comme un récit en bonne et due forme, ni même comme un récit sans forme. Absolument pas. Je n’accorde pas non plus un intérêt particulier à mon passé. Ni ne me soucie beaucoup de mon futur.
22Ce peu d’intérêt pour le passé et pour le futur est une première manière de présenter cette disposition épisodique. Une autre manière serait de préciser qu’il m’est évident, quand je me perçois ou que je me comprends moi-même comme un sujet, que le passé ou le futur les plus éloignés ne sont pas mon passé ou mon futur, bien qu’ils soient certainement le passé ou le futur de l’être vivant Galen Strawson. Cette façon de présenter les choses est provocante, peut-être choquante, mais je crois qu’elle dit aussi avec justesse la manière dont je me représente moi-même comme « sujet ». Je n’ai pas particulièrement le sentiment que « Je » – le Je qui considère maintenant cette question – était là plus avant dans le passé. Et il me paraît certain qu’il ne s’agit pas là d’une absence d’émotion. C’est plutôt un constat factuel de ce que Je suis – de ce qu’est l’entité psychique qui considère en ce moment-même ce problème.
23J’utiliserai désormais le « Je* » pour représenter la façon dont je me perçois quand je me comprends moi-même comme une intériorité, un soi, une entité mentale dans le présent. Ce « Je* » draine avec lui une large famille de formes grammaticales apparentées – « moi* », « mon/ma* », « tu* », « soi-même* », « eux-mêmes* », etc. Ces mots grammaticaux ont des implications métaphysiques importantes : ils réussissent à viser cette intériorité que l’on s’accorde à appeler un « soi », ou un « sujet », et à y faire véritablement référence (savoir si c’est juste ou non n’a pas ici beaucoup d’importance13).
24Si je considère mon propre cas, il m’apparaît donc, avec netteté, que les événements de mon passé le plus lointain ne « me* » sont pas arrivés. Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela ne signifie certainement pas que je n’aie aucun souvenir autobiographique de ces expériences passées, car j’en ai. Cela ne signifie pas non plus que mes souvenirs autobiographiques ne présentent pas ce que les philosophes appelleraient une connaissance « de l’intérieur » – c’est le cas pour plusieurs d’entre eux, et ils incarnent certainement les expériences de l’être que je suis. Mais il ne s’ensuit pas que je considère ces événement comme m’étant arrivés à moi-même*, ni même qu’ils « me* » soient arrivés à proprement parler. Ils ne se présentent pas à moi comme des choses qui « me* » soient arrivées, et je crois que je suis tout à fait exact, et littéral, lorsque je dis qu’ils ne « me* » sont tout simplement pas arrivées.
25— Cela ne peut être, diraient mes contradicteurs. Si l’une des expériences dont je me souviens m’apparaît comme vécue « de l’intérieur », elle doit, par définition, être perçue comme quelque chose qui m*’est arrivé.
26C’est pourtant bien le cas : le fait qu’un souvenir soit éprouvé comme vécu « de l’intérieur » peut être complètement dissocié du sentiment que l’on est le sujet de l’expérience remémorée. Le souvenir que j’ai d’être tombé d’un bateau présente par définition cet aspect, celui d’une expérience vécue « de l’intérieur » – que ce soit visuellement (l’eau se précipitant à ma rencontre), de manière kinesthésique, ou de manière proprioceptive14. Il n’en découle certainement pas qu’il me procure le sentiment ou la croyance que ce dont je me souviens me soit arrivé à moi*, à ce sujet que j’ai le sentiment d’être maintenant quand je suis en train de me percevoir spécifiquement comme sujet. Les deux choses sont dissociées, même quand une composante émotionnelle affecte la remémoration. Que le souvenir soit éprouvé de l’intérieur, et marqué affectivement, n’implique pas que je m’éprouve comme le sujet de l’expérience remémorée, même si pour beaucoup de personnes ces deux choses vont de pair.
27Dans mon cas, c’est tout simplement un fait d’expérience. J’ai bien conscience que mon passé est le mien dans la simple mesure où je suis un individu, et j’accepte pleinement qu’à certains égards il présente une réelle pertinence pour moi* maintenant, notamment une pertinence de nature émotionnelle et morale. Mais en même temps, je n’ai pas le sentiment que j*’aie été là dans le passé, et je pense même qu’il est évident que je* n’étais pas là, d’un point de vue « métaphysique », si je puis dire. Quant à mes préoccupations pratiques pour le futur, elle sont biologiquement – viscéralement – fondées et autonomes (elle sont à vrai dire constitutives de l’humain), en sorte que je peux les éprouver fortement même si je n’ai pas particulièrement le sentiment que je* serai là dans le futur.
285
29J’en ai dit assez, pour le moment, sur le sentiment de la vie « épisodique ». Mais qu’en est-il de la vie « narrative » ? Que veut dire l’idée, très répandue, que la vie humaine soit narrative par nature ? Faut-il être « diachronique » pour être « narratif » ? Beaucoup de questions émergent ici.
30Une formulation frappante de la thèse de la narrativité psychologique est exposée par Roquentin dans La Nausée : « Un homme, c’est toujours un conteur d’histoires, il vit entouré de ses histoires et des histoires d’autrui, il voit tout ce qui lui arrive à travers elles ; et il cherche à vivre sa vie comme s’il la racontait15 ». Sartre présente ici l’impulsion narrative, le fait même du récit (story-telling), comme un défaut, une disposition fâcheuse. Il accepte, pour ainsi dire, les principes d’une narrativité psychologique tout en rejetant ceux de la narrativité éthique. Pour lui, l’être-narratif n’est pas une condition d’authenticité, c’est, bien au contraire, un exemple de mauvaise foi, d’inauthenticité radicale (et proprement irrémédiable).
31La majorité « pro-narrative » concèderait sans doute à Sartre le fait qu’un récit peut être erroné, mais elle posera toujours que le récit n’est pas mauvais en soi et qu’il est même nécessaire à une bonne vie. C’est pourtant à Sartre que je m’accorde sur cette question éthique.
32Considérons quelques versions actuelles de la thèse de la narrativité psychologique. Elle est, comme je l’ai dit, largement répandue. Oliver Sacks, par exemple, soutient que « chacun de nous construit et vit “un récit” ». Il précise que : « ce récit c’est nous-mêmes, c’est notre identité ». L’éminent psychologue Jerry Bruner parle de manière similaire « des histoires que nous racontons à propos de nos vies ». Il avance que « le soi est une histoire perpétuellement réécrite », et qu’« à la fin, nous devenons les récits autobiographiques à travers lesquels nous “racontons” nos vies »16. Dan Dennett affirme à son tour que :
Nous sommes tous des romanciers virtuoses, qui nous trouvons nous-mêmes engagés dans toute sorte d’attitudes, et nous cherchons toujours à nous présenter sous le meilleur profil possible. Nous cherchons à rendre cohérent tout le matériel dont nous disposons en vue d’une simple belle histoire. Et cette histoire est notre autobiographie. Le personnage principal de fiction qui est au centre de cette autobiographie est notre « soi »17.
33Marya Schechtman va plus loin, en combinant étroitement narrativité éthique et narrativité psychologique, d’une manière explicite et directe. Une personne, dit-elle, « crée son identité [seulement] en construisant un récit autobiographique – une histoire de sa vie ». Il serait nécessaire d’être en possession d’un récit complet et « explicite [de sa vie] pour se développer pleinement en tant que personne »18.
34Charles Taylor présente les choses de la façon suivante : une « condition fondamentale de notre sentiment de nous-mêmes », pose-t-il, « est de comprendre nos vies sous la forme d’un récit », et plus précisément « comme un récit qui se développe ». Ce n’est pas, à ses yeux, une question de choix ; nos vies existent « aussi dans un espace de questions auxquelles seule une narration cohérente peut apporter une réponse »19. Il rejoindrait volontiers le personnage de Claire dans le roman Génération X de Doug Coupeland : « Claire […] rompt le silence en disant que ce n’est pas sain de vivre sa vie comme une succession de petits moments isolés de détente. “Soit nos vies deviennent des histoires, soit il n’y pas moyen de les traverser” ». Mais Taylor attribue un poids moral beaucoup plus lourd à ce qu’implique le fait de traverser une vie. C’est « parce que nous ne pouvons que nous orienter vers le bien, et déterminer ainsi notre situation relative par rapport à celui-ci, et donc déterminer l’orientation de nos vies, [que] nous devons inévitablement concevoir nos vies dans une forme narrative, comme une “quête” […] et […] embrasser notre vie dans un récit »20. Ce sont, précise-il, « des exigences structurelles inévitables de l’agent humain »21. Paul Ricœur le rejoindrait sur ce point : « Comment, en effet, un sujet d’action pourrait-il donner à sa propre vie, prise en entier, une qualification éthique, si cette vie n’était pas rassemblée, et comment le serait-elle si ce n’est précisément en forme de récit22? » Mon principal étonnement, ici, concerne ce que signifie concrètement « donner à sa propre vie, prise en entier, une qualification éthique » ; et pourquoi diable, pris dans la variété de l’existence, devrait-on penser qu’il est essentiel de se comporter ainsi ? Il me semble que ces pensées sont motivées par le sentiment que leur auteur se fait de l’importance ou de la significativité particulière de sa vie, un sentiment que n’ont pas d’autres individus. Un grand nombre d’entre eux ont des engagements religieux qui sont liés à ce sentiment. Ils sont enveloppés par une forme de croyance religieuse qui vise avant tout – comme quasiment toute croyance religieuse – la définition du sujet23.
35Alasdair MacIntyre est peut-être la figure fondatrice de ce narrativisme moderne, et son point de vue est assez semblable à celui de Taylor. « L’unité d’une vie individuelle », pose-il, est « l’unité d’un récit incarné dans une vie unique. Demander “Quel est le bien pour moi ?” c’est demander comment je peux vivre au mieux cette unité et la compléter… » L’unité d’une vie humaine, poursuit-il, « est l’unité d’une quête narrative… Mais les seuls critères du succès de toute une vie sont les critères du succès d’une quête narrée. Quel est le but de cette quête ?… une quête du bien… la bonne vie pour l’homme est une vie passée à la recherche du bien pour l’homme24. » L’affirmation de MacIntyre ne semble pas, au premier abord, toucher à des questions psychologiques, mais avant tout morales : une bonne vie est une vie qui a une unité narrative. Mais une bonne vie est aussi une vie où l’on passe son temps à chercher la bonne vie, et l’on perçoit ici une forte incitation à penser que la recherche d’une bonne vie implique un engagement narratif ; auquel cas, la possibilité d’une unité narrative de la vie suppose en effet que le sujet se fasse avant tout une idée narrative de lui-même.
36Je ne m’accorde pas à ces propositions. Il me semble que MacIntyre, Taylor et plus généralement les tenants de la thèse de la narrativité éthique, en réalité, parlent tout simplement d’eux-mêmes. Il se peut que ce qu’ils disent soit juste dans leur cas précis, à la fois psychologiquement et éthiquement. Et c’est sans doute là le meilleur projet éthique que des individus ainsi disposés puissent mettre en œuvre25. Mais même si cela est juste pour eux cela ne signifie pas que ça le soit pour d’autres types de personnalité éthique, et de nombreuses personnes sont presque détournées de leur propre vérité lorsqu’on les incite à croire que la narrativité, en tant que telle, est nécessaire à l’accomplissement d’une bonne vie. Ma propre conviction est même que les meilleures vies n’impliquent quasiment jamais ce genre de récit de soi, et que nous avons déjà ici une autre profonde division du genre humain.
37Lorsqu’un individu « narratif » comme John Campbell affirme que « l’identité [à travers le temps] est centrale pour ce à quoi nous sommes attachés dans nos vies ; une chose à laquelle je suis attaché est de savoir ce que j’ai fait de ma vie26 », je suis aussi perplexe que Goronwy Rees quand il réplique :
D’aussi loin qu’il m’en souvienne, cela m’a toujours surpris et rendu un tant soit peu perplexe que des personnes doivent tant payer pour garantir que chacune d’elles possède ce qui est habituellement appelé un « caractère », c’est-à-dire une personnalité [ou la possession d’une personnalité propre] avec sa propre histoire continue [….] Je n’ai jamais été capable de trouver quelque chose de cette sorte en moi-même […]. Comme j’admire ces écrivains qui sont vraiment capables de saisir la progression de ce qu’ils appellent leur personnalité, de décrire les conditions qui déterminent leur naissance, de tracer joliment la courbe de leur développement […]. De mon côté, il me serait presque impossible de raconter une telle histoire, parce que, à aucun moment de ma vie, je n’ai eu cette sensation enviable de constituer une personnalité continue.
Quand j’étais enfant, cela ne m’inquiétait pas, et en effet si j’avais connu à l’époque Der Mann ohne Eigenschaften de Robert Musil, j’aurais reconnu cet homme sans qualités comme mon frère de sang et je me serais réjoui de n’être pas seul au monde ; mais en l’état, je me contentais en privé de ma propre fantaisie dans laquelle je figurais en tant que M. Personne27.
38Contrairement à Rees, je crois être parfaitement conscient d’avoir une certaine « personnalité », mais je ne suis absolument pas concerné par une question du type « Qu’est-ce que Galen Strawson a fait de sa vie ? », ou « Qu’ai-je fait de ma vie ? » Je suis en train de vivre cette vie, et ce genre de pensée autoréflexive est étrangère à ce processus. Cela ne signifie pas que je sois, d’une façon ou d’une autre, irresponsable. Mais ce qui me préoccupe, dans la mesure où je me préoccupe de moi-même et de ma vie, est de savoir ce que je suis maintenant. Ce que je suis maintenant est profondément façonné par mon passé, mais ce sont seulement les conséquences de ce façonnement dans le présent qui comptent, et non pas le passé en tant que tel. Je me reconnais donc ces lignes du comte de Shaftesbury :
Les métaphysiciens […] conviennent que si la mémoire est ôtée le soi est perdu. Et qu’importe la mémoire ? Qu’ai-je à faire du passé ? Si seulement tandis que je suis je suis seulement tel que je devrais être, que m’importe-t-il de plus ? Et je peux bien ainsi perdre mon soi à chaque heure, et être vingt soi successifs, ou vingt soi nouveaux, c’est tout un pour moi : pourvu que je ne perde pas mon opinion [c’est-à-dire ma conception générale, mon caractère, mon identité morale]. Si je la porte avec moi, il y a un je : tout est bien… Le maintenant ; le maintenant. Occupons-nous de cela : il est la source de tout28.
39Je pense, par conséquent, qu’il faudrait abandonner aussi bien la thèse de la narrativité éthique que celle de la narrativité psychologique, même dans leurs versions non triviales. (Que seraient des versions « triviales ? Ce seraient les affirmations d’une narrativité essentielle qui portent sur des exemples du type : faire du café est un récit, implique une narrativité essentielle, parce qu’il y entre une composante d’anticipation et d’ordre à suivre et que la vie de tous les jours regorge de « récits » de cet ordre)29.
40Est-ce que je manifeste de l’humeur lorsque je rends compte du succès de ces pensées, puisque je les crois fausses ? Pas vraiment. L’effort pour penser l’humain laisse beaucoup de place à l’erreur sur des sujets de cet ordre. Je suis pourtant persuadé qu’une partie du succès de ces théories repose sur un effet de mode dans le milieu intellectuel. Et je crois que ceux qui sont enclins à écrire au sujet de la « narrativité » ont tendance à avoir des conceptions ou des dispositions fortement « diachroniques » et « narratives », et à généraliser à partir de leur propre cas, dotés de cette étonnante confiance que les gens ressentent lorsque, considérant les éléments issus de leur expérience qui sont existentiellement fondamentaux pour eux, ils soutiennent qu’ils doivent aussi être fondamentaux pour n’importe qui d’autre30.
416
42— Tout cela est bien beau, mais qu’est-ce exactement que la narrativité psychique ? Vous n’avez toujours pas posé la question frontalement, et vous tournez autour du sujet…
43Sans doute faut-il d’abord repréciser qu’être « diachronique » n’équivaut pas à être « narratif ». Il doit y avoir quelque chose de plus pour percevoir sa vie comme un récit que le simple fait d’être « diachronique ». On peut être « diachronique », et se(*) percevoir naturellement comme quelque chose qui existe dans le passé et le futur, sans éprouver le sentiment particulier que sa propre vie constitue un récit à proprement parler.
44— Soit. Mais vous n’avez toujours pas défini ce qu’est un récit.
45Et bien, le récit est, par convention, une histoire mise en mots. J’utilise ce terme pour donner – au moins – une certaine unitéou une certainecohérence de développement,et donc de temps,aux choses auxquelles le récit est habituellement appliqué – vies, tranches de vie, écrits. Il ne s’applique donc pas à des séquences d’événements connectés par hasard ou radicalement déconnectés, mêmes quand ceux-ci sont ordonnées temporellement et se suivent vraiment, ou à des écrits d’ordre strictement aventureux ou « découpés » par hasard31.
46— Cela ne nous mène pas bien loin : il nous reste à savoir ce que produirait une unité ou une cohérence de développement dans une vie qui serait narrative par nature. Après tout, il semble évident que chaque vie humaine présente une unité de développement – une unité de développement de caractère historique aussi bien que biologique –, du simple fait que c’est une vie humaine. Si l’on écarte les cas d’extrême folie, toute vie humaine, même celle qui semble hautement désordonnée, peut faire l’objet d’une biographie possédant toutes les caractéristiques impliquées par l’unité de récit propre à ce genre littéraire. Or si cette sorte d’unité de développement est suffisante pour une structure narrative, alors il est tout bêtement vrai que toutes les vies humaines ont une structure narrative. En fait, même les chiens et les chevaux pourraient être le sujet d’excellentes biographies…
47C’est vrai. Et c’est pourquoi, je pense, les tenants de la thèse de la narrativité psychologique ajoutent que pour qu’une vie soit un récitau sens propre, celle-ci doit être vécue « narrativement ». Il s’agit avant tout de percevoir et de concevoir sa vie comme un récit, de l’interpréter comme un récit, et donc de la vivre comme un récit. Résumons et schématisons en disant que cette narrativité « objective », requiert une narrativité « subjective »32.
48— Voilà que vous utilisez la notion de narrativité psychologique pour caractériser la notion de narrativité « objective », c’est-à-dire le récit ; alors que je n’ai toujours pas compris ce qu’est la narrativité psychologique…
49Effectivement, ce n’est pas facile à expliquer. Partons de l’idée d’une construction ou d’une interprétation. La conception « narrative » de la vie implique à l’évidence une sorte de construction – une construction unificatrice, ou une recherche de forme (form-finding) [F] – à partir des événements d’une vie ou de plusieurs tranches de vie. Je ne pense pas que cette construction doive impliquer une quelconque activité intentionnelle, ni des modifications ou des ajouts à partir des faits. Mais l’attitude « narrative » doit (nous l’avons toujours soutenu) comporter quelque chose de plus qu’une disposition à saisir sa vie comme une unité simplement parce que ce serait là la vie d’un être biologiquement unique. Cette attitude ne se résume pas non plus à une capacité à produire un enregistrement séquentiel du cours véritable de la vie – l’histoire véritable –, même si cette vie illustre en fait un motif classique de développement narratif, indépendamment de toute construction ou de toute interprétation. Cette attitude suppose que le sujet s’engage – je le répète – dans une sorte d’interprétation de sa propre vie. Ce sujet doit tendre vers une certaine recherche de cohérence sur une échelle relativement large, une recherche d’unité, une recherche de motif, ou plus généralement une tendance à la recherche de forme (form-finding) quand il appréhende sa propre vie, ou des tranches de vie, à une échelle relativement vaste33.
50 — Mais cela ne permet toujours pas de distinguer la « narrativité » de la « diachronicité » : le tempérament diachronique implique déjà que l’on projette une certaine construction sur la vie – la vie de cet être que l’on est ; cela suppose que l’on appréhende cette vie à travers le sentiment unificateur qu’on(*) était là dans le passé et qu’on sera toujours là dans le futur. Mais vous avez dit qu’être « diachronique » n’était pas suffisant pour être « narratif ».
51Je suis prêt à accorder qu’être « diachronique », c’est déjà mettre une certaine construction dans sa vie, au sens où vous l’avez décrit. Néanmoins on peut être « diachronique » sans concevoir activement sa vie, de manière consciente ou inconsciente, comme une sorte d’unité de développement de type éthico-historique, en termes d’histoire et de constitution d’un personnage, de Bildung ou de « quête ». On peut être « diachronique » sans avoir besoin de se percevoir comme quelque chose qui persiste dans le temps34.
52— Vous vous répétez… et ma question reste sans réponse : quelle sorte d’interprétation de soi est nécessaire pour être « diachronique » ? À quel moment traversons-nous la frontière entre la diachronicité et la narrativité ? Ce n’est toujours pas clair…
53C’est juste : l’idée que la recherche de forme soit une condition nécessaire à la disposition « narrative » est très vague, mais son manque de précision participe peut-être de sa valeur, et il apparaît de toute façon que la « diachronicité » et la « recherche de forme » sont indépendantes l’une de l’autre. En pratique, sans aucun doute, les deux ont tendance à se présenter ensemble, mais on peut imaginer une personne « épisodique » chez qui la tendance à la recherche de forme serait précisément stimulée par l’absence de conception diachronique ; on peut imaginer, inversement, une personne « diachronique » qui, contrainte par les circonstances, vivrait une vie hasardeuse et très discontinue, et qui n’aurait aucune tendance à rechercher une unité ou un schéma narratif dans celle vie. Certains tempéraments « diachroniques », dans des circonstances similaires, peuvent passer d’une disposition à une autre à l’égard de la recherche de forme, en se mettant en quête de forme précisément parce qu’ils souffrent d’une vie faite d’« embêtements qui n’en finissent plus »35… Stendhal, radicalement non-narratif, pourrait être décrit cela, si l’on songe à tous ses projets autobiographiques chaotiques – même si je suis plutôt enclin à le considérer comme non diachronique36. En tout cas, il reste que l’on peut être « diachronique » tout en pensant très peu à soi. Nous pouvons être amenés à penser, à propos de tous les événements du passé dont nous avons le souvenir, que ceux-ci nous sont bien arrivés à nous*, sans saisir de manière pratique notre vie comme une unité quelle qu’elle soit – notamment une unité narrative.
54Je pense que cette idée d’une « recherche de forme » saisit quelque chose d’essentiel à la définition d’un tempérament « narratif », et que ce quelque chose va résolument au-delà du fait d’être ou non « diachronique » ; on pourrait suggérer que cette recherche de forme est non seulement nécessaire mais même suffisante à la narrativité psychologique.
55Certes, on peut dire que si l’on est naturellement « narratif », on peut aussi (évidemment) manifester une certaine tendance au récit(story-telling) [S] lorsque l’on appréhende sa propre vie – le récit est ici compris d’une façon telle qu’il n’implique pas nécessairement une tendance à la fabrication, consciente ou non, mais ne l’exclut pas non plus. De ce point de vue, on peut assurément être disposé à appréhender sa vie, ou à se penser soi-même, selon un modèle correspondant à la forme d’un genre narratif reconnu.
56La fabrique de récits est une recherche de forme (mais il y en a d’autres), dont le modèle de base pourrait être, prosaïquement, la façon dont des journalistes ou des historiens impartiaux savent rapporter une succession d’événements. Evidemment, ils font une sélection parmi des faits, mais on suppose qu’ils ne les déforment pas, qu’ils ne les falsifient pas, même s’ils font bien plus que lister simplement ces faits dans un ordre chronologique adéquat pour les organiser. Dans son mode non-falsifié, le récit implique la capacité à détecter – sans les inventer – des cohérences de développement au sein de la diversité de la vie. C’est un moyen grâce auquel on peut saisir des constantes personnelles fondamentales qui, en effet, existent bel et bien dans la vie de chaque être humain – bien qu’il me semble que cela peut aussi être possible dans le cas d’une recherche de forme sans récit.
57Le récit implique donc une recherche de forme, et l’association du récit à la recherche de forme est sûrement – banalement – suffisant pour définir la disposition « narrative ».
587
59J’avance une hypothèse plus perturbante : si l’on est « narratif », on aurait aussi tendance à s’engager inconsciemment dans l’invention, la fiction ou quelque chose de ce genre – falsification, affabulation, révision – quand on appréhende sa propre vie. Appelons cela, sans connotations, révision [R]. Il se pourrait que la disposition à une représentation narrative de soi comporte toujours une certaine tendance à la révision, une révision qui n’implique rien de plus que le fait que l’individu modifie son point de vue sur les événements de sa vie. (On peut modifier son point de vue sur les événements de sa vie sans aucune falsification, simplement en parvenant à voir les choses plus clairement).
60La révision, dans ce sens, est par définition non-consciente. Elle peut parfois apparaître de manière consciente, dans le cas de mensonges délibérés ; elle peut aussi présenter des aspects semi-conscients, mais il ne s’agit alors pas de révision dans le sens indiqué plus haut, à moins que (ou jusqu’à ce que) ces productions finissent par devenir vraies de façon à ce que soit exclue une falsification consciente37. La frontière entre conscient et non-conscient est à la fois opaque et poreuse, mais je pense que la notion de « révision » résiste à tout cela. Les cas paradigmatiques sont évidents, et extrêmement courants.
61S’il est vrai que la disposition « narrative » implique une tendance à la révision, voilà qui met en péril la thèse de la narrativité éthique, car ses défenseurs ne peuvent pas vouloir que le succès éthique dépende essentiellement d’une espèce de falsification. Je n’ai à vrai dire aucun doute sur le fait que quasiment toute narrativité humaine soit potentiellement compromise par la révision, mais je ne pense pas que cela soit toujours le cas. C’est de toute façon un phénomène vaste et complexe, et je me contenterai de quelques remarques à ce sujet.
62On dit souvent que la mémoire autobiographique est avant tout un phénomène de construction et de reconstruction (selon les termes de la psychologie expérimentale) plutôt qu’un simple phénomène de reproduction, et cela est évidemment vrai38 : la mémoire efface, abrège, coupe, réorganise, exagère. Mais même si la construction et la reconstruction sont universelles en ce qui concerne la mémoire autobiographique, elles n’impliquent pas nécessairement la révision telle que je l’ai définie, parce qu’elles peuvent former un récit librement construit ou issu d’une recherche de forme.
63Beaucoup de théoriciens suggèrent que nous sommes tous, sans exception, d’incorrigibles fabulistes de nous-mêmes, des « narrateurs peu fiables » de nos propres vies39, et certains se réclament d’une plus grande honnêteté dans la perception de leurs vies, et voient de l’arrogance, de l’aveuglement, etc. chez ceux qui le nient. Mais cette idée ne tient pas, elle n’est pas juste pour tout le monde : nous avons ici affaire à une autre divergence d’ordre avant tout psychologique. Certains sont des affabulateurs tout au long de leur vie. Chez d’autres, la mémoire autobiographique est fondamentalement fidèle à la réalité, quels que soient les processus automatiques de remodelage et de reformulation qu’elle peut mettre en œuvre40.
64Certains pensent que cette révision est toujours chargée (charged), comme ils disent – toujours motivée par un noyau d’émotions morales interconnectées, au premier rang desquelles l’orgueil, l’amour-propre, la vanité, la honte, le regret, le remords et la culpabilité. D’autres vont même plus loin, affirmant avec Nietzsche que nous révisons toujours en notre faveur : « “Voilà ce que j’ai fait”, dit ma mémoire. “Je n’ai pu faire cela” – dit notre fierté, qui reste inflexible. Et finalement, c’est la mémoire qui cède41. »
65Il me semble, en fait, qu’aucune de ces propositions n’est juste. L’idée que toute révision soit « chargée » repose sur la mobilisation d’émotions morales assez particulières, comme la modestie, le peu d’estime de soi, la gratitude ou le pardon ; certaines personnes tendent à réviser leurs souvenirs à leur propre détriment ou à l’avantage des autres ; mais cela ne change rien. Cette révision peut intervenir simplement parce qu’un individu qui serait, par nature, à la recherche d’une forme (a natural form-finder), serait aussi quelqu’un de très distrait, échouant à construire une histoire cohérente à partir d’éléments limités42. Des narrateurs contrariés peuvent tomber dans la « révision » simplement parce qu’ils ne parviennent pas à trouver une forme dans leurs vies, sans pour autant être guidés par une volonté quelconque de préserver ou de restaurer leur propre estime. Le compte-rendu de John Dean de ses conversations avec Nixon aux audiences du Watergate est un exemple célèbre de révision sans charge émotionnelle. Quand les enregistrements ont été retrouvés, son témoignage s’est révélé, de manière impressionnante, aussi « précis sur les positions de base des individus » qu’« imprécis sur ce qui avait effectivement été dit au cours d’une conversation donnée ». Sa relation était une révision, outre l’oubli ordinaire et la reconstruction moralement neutre, car elle contenait indéniablement des erreurs, mais il n’y a aucune raison de penser que cette révision fût chargée, ou significative43. Les souvenirs « flash » (par exemple le souvenir que l’on a de ce que l’on était en train de faire lorsqu’on a appris l’assassinat de Kennedy ou le 11 septembre) peuvent se révéler étonnamment inexacts – malgré notre certitude de nous les rappeler avec précision –, mais, encore une fois, il n’y a aucune raison de penser que la révision qu’ils impliquent soit chargée de sens subjectif44.
66De plus, même quand la révision est chargée, l’idée selon laquelle nous réviserions toujours en notre propre faveur doit être confrontée à une évidence : certaines personnes tendent à gauchir leurs souvenirs à leur propre détriment – ou tout simplement à oublier les bonnes actions dont elles sont l’auteur45. La Rochefoucauld posait que « l’amour-propre est plus habile que le plus habile homme du monde » ; il disait vrai. Et réviser à son propre détriment peut ne pas être plus attractif que réviser à son propre avantage. Mais La Rochefoucauld est parfois trop intelligent, ou biaisé, à force de cynisme46.
67La tendance à la révision n’est pas un élément nécessaire pour être « narratif ». Dans le cas fragile qui est le nôtre, la narrativité va rarement sans révision, mais le récit suffit à la narrativité, et on peut être narrateur sans avoir de tendance à la transformation. La thèse de la « narrativité éthique » surmonte donc la menace posée par l’idée de révision. Quand Bernard Malamud affirme que « toute biographie est en fin de compte une fiction », en se basant simplement sur le fait qu’« aucune vie ne peut être capturée dans son intégralité, telle qu’elle était », cela n’implique pas que celle-ci doive aussi, finalement, être fausse47.
688
69J’ai fait un certain nombre de distinctions, mais aucune n’est véritablement tranchée, et si quelqu’un me demandait comment les individus « diachroniques » [D], ceux qui sont en quête de forme [F], les « story-tellers » [S] et les narrateurs tendant à la révision [R] sont reliés les uns aux autres, la réponse que je serais en mesure de donner est que quasiment tous les cas sont envisageables. La propension au récit comprend d’évidence une recherche de forme, puisque le récit est tout simplement un genre particulier de forme, mais je ne vois aucun autre lien logique s’imposer entre toutes ces dispositions. Certains pensent que les individus normaux présentent l’ensemble de ces dispositions. Je crois au contraire que certains individus normaux n’en présentent aucune. Certains pensent que la propension au récit implique nécessairement les quatre. Je crois (comme je viens juste de le souligner) qu’elle n’implique rien de plus qu’un récit mis en forme (on n’en a pas besoin pour être « diachronique »). Si, pour finir, l’idée de « narrativité » est simplement employée pour désigner n’importe quel type d’attitude auto-réflexive, et le fait que la vie d’un individu soit considérée comme évaluable, alors je pense que la « narrativité » n’implique rien de plus qu’une recherche de forme, et n’implique absolument aucun élément distinctement narratif.
70Comment les différents auteurs que j’ai cités s’inscriraient-ils dans un tel schéma ? Je dirais que Dennett endosse la panoplie complète [+D+F+S+R] de la conception « narrative » de l’existence, et paraît accorder une place cruciale à la révision (Bruner, me semble-t-il, serait en accord avec cette importance donnée à la révision) :
Notre tactique principale d’autodéfense, de maîtrise de soi, et d’autodéfinition ne consiste pas à tisser une toile ou à construire des digues (comme les araignées, ou les castors), mais à raconter des histoires, et plus particulièrement à composer et à contrôler l’histoire que nous racontons aux autres – et à nous-mêmes – sur ce que nous sommes48.
71Il me semble que Sartre s’intéresse à la fois à la recherche de forme, à la propension à raconter, et à la question de la révision, [+F+S+R], mais n’est pas particulièrement concerné par une représentation diachronique de la vie prise comme totalité [D], notamment parce qu’il s’intéresse principalement au court terme, au récit du moment présent.
72La définition de la narrativité proposée par Schechtman correspondrait à une équation de type [+D+F+S±R] : il considère que nous sommes tous « diachroniques » dans notre façon de nous représenter la vie, que cela implique que nous recherchions une forme pour la nôtre, et que cette forme soit un récit ; mais il ajoute que le récit que nous faisons de nous-même ne doit pas présenter trop de révisions ou d’accommodements :
constituer une identité exige qu’un individu conçoive sa vie comme ayant une forme et la logique d’une histoire – plus spécifiquement, l’histoire de la vie d’une personne – « histoire » étant compris comme un récit traditionnel, linéaire49.
73Je me considère moi-même comme dépourvu de toutes ces dispositions. Je vois bien la fragilité de ma position lorsque je prétends ne pas gauchir particulièrement mes récits (il entre dans la définition de la révision que celui qui révise, gauchit, transforme, n’ait pas conscience de le faire). Je me trompe peut-être, mais (bien sûr) je crois que non.
74Si l’on suit jusqu’au bout le point de vue de Schechtman, cela fait de moi quelque chose qui n’est pas exactement une « personne ». Certaines créatures vivantes, pose-t-elle, « inventent des histoires à partir de leurs vies, et c’est cette capacité qui fait d’elles des personnes » ; avoir une « identité en tant que personne suppose d’« avoir une conception narrative de soi […] et de percevoir les événements de sa vie à travers l’image que l’on se fait soi-même de l’histoire de cette vie ». Il s’agit là d’une affirmation courante, mais Schechtman va plus loin en déclarant que « les éléments du récit d’une personne » n’existent que dans « son propre récit intérieur », et que ceux que celle-ci « ne peut pas formuler […] ne font que partiellement partie d’elle – ils sont reliés à elle selon un degré plus faible que les parties du récit qu’elle peut formuler »50.
75Cela me paraît exprimer un idéal de contrôle et de conscience de soi dans la vie humaine qui me semble faux, et potentiellement dangereux. La propension à une expression narrative de soi est naturelle chez certains – et peut être d’une aide précieuse – mais, chez d’autres, elle n’est absolument pas naturelle, et peut se révéler néfaste. J’ai même le sentiment qu’elle procure presque toujours plus de mal que de bien – le recours au récit, la recherche d’une cohérence narrative dans la vie, m’apparaît comme un obstacle flagrant pour la compréhension de soi, pour une perception juste, globale, pratique, implicite ou explicite, de sa nature. On sait bien que raconter et re-raconter son propre passé induit des modifications, des atténuations, des exagérations, des altérations par rapport aux faits, et des travaux récents ont montré que ce n’était pas seulement là une faiblesse psychologique de l’être humain : le fait que tout compte-rendu conscient et élaboré d’événements du passé comporte des altérations s’avère être une conséquence inévitable du fonctionnement du processus neuropsychologique de la production des souvenirs51. Les conséquences sont évidentes : plus l’on se rappelle, plus l’on se raconte et se re-raconte soi-même, et plus l’on s’éloigne d’une compréhension juste de soi, de la vérité de son être. Certaines personnes racontent constamment à d’autres leurs expériences quotidiennes, avec enthousiasme ; elles sont pourtant en train de s’éloigner irrévocablement de la vérité. D’autres ne le font jamais, et lorsqu’elles sont obligées de rassembler en récit les événements de leur vie, elles le font avec maladresse, difficulté et gêne, et d’une manière qui semble résister fortement et comme naturellement au récit. Parmi ces « non-narratifs », ces « anti-narratifs », il y en pour qui tout récit – par exemple celui que quelqu’un d’autre ferait de leur vie à eux en leur présence – semble rater la cible, manquer la vérité, même si tous les faits rapportés sont justes.
76La « narrativité » n’est pas nécessaire à l’examen de soi et de sa propre vie (ni même la diachronicité) ; et il est encore moins évident que l’examen de la vie, que Socrate considérait comme essentiel à l’existence humaine, soit toujours une bonne chose. On peut évoluer et progresser sans aucun retour explicite, en particulier narratif – tout comme les musiciens peuvent progresser grâce à des séances de répétition sans se remémorer ces séances. La question du « vivre bien » est, pour beaucoup, un projet absolument non-narratif. Si certaines façons de se comprendre sont parfois nécessaires pour une bonne vie, elles n’impliquent rien d’autre que la recherche d’une forme, qui peut exister sans propension au récit, et qui peut être d’ordre simplement osmotique, systémique, sans mise en scène dans la conscience.
77On pourrait penser que le progrès dans la compréhension de soi en psychothérapie, du moins, est un projet essentiellement « narratif ». Il est vrai que la thérapie permet d’ordinaire d’identifier des connections causales essentielles entre les aspects du début de vie et la configuration de celle-ci dans le présent. Mais même si ce que l’on apprend prend la forme d’un « c’est parce qu’il est arrivé X et Y à cet enfant, que je suis maintenant Z », la connaissance de ces connexions causales ne repose pas sur une disposition psychique spécifiquement (ni même vaguement) narrative, pas plus que lorsque l’on découvre, adulte, qu’une cicatrice (physique) a été causée par la chute d’un landau. Ce n’est pas une condition pour une thérapie effective – et l’on n’a probablement pas non plus besoin d’éprouver le sentiment « diachronique » que cet enfant rencontré en thérapie était « soi-même »*. Avec plus d’évidence encore, on n’a pas besoin d’un récit satisfaisant, « forgé » par un thérapeute, ou émergeant au cours de la thérapie, afin de bien vivre. Dieu nous en garde !
789
79— Désolé, dira mon contradicteur, mais vous n’avez vraiment aucune idée de la force et de la portée de la thèse de la « narrativité » psychologique. Vous êtes tout aussi « narratif » que n’importe qui d’autre, et bien des récits sur vous-même conditionnent la façon dont vous vous pensez vous-mêmes, même s’ils ne sont pas conscients.
80Ici, j’abandonne. Je pense simplement qu’il n’en est pas ainsi, et que les problèmes que cela pose ne sont pas seulement d’ordre terminologique. La compréhension de soi n’a pas à prendre une forme narrative, même de manière implicite. Je suis certes un produit de mon passé, y compris de mon passé très lointain, pour de nombreux aspects très importants, mais il ne s’ensuit pas que la compréhension de moi-même, ou une meilleure compréhension de moi-même, doive prendre une forme narrative, ni d’ailleurs une forme historique. Si l’on me demande d’expliciter cette compréhension de moi, je peux illustrer la perception que j’ai de moi-même en faisant référence à des choses que j’ai faites (que Galen Strawson a faites), mais il ne s’ensuit certainement pas que j’aie une conception « diachronique » de moi-même, encore moins une conception « narrative ».
81Heidegger indique, dans le souvenir de Socrate, que l’existence d’un être humain – l’existence d’un « Dasein » – repose sur le fait que son être soit pour lui une énigme. Soit, mais rien n’indique qu’être une chose dont l’être est pour elle-même une énigme implique une perspective narrative. Heidegger souligne que « la compréhension de soi est constitutive de […] ce que l’on est ou de qui l’(on) est », et que cette compréhension consiste principalement à « se déterminer soi-même comme quelqu’un en se projetant vers une manière d’être possible »52. Ici il semble effectivement (quoique je ne comprenne pas tout à fait son idée du temps) insister sur l’importance d’avoir une représentation diachronique et même narrative de soi. Si c’est le cas, alors – encore une fois – je ne m’accorde pas à cette proposition : ni en tant qu’affirmation universelle sur l’existence humaine, ni en tant que proposition sur ce que signifie, pour les êtres humains, d’être ce qu’ils sont ou qui ils sont, ni en tant qu’affirmation normative sur ce que doit être une existence humaine bonne ou authentique, ni comme proposition sur ce que toute compréhension de soi implique, ni, enfin comme conception de ce qu’est la meilleure façon de se comprendre soi-même. Peut-être l’authenticité heideggérienne est-elle compatible avec l’idée, apparemment contraire, qu’il importe de vivre le moment présent – « N’ayez donc point de souci du lendemain, car le lendemain aura souci de lui-même : à chaque jour suffit sa peine53 » ; mais cela ne change pas les termes du débat.
8210
83Il y aurait encore beaucoup à dire. Certains objecteraient peut-être que la vie « épisodique » doit, d’une façon ou d’une autre, être malheureuse. Mais les vies véritablement insouciantes, qui attendent de voir ce qui se passe au jour le jour, sont aussi parmi les meilleures qui soient : vivantes, heureuses, profondes54. Certains pensent qu’une personne « épisodique » ne peut pas vraiment connaître la véritable amitié, ni même être loyal. Ils sont contredits par Montaigne, un grand épisodique, célèbre pour son amitié avec Étienne de la Boétie, et qui jugeait qu’il « ne savait rien faire aussi bien qu’être ami » ; pourtant : « Il n’y a pas d’homme auquel il convienne aussi mal [qu’à moi] de parler de mémoire. Car je n’en reconnais quasi pas trace en moi et je ne pense pas qu’il y en ait au monde une autre [qui soit] aussi monstrueuse en déficience55 ». Montaigne se considérait souvent mal jugé et mal compris ; lorsqu’il confessait avoir une très mauvaise mémoire, on l’accusait d’ingratitude : « En s’attaquant à ma mémoire, on met en cause mon affection », déplore-t-il56. Le talent ou la disposition à l’amitié ne requièrent pourtant aucune capacité à se remémorer dans le détail des expériences partagées dans le passé, ni même aucune tendance à leur donner de la valeur. Ils se manifestent par ce qu’on est au présent.
84Les individus « épisodiques » peuvent-ils même être dotés de moralité ? Cette question en trouble plus d’un. Kathy Wilkes pense que non57. Il en est peut-être de même de Plutarque et de nombreux autres penseurs. Mais la « diachronicité » n’est pas une condition nécessaire pour avoir une bonne existence morale, ni pour avoir le sens des responsabilités58. Comme la disposition à la narrativité, dans le domaine de l’éthique elle m’apparaît même comme un obstacle ou une mauvaise habitude, plutôt qu’une condition requise pour une bonne vie. Le risque est celui d’une étrange marchandisation de la vie et du temps – de l’âme, comprise dans un sens strictement laïc. Ce n’est pas l’essentiel. « Nous vivons », comme l’observe un grand auteur de nouvelles Victor Sawdon Pritchett, « derrière chaque histoire que nous faisons naître59 ».