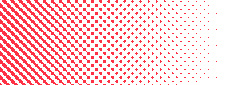Entretien avec Alexandre Gefen.
Dominique Viart, en tant que spécialiste de la littérature française contemporaine, avez-vous l'impression d'avoir à défendre la vitalité de ce que vous avez appelé « "la littérature au présent » ?
1J’aimerais pouvoir répondre par la négative : et dire que les livres se défendent seuls, qu’ils imposent leur puissance de fascination et de questionnement, même s’il y faut parfois du temps. Car, de fait, la littérature française contemporaine est de qualité et de grand intérêt. Bien sûr, on ne saurait tenir un propos aussi général sans le nuancer, mais il est patent que des œuvres de premier plan s’élaborent depuis la fin des années 1970. Et que d’autres, extrêmement prometteuses, naissent sous nos yeux. Nombre d’entre elles n’ont pas renoncé aux exigences formelles des dernières avant-gardes, mais leur finalité n’est plus seulement exploratoire : si elles inventent à leur tour des formes nouvelles, c’est parce qu’elles se confrontent à des questions longtemps laissées en suspens ou en jachère. Et qu’elles le font avec un sens critique peu commun.
2Mais il est vrai que cela ne semble pas évident pour tout le monde, au contraire. Et que ces œuvres sont doublement noyées : d’une part dans le flot des publications de médiocre qualité dont la principale justification tient plus du système de financement du monde éditorial que de la recherche d’œuvres fortes, et d’autre part sous une marée d’opinons toutes faites et jamais vérifiées, selon lesquelles les écrivains français seraient tous nombrilistes, minimalistes ou « autofictifs ». Une doxa, dont le thème et les variations se sont installés avec insistance à coup d’articles et d’ouvrages rapides, prétend en effet qu’il n’y a plus de littérature française. Non sans contradictions d’ailleurs : car à rassembler les arguments de ces opuscules, la littérature française serait trop formaliste et autotélique, mais les mêmes pamphlétaires regrettent, parfois dans le même ouvrage, le temps où les auteurs dits du « Nouveau Roman » rayonnaient internationalement, étaient appelés à enseigner dans les Universités américaines. De même, elle serait à la fois trop « germanopratine »…, mais aussi trop « provinciale » ; trop élitiste ou difficile d’accès, mais aurait abandonné les exigences de la langue et du style, etc.
3Tout cela témoigne le plus souvent d’une méconnaissance de la réalité effective de notre littérature. Et d’une étonnante prétention à rassembler en un même jugement des œuvres aussi diverses que celles qui nous sont données à lire. Il est du reste assez effarant (et, à certains égards, consolant) de constater quels sont les écrivains mentionnés par ces articles et pamphlets : la plupart du temps, il n’y en a même pas ! On procède par allusions, pures assertions et vérités que l’on croit générales. Et lorsque certains sont nommés, le moins que l’on puisse dire est qu’ils ne sont guère représentatifs de la richesse littéraire actuelle – mais plutôt les vedettes de la promotion médiatique.
4Aussi est-il nécessaire de travailler à faire connaître et reconnaître cette richesse. C’est dans cette intention que je me suis efforcé, depuis une quinzaine d’années maintenant, avec quelques amis et collègues, de soutenir l’idée que la littérature contemporaine méritait d’intéresser l’Université. Une telle entreprise avait au moins trois vertus : elle mettait à l’épreuve de l’exigence critique universitaire des textes qui manifestaient là leur puissance ; elle offrait à ces textes un autre temps de lecture, en évitant qu’ils disparaissent emportés par le rythme toujours plus rapide des « retours » de librairie, à peine aperçus par une presse littéraire trop souvent contrainte, elle aussi, de sacrifier son espace et de réduire ses choix éditoriaux pour « coller » aux attentes de son propre marché (bien des critiques littéraires de la presse se plaignent de devoir sacrifier leurs découvertes au bénéfice du roman dont « il faut avoir parlé »).
5Enfin et surtout, elle permettait de construire une réflexion générale sur le fait de la littérature contemporaine, c’est-à-dire sur ses enjeux, ses choix esthétiques mais aussi éthiques ou sociaux, ou encore sur sa façon de se construire par rapport à une histoire littéraire dont elle hérite et qu’elle relit à sa manière, et de s’inscrire dans le champ socioculturel. Car les détracteurs de la littérature actuelle en jugent d’après des critères qui ne correspondent guère à l’entreprise des écrivains. Jean-Marie Domenach, l’un des premiers à entrer en lice (Le Crépuscule de la culture française ?, Plon, 1995) regrettait par exemple de ne plus trouver dans les librairies de Malraux ni de « Grand Ecrivain » susceptible de définir des « morales d’action »… sans voir que c’est là justement une posture que les écrivains eux-mêmes avaient récusée.
6C’est pourquoi j’ai essayé de définir quels étaient ces « enjeux » que les écrivains se donnaient à eux-mêmes et dont leurs œuvres témoignent, explicitement ou non, notamment, avec Bruno Vercier, dans La Littérature française au présent (Bordas, 2005 édition augmentée en 2008). Entreprise délicate, car l’un des traits de la littérature contemporaine est de ne guère se définir elle-même. En ce sens, oui, j’ai donc « l’impression d’avoir à défendre la littérature au présent », c’est-à-dire d’avoir à la mieux faire connaître et comprendre, à la faire prendre en considération pour ce qu’elle est et non vilipender pour ce qu’on la croit être. Travail d’inventaire et de commentaire, de contextualisation et d’explication particulièrement stimulant, pour lequel j’avais créé d’abord la « série » Écritures contemporaines aux éditions des Lettres modernes-Minard, puis l’année dernière, la collection Ecrivains au présent, initialement chez Bordas, désormais accueillie chez Armand Colin, où sont approfondis par de substantielles monographies sur auteurs les travaux qui se développent sur la littérature actuelle.
7De fait, il me semble maintenant que la conviction s’est installée dans le monde universitaire d’un intérêt majeur de la littérature contemporaine. Les cours, les séminaires, les colloques, les publications qui lui sont consacrés sont de plus en plus nombreux, souvent très riches. Nombre d’étudiants inscrivent des travaux de recherche dans ce domaine. Au point qu’il devient sans doute nécessaire d’exercer une nouvelle vigilance, afin de s’assurer que les études contemporaines ne perdent pas leur propre crédit en acceptant de faire entrer dans leur corpus des livres de peu d’intérêt, mal écrits, et qu’elles ne se dévoient pas en courant après l’actualité. Et donc de poser la question d’une évaluation des œuvres, comme l’ont justement fait quelques chercheurs rassemblés autour de Dominique Vaugeois (« La valeur », Revue des Sciences Humaines, n° 283, 2006) et de Dominique Rabaté (« L’art et la question de la valeur », Modernités, n° 25, PU Bordeaux, 2007).
La fin de la littérature, la fin de l'écrivain, la fin de la culture française, est-ce pour vous la même chose ?
8Je suis toujours très réservé envers de telles notions, voire de telles proclamations. On se souvient de la remarquable bêtise qui a consisté à décréter la « fin de l’Histoire ». Depuis cette affirmation de Francis Fukuyama, le monde n’a pas cessé de bouger, les antagonismes de se déplacer vers d’autres extrémismes, plus religieux qu’idéologiques (ou plus exactement des idéologies fanatiques sous le masque religieux), et même le capitalisme libéral que le penseur américain voyait partout triomphant et désormais sans contre-modèle est aujourd’hui remis en question. Aussi devons-nous nous garder d’annoncer la « fin » de quoi que ce soit. Sauf à considérer, avec plus de nuances, qu’en effet des déplacements s’opèrent, que le statut de l’écrivain et de la littérature ne sont plus les mêmes qu’autrefois. Ce qui n’est pas la fin de la littérature, mais celle d’une certaine conception, et d’une certaine réception, de la littérature.
9Car il est certain que nous traversons une période de mutations fortes, qui ne laissent pas les pratiques culturelles indemnes. Pour comprendre ce qui est en jeu, il faut analyser les diverses acceptions de ces trois formules et distinguer les niveaux de réflexion.
10La « fin de la littérature » correspond, en effet, au moins à trois types de questions. Le premier niveau d’analyse, externe à la littérature elle-même, constate que la « Littérature » (avec majuscule) a perdu son audience ancienne, qu’elle n’est plus, si elle l’a été, la première des disciplines artistiques, nimbée d’un sacré que lui avaient conféré les romantiques, qu’ont exacerbé les Avant-gardes et que la Modernité a radicalisé en détachant la littérature du monde. Mais ceci est un phénomène assez vaste, qui excède bien le périmètre national, même s’il est plus accusé chez nous eu égard à la place que nous avions accordée à la littérature depuis les Lumières. Il concerne les nouveaux équilibres culturels, le goût (et bientôt le coût) du papier par opposition au privilège accordé aux écrans (cinéma, télévision, internet, jeux vidéo), à d’autres modes de loisirs et d’acculturation, procède d’un autre rapport au temps… Il concerne aussi l’importance que l’on donne, ou non, à l’étude de la littérature dans le système éducatif (valorisée ou secondaire ; pour spécialistes ou pour tout le monde), la finalité que l’on attribue à cette étude (étudier la littérature pour la littérature, comme une technè, ou, inversement, pour ce qu’elle permet de développer : un regard sur le monde, un esprit critique, une appropriation en profondeur de la langue, de ses effets et de ses puissances, « une voie d’accès », comme l’écrit Bouveresse, « qui ne pourrait être remplacée par aucune autre, à la connaissance et à la vérité »). C’est aussi la conséquence d’une redistribution des hiérarchies sociales, dont le professeur est victime comme l’écrivain : ils ne font plus référence. Le temps n’est plus de Victor Hugo Pair de France, de Lamartine candidat aux élections présidentielles, de Malraux ministre, et pas même celui des Barrès, Aragon ou Sartre, Maîtres à penser.
11Il est vrai, comme je le rappelais plus haut, que les écrivains se sont eux-mêmes démis de cette fonction, qu’ils en ont, comme Beckett ou Claude Simon, récusé la pertinence (lequel Simon ferraille cependant contre Kenzaburo Oé à propos de la reprise des essais nucléaires français). Nous sommes désormais entrés, en matière d’opinion, dans le paradoxal règne médiatique du quidam (sollicité par les « micro-trottoirs » et les « panels » d’émissions politiques) et de l’expert. Entre les deux, plus guère de place pour les penseurs du lien et du général. Encore moins pour ceux qui approfondissent les questions, en mesurent les résonances intimes ou ultimes. Exeunt les écrivains, les philosophes. Ne demeurent que quelques « intellectuels médiatiques » dont les propos stagnent le plus souvent à la surface des choses.
12Second niveau d’analyse, interne à la chose littéraire cette fois : c’est la littérature qui aurait, elle-même, énoncé et mis en scène sa propre fin. Telle est la thèse de William Marx dans L’Adieu à la littérature (Minuit, 2005). La formule de votre question rappelle d’ailleurs celle qui ouvre l’épilogue de ce livre : « Fin de l’écriture, fin de l’écrivain, fin de la critique ». C’est alors toute la démonstration de l’auteur, impressionnante de maîtrise et de culture, qu’il faudrait reprendre et commenter pour en traiter et la discuter. En substance, William Marx explique qu’après un temps d’expansion puis un autre d’autonomisation, la littérature française s’est elle-même dévalorisée de l’intérieur. Soit que les écrivains, mal remis de la rupture de Rimbaud avec la poésie, ne croyaient plus en elle ; soit qu’ils aient affecté de n’y plus croire pour mettre en œuvre une esthétique du désastre et du silence. Ce qui est fascinant dans cette démonstration, c’est qu’elle est à elle-même quasiment son antidote. Car William Marx ne dit rien, ou presque, des mutations extérieures que l’on vient d’évoquer. Si la littérature dépérit, selon lui, ce n’est pas tant de pâtir d’une concurrence extérieure, des mutations sociales ni des lois du marché, c’est de l’avoir choisi. Belle preuve, à certains égards, de sa puissance préservée, non ? Du coup ce livre qui se lit « comme un roman » (et avec grand plaisir) offre le « grand récit » de la littérature par elle-même. Qui se donne naissance et se met à mort motu proprio, affichant et célébrant paradoxalement ainsi non sa fin mais sa toute puissance.
13Je pense qu’il faudrait compléter ce constat et ce « récit » par une réflexion sur les rapports que la littérature entretient avec le monde, avec l’Histoire, avec le politique, avec les grandes questions héritées d’une métaphysique sécularisée : celles du sens, des valeurs, du rapport à autrui, de l’humain. Non pour considérer la littérature comme un symptôme ou un témoignage de son temps, à la façon des Historiens de la culture, ni pour la concevoir comme l’émanation des réalités socio-économiques, historiques, politiques ou sexuelles, à la façon des sociologues de la littérature ou des Cultural Studies, mais en littéraires… Et nous serions étonnés. Car la littérature est, avec la philosophie, (mais dont les livres et les pensées sont plus ardues, moins largement accessibles et plus conceptuelles), le seul lieu où se pensent et s’éprouvent ces questions qui ne cessent de travailler les hommes – ceux, du moins, qui s’accordent encore le temps de penser. Un lieu à la fois en dehors de tous dogmes (politiques, religieux…, lesquels imposent une pensée plus qu’ils ne la suscitent)et de toutes spécialisations disciplinaires (qui circonscrivent le regard à leur champ propre). Notre temps se défie – en Occident – du religieux et même du politique (qui est sans doute en train de renaître sous une autre forme que celle, massivement discursive, des idéologies). Or, c’est là, me semble-t-il, le lieu d’une véritable résistance du littéraire.
14Je suis frappé par la quantité de gens qui lisent, et pas seulement par divertissement. La crise économique dans laquelle nous sommes plongés a attiré au Salon du livre de Paris une fréquentation accrue de 20%. Un récent article paru dans Le Monde évoquait une augmentation des achats en librairie. Aux chiffres qui indiquent une désaffection envers la littérature, il conviendrait en outre d’opposer ceux qui témoignent de la fréquentation des bibliothèques, des « rencontres » en tous genres, lesquelles se multiplient, autour du livre : Manosque, Bron, Toulouse, Paris, Lyon, Chambéry, Saint-Malo, Lagrasse, Le Chambon sur Lignon…, toutes les villes ont leurs « Marathons », leurs « Correspondances », leurs « Enjeux », leur « Festival », leur « Foire », leur « Banquet », leurs « Lectures sous l’arbre », leurs « Assises », leurs rencontres où les lecteurs affluent. Connaît-on quelque chose d’équivalent dans la France du premier xxe siècle, lorsque la Littérature, nous dit-on, était dominante ? Je ne le pense pas. Sans doute faut-il, là encore, se garder d’une sorte de dévoiement, où le « spectacle » viendrait se substituer la lecture personnelle : Michel Deguy ne cesse de nous alerter sur ce danger du « culturel » – et c’est la question que nous avons voulu poser cette année, avec Sylvie Gouttebaron, lors des rencontres que nous organisons avec la Maison des Écrivains et de la Littérature de Paris, en interrogeant la « plasticité » de la littérature.
15Troisième niveau d’analyse : celui d’une évaluation de la littérature, qui rejoint le propos que j’esquissais tout à l’heure. Que vaut la littérature française aujourd’hui ? Non pas sur le marché économique du livre et/ou de la culture, comme le pense Donald Morrisson, mais en soi et pour nous. C’est à cette question que prétendaient répondre, hâtivement, les pamphlets parus dans les années 1990 (Jean-Marie Domenach, Jean-Philippe Domecq) dans la lignée des polémiques sur la valeur de l’art contemporain. Il suffit de relire aujourd’hui ces ouvrages pour constater leur peu de pertinence, leur ignorance ou leur mauvaise foi. Aucun des écrivains majeurs – Quignard, Michon…– qui s’affirmaient alors n’y figure. C’est là qu’est notre véritable travail de chercheurs et de critiques : en étudiant les œuvres de près, pour ce qu’elles se proposent d’être et de dire, pour les questions qu’elles explorent et redisposent, pour les failles qu’elles creusent et les perplexités qu’elles font sourdre…, nous manifestons leur force et leur intérêt.
16De même que signifie la « fin de l’écrivain » ? Que l’on cesse(ra) d’écrire de la littérature ? Je n’y crois pas un seul instant. La quantité de livres qui paraissent chaque année suffit à montrer à quel point la littérature jouit d’une image positive et suscite le désir. La multiplication des manifestations que j’évoquais à l’instant et l’affluence que ces initiatives suscitent est encore le signe d’une vitalité incontestable. Les gens lisent et se pressent pour écouter les lectures, rencontrer les écrivains, échanger avec eux. Il est certain, en revanche que le « statut » et l’« image » de l’écrivain ont changé : celui-ci paraît désormais plus proche, plus accessible. Y compris par l’intermédiaire des « blogs » où certains dialoguent avec des lecteurs qui n’auraient peut-être pas osé leur envoyer une lettre. Du coup, son verbe a perdu une certaine valeur oraculaire. Mais il n’en garde pas moins une résonance forte, qui agit selon d’autres modalités, moins magistrales mais pas moins prégnantes.
17En fait, il faut penser à la fois deux phénomènes : le changement de statut social de l’écrivain et les évolutions de sa langue. Les deux sont intimement liés. La langue de Pascal Quignard, par exemple, retranche l’écrivain au moins aussi sûrement que son retrait de la vie publique. C’est, en quelque sorte, le modèle de Maurice Blanchot ou de Julien Gracq : une certaine hauteur rhétorique qui s’accommode mal de sa traduction publique dans l’espace commun. Elle requiert au contraire une expérience singulière, celle, justement, de la lecture solitaire, lente souvent, disponible au phrasé tout aussi singulier de l’écriture. Une forme d’ascèse peut-être. Autrefois, l’écrivain ne se « produisait » pas beaucoup en place publique : il se réservait. Pour le rencontrer, on lui écrivait. Et la rencontre se faisait en privé, avec cet effet d’intimidation, ce rituel aussi de la visite. Il est notable que les premières émissions que la télévision a consacrées à la littérature se soient justement construites sur ce modèle, avec cet art singulier du dialogue cultivé par Pierre Dumayet. Mais ce n’est pas seulement, comme on pourrait le penser, une question de « génération » ni d’« époque ». Henri Michaux, qui se refusait toute prestation publique, et Eugène Guillevic, qui y consentait aisément, ont à peine huit ans d’écart. Ce n’est pas, non plus, une question de « qualité » de l’œuvre : l’un n’est pas, me semble-t-il, moins écrivain que l’autre. De même aujourd’hui, pour un Quignard qui se réserve d’autres s’offrent volontiers à la rencontre. Ce qu’invente ou favorise notre temps, ce sont des manières diverses d’être écrivain, comme il y a des manières diverses d’être dans la langue.
18Alors « fin de l’écrivain » ? Oui, si la question porte sur l’unicité d’un paradigme – l’écrivain– nous sommes entrés dans l’ère des écrivains. Mais ne nous y trompons pas : nous y étions déjà depuis longtemps : entre Zola et Rimbaud, quel rapport ? Entre Hugo et Mallarmé ? Entre Breton, chef de file, et Reverdy, retiré à Solesmes ? La différence, entre notre temps et ces époques plus lointaines est plutôt question de regard et de relais. Car ce qui nous convainc d’un moindre écho des écrivains est surtout le déplacement de l’échelle médiatique. Les anciennes grandes revues, auxquelles tout un public lettré faisait confiance, ont cédé la place. Et ce n’est pas la télévision qui servira de caisse de résonance aux œuvres essentielles de notre temps.
19Quant à la « fin de la culture française », s’il s’agit de dire que cette « culture française » ne s’exporte plus aussi bien qu’autrefois, comme le souligne le journaliste Donald Morrisson, cela sans doute est vrai. Mais est-ce à dire qu’elle n’existe plus ? Nos vins subissent désormais la concurrence de ceux d’Australie, du Chili ou de Californie, sont-ils moins bons pour autant ? Pierre Bergounioux notait, dans une perspective toute marxiste, que la puissance internationale d’une culture dépend de la puissance économique du pays qui la produit, et donc de l’importance de son Produit Intérieur Brut. Le nôtre n’est certes pas flamboyant. D’autres écrivains, de Jean Rouaud à Richard Millet développent, chacun à sa manière, le même type d’argument, qu’il s’agisse de constater (Jean Rouaud) ou de regretter (Richard Millet) la dissolution d’une « certaine idée de la France » et de son rayonnement. De fait, nous avons eu une culture dominante, du temps où la France était une grande puissance et régissait des colonies.
20Mais je ne suis pas tout à fait convaincu par ces arguments qui indexent la littérature à des critères bien peu culturels. Car alors la culture française n’était que l’ombre portée d’un pouvoir, économique et politique. Or ce qui retient le monde auprès de notre littérature, c’est sa force critique, la résistance qu’elle représente face aux pouvoirs, aux hégémonies culturelles. Souvenons-nous du Cahier d’un retour au pays natal de Césaire et de sa tension interne quant à la langue et à la culture : Césaire en appelle à Rimbaud et Lautréamont contre le français colonial. Ce qui l’attache à notre littérature, c’est ce qui en elle se rebelle contre les puissances établies, les académismes, les tutelles. Et cette résistance-là est toujours à l’œuvre. J’ai la chance d’être souvent invité à parler de notre littérature à l’étranger : je constate combien mes auditoires sont toujours curieux d’autres modèles de pensée et d’autres formes culturelles que celle qui s’étend à travers le monde. Il y a un « altermondialisme » de la culture, comme il y en a un de l’économie, et la littérature française en bénéficie bien plus que si elle s’inféodait aux modèles internationaux afin d’être plus largement « vendue » à travers la planète.
21Songez au nombre d’écrivains qui, encore aujourd’hui, choisissent le français pour écrire, choix bien peu stratégique, bien peu commercial, dirait Donald Morrisson, mais combien révélateur de ce que notre littérature représente, puisque l’on a à ce point envie d’écrire en cette langue, et donc, peu ou prou, de s’inscrire à la fois dans son histoire et dans son présent. Dans un entretien Atiq Rahimi lie ce choix à des questions de valeurs humaines autant que littéraires. Tout cela témoigne d’une attraction qui perdure et de ce que la littérature française, y compris contemporaine, continue de représenter une valeur forte dans bien des consciences. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard, si notre effort pour étudier la littérature française actuelle à l’Université a d’abord été soutenu, quand ce n’était pas anticipé même, par nos collègues étrangers.
Dans le champ critique, quelles analyses faites-vous des récents essais publiés sur la question de l'épuisement, de la fin, de la décadence ou encore de l'enfermement progressif de la littérature française au cours du xxe siècle ?
22Là encore la question est vaste, car elle recouvre des problématiques bien diverses. Et les termes que vous reprenez n’appartiennent pas aux mêmes champs. Lorsque Dominique Rabaté intitule un essai Vers une littérature de l’épuisement, il consacre son travail non pas à un supposé épuisement de la littérature, mais à une forme particulière, celle du récit, dans laquelle une poétique de la voix tente d’épuiser les possibles du sujet. Il souligne alors à quel point la littérature française a su, avec des écrivains comme des Forêts ou Beckett, pousser au plus loin l’investigation des limites non pas seulement de la langue ou de la littérature mais de la parole qui s’y peut déployer. Cela est bien différent des réflexions de John Barth, dans The Literature of Exhaustion, article puis livre qui datent de 1967, je le rappelle !, donc loin de valoir pour une littérature contemporaine très nettement postérieure. Barth voulait réfléchir sur les possibilités du roman dans un temps dominé par l’investigation formelle. Revenant quelques années plus tard (en 1980) sur ses réflexions, Barth précise qu’il s’agissait pour lui de traiter de « l’épuisement […] de l’esthétique du grand modernisme », que son essai « disait tout simplement que les formes et les genres artistiques naissent et se développent dans l’histoire de l’humanité et sont aussi sujets à l’épuisement, du moins dans l’esprit d’un certain nombre d’artistes à des moments et dans des endroits précis ; autrement dit que les conventions artistiques peuvent être écartées, subverties, transcendées, transformées ou même retournées contre elles-mêmes pour engendrer de nouvelles œuvres pleines de vie ». Il souligne enfin que, selon lui, « la littérature ne connaîtra jamais l’épuisement ». Rien là, sans doute finalement de très original, malgré les polémiques alors déjà suscitées, sinon un constat d’évolution et d’usure des formes littéraires, puis un appel à leur renouvellement. Du reste l’article de 1980, qui complète et corrige le premier, s’appelle justement « The Literature of Replenishment ».
23Une pertinente étude de l’écrivain et professeur Bertrand Gervais, « La mort du roman : d’un mélodrame et de ses avatars », paru dans Études littéraires en 1999, montrait déjà combien ces questions de « mort du roman » ou d’épuisement de la littérature relevaient plus de l’imaginaire que de la pertinence théorique. Sans doute n’a-t-elle pas été lue puisque de telles convictions perdurent. De même, on ne peut véritablement arguer d’un « enfermement progressif de la littérature au cours du xxe siècle ». Car s’il y a bien un effet de clôture parfois, chez Blanchot par exemple, une apologie ou une « hantise du silence », la littérature ne vaut jamais plus que son affrontement à cette clôture. Les grandes œuvres de la modernité, de Faulkner à Claude Simon, de Joyce à Beckett excèdent de loin la question de la forme, mais tentent de trouver les voies d’un dire inouï qui permette de nouvelles perceptions du monde, d’autres creusements du sujet, des traversées inédites de questions sociales ou métaphysiques devenues inaccessibles par le jeu des discours académiques. Les œuvres qui s’élaborent aujourd’hui n’ont pas renoncé à ce programme.
24À vrai dire, il ne me paraît même plus nécessaire de démentir ces propos mais peut-être d’interroger leur persistance. Tel est le projet du colloque qu’avec Laurent Demanze, nous nous proposons de réunir à Lille, en 2010, sur « Les fins de la littérature », en laissant entendre dans le pluriel de cet intitulé que divers discours, opinions et perspectives sont ici enchevêtrées, mais aussi en suggérant aussi que ces « fins », dans une autre acception du terme, pourraient bien être revisitées non comme des impasses, mais comme de nouvelles ambitions pour la littérature.
25Je me permets d’esquisser ici une hypothèse : il me semble que la meilleure littérature est celle qui déconcerte son lecteur, plutôt que celle qui le caresse dans le sens du poil. Il n’est pas agréable d’être bousculé dans ses préférences, ses choix ou ses certitudes. Tout ce qui ébranle nos convictions nous met en péril et nous inquiète. Or la littérature actuelle se reconfigure. Les meilleures œuvres se risquent sur des chemins non balisés. Il faut accepter d’entrer dans cette inquiétude. Au contraire, bien des « discours de la fin » s’arcqueboutent sur leurs valeurs et leurs certitudes, et fonctionnent sur la nostalgie. Symptomatique est, dans nombre de ces propos, l’importance donnée à la part autobiographique, aux souvenirs de jeunesse de l’auteur – on en lit chez Todorov, chez Domenach, chez Domecq (alors même d’ailleurs qu’ils condamnent le « nombrilisme » de la littérature… !)
Quels rapports existe-t-il entre les interrogations franco-françaises (l’aveuglement formaliste, la ruine d’une tradition, le déclin d’une aristocratie, etc.) et les spéculations étrangères sur le devenir de la littérature dans un espace intellectuel libéral mondialisé ?
26Vous pointez dans votre question le fossé qui sépare entre eux deux espèces de « déclinologues » : les conservateurs et les libéraux. Les premiers regrettent la domination d’une certaine littérature, plus préoccupée de son élégance que de sa forme, très classiquement conçue sur le modèle des « Grands Auteurs ». Les autres considèrent que la littérature est un art du passé, sauf à se construire en fonction de critères qui tiennent plus du marketing que de l’art. À certains égards, la meilleure grille de lecture de cette partition, c’est peut-être Les Droites en France de René Rémond : il y a une critique « légitimiste », qui prône le conservatisme et le respect des traditions ; et une critique « orléaniste » qui voudrait livrer la littérature au marché… Ces deux tendances n’ont qu’un maigre rapport, illusoire : celui de croire qu’un bon écrivain, « vendeur », auteur de « best-sellers » serait celui qui écrirait aujourd’hui comme Balzac, Maupassant ou Hugo. Sans voir qu’à la copie, on préfère toujours l’original et qu’on lit Hugo et Balzac en écrivains du « patrimoine » ou du « répertoire » comme on dit à la Comédie Française. C’est-à-dire non pas comme des écrivains caducs ou dépassés, mais en auteur de formes à la fois pertinentes et novatrices pour le temps dans lequel elles s’élaboraient, et qui gardent leur puissance parce qu’elles conservent ce génie qui les a fait naître, mais que n’aurait plus, aujourd’hui, quiconque les voudrait imiter. Mais en fait tout oppose ces deux tendances, car les uns voudraient pérenniser une grandeur passée selon des recettes qui avaient leur efficacité dans un monde qui n’existe plus, et les autres plier la littérature à n’être qu’une forme contemporaine du divertissement, ciblée selon des études de marché.
Quels rôles jouent dans un tel débat les théoriciens français des années 1960, de Barthes à Blanchot ?
27Blanchot sans doute a pu susciter des inhibitions, ainsi que des rejets, par la contrainte que sa pensée exerce sur la littérature en lui imposant une forme de clôture. Mais la hauteur de ses réflexions est aussi garante d’exigence littéraire. Ceci dit, je pense que les écrivains d’aujourd’hui se sont détachés de ce type de pensée, qui se mesure aux paradoxes et à l’énigme. Barthes en revanche demeure certainement plus présent dans les mémoires, mais c’est parce qu’il y a plusieurs Barthes. On a certainement pris de la distance avec le sémiologue de S/Z, mais les aperçus autobiographiques de Roland Barthes par lui-même, les réflexions sur le romanesque et « l’écriture du roman », sur la photographie, sur les mythologies, sur la voix, sur le plaisir du texte…, continuent de travailler en sourdine. C’est ainsi, par exemple, qu’il m’a paru que sa définition du romanesque permettait de comprendre au plus juste l’esthétique à l’œuvre dans les romans d’Echenoz. Ou encore que nous avons, avec Dominique Rabaté et de nombreux autres chercheurs, revisité la notion d’« écriture blanche » et ses possibles applications pour un éventail assez large d’œuvres, de Cayrol et Camus à Antoine Emaz ou Annie Ernaux, ou, en amont à propos de Bove (voir Écritures blanches, sous la dir. de D. Rabaté et D. Viart, PU de Saint Étienne, 2009). Enfin, me semble-t-il, on lit Barthes autrement aujourd’hui. Non plus comme le théoricien d’un système, mais par fragments, en retenant des fulgurations de sa pensée, des échappées : ainsi par exemple cette formule « On écrit avec de soi » retenue par François Bon pour réfléchir à son travail et nourrir son livre Tumulte.
28Mais s’il fallait désigner un penseur dont les réflexions demeurent centrales pour nombre d’écrivains contemporains, c’est plutôt à Michel Foucault que je ferais référence. Il fut le penseur de l’archéologie et de l’archive, dont on connaît l’importance pour les pratiques littéraires actuelles, comme l’a bien montré Michael Sheringham ; celui des « vies infâmes », dont les « minuscules » sont une sorte d’avatar, et plus largement des « fictions biographiques » dont le succès ne se dément pas. Il a contribué à réarticuler la littérature et l’Histoire, s’est rendu attentif aux Discours et à leurs effets de pouvoir qu’une certaine littérature pend aujourd’hui pour cible. Il a réfléchi à l’« usage des plaisirs » et au « souci de soi » qui excèdent la seule sexualité. Il a théorisé l’enfermement et l’exclusion qui sont aussi des thèmes majeurs de notre temps.
29Bien d’autres seraient encore à nommer, car c’est un trait de la littérature contemporaine d’être dans le dialogue avec les sciences humaines et avec la pensée. Et pas seulement celle des années 1960-1970. Qu’on adopte ou non ses positions, Bourdieu est un intercesseur important pour Annie Ernaux, pour Pierre Bergounioux. Deleuze, Rancière, Agamben, Didi-Huberman…, mais aussi des historiens comme Carlo Ginzburg, des anthropologues…, continuent d’être lus et de nourrir les œuvres contemporaines. Et ce dialogue, implicite souvent, explicite parfois, montre bien que la littérature n’est pas repliée sur elle-même.
Les positions de Richard Millet vous semblent-elles représentatives ? Et quels rôles jouent les écrivains dans un tel débat ?
30Il est amusant que vous posiez la question de Richard Millet, après mon allusion aux Droites en France ! Voilà bien un écrivain « légitimiste », attaché aux valeurs de la Chrétienté et à la « grande littérature », dont il est, vous le savez, le « dernier écrivain » (sic). Plutôt que « représentatives », je dirais que les positions de Millet sont radicalisées. Volontiers excessives. Peut-être un peu théâtralisées : il y a du Léon Bloy chez cet auteur. Sans doute s’inscrivent-elles plus largement dans ce paysage critique que vous décrivez, et l’on pourrait, à ce titre, les rapprocher des positions d’Alain Finkielkraut ou des pamphlets de Philippe Muray. Mais une autre façon de les envisager, dans une approche plus « bourdieusienne », serait d’en mesurer l’inscription et l’effet dans le « champ littéraire ». Il s’agit alors d’occuper une place, de construire ce que Jérôme Meizoz appelle à juste titre une « posture littéraire ». Et pour Richard Millet, devenu éditeur, de se faire gardien d’un temple profané, abandonné à sa ruine, celui de la Littérature avec majuscule, et du « sentiment de la Langue ».
31Le recours à une telle « grille de lecture », outre qu’il faudrait sérieusement en réviser le modèle pour tout ce qui concerne la littérature postérieure aux années 1960-1970 (car je ne crois pas, contrairement à Gisèle Sapiro, que le « champ littéraire » conserve sa validité quelle que soit la période considérée), est assez intéressant dans le cas de Millet. Car il fait hésiter entre deux positions, celle de « l’esthète » et celle du « notable conservateur ». Millet a, dans ses meilleurs livres, le talent du premier, mais les valeurs du second, lui qui écrivait déjà (sous pseudonyme), en 1991 : « Déjà peu recommandable, la démocratie est haïssable quand elle devient dictature des syndicats, ligues, associations, “minorités” : règne de l’individu déchristianisé […] ». On le voit, chez cet écrivain, l’idéologie précède le talent, lequel s’affirme avec La Gloire des Pythre (1995) et se maintient souvent, mais se dérobe hélas parfois, lorsque l’œuvre cède au bavardage complaisant, comme dans le récent Confession négative. Pour essayer de ne pas trop se confiner dans la convention du notable, Millet extrémise ses positions et multiplie les provocations, espérant y gagner en valeur esthétique. En fait, c’est comme s’il y avait, chez lui, un besoin d’exécration, nécessaire pour donner à l’œuvre même son énergie, parfois son tragique. Exécration qui se manifeste dans les entretiens, les pamphlets et se thématise volontiers, dans l’œuvre, sur le mode de l’excrétion. Aussi ne crois-je pas qu’il soit « représentatif », sa complexion est trop singulière. Singularité qu’il cultive à l’envi, d’ailleurs.
32Quant au rôle des écrivains dans ce débat, vous le remarquerez, il est pour le moins réduit, ce qui me fait dire que ce débat n’est pas « littéraire ». À part quelques pamphlétaires – Domecq, Millet, Muray, Renaud Camus, Marc Petit… –, ce ne sont pas vraiment les écrivains qui mènent le débat, plutôt des critiques – Todorov, Maingueneau, Bouveresse…, et encore nombre d’entre eux s’inquiètent-ils de la place et de la forme prise par les études littéraires, plus qu’ils ne prennent véritablement en considération la création littéraire actuelle –, ou des journalistes comme Morrisson. Les écrivains sont plus occupés à construire leur œuvre, sans vraiment se soucier des derniers bulletins de santé de la littérature.
De quelles erreurs de jugement faut-il donc se prémunir ?
33Il me semble que nous devons réviser en partie notre façon d’aborder les œuvres et surtout de juger de leur valeur – on y revient ! D’abord en se convainquant qu’une œuvre ne peut être jugée que pour ce qu’elle prétend être et pour les enjeux qu’elle se donne. Il n’y a guère d’intérêt à ergoter sur la valeur « littéraire » des romans en course pour les prix de rentrée : la plupart n’en ont guère et ce n’est pas leur ambition. L’œuvre littéraire ne cherche pas d’abord à plaire, mais à déplacer quelque chose dans l’esprit de son lecteur. Il convient alors de mesurer à quelle nécessité répondent ses choix esthétiques, quels effets ils cherchent à produire, en vue de quoi. Quelle cohérence est à l’œuvre dans le texte, à quel type de préoccupations ou d’impossibilités il s’affronte, et comment le fait-il, etc. C’est à dire qu’il faut entrer dans le jeu, ou le travail, de l’écrivain, se rendre attentif à l’écriture, se plier à l’exigence de son texte – lorsque celui-ci manifeste une telle exigence, bien sûr. Et ne pas en traiter avec des critères esthétiques pré-établis.
34Et surtout se garder des opinions à la mode, livrées à l’emporte-pièce sans vérifier qu’il ne se passe pas quelque chose d’important dans ces livres que l’on dénigre en bloc souvent sans même les avoir ouverts. Je crois surtout qu’il faut donner, dans la critique littéraire, toute sa place à l’interprétation des textes. Pas seulement décrire leurs mécanismes, ni les inscrire dans les débats esthétiques de l’Histoire littéraire, mais montrer comment le travail du texte élabore des effets de sens, contribue à déplacer notre regard, à déjouer les illusions, susciter d’autres perspectives, élargir notre manière d’être au monde.
Selon vous, Dominique Viart, qu'apportent-elles les théories déclinologiques à ceux qui les formulent ?
35…sans doute la notoriété de Cassandre ?