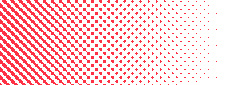Textes, suivi de La Mort de la littérature, Paris, « l’Herne », 1971.
Cet texte est publié grâce à l’aimable autorisation des éditions de l’Herne : www.editionsdelherne.com
1Faut-il m’en expliquer ? En fait, ces « textes » ne recouvrent aucun mystère : ils ne cherchent ni la provocation, ni la complicité. Ils ne donnent rien à comprendre. Ils se présentent tels quels. Et pourtant, de tout écrit, cela peut-il se dire ?
2Quiconque, agacé par leur banalité, les rejetterait, disant : C’est trop facile. N’importe qui pourrait en faire autant ! aurait sans le savoir (c’est-à-dire en toute ignorance de cause) exprimé à ma place, et à la place de tout le monde, ce qu’il importait précisément de deviner. Touchante simplicité ! Le disant, il n’aurait pourtant rien dit de personnel, rien de ce qu’un autre – vous, ou moi – pourrait dire à sa place. N’importe qui peut en effet dire que tout le inonde peut en faire autant. Au lieu de voir dans cette réponse la solution qui permettrait de considérer le problème comme résolu, je voudrais y voir, au contraire, le point à partir duquel il se pose. Qui donc a fait ces « textes » ? Il s’agit de mettre à l’épreuve le sens même de cette question, tout en essayant d’y répondre. En d’autres termes : Qu’est-ce que ça veut dire : faire un « texte » ?
3Ou, se faisant écho, ces deux questions :
4Qui fait un « texte » ? Comment se fait un « texte » ?
5Ou encore, formulées autrement :
6De qui, et de quoi, un « texte » est-il fait ?
7Autant de questions où se trouvent impliqués réciproquement et l’« auteur » et le « texte », à la fois et alternativement sujet et objet de la question. L’« auteur » et le « texte » sont donc pris dans un mouvement où, au lieu de demeurer distincts, (l’auteur et l’œuvre ; l’un facteur de l’autre) ils se renversent, pour ainsi dire, l’un dans l’autre – se créent et s’annulent l’un l’autre.
8Jusqu’à présent, en matière de poétique, il était convenu de penser selon le sens unique allant de l’auteur à l’œuvre, du sujet créateur à l’objet créé. Cet objet (linguistique) était reconnaissable en tant qu’objet poétique dans la mesure où l’on savait avoir affaire à une fabrication « gratuite » du langage. Il se distinguait donc doublement du langage ordinaire : d’une part, à cause du caractère utilitaire de celui-ci (appelé par certains « langage instrument »); d’autre part, du fait que le langage ordinaire n’est produit (créé par personne en particulier), contrairement à l’objet poétique (le poème, étymologiquement, chose faite – par excellence) fabriqué, construit par celui qu’il est convenu d’appeler « auteur ».
9Mais quoi si l’« auteur » ne se trouve plus à l’origine du « texte » ? Alors, à qui appartient ce texte ? Et quelle est sa finalité ? Autant de questions auxquelles ma théorie de l’intentionalité ne peut plus répondre de façon satisfaisante.
10Ainsi, le problème de l’utilisation d’un texte (de sa fin) est-il le même que celui de sa provenance (de son origine) ; ils relèvent ensemble du problème de son appartenance, de sa propriété – c’est-à-dire, à la fois, de celui auquel il appartient, et de la propriété de son usage. C’est ce que je voudrais expliquer ici.
11Le téléphone, moyen de communication interindividuel type dans notre société, fournit un exemple particulièrement approprié. Qui fait un annuaire des téléphones ? Qui en est l’auteur ? Répondre que ce sont les employés des P. et T. (d’ailleurs, lesquels ?) n’est pas suffisant. Un annuaire est aussi fait de (et par – à y réfléchir un peu il ne s’agit pas là d’un simple jeu sur les mots) tous les abonnés qui y figurent – qui ont prêté leur nom pour le faire. À cette masse déjà impressionnante d’auteurs (quoique limitée, calculable) s’ajoutent tous les usagers possibles (abonnés ou non ; éventuels ou actuels). N’importe qui. Tout le monde. Dans ce vaste et impersonnel réseau de communication, ce sont les usagers qui composent – à la fois sont et font – le texte ; en d’autres termes qui en sont l’objet et le sujet.
12Alors si « je » choisit au hasard n’importe quelle page de l’annuaire et que « je » la place à côté d’autres « textes » sélectionnés selon les mêmes principes, « je » ne sort pas de l’impersonnel car, d’une part il n’est pas à l’origine de ces textes (il ne les a pas faits, fabriqués), d’autre part, comme nous en avions convenu au début, n’importe qui d’autre aurait pu (et pourrait) en faire autant à sa place. Parler d’intentionalité n’a donc plus de sens, car l’intention est engloutie, noyée dans la généralité de toutes les autres intentions actuelles ou virtuelles des usagers-fabricateurs de ces pages. On devrait donc pouvoir dire que ces « textes » sont aussi in-tacts après avoir été extraits de leur contexte d’origine qu’avant.
13Pourtant...
14Si les pages d’un annuaire (ou de n’importe quel autre texte) ne m’appartiennent pas en propre (j’insiste sur le pléonasme), n’appartiennent à personne (ou, ce qui revient au même, appartiennent à tout le monde), si, par conséquent, il n’entre rien de ma fabrication dans ce « texte », pas plus que dans les autres auxquels il sera juxtaposé, de les avoir isolés d’abord, puis recueillis, de les avoir séparés de leur premier contexte pour les avoir rassemblés autrement, suppose un trafic, même minimum, provoque un déplacement, aussi léger soit-il, comparable à celui que signale le passage d’une présence dans une pièce où des objets ont bougé (mieux : ont été bougés) de leur place ordinaire.
15Si, à ce propos, il est possible de parler de « poésie », c’est dans ce frémissement des « textes » qu’il faut la chercher, la découvrir, l’inventer. Elle ne se laisse donc pas seulement, ou nécessairement, cerner dans les formes stables et convenues d’une poétique héritée de la tradition (dont les innovations seraient malgré tout reconnues et reconnaissables en tant que « poésie » parce que produites à l’intérieur d’un système resté incontesté dans son ensemble), mais on peut l’y trouver dans le langage en général, du simple fait qu’aucun langage n’est littéral. Par là j’entends, non pas que le langage renvoie à un ailleurs, un au-delà du langage (ce qui supposerait qu’il y eût un ici), mais que dans toute communication se trouve inscrit (built in) l’écart inhérent à son articulation. Cet écart constitue le jeu du langage, la possibilité de sa poésie, c’est-à-dire la part irréductible du hasard, de l’indétermination, de l’inachèvement, de l’informe qui rendent possible (et fatal !) à la fois la nécessité de la dépendance du sujet et de l’objet en fonction de leur histoire et de leur structure. Et la nécessité de leur indépendance.
16Tout langage attend donc son poète – lui, vous, n’importe qui – pour en faire surgir la poésie. On ne saurait plus dire que le poète est à l’origine de son langage puisque c’est le langage qui crée le poète et non l’inverse. On ne saurait plus dire non plus que la poésie dépend de l’intention du poète sous prétexte qu’il donne le label « poème » à ce qu’il écrit et que ceux qui participent à la même histoire acceptent de reconnaître pour tel. La poésie n’est donc pas dans des textes d’un type donné (convenu), mais, virtuelle et diffuse, dans le langage lui-même c’est-à-dire dans le rapport scripteur-écriture-lecture-lecteur. Plus généralement encore dans le jeu de toute communication.
17Le jeu implique toujours une alternance de la présence et de l’absence (comme les deux côtés d’une balançoire qui ne peuvent être simultanément ou en haut ou en bas), jeu dont je voudrais dire quelques mots ici.
18Si l’on part de celui qui a recueilli des textes, sa présence – on l’a vu plus haut – y est imperceptible, négligeable ; maintenant évanouie sans laisser d’autre trace que ces mystérieux glissements, ces frôlements où peuvent seuls se deviner la marque d’un passage ; cette présence, maintenant passée, se trouve donc muée en absence.
19Traits sur la pierre, entailles dans le bois, usures, encoches, stries, graffiti ; celles-ci et toutes autres traces où se lit le passage; tous ces signes discrets, d’une présence ruinée – tout comme cet invisible oiseau qui, divisant la hauteur d’un arbre incertain s’ingéniait à faire trouver la journée courte, explorait d’une note prolongée la solitude environnante, mais recevait d’elle une réplique si unanime, un choc en retour si redoublé de silence et d’immobilité qu’on aurait dit qu’il venait d’arrêter pour toujours l’instant qu’il avait cherché à faire passer plus vite – chavirants témoignages où se grave en nous, par l’écho qu’ils provoquent, une émotion aussi dense que celle que pourrait nous procurer « l’art » le plus accompli.
20Cette présence n’est donc pas au centre des choses, reconnaissable, souveraine. Son empire est passé. Les choses ont cessé de lui appartenir. Ou plutôt, si elle demeure au centre des choses, c’est en tant que question, la question de son appartenance aux « textes », ou de sa propriété sur eux; la question de savoir si les choses lui ont jamais appartenu, ou si, au contraire il n’en a été que le simple dépositaire, l’usager temporaire ; le relais.
21« Je » est donc dans les « textes », mais non pas comme sujet, à leur origine – c’est-à-dire en tant que leur « auteur » – mais comme leur objet, celui qu’il faut y chercher précisément parce qu’il en est absent... Mais aussi celui qu’il est vain de prétendre y découvrir puisqu’il en est absent.
22Quête du sujet, vouée à l’errance, vouée à l’erreur !
23Si la simple accumulation de « textes » produit ce glissement minimum qui permet de déceler le passage d’une présence, celle-ci se trouve pourtant réduite à son minimum signalétique. Elle n’est donc pas anonyme. Elle ne peut pas l’être. Inscrite dans les signes, avant même de signaler quelque chose, elle se signale. Ainsi, en donnant le signalement d’une présence, les « textes » signalent l’identité de celui qui les a rassemblés. Mais rien de plus. Cette identité n’est rien de plus que le minimum signalétique offert au douanier par le passeport, à l’officier de police par la carte d’identité, à l’usager du téléphone par les indications de l’annuaire. Minimum inévitable à quoi cette présence se résume et se résout – sans regret ni plaisir, sans honte ni vanité, sans effusion ni contrainte, sans le moindre sentiment ni la moindre marque d’une quelconque émotion – pour la simple raison que « c’est comme ça », que toute trace recouvre une absence, que c’est précisément sa raison d’être de trace. Au lieu donc de chercher à contrecarrer sa nature, en essayant d’y forcer les signes d’une présence qui ne peut qu’en demeurer exclue, pourquoi ne pas abonder dans le sens de la trace, favoriser sa nature, tenter dans la mesure du possible d’en effacer tous les signes de la « présence » ?... sachant toutefois qu’un total succès demeure impossible parce que contraire aussi à cette même nature.
24On comprendra que, dans une telle perspective, marquée par le souci du plus grand dénuement, du dépouillement le plus radical, ces « textes » ne puissent paraître sous le sceau d’une signature puisque vient d’être contestée la possibilité de parler à leur sujet de la présence d’un « auteur ».
25La présence d’un lecteur n’est pas plus explicite – ni impliquée – que celle d’un auteur. Elle reste tout aussi indéterminée car ces « textes » ne s’adressent pas à tel ou tel public. Ils s’adressent à tout le monde, à tout usager de la chose écrite, à toute personne sachant lire.
26Bien qu’indéfini, le public-usager ne reste cependant pas dans une indétermination complète; il se manifeste, là encore, par un minimum signalétique : celui auquel se réduisent les coordonnées d’une histoire et d’une culture. Pourtant, la lecture la plus flexible possible est garantie, car rien (ou le minimum constitué par le texte même) ne vient en entraver l’usage ou en limiter l’écho. Celui qui a rassemblé les « textes » opérant un contrôle minimum sur leur lecture, tout se passe entre les lignes, dans l’intervalle des mots, dans le blanc qui sépare les « textes », dans l’espace sémantique entre titre et « texte », en un mot, dans tout ce qui, sciemment, est resté tu et qu’il dépend de l’usager de mettre en jeu selon son propre système de résonnances. De ce fait le « texte » perd le caractère sacré qu’on se plaît à lui donner dans notre culture. Langage sacré (poétique) et langage ordinaire cessent de s’opposer comme l’aristocratie à la plèbe, de même que cessent de s’opposer la gratuité à l’utilité du langage. Alors on ne se trouve plus devant la poésie comme au seuil d’une église, lieu que tout désigne au profane comme « sacré », lieu qui provoque le déclic : Attention, sanctuaire ! ou son équivalent littéraire : Attention, poésie ! engendrant automatiquement un comportement de respect guindé, de décence compassée dont l’affectation est en contraste évident avec les profanations et les dérèglements les plus grossiers de la vie et du langage dits de tous les jours. Hypocrite révérence !
27De ce point de vue – et si l’on s’en tient à l’époque moderne – Baudelaire doit être tenu pour un des principaux responsables de cette sacralisation de la poésie. Si, depuis une ou deux générations les caractéristiques de cette sacralisation ont changé et semblent s’être émoussées, celle-ci n’en reste pas moins vivace (plus encore dans l’art du langage d’ailleurs que dans les arts plastiques qui marquent une nette avance sur celui-là).
28En incorporant dans l’art des éléments (objets ou fragments d’objets « naturels » ou « fabriqués ») que la tradition n’avait pas admis jusque-là, cubistes et surréalistes ont contribué à modifier les frontières du sacré artistique, mais, quoique déplacé et agrandi, le champ de l’art est resté pour eux sacré. En effet, telle la fée qui de sa baguette métamorphose la citrouille en carrosse, il suffisait au poète, à l’artiste surréaliste de frapper de sa signature l’objet le plus vil (Duchamp, le pissoir !), pour prétendre l’avoir élevé à la « dignité » de l’art. Un tel processus, quoiqu’à sa manière et jusqu’à un certain point démystificateur (comme l’avait été, un siècle auparavant, pour Hugo, le bonnet rouge sur le dictionnaire) se situe encore à l’intérieur d’une tradition qui fait du poète un mage et un rédempteur. L’artiste continue à être ce démiurge dont le rôle consiste à sauver les hommes de la platitude et des turpitudes du quotidien utilitaire, à les racheter en leur offrant les consolations d’un langage gratuit ; à se sacrifier pour donner un sens plus pur aux mots de la tribu.
29Sous une forme ou sous une autre, il s’agit toujours de la même religion de la beauté, cette « déesse » stupide, muette comme un rêve de pierre, justification de tant de fanatismes et prétexte à tant de lâchetés. De son culte, le poète s’est toujours offert à être le grand prêtre, quitte à en devenir parfois la victime. À être le prophète, et parfois le martyr !
30Alors, si en début et en fin de compte ces « textes » ne sont attribuables à personne (ne provenant de, et n’étant destinés à personne) leur appartenance, propriété, appropriation – et par extension celles de tout écrit – ne répondent plus aux conventions acceptées. Par là même, le critère d’« originalité » de la production artistique s’en trouve modifié et contesté2. Écrire serait donc d’abord citer. « L’écrivain » ne serait plus celui qui « se met à l’écoute de la voix intérieure » mais celui qui cite, celui qui met le langage entre guillemets, c’est-à-dire à la fois s’en écarte, l’appelle à lui, en un mot, le désigne comme langage.
31Si l’on s’arrête un instant sur la fonction des guillemets dans le discours, on s’aperçoit, en effet, qu’ils servent à isoler un mot, une expression, un texte, à les mettre à distance (la « distance esthétique » est-elle autre chose ?). L’« écrivain » les refuse tels qu’ils lui sont livrés, donnés. Ce geste est bien le contraire d’une appropriation ! Pourtant, il les appelle aussi à lui puisqu’il les incorpore à son discours, puisqu’il les fait la matière de son discours.
32L’« écrivain » n’est donc ni dans, ni en dehors de son langage. Il ne s’y arrête pas. Il ne fait que le traverser. Mais comment dire que c’est son langage puisque le langage qu’il met entre guillemets est un langage emprunté ? Ainsi, loin d’accaparer le langage pour le fixer, l’« écrivain » le suspend pour le transmettre. En le remettant en circulation, pour ainsi dire porté par des guillemets, il contribue à le rendre indéfiniment compréhensible. Et cela, non parce qu’il l’aurait soudain et magiquement métamorphosé à l’aide des guillemets mais parce que ceux-ci soulignent son caractère métamorphosable. Être « écrivain », « poète », ne correspondrait plus à une identité particulière, mais à une situation particulière, accessible pourtant à chacun.
33Le langage « poétique » n’est donc pas un autre langage, c’est le même langage. Ou plus exactement c’est le langage même dont la nature (et la fonction) de retournement, de redoublement se trouve tout à coup exposée.
34Mais, dire comme le fait toute une tradition que le « langage poétique » se définit et se mesure par son écart par rapport au « langage ordinaire », c’est prétendre que tout écart de langage est poétique et que l’absence d’écart est nécessairement prosaïque, ce qui est évidemment absurde. Dire que « le poète ne parle pas comme tout le monde », contraster prose et poésie, langage naturel et langage d’art, langage des savants (censé s’approcher d’un soi-disant degré zéro de l’écriture) et langage des poètes (censé s’en éloigner au maximum) ; enfin, fonder la poéticité de la poésie sur le consensus, c’est-à-dire sur ce que la majorité (laquelle ?) reconnaît pour « poésie », ne fait que renforcer les préjugés de la tradition en l’habillant d’un positivisme à bon marché qui ne rend pas la stylistique (celle-ci du moins !) plus scientifique pour autant.
35S’il existe en écart – ce dont nous sommes persuadé – ce n’est pas un écart par rapport à une norme, c’est un écart dans la norme. Ou plus exactement, la norme (la loi du langage) est fondée dans la possibilité de l’écart. Ce qui doit être compris de deux façons : 1) c’est parce que l’écart est possible que la norme est nécessaire ; 2) c’est parce que l’écart existe que la norme est possible, qu’elle peut exister.
36L’écart est donc inscrit (built in) dans la loi. C’est son articulation même. La loi, en tant qu’affirmation et articulation de la possibilité de l’écart contient, de ce fait, quelque chose d’inachevé, d’informe, qui lui échappe et qui n’est rien d’autre que l’affirmation et l’articulation du désir ; ce désir où doit se lire l’écart puisque d’un côté il repousse, pour rapprocher de l’autre les membres de la société.
37Anthropologie et psychanalyse se rejoignent à ce carrefour pour nous apprendre que le langage obéit, à la loi du désir; que, comme ce dernier, le langage, nous vient toujours d’ailleurs (d’où sa nature d’écho, de citation, par quoi se manifeste l’écart) ; enfin, qu’inversement le désir obéit à la loi du langage. Il paraît alors évident que s’arrêter au niveau de l’intention pour rendre compte du poétique, c’est se limiter à n’appréhender que la partie émergée de l’iceberg.
38À partir, d’une part des concepts du désir, du don, de l’échange tels que nous les offrent les disciplines dont il vient d’être question, et de l’autre du concept de l’écart tel que je tente de le définir du point de vue de la poétique du langage, un champ nouveau s’ouvre, intact, à notre enquête : l’économie poétique, que je ne fais ici qu’étiqueter puisque mon propos est ailleurs, quitte à en entreprendre l’exploration plus tard, dans un autre contexte.
39Désir et langage, étant inscrits (built in) l’un dans l’autre, ils « parlent » l’un pour l’autre, l’un à la place de l’autre. D’où leur commune nature de redoublement, de retournement. Et le jeu qui y est inhérent. Ce jeu du langage-désir fonde le langage dans la poéticité. Cette thèse rejoint celle de Rousseau qui dans l’Essai sur l’origine des langues écrivait : « le langage figuré fut le premier à naître » et : « d’abord on ne parla qu’en poésie » ; ce que je serais tenté de reformuler ainsi : c’est parce qu’il y a de la poésie qu’il y a du langage, et non l’inverse.
40Écho, la poéticité du langage se laisse définir par deux caractéristiques nécessaires et suffisantes : le déplacement et la répétition.
41Il serait faux de penser que le déplacement se situe par rapport à un lieu d’origine du mot (ou du texte), telle une définition de dictionnaire servant de point de départ au sens d’où il aurait été dévié pour lui donner un « effet poétique ». Décrire ainsi le déplacement laisserait supposer encore une fois, que l’intention du locuteur (poète ou lecteur) y est pour quelque chose, qu’il a voulu donner aux mots, ici un sens « poétique », là un sens « utilitaire ». S’il en était ainsi, tous les textes étiquetés « Poésie » devraient nous toucher « poétiquement ». Ce qui n’est évidemment pas le cas. Au contraire, la possibilité de déplacement se trouve dans la nature même du langage, dans le fait que le langage est « sémantique », c’est-à-dire dans la vibration ou le frémissement dont les mots sont auréolés et qu’aucun dictionnaire n’arrivera jamais à « rendre ». Dans le jeu du sens3. Mais, qu’on ne s’y méprenne pas : il ne s’agit pas d’invoquer ici de soi-disant mystères du langage et de basculer dans les aberrations d’un quelconque mysticisme. Il s’agit uniquement de mettre en garde contre une rationalité réductrice qui consisterait à prétendre expliquer le déplacement-dans-le-langage par autre chose. L’expliquer par une histoire, soit individuelle, soit collective (deux modes de la conscience) est impossible puisqu’il se confond précisément avec cette histoire, puisqu’il est cette histoire, c’est-à-dire tout ce que nous pouvons espérer en savoir. Puisqu’il est le temps en marche dans le langage. L’expliquer par les structures de la métaphore et de la métonymie – qui sont évidemment les formes élémentaires du déplacement4 – n’est pas plus satisfaisant puisque c’est le déplacement lui-même qui fonde toute structure.
42Autant de la répétition. Car la répétition est un mode différent du déplacement. Elle en est la face musicale, temporelle, le rythme, qui dans la prosodie traditionnelle prend la forme ostensible de la rime.
43Répétition et déplacement se renversent l’un dans l’autre : la répétition est un déplacement du même, et le déplacement une répétition de l’autre. Mais la répétition n’est jamais tout à fait la même, ni le déplacement absolument autre. C’est ce qui fait du langage ce qu’il est : à la fois progression et retour de la communication. Échange.
44A rose is a rose is a rose... Géniale formule qui résume et illustre la poéticité du langage. À ce carrefour de l’écho le plus « simple » où se laisse lire, paradoxalement, sa double nature – poésie et langage se renvoient l’un à l’autre indéfiniment.
45Contester à l’« auteur » un droit de propriété sur son langage; briser les barrières qui séparent langage « littéraire » et langage « ordinaire » ; renverser les rapports du langage et de la poésie ; une telle aventure5 ne va pas sans quelques conséquences pour l’examen critique de la matière linguistique que l’on aura choisi d’appeler « littérature ». En d’autres termes (dans ceux de la tradition – et qui ne se soutiennent qu’à coups de guillemets) : que va devenir la « critique » ? comment le « discours critique » va-t-il se situer par rapport au « discours littéraire » ?
46Disons tout de suite que, dans cette façon de poser la question, il ne s’agit que d’un problème tactique, opératoire, dont la validité devra être contestée au fur et à mesure de l’opération –puisque par principe, c’est la validité même de la distinction des différents types de discours qui sont ici mis en question.
47En effet si la matière littéraire s’étend en droit à tous les signes linguistiques, il est logique de penser que toute distinction entre langage littéraire, langage ordinaire, langage critique s’abolit elle aussi en droit, car aucune différence de nature ne les sépare essentiellement. Par là-même, et au premier abord, l’opposition d’un langage et d’un métalangage s’effacerait d’elle-même. Elle laisserait place à un déroulement continu de signes s’étalant infiniment et indéfiniment, tous au même niveau, sans qu’aucune priorité ni antériorité ne puisse être attribuée à tel type d’entre eux puisque, on s’en souvient, rien n’empêche à chacun de ces signes de fonctionner, à n’importe quel moment de sa carrière, comme citation; puisque – quel qu’il soit – il contient l’écart qui le dédouble en écho. Telle est sa nature. Il est donc vain de vouloir d’abord séparer des fonctions (littéraire, utilitaire, critique...) à partir de soi-disant modes de discours, donnés et acceptés pour tels avant examen. Poser dès l’abord l’existence dédoublée d’un langage et d’un métalangage, c’est marquer la priorité et l’antériorité de l’un sur l’autre, c’est supposer un langage « premier », « simple » et un langage second qui s’en écarte. La seule validité du concept métalangage est opératoire, car il est évident qu’à un moment donné il devient nécessaire de différencier des types de discours pour les besoins de toute cause épistémologique – mais ce ne sera jamais de façon absolue ou permanente. Dans ces conditions la « littérature » n’a aucune existence propre, ou de droit ; ce terme ne garde donc de sens que dans le champ (infiniment variable dans son découpage) défini par la conjonction de telle lecture et de telle écriture. La lecture-critique n’est autre qu’une invention et un inventaire de la littérature. L’une et l’autre s’effacent pourtant aussitôt que constituées : leur existence ne se soutient que de leur conjonction, c’est-à-dire des signes qu’elles partagent, qu’elles mettent en commun ; et en communication, pendant la durée de ladite communication. Rien d’autre n’en fixe, n’en détermine l’existence ou l’organisation.
48La « littérature », alors, ne se distingue pas des autres signes comme un mode particulier du discours, mais comme une façon particulière de lire et déchiffrer les signes. Est littéraire non tel texte à l’exclusion de tel autre, mais les textes que le lecteur décide de qualifier ainsi.
49Si l’on accepte cette thèse, il faut nécessairement en conclure qu’une certaine conception de la « littérature » – celle qui fait de certains signes une aristocratie du discours, séparée (par quelle décision magique ?) de la trivialité et de la vulgarité du « langage ordinaire » – perd toute validité, tout fondement, en perdant ses privilèges.
50Cette « littérature », dépotoir des sentiments, musée des « belles lettres », a vécu. Alors, les signes, tous les signes, s’ouvrent à une nouvelle lecture – fragmentaire évidemment – mais libérée des entraves d’un « goût » arbitraire et stérilisant.
51Le découpage des signes s’opère donc dans une masse, bande, flot, non frayé, non morcelé de signes proliférants ; sorte de film avant le montage que l’on pourrait appeler le discours du monde ; ensemble, amas, accumulation de tous les discours, de tous les signes, de toutes les traces qu’aucune frontière temporelle ou spatiale, historique ou culturelle ne viendrait, en principe, de son pointillé interrompre le cours; masse de tous les messages de l’histoire dont le bruissement uniforme et continu, ou la stridence, empêcherait tel sens particulier de se manifester. Dans cette Babel, tous les sens se valent : non-sens dans l’attente d’être tranché (comme on dit d’un argument qu’on le tranche, qu’on en décide) chaque fois que s’amorce, puis explose, la signification. Alors le sens se répand d’un seul coup à travers cette déchirure décisive. Délicate ou violente, spontanée ou contrainte, l’incision-décision parcourt la masse globale des signes, les divise, les fragmente, les fait éclater. De cette chirurgie jaillit un sens. Ce sens n’est autre que la rupture elle-même qui débonde son flot. Filet ou torrent qui n’en finit plus de signifier.
52Dans ce surgissement du sens, tout se brise en même temps que tout s’ordonne. Tout s’ordonne parce que tout se brise.
53Le sens s’organise dans le non-sens ; il ne le remplace pas. Il ne le recouvre ni ne l’oblitère. Il le désigne, le présente Ainsi, puisque le non-sens ne s’efface pas (poliment) devant le sens, on ne saurait prétendre que celui-ci soit jamais établi. Puisqu’il tranche, ordonne, exécute, le sens n’est accessible que sous l’espèce de la violence, du scandale, de la tyrannie. Toujours usurpateur, le sens n’est jamais légitime. Voilà pourquoi il convient de le dénoncer, au lieu de s’y soumettre. Mais, puisque tel est fatalement son rôle, autant le lui faire jouer jusqu’au bout. Que cette tyrannie soit une terreur, cette violence une subversion ! Alors, si le sens commande la subversion (comme on dit d’un point géographique qu’il commande un lieu stratégique; c’est-à-dire qu’il en interdit et y livre en même temps l’accès), s’il l’ordonne (l’exige donc, aussi), il la maintient dans sa virulence révolutionnaire, son intransigeance acide. Et par là, il prend part à sa propre subversion. (Seule une telle démarche permet d’éviter la retombée dans la quiétude de la positivité, dans la mollesse et le confort du « tout est dit », – dans l’ordre du sens).
54Mais on pourrait aussi bien retourner la proposition qui vient d’être faite et dire que la subversion commande le sens. C’est par elle que le sens peut surgir. La subversion appelle donc un sens, mais en l’attirant à elle, elle le contamine, le subvertit. Ainsi, le sens reste-t-il toujours déçu. Et décevant. Il ne se manifeste qu’en tant que perte, que fuite : prétendre le fixer, c’est le laisser échapper ; mais le lâcher ne permet pas non plus de le saisir.
55Où ? Et, quand le sens ? En deçà de nous, dans un passé dont notre mémoire serait la récapitulation ? Au-delà, dans un avenir prêt à être saisi, dans une aube « à vivre » ? Évidemment non, car un tel passé, ou un tel avenir ne saurait se construire qu’à partir d’un présent fixe, solide, qui précisément fait défaut. Il « est » ce manque : la subversion même qui creuse la présence. Ainsi, au fur et à mesure qu’il se « présente », il s’efface.
56Mécanisme en tous points comparable au processus cinématographique : à quel moment du film se localise son sens ? 1) Sur la pellicule, avant la projection ? Son sens serait alors dans l’attente de cette projection à venir. 2) Sur la pellicule, après la projection ? Son sens serait dans la remémoration de la projection passée. 3) Au cours de la projection ? Mais alors, sur quelle séquence, sur quelle image? En choisir une – pour y fixer le sens du film, c’est évidemment contredire sa nature cinématographique en le privant de son mouvement. Aucune de ces trois hypothèses n’est donc satisfaisante, car le sens n’est jamais localisable (Chercher le sens dans le mouvement même est une erreur, car le mouvement n’est que la condition de sa possibilité).
57Qu’il soit passé ou avenir, le sens reste un faux-sens, route barrée sur laquelle nous nous lançons. Nous vivons donc dans l’erreur (et l’errance) du déchiffrement des signes – leur « présence » constituant précisément le point aveugle, le moment subversif par excellence à partir duquel s’opère la subversion, c’est-à-dire ce renversement des données du temps où « passé » et « avenir » basculent l’un dans l’autre. Qu’en conclure, sinon que par la suite de ces réductions, le sens a perdu jusqu’à sa valeur opératoire : même comme « moment » de la subversion, il est impossible d’en appeler à lui. Concurremment et/ou parallèlement, la temporalité (qui en est pour ainsi dire l’autre face) perd alors elle aussi, toute valeur opératoire : il est impossible d’en appeler à elle comme « sens » de la subversion.
58Quant à ce dernier terme, il ne faudrait pas croire qu’il soit le seul à retenir, magiquement, une valeur positive - clef de voute de tout l’édifice. Son rôle joué (subversion du sens ; subversion de la temporalité) il ne soutient plus rien, pas même la négation. Il s’efface donc de lui-même faute d’être étayé d’un quelconque complément – si ce n’est, à la rigueur, en s’attribuant à lui-même son propre complément : subversion de la subversion.
59Après ce détour obligé, mise en garde sur la possibilité de l’établissement du sens, il convient de revenir à la question initiale et de se demander dans quelles conditions et à quel prix s’opère la lecture-écriture des signes. Puisque son seul statut viable est de subversion, sa fonction ne peut être que terrorisante : elle consiste à mettre le feu aux poudres, à activer l’incendie – à brûler, à consumer du/le sens. Par ce geste, la lecture-écriture rend manifeste l’impossibilité du sens. Mais qu’on n’aille pas croire, se fiant aux quelques métaphores pyroïques précédentes, que notre souci caché ou avoué soit de purification. Changeant de registre, changeant de geste, mais lui préservant le même rôle, j’aurais pu aussi bien dire6 que la lecture-écriture consiste à remuer la merde. On voit bien que cela revient au même : le feu et la merde ; jeu enfantin, jeu de l’enfance – mais sans innocence comme l’enseigne la psychanalyse. Ni pur, ni impur; et pourtant joyeux !
60Croire que ce jeu est synonyme d’irresponsabilité serait se laisser prendre aux apparences. Ce jeu n’est ni tout à fait libre, ni tout à fait gratuit car nous sommes en cause : nous sommes cette matière même et les sujets qui le remuons. Notre merde, c’est notre histoire – c’est, comme on dit, notre affaire ; c’est aussi nous qui la faisons. Inversement, notre histoire nous défait ; littéralement, elle nous décompose. Comme la mort. Elle est notre mort. Nous somme donc l’histoire de notre matière en même temps que la matière, de notre histoire. Nous nous faisons en même temps que nous nous défaisons. Sans fin ni commencement. Car ce qui se « fait » par un bout se défait par l’autre – tout comme la bande du film.
61Notre histoire est dans toutes ses acceptions organiques. Elle nous digère et nous la digérons : elle consiste à absorber des signes, qui, à leur tour nous absorbent : matière nourricière et fécale des signes que nous consumons et secrétons. Voilà à quoi se résume la dépense de notre énergie. La chimie de notre histoire correspond à l’économie de notre discours. Paradoxal circuit à travers lequel nous nous communiquons et nous nous échappons.
62Mais la consumation reste inévitablement sélective, jamais totale : la merde, les cendres sont matière. Alors, le discours renait de ses cendres, fertilisé, nourri précisément par ce déchet dont il est à la fois le produit et le producteur. Le cycle naturel se déploie, par lequel le « reste » est récupéré comme engrais, puis consumé à nouveau..., mais sous une autre forme. Dans l’économie des signes, la ruine du discours demeure la condition de sa possibilité. C’est à partir de cette faillite, que se tirent et se tissent les fils de la communication. C’est dans cette faille du discours que se joue l’histoire.
63La communication historique (c’est-à-dire le discours qui s’instaure entre présent, passé et avenir) est constituée par l’ensemble des signes qui s’échafaudent à chaque époque d’une part pour que celle-ci se donne à comprendre à elle-même et s’offre à la compréhension des époques qui la suivent et d’autre part pour construire un sens à l’aide des signes laissés par les époques passées. C’est dans ce dialogue, cette double voix (d’un « nous » présent et d’un « ils » passé – qui se répondent) que se fait l’histoire, qu’elle se fabrique. D’où l’échange qui instaure dans l’histoire son jeu flottement inévitable du discours et de ses ambiguïtés, décalage de l’écho par rapport à la voix, de la question par rapport à la réponse. Cette dislocation est fonction des conditions physiques (économiques, biologiques, etc.) et psychiques (imaginaire, structures mentales, croyances, etc.), qui prévalent à chaque « époque »7. D’où les inévitables malentendus, perpétuelles mises au point, succession de ratures, d’amendements, de corrections, de repentirs d’une époque à l’autre.
64On ne saurait donc faire de l’histoire une catégorie (objective) de la pensée, mais seulement une condition. Comme la littérature, l’histoire se construit : texte sans fond aux combinaisons inépuisables8 et dont chaque « époque » ne consume qu’une partie.
65En effet, ce qui se consume – brulé, évacué, sacrifié – n’est ni arbitraire, ni indifférent, ni indéfini. Puisque, tous ces signes ne sauraient être consumés à la fois dans une culture, et à une « époque » données, il faut chercher dans le processus de sélection des signes, dans le choix des priorités, dans les modes et les foyers de consumation, les règles du jeu historique de l’« époque » et de la culture en question. Leur élaboration constitue le champ dans lequel s’invente et se détermine l’histoire.
66Ainsi, histoire et littérature n’ont aucune existence en soi. C’est nous qui les constituons comme objet de notre connaissance. Et cet objet, fruit de notre invention, nous constitue comme sujets – à la fois être agissants et agis, dominants et dominés.
67« Le sens de l’histoire » (et de la littérature) n’est donc qu’un mythe auquel nous nous accrochions – peut-être par quelque viscéral désir – (né de notre faiblesse et de notre lâcheté), de croire que la vie avait un fondement qui puisse la justifier; par quelque obscur besoin de nous orienter, et par là de tenter de nous soustraire à ce que notre société appelle folie.
68On ne s’étonnera pas de ce que, au moment de mettre le dernier mot à ces « textes » et au commentaire qui les accompagne, celui qui les lance – ou plutôt qui les relance – ne cherche aucunement à en orienter ou en contrôler l’usage. En d’autres termes, il refuse de croire, sans coquetterie mais sans naïveté non plus, que le problème de son identification soit de la moindre conséquence. Il sait qu’en se soustrayant ainsi à l’emprise du « lecteur », il lui tend un piège : d’une part il refuse de donner (faudrait-il dire : prêter ?) son nom à ces « textes » ; de l’autre il ne fait aucun mystère de ce nom qu’un enfant de dix ans pourrait retrouver en toutes lettres dans les « textes ». Inversement, ce piège est aussi celui dans lequel il ne peut pas ne pas tomber lui-même : en effet, il n’a aucun moyen (ni même la prétention) de s’y soustraire étant donnée l’ambiguïté insoluble d’une « illusoire-présence-anonyme » (on devine la fondamentale contradiction); présence et anonymat accusés et refusés ensemble par le paraphe final. Dans ce sceau se trouve le nœud du piège qui rend tout rapport d’un « lecteur » à un « auteur » impossible.
69Alors, puisque trace il y a d’un passage, d’une transformation, d’un travail (comme on dit d’un bois qu’il travaille, qu’il joue, sans qu’on puisse indiquer s’il en est le sujet ou l’objet), celui qui s’y est livré, et qui y a été livré, ne se soucie autrement de les marquer que d’initiales – premières lettres du nom qui, jointes, composent (effet du hasard ? on ne le lui a pas dit) le pronom de la première personne, celle-là même qu’il s’agit d’inventer et qui se signale ici la dernière :
70J. E.