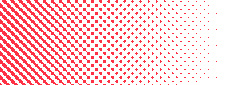Interprétation, restitution et réécriture du texte médiéval
1. Spécificité du texte médiéval
1L’édition de textes littéraires en langues romanes du Moyen Âge est confrontée à des problèmes et à des difficultés reconnus depuis longtemps comme spécifiques1. Rappelons-en tout d’abord les contours. L’édition de textes du Moyen Âge se démarque très nettement, sur un point capital, de la philologie des textes modernes : elle vise en effet, dans la plupart des cas, la restitution critique d’un texte que l’on connaît seulement par le biais de copies plus ou moins éloignées de l’original et en tout cas postérieures à celui-ci, alors que les spécialistes de textes modernes travaillent d’habitude sur des œuvres dont on possède une ou plusieurs versions imprimées autorisées par l’auteur. Par conséquent leur intérêt porte plutôt sur les étapes qui précèdent les versions finales, alors que ce cas demeure dans le domaine médiéval tout à fait exceptionnel, même s’il est connu par nos études : il suffit de penser aux formes multiples du recueil lyrique de Pétrarque qui ont précédé la rédaction définitive, autorisée et surveillée par le poète2.
2D’autre part, l’édition des textes médiévaux partage la même tâche de restitution critique que sa sœur aînée, la philologie des textes classiques : établir le meilleur texte possible, voire celui censé se rapprocher le plus des intentions de l’auteur, à partir des données livrées par la tradition manuscrite. Cela dit, les formes de transmission des deux types de textes demeurent d’ordinaire fort divergentes : face à une tradition des textes classiques que l’on a qualifiée de quiescente, c’est-à-dire caractérisée par une attitude respectueuse de la part des copistes, une fréquence plutôt faible de variantes et une oscillation linguistique restreinte, celle des textes vernaculaires du Moyen Âge est généralement active, à savoir troublée par les interventions massives des copistes, qui conduisent à une floraison de rédactions et de variantes et à un flottement linguistique continu3.
3C’est donc la mobilité extrême, découlant de l’affirmation lente et contrastée de la figure de l’auteur au Moyen Âge, qui caractérise tout d’abord le texte médiéval et l’éloigne, dans son parcours à travers les siècles, du texte latin ou grec. La conception de l’œuvre vernaculaire que se font généralement les hommes au Moyen Âge est une conception ouverte, dynamique, peu sensible au principe d’autorité, ce qui implique que l’œuvre peut être sujette à l’intervention de n’importe quel acteur de la transmission et qu’elle est, par là-même, susceptible de subir de nombreuses opérations : celles-ci sont parfois superposées au sein du même témoin et vont du découpage à l’interpolation, de la réécriture plus ou moins systématique au simple rajeunissement linguistique. Or, cette conception et ses effets pratiques, qui certes ne valent pas pour tous les genres et toutes les époques au même degré, comportent un ensemble de problèmes qui fait de l’édition de textes médiévaux une expérience intellectuelle, si j’ose dire, plutôt singulière.
2. Un cas concret : le Roman d’Eneas
4Pour donner un aperçu de la situation, je crois utile de rapporter dans ses grandes lignes un cas concret, choisi parmi les moins extrêmes. Prenons donc la tradition manuscrite d’un texte majeur du XIIe siècle français, le Roman d’Eneas, adaptation plutôt fidèle pour ce qui est de la trame, assez libre dans l’expression, de l’Énéide de Virgile, qui comporte un peu plus de 10000 octosyllabes, remonte aux environs de 1160 et a son origine dans la cour des Plantagenêts. De ce volet de la série des romans dits d’antiquité (Thèbes, Eneas et Troie) ne sont connus que neuf manuscrits4 :
|
A |
Florence, BML, Pl. 41.44 |
f. 1-60v |
1200 environ, Est de la France |
|
|
B |
Londres, BL, Add. 14100 |
f. 2-73v |
XIV2/3 siècle, Nord-Est de l’Italie |
|
|
C |
Londres, BL, Add. 34114 |
f. 105-164 |
XIV3/3 s., Angleterre |
recueil |
|
D |
Paris, BnF, fr. 60 |
f. 148-186v |
1315-1340, Paris |
recueil |
|
E |
Paris, BnF, fr. 12603 |
f. 111-144v |
1300 env., Arras |
recueil |
|
F |
Paris, BnF, fr. 1416 |
f. 1-63 |
1252, Nord de la France |
recueil |
|
G |
Paris, BnF, fr. 1450 |
f. 83-112v |
XIII2/4 s., Nord-Est de la France |
recueil |
|
H |
Montpellier, BI-SM, H 251 |
f. 148-207v |
XIII2/2 s., Île de France |
recueil |
|
I |
Paris, BnF, fr. 784 |
f. 70-119v |
1300 env., Champagne |
recueil |
2.1 L’éditeur au travail
5Un philologue néerlandais, Jean-Jacques Salverda de Grave (1863-1947), passa ses années de formation à élaborer l’édition de l’Eneas, parue en 1891 (Eneas1). Son analyse des rapports entre les manuscrits, dûment réfléchie, certifie que A et B sont des copies extrêmement proches, malgré les dégradations assez fréquentes que l’on doit au copiste de B, d’un excellent modèle, dénommé x. Il est avéré aussi que H et I, également fort semblables et partageant aussi de nombreuses lacunes, et d’un autre côté E et F forment le groupe y, au sein duquel le ms. G est plutôt à placer sur la même ligne que E et F, même si on ne peut pas exclure qu’il ait parfois eu accès à la source de HI. Ceci étant assuré, la position des mss. C et D soulève de nombreuses questions. Bien qu’on puisse placer C dans le même groupe qu’A et B, force est de constater que C combine souvent les leçons de plusieurs sources et enchaîne parfois, de façon maladroite, des vers relevant de groupes différents et relatant le même passage. Enfin D, qui offre à plusieurs endroits une version éloignée de celle de tous les autres témoins et en même temps plus proche de l’Énéide, est considéré comme étant l’œuvre d’un remanieur fort averti, et classé, avec hésitation, dans un groupe à part, même si l’éditeur reconnaît que par endroits ce remanieur s’est servi d’une source du type y’, probablement proche de F (Eneas1, p. v-xii). La réflexion mène donc à l’établissement d’un stemma, constitué par trois groupes (Eneas1, p. xii) :

6L’accord de deux des trois groupes de manuscrits devrait normalement indiquer la bonne leçon. Toutefois, la prudence s’impose. La part très importante de contamination constatée dans le ms. C entraîne l’éditeur à ne pas en tenir compte ; de plus, il déclare au préalable qu’il faudra se méfier systématiquement du ms. D, étant donné son travail de réécriture qui tente de rapprocher le texte vernaculaire de la source latine, et la contamination avec une source du troisième groupe. Le ms. A, qui est « le plus ancien, mais aussi le plus correct de tous nos manuscrits » (Eneas1, p. xiii), est pris pour base de l’édition : le texte est considéré comme assuré quand AB s’accordent avec D contre y ou avec ce dernier contre D ; en revanche, l’accord de D avec y contre AB ne détermine pas de choix automatique en faveur de Dy, mais nécessite une évaluation prudente, au cas par cas.
7En laissant délibérément de côté le problème, fort embrouillé, des couplets supprimés ou ajoutés dans les différents manuscrits, ainsi que celui des interpolations évidentes ou présumées5, tâchons de voir quelques exemples significatifs de cette pratique. L’exemple (1), tiré de l’épisode de la mise en bière du corps de Camille et de son renvoi au pays, montre l’importance de D pour la constitution du texte (Eneas1, p. 278)6 :
8(1) 7484 « Desus la biere ot un chassal “Au-dessus de la bière se trouvait une couverture
7485 de vert cendal et de vermeil, de taffetas vert et rouge,
7486 por tenir l’onbre del soleil. » pour protéger l’ombre du soleil”
7484Desus] desor DFG, dseur E, et sus I ; chassal] umbrail C, cendal EFGHI – 7485 qui fu de uert et de uermeil EFGHI
9L’accord de D avec x impose la leçon chassal, au sens – on suppose – de “couverture”, contre celle, sûrement banale, de y (mss. EFGHI : cendal “taffetas”), qui est ainsi contraint de récrire le vers suivant. Quant à l’éditeur, il ne se soucie guère du fait qu’il s’agisse de la seule attestation du mot en ancien français7. De même, au v. 6130, lorsque le corps de Pallas est ramené sur une civière, un autre hapax, chace “couverture”, dont le lien étymologique plausible avec chassal n’a pas échappé à Gaston Paris8, est retenu, même si le soutien de D fait défaut (Eneas1, p. 226) :
10(2) 6130 « et d’une chace volatille “et d’une couverture légère
6131 puis fist desus un aombrail on fit au-dessus un parasol,
6132 tot environ come buschail. » tout autour comme une courtine”.
6130d’une] duno B, une D ; chace] chate B, chiere CD ; volatille] volatil C ; dun drap de soie molt soutille EFG, cortine ot de soie soutille HI – 6131 puis fist desus] i f. de desuis C, et f. deseure E, et f. desor F, f. par desor G, et dedesus fait H, et de sus fet I ; aombrail] habitail EFGHI ; mist dedesor a un ombrail D – 6132 come] come un G
11Face à l’éclatement des leçons dans les différentes branches de la tradition manuscrite, l’éditeur se tient à la leçon de A (chace), qui a l’avantage d’être difficile – et justifie donc l’effort de rationalisation mené par les autres témoins –9 et de présenter le même radical du terme (chassal) employé plus loin, mais dans un contexte identique, lors de la description de la mise en bière de Camille10.
12En revanche, l’exemple (3.a), concernant l’épisode de Cerbère, illustre bien comment l’éditeur réagit face à l’insuffisance de x (Eneas1, p. 97) :
13(3.a) 2601 « ainz que li charmes fust feniz, “avant que la formule ne fût terminée,
2602 fu Cerberus bien endormiz ; Cerbère fut profondément endormi :
2603 il est colchiez tot en reorte il s’est couché tout en rond
2604 en sa fosse joste la porte. » dans sa fosse, près de la porte”.
2601 li] son HI ; fust] fu E – 2602 fu Cerberus] sest c. D, c. est EF, c. fu CG ; bien] touz H, tout I – 2603 est] sest ABCDEHI ; reorte] roote DH, reote F – 2604 sa] la G ; fosse] roiffe A, roiste B ; joste] delez HI ; la] sa C
14Puisque au v. 2604 roiffe (A) signifie “rogne, gale de la lèpre”11 et que roiste (B) est un adjectif (“raide, escarpé”)12, on a l’impression qu’une dégradation s’était déjà produite dans le modèle commun, peut-être à cause d’une anticipation dans la copie de la préposition qui suit (ioste dans les mss.). Salverda de Grave a ainsi intronisé la leçon de CDEFGHI, fosse, donc l’accord de D avec y contre x, vu la défaillance évidente de ce dernier. On remarque en effet que la leçon fosse colle assez bien au passage correspondant dans l’Énéide (l. VI, v. 422-23) : « […] atque immania terga resolvit / fusus humi totoque ingens extenditur antro » “il dénoue sa croupe gigantesque / répandue sur le sol, s’étend, énorme, dans toute la profondeur de sa caverne”13. Fosse n’a pas ici forcément la valeur du français moderne “fosse”, c’est-à-dire “cavité dans le sol”, que l’éditeur lui assigne dans le glossaire, puisque l’occurrence du v. 2351, « La ot une fosse parfonde » “Là il y avait une caverne profonde” (doublée par celle du v. 2356)14, lorsque l’adaptateur décrit l’entrée des enfers, ne peut, me semble-t-il, qu’être interprétée dans le sens de “caverne, grotte”, eu égard au calque flagrant du passage correspondant dans l’Énéide (l. VI, v. 237 : « Spelunca alta fuit […] » “Il y avait une caverne profonde”)15. De plus, on repère un témoignage de cette acception du terme au sein de la tradition manuscrite de l’Eneas, dans l’épisode de la partie de chasse au cours de laquelle Énée et Didon arrivent enfin à s’aimer (v. 1445-538) : quand une tempête soudaine disperse les chasseurs, Énée et Didon restent ensemble et « Tant ont alé fuiant andui, / a une crote sont venu. / Iluec sont andui descendu » (v. 1518-20 ; “Ils vont fuyant tous deux si bien qu’ils sont venus à une grotte. Là ils sont descendus”)16 ; l’auteur médiéval reproduit ici le texte de l’Énéide presque mot à mot (l. IV, v. 165-66 : « Speluncam Dido dux et Troianus eandem / deveniunt […] » “Didon et le chef troyen se retrouvent dans la même grotte”)17. Or, les mss. CDFG présentent fosse au lieu de crote “caverne, grotte” de AB18. Il s’avère d’ailleurs que fosse était aussi employé en ancien français au sens de “tanière (d’une bête sauvage)” ou, simplement, de “caverne, grotte”19 : à propos de cette dernière acception, on peut mentionner, par exemple, le v. 1233 de la Vie de Saint Thomas de Canterbury de Guernes de Pont-Sainte-Maxence, « Rome fu maisun Deu ; or est fosse a larrun » (“Rome a été maison de Dieu ; elle est maintenant une caverne de bandits”)20, où la citation appuyée des Évangiles – ce sont les mots du Christ qui chasse les marchands du Temple : « et dicit eis : “Scriptum est : Domus mea domus orationis vocabitur. Vos autem facitis eam speluncam latronum” » (Mt XXI,13) – nous assure que fosse a larrun traduit speluncam latronum. Si donc fosse pouvait signifier “caverne” au v. 2604 de l’Eneas, une correspondance exacte avec la source virgilienne, qui clôt le v. 423 sur antro, serait établie.
15L’édition de Salverda de Grave parue en 1891 est une édition que l’on qualifie à juste titre de reconstructionniste, c’est-à-dire bâtie sur les principes de la méthode dite de Lachmann, appliquée pour la première fois aux textes vernaculaires, et de façon cohérente, par l’un de ses maîtres, Gaston Paris (1839-1903)21. La qualité de ce travail est due à une application généralement modérée et avertie de cette méthode, ce qui d’ailleurs lui valut un bon accueil : Gaston Paris et Adolf Tobler (1835-1910), les dieux tutélaires de la philologie romane à l’époque, en donnèrent des comptes-rendus nourris de remarques ponctuelles, souvent critiques, toujours appropriées, mais somme toute positifs, puisque, comme le dit le premier, « le texte ainsi établi est très satisfaisant dans son ensemble22 ».
2.2 Retournements
16Par la suite, Salverda de Grave continua ses recherches sur le Roman d’Eneas tout au long de sa vie et fut chargé dans les années 1920, par la maison d’édition Champion, de publier à nouveau le roman, cette fois-ci dans la prestigieuse collection des Classiques français du moyen âge (Eneas2). Ce fut l’occasion d’un revirement spectaculaire. Les principes de cette nouvelle entreprise, inspirés d’un bédiérisme sec et rigoureux, sont d’ailleurs affichés en tête de l’introduction (Eneas2 I, p. iii-xxxvi) : d’abord, on déclare renoncer à l’idée de retrouver la forme originale du poème, étant donné qu’elle est, comme l’a montré Joseph Bédier (1864-1938), impossible à atteindre, sauf cas exceptionnels ; sera donc reproduit, tout simplement, le manuscrit considéré comme le plus proche de l’original, c’est-à-dire A, dont toute leçon, pourvu qu’elle soit intelligible, sera gardée ; enfin, l’éditeur se flatte d’avoir, par ce système, « réduit à un minimum l’élément personnel dans cette constitution du texte » (Eneas2 I, p. iii). Ces propos, compte tenu de l’époque, ne nous surprennent pas, même quand ils sont prononcés par un spécialiste mûr, formé à l’école de Gaston Paris et auteur d’un certain nombre d’éditions fondées sur des principes lachmanniens23. Mais voyons-en les conséquences sur l’établissement du texte par le biais de quelques exemples. Le passage dans lequel Cerbère s’endort subit dans la nouvelle édition une modification remarquable (Eneas2 I, p. 80) :
17(3.b) 2601 « ainz que li charmes fust feniz,
2602 fu Cerberus bien andormiz ;
2603 il s’est colchiez toz en reorte
2604 en sa roiffe joste la porte. »
18La leçon de A a été conservée par l’éditeur au v. 2604, alors que celle de B (roiste) suggère qu’une altération était déjà dans le modèle commun. D’ailleurs, aucune note n’éclaire le lecteur, qui peut seulement se référer au glossaire, où roiffe est traduit, suivant les dictionnaires, par « rogne » (Eneas2 II, p. 255). Or, je n’ai pu repérer aucune allusion à une maladie de la peau parmi les attributs monstrueux de Cerbère, ni dans le livre VI de l’Énéide, ni dans les commentaires du texte latin qui circulaient au Moyen Âge et qui ont été publiés24, ni, enfin, dans la description du gardien des enfers que l’auteur d’Eneas développe abondamment, et de façon savoureuse (v. 2560-604), bien au-delà des indications de la source latine25. Ce n’est donc pas un hasard si l’on devine, à cet endroit, un véritable embarras dans la traduction, d’habitude heureuse, que Martine Thiry-Stassin a donnée du texte établi en 1925-29 : ne pouvant ni accepter ni ménager roiffe au sens de “rogne”, elle considère roiffe comme étant une variante – malheureusement non attestée – du mot rafle “hotte, grand panier”26, peut-être sur la base du fait qu’une variante connue de roiffe “rogne” est rafle ; l’hypothèse, déjà fort téméraire du point de vue méthodologique, est loin d’amener à un résultat satisfaisant – le voici : « il s’est couché tout en rond dans son grand panier à côté de la porte27 ». Un panier pouvant contenir Cerbère m’est inconnu et difficile à imaginer.
19D’ordinaire, la fidélité au ms. A n’est pas mise en cause, même lorsqu’il est facile de soupçonner l’innovation banalisante. Dans le long épisode de Vénus qui séduit Vulcain pour qu’il forge les armes destinées à Énée (v. 4297-410), épisode qui correspond à celui du livre VIII de l’Énéide (v. 370-453) mais avec une part importante d’originalité dans les détails, l’auteur de l’Eneas introduit, de son propre chef, le récit des amours de Vénus et Mars, que l’on rattache à la trame pour expliquer le fait que Vulcain s’unisse à Vénus pour la première fois depuis sept ans. La haine conçue par Vénus est due au mauvais tour joué par son mari lors d’un de ses rendez-vous amoureux avec Mars, lorsque Vulcain les enveloppa dans un filet de fer et les montra aux dieux. Or, il est évident, et reconnu depuis longtemps, que la source de ce récit est le livre IV des Métamorphoses d’Ovide (v. 169-89), où l’on retrouve chez les dieux la même attitude ambiguë et malicieuse que dans l’Eneas (Eneas2 I, p. 133)28:
20(4) 4371 « Cele chose desplot as deus ; “La chose déplut aux dieux ;
4372 por quant s’en i ot il de teus pourtant il y en eut
4373 qui volsissent estre alsement qui auraient voulu aussi être
4374 laciez o li estroitement. » étroitement enlacés à Vénus”.
186 « […] illi iacuere ligati
187 turpiter, atque aliquis de dis non tristibus optat
188 sic fieri turpis […] »
21D’ailleurs, Edmond Faral voyait dans ce rapprochement « la preuve irréfutable que l’auteur de l’Eneas connaissait le texte même d’Ovide29 ». Ceci rappelé, observons le passage qui dans l’Eneas précède le groupe de vers cité et porte sur la convocation des dieux, selon les deux éditions (Eneas1 p. 160-61 [à gauche] et Eneas2 I, p. 133 [à droite]) :
22(5) 4368 « trestoz les deus i amena « trestoz les deus i amena
4369 et mostra lor tot en apert et mostra lor tot an apert
4370 cele avoltire a descovert. » cele aventure a descovert. »
4368-70 omisEFHI – 4368 trestoz] et tos G ; amena] auna D – 4370 cele avoltire] cele auenture AB, cel a. D, cel aultere G.
23La modification introduite dans la seconde édition ne peut pas surprendre, vu les principes de méthode et la possibilité d’interpréter, d’un point de vue lachmannien, l’accord de D et G comme le résultat de la contamination du premier– aucun autre manuscrit du groupe y ne garde le vers, pour des raisons différentes. Cela dit, l’amendement a du poids. Aventure ne pouvant pas signifier à cette époque “intrigue amoureuse”, la seule valeur raisonnable est ici “fait, événement”30. D’ailleurs, le mot est employé dans l’Eneas une fois pour “sort, destin” (v. 1025), qui est son sens principal, une fois dans la locution metre en aventure “abandonner au hasard” (v. 209), deux fois dans la formule d’exclamation quel aventure ! “quel malheur !” (v. 1686 et 5176).
24En revanche, l’intérêt de la leçon écartée en 1925-29 est tout autre. Non seulement avoltire “adultère” est déjà utilisé dans l’Eneas, et dans le même sens (lorsque la reine rappelle à son mari, Latinus, que naguère Pâris tint en avoltire Hélène [v. 3291-97]), mais les termes correspondants en latin apparaissent à deux reprises dans le récit ovidien des amours de Vénus et Mars qui est censé représenter la source directe de l’auteur vernaculaire : au début de son récit, Ovide résume les faits par le biais d’une formule fort claire, adulterium Veneris cum Marte (v. 171) ; lors de la capture des deux amants, Mars est dénommé adulter (« Ut venere torum coniunx et adulter in unum, / arte viri vinclisque nova ratione paratis / in mediis ambo deprensi amplexibus haerent » “À peine l’épouse et le dieu adultère se sont-ils réunis dans la même couche / que, grâce à l’habileté de l’époux, pris tous les deux dans les liens de cette invention nouvelle, / ils sont immobilisés au milieu de leurs embrassements” [v. 182-84])31. Certes, le mouvement discontinu d’adhésion et d’innovation par rapport à la source, ici ovidienne, dont l’adaptateur médiéval fait preuve à tout moment ne nous permet pas de trancher entre aventure et avoltire. Cependant, l’exemple nous aide à cerner la portée des changements d’une édition à l’autre, parfois même dans le sens apparent de l’appauvrissement sémantique, et souligne par conséquent l’importance que tout lecteur, de l’amateur à l’exégète, doit accorder à l’examen de l’apparat et des richesses qu’on y découvre le plus souvent.
25On pourrait multiplier les exemples de ce type, mais on craint de finir par donner l’impression d’une succession infinie de points critiques mal élucidés, alors qu’en réalité l’édition parue en 1925-29 est, en général, très bonne et le texte établi à partir du ms. A s’avère, dans l’ensemble, cohérent, fiable et, par endroits, même supérieur à celui livré en 1891, où les reconstructions hasardeuses et les solutions contradictoires ne manquaient pas. D’ailleurs, quand on lit en profondeur l’apparat critique de l’édition parisienne, on comprend aisément que l’éditeur était conscient de l’outrance de sa foi dans le bon manuscrit et que, s’il considérait certaines de ses hardiesses justifiées, c’était parce qu’il avait déjà pourvu la communauté scientifique d’une édition lachmannienne, à laquelle elle pourrait toujours recourir, pour contrôler, comparer et éventuellement tempérer les nouvelles propositions. Une preuve de cet état d’esprit est livrée par l’exemple (6), tiré du dialogue entre Lavine et sa mère sur la nature d’Amour (v. 7857-8024) qui fait partie de la longue et heureuse addition – par rapport à la trame de l’Énéide – vouée à l’analyse des chagrins d’amour de Lavine et du héros. La reine essaye de convaincre Lavine d’aimer Turnus, mais Lavine déclare ignorer ce qu’est Amour ; la mère décrit alors les maux et les joies d’Amour, mais Lavine refuse d’aimer Turnus par crainte d’Amour. Voici un extrait de cette série de réponses du tac au tac (Eneas1 p. 297) :
26(6.a) 8001 « Entenz i tu encor neient ?” “N’y comprends-tu encore rien ?
8002 “Quant ge ne l’oi, ne sai coment”. – Puisque je ne l’ai appris, je ne sais comment.
8003 “Ne te di ge les traiz d’amer ?” – Ne t’ai-je décrit les traits de l’amour ?
8004 “Molt me senble sur et amer”. – Il me semble bien aigre et amer.
8005 “Ja vient aprés la granz dolçors, – Mais après vient la grande douceur,
8006 asez en a l’en ainz dolors. on la ressent mieux que la douleur.
8007 Amors saine, quant a navré”. » Amour guérit quand il a blessé”.
8001 Entenz i tu encor] e. y tu uncore C, e. tu encore DF, en sens tu di e. I – 8002 Quant ge ne l’oi] q. ie ne lay D, certes nenil HI ; ne sai] nen s. G, et ie EFHI – 8003 te di ge] tei ie dist I ; les traiz] lo trait AB – 8004 pluis qe siue me semble amer C ; Molt me senble] m. m. samblent EFG, oil trop sont HI ; sur] fier AB, dur HI – 8004.1-2 por amor doit on molt soffrir | car il le puet tres bien merir EF – 8005 on en suefre molt grant dolor EF ; Ja] sen HI – 8006 ainz en a en molt grant doulor D, ains que on en uiengne a le doucor E, ains que lon uigne a la dolcor F, a. en a en mains d. G ; ainz] puis C – 8007 a] qad C
27La seule modification digne d’intérêt dans la nouvelle édition concerne le couplet 8003-04 (Eneas2 II, p. 64) :
28(6.b) 8003 « “Ne te di ge lo trait d’amer ?
8004 “Molt me sanble fier et amer”. »
29Il s’agit de fier “sauvage, cruel”, variante de AB préférée à sur “aigre” de DEFG, pourtant le seul adjectif qui, étant quelque peu rare – même si en réalité il est bien attesté et souvent associé à amer –32, pouvait aspirer au rôle de lectio difficilior. Il faut aussi ajouter, ce qui paraît décisif, qu’ici on est en plein domaine sensoriel du goût, comme le confirme la réponse de la mère, qui insiste, tout de suite après, sur la granz dolçors d’Amour (v. 8005) ; et au goût renvoient, de façon précise et complémentaire, sur “aigre” et amer. Ces considérations, fort élémentaires, devaient d’ailleurs être présentes à l’esprit de l’éditeur, puisqu’il a ajouté, dans l’apparat de la deuxième édition, à la suite des leçons rejetées : « la leçon de DEFG, appuyée par celle de HI, est plutôt la lectio difficilior » (Eneas2 II, p. 194).
2.3 Réception du travail d’édition
30Celui que l’on vient de relever n’est qu’un des nombreux indices de la nature complémentaire, voire supplétive – par rapport à celle de 1891 – que l’édition de 1925-29 devait avoir dans l’esprit de Salverda de Grave. Ce qui, bien évidemment, n’a pas été compris. Depuis, l’édition de 1925-29 est en effet devenue la vulgata sur laquelle les études littéraires concernant l’Eneas ou les romans d’antiquité, avec très peu d’exceptions, se fondent, comme s’il s’agissait de l’autographe livré par l’auteur, et la vieille édition a été tout simplement reléguée aux oubliettes33. Il est d’ailleurs éloquent qu’aucune réflexion critique n’ait été engagée, par la suite, autour du texte de l’Eneas34: l’édition du roman selon la rédaction du ms. D livrée par Aimé Petit en 1997, bien que soignée et utile, n’apporte pas beaucoup sur le fond, étant donné le caractère fort singulier de ce remaniement35. Une telle attitude n’a pas été remise en question par le regain d’intérêt dont l’œuvre a joui à partir des derniers années du XXe siècle et on constate en général, encore aujourd’hui, la même croyance, dépourvue de toute approche critique, dans le texte fixé en 1925-29 et le manque total d’attention à la profondeur du texte, rendu précaire, flottant et par endroits aléatoire par une tradition manuscrite fort problématique. J’en donne un exemple.
31Philippe Logié a publié en 1999 une analyse minutieuse des différents procédés de traduction du texte de Virgile mis en œuvre par l’auteur de l’Eneas36. L’utilité de cette étude est certaine, mais il est aussi vrai qu’elle aurait gagné en efficacité si elle avait examiné l’ensemble de la tradition textuelle du roman médiéval : au contraire, l’analyse a pour seule base le texte établi en 1925-29, l’édition précédente ne figure que dans la bibliographie et les plongées dans les méandres de l’apparat critique s’avèrent inexistantes37. Comment, alors, est-il possible de dresser des grilles et des rapports quantitatifs entre les différents procédés d’adaptation, établis par le biais d’analyses d’une finesse et d’une précision extrêmes, si l’on ne sait pas, pour revenir à notre exemple (3), que en sa fosse a bien des chances d’être la bonne leçon au vers 2604 et que, pouvant donner à fosse la valeur de “caverne”, cette leçon traduit précisément l’antro de la source latine ?
32La remarque est tout aussi valable pour les leçons de AB écartées lors de la seconde édition, qui ont, elles aussi, sombré dans l’oubli. Voyons-en un cas de figure. Les dernières décennies ont connu le développement des études concernant le sort d’un certain nombre de figures mythologiques de l’antiquité, surtout féminines, dans la littérature du Moyen Âge. L’une des figures les plus chères à ce genre d’études est celle de la Sibylle, sur laquelle Josiane Haffen s’était déjà penchée en 1984, après le travail pionnier de William Kinter et Joseph Keller et l’incursion de Helen Laurie38. Les altérations qui marquent le parcours de la Sibylle à travers les siècles médiévaux sont déjà esquissées, d’après Haffen, dans l’Eneas, où la Sibylle revêt des allures d’enchanteresse – elle donne à Énée un onguent qui protège contre la puanteur des enfers (v. 2393-96) et ensuite endort Cerbère par le biais d’un charme (v. 2587-604) – : « ces traits, que la Cumane ne possède pas dans Virgile, rendent cette sibylle comparable aux fées du Moyen Âge39 » ; ainsi, on s’explique aisément pourquoi certaines fées, dans des œuvres narratives postérieures, portent le nom de Sibylle. D’ailleurs, « à l’instar de la fée médiévale, la Sibylle vit […] dans un monde en marge de l’univers des vivants – cas de la Cumane de l’Énéide, entre autres –, elle a le don de la prophétie, et elle bénéficie, à défaut de l’immortalité, d’une longévité extraordinaire. De par ses caractéristiques et de par ses aptitudes, qui ne sont pas l’apanage du commun des mortels, et que seules les fées ont en partage avec elle, la Sibylle semblait donc toute désignée pour devenir une fée au Moyen Âge40 ». Depuis, nombreux ont été ceux qui se sont occupés de la Sibylle dans l’Eneas41. On pourrait légitimement croire que le sujet est bien éclairé. Faisons toutefois une vérification, à partir du passage où l’on décrit la prophétesse telle qu’elle apparaît à Énée à peine débarqué (Eneas2 I, p. 70)42 :
33(7) 2267 « Ele seoit devant l’antree, “Elle était assise devant l’entrée,
2268 tote chenue, eschevelee ; la chevelure toute blanche, hérissée ;
2269 la face avoit tote palie elle avait la face blême
2270 et la chair noire et froncie ; et la chair noire et ridée ;
2271 peors prenoit de son regart, on prenait peur devant son regard,
2272 feme sanblot de male part. » elle ressemblait à une femme venue de l’enfer”.
2268 tote chenue] tote nus piez AB, tout chanue C, canue toute E – 2269 la face auoit noire et froncie H ; la chiere auait noire et froncie I ; avoit tote palie] a. t. empalie CEF – 2270 la face iaune et enpalie HI ; chair noire] ch. et n. DEFG ; froncie] refrouncie C – 2271-72 omisD – 2271 prenoit] prent on E ; orent HI ; regart] esgart CEF
34Dans ce passage marqué par un flottement textuel assez important, ce que je trouve remarquable est la variante tote nus piez de AB pour tote chenue de DEFGHI au v. 2268, cette dernière étant une qualification tout à fait attendue et traditionnelle pour souligner le grand âge de la prophétesse (on la retrouve d’ailleurs plus loin, au v. 2295 : « Elle crolla lo chief chenu » “Elle secoua sa tête chenue”). Or, la leçon rejetée à deux reprises par Salverda de Grave ne me paraît pas anodine. D’une part, ce vers de l’Eneas selon AB se retrouve tel quel – exception faite pour le pluriel – dans le Roman de Thèbes, au cœur de l’épisode célèbre des dames d’Argos qui, ayant appris le désastre de l’armée grecque, décident de se rendre à pied à Thèbes pour récupérer les corps de leurs proches et les enterrer. Le départ de cette marche héroïque, qui durera trois jours, est ainsi fixé dans les différentes versions du Roman de Thèbes : « toutes nuz piez, eschevelees, / en lor chemin en sont entrees » “toutes les pieds nus, les cheveux épars, / elles se sont mises en route” (v. 9945-46)43. L’influence exercée par le Roman de Thèbes, probablement le plus ancien des romans d’antiquité, sur l’Eneas a été maintes fois commentée44, mais cette éventuelle transmission de vers et d’image d’un roman à l’autre est frappante et ne peut être imputée, de façon directe, à la contiguïté des deux œuvres dans la tradition manuscrite, car les mss. de Florence et de Londres, les seuls à garder la leçon tote nus piez, ne contiennent que l’Eneas.
35D’autre part, l’association des pieds nus et des cheveux épars n’est pas rare dans la littérature française des origines et, de façon quelque peu surprenante, revient dans des scènes de séduction. Dans Floovant, par exemple, une chanson de geste en alexandrins assonancés de la fin du XIIe siècle, Florette, la fille du roi Flore, au service duquel le héros, Floovant, lutte contre les sarrasins, se présente à ce dernier pour lui demander de l’embrasser, car elle est amoureuse de lui. La jeune fille paraît alors sur scène de manière pour le moins inattendue : « La pucelle desvaule contr’aval le plainchié, / Nu-piez, eschavolee, portoit .I. esprivier » “La jeune fille descend le long de la salle planchéiée, / nu-pieds, échevelée, elle portait un épervier” (laisse XVII, v. 500-01)45 ; dans le Lai de Désiré, daté aux environs de 1200, les mêmes traits sont prêtés à la jeune fille, véritable être féerique que Désiré rencontre dans la forêt, près de la fontaine, au début du récit et qui mène le héros chez la fée tout en l’instruisant convenablement : « La colur ot blanche e rovente, / e de cors fu ben faite et gente ; / sanz guimple esteit eschevelee / e nu pez feu pur la rosee » “Son teint était blanc et rougissant, / et son corps était bien fait et beau ; / sans guimpe, elle avait les chevaux épars et les pieds nus à cause de la rosée” (v. 137-40)46. J’ignore si ce détail des pieds nus associé aux cheveux épars est un attribut marquant les êtres féeriques au Moyen Âge, mais il doit sans doute être tentant, pour quelqu’un de compétent dans ce domaine, de suivre la piste et d’étudier l’évolution du personnage de la Sibylle dans la direction de la fée médiévale à la lumière de la variante attestée par les mss. AB. Et cela, sans revenir au choix fait par l’éditeur d’écarter cette leçon. De plus, le fait que, pour caractériser la jeune fille en train de séduire, des textes fort éloignés entre eux aient recours au même couple d’attributs (pieds nus/cheveux épars), n’est pas sans rappeler la foule de sibylles séductrices et sensuelles qui peuple les romans arthuriens en prose du XIIIe siècle47 : enfin, on s’attendrait à ce que les exégètes foncent sur la variante de AB et nous en expliquent la genèse, le contexte dans lequel elle a pu se produire et, surtout, son sens, eu égard aux stades successifs de la métamorphose de la figure de la prophétesse que l’on vient d’évoquer.
36Or, le résultat de cette vérification est décevant, car aucune des études, pourtant si détaillées, vouées récemment à la Sibylle médiévale ou à celle de l’Eneas ne fait mention de la variante de AB, sauf erreur de ma part. La rigueur, les scrupules et l’intégrité que l’on exige de tout éditeur dans le défi de rendre compte, en principe, de toutes les questions posées par le texte auquel il s’attache, ne sont donc nullement partagés par les exégètes, c’est-à-dire les premiers destinataires du texte critique ainsi établi48. Le court-circuit est patent et soulève des questions : cette attitude n’équivaut-elle pas à méconnaître que le texte vernaculaire médiéval est d’ordinaire une entité complexe et précaire, faite de couches plutôt que de surfaces, d’hypothèses plutôt que de faits assurés ? D’autre part, l’œuvre du philologue, en raison de ces contenances, n’est-elle pas élevée, malgré le philologue lui-même, c’est bien le cas de le dire, au rang de celle de l’auteur ? Dépouillé de toute réserve, hasard, défaillance, voire erreur de l’éditeur – outillage d’atelier tenu désormais pour désuet et superflu –, le texte établi, une fois consacré par la communauté scientifique, fournit une surface lisse, idéale pour toute sorte d’exercices intellectuels.
3. Mise en garde
37Le cas que je viens d’exposer de façon sommaire n’est certainement pas la règle au sein de nos études, mais il n’est pas non plus une exception flagrante. Certes, au cours des dernières décennies on a pu constater, d’une part, une évolution remarquable dans la pratique des éditeurs, déterminée entre autres par la nouvelle attention portée aux manuscrits, considérés comme des entités à part entière, des produits socio-historiques normalement doués de cohérence, et non plus des dépôts aseptiques de variantes. Cette nouvelle sensibilité est le résultat d’un long processus d’enrichissement méthodologique, nourri des échanges avec des disciplines telles que la codicologie, la linguistique et l’histoire49. D’autre part, les spécialistes de la littérature du Moyen Âge se sont faits de plus en plus exigeants, en règle générale, par rapport à la clarté et au caractère exhaustif de chaque hypothèse d’établissement du texte, et ont tendance, quant à eux, à interroger toutes les couches dont se compose la tradition textuelle d’une œuvre. Restent pourtant ouverts de nombreux problèmes, inhérents, si j’ose dire, à la nature même du texte médiéval, exposé dès son éclosion à des courants d’altération aussi puissants que contradictoires. Le cas que l’on vient d’examiner nous met, de plus, en garde contre les aléas de la réception du travail philologique moderne, à savoir le danger d’identifier sans médiations une hypothèse de restitution du texte, étroitement liée aux convictions et au goût de l’éditeur et, nécessairement, sujette aux moyens et aux schémas herméneutiques de l’époque, avec le texte présumé original lui-même. Autrement, le philologue risque de n’être rien de plus que le dernier – et pas forcément le plus sagace – des remanieurs.