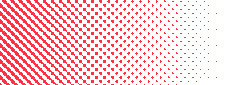Lire la négativité queer dans Saute ma ville (1968) de Chantal Akerman
1Saute ma ville (1968) marque le début de la carrière cinématographique de la réalisatrice, actrice, écrivaine et artiste Chantal Akerman (1950-2015)1. Dans ce court-métrage de treize minutes, Akerman joue le seul personnage. L’image montre d’abord un complexe résidentiel sur lequel le titre et la dédicace apparaissent, ensuite un immeuble filmé de bas en haut, puis l’arrivée précipitée de la jeune protagoniste. Elle entre dans son immeuble, prend son courrier, court vers l’ascenseur et, sans attendre qu’il arrive, monte les escaliers quatre à quatre en criant « pipi ! ». Une voix hors-champ accompagne l’arrivée de la protagoniste. Elle chante le mouvement « Tambourin » de la Suite en mi mineur (1724) de Jean-Philippe Rameau. Cette danse baroque conçue pour le clavecin est transposée par la voix d’Akerman, qui la chante en prenant ses libertés avec le rythme de danse écrit par Rameau, modérant la vitesse en fonction de l’essoufflement de son personnage qui monte les escaliers en même temps. C’est le premier de plusieurs refus. Une fois arrivée dans son appartement – la suite du film se déroule uniquement dans la cuisine –, une série d’actes se succèdent. La protagoniste scotche l’encadrement de la porte fermée sans faire attention à son travail et abandonne vite la tâche, se mettant à table pour manger. N’ayant pas terminé son plat, elle le place par terre, casse le robinet en essayant de boire dedans, met de l’eau à bouillir sur le feu et retourne à la porte. Ensuite, la protagoniste commence à accomplir des tâches ménagères à l’envers. Après avoir jeté un seau d’eau sur les poêles et produits éparpillés par terre, la protagoniste passe le balai avec de grands gestes exagérés. De temps en temps, elle reprend le travail de calfeutrer la porte. La voix hors-champ accompagne les actes réalisés dans la cuisine et annonce l’explosion que la coupe au noir remplace visuellement. En effet, dans les dernières minutes du film, la protagoniste met le feu à une lettre qu’elle a reçue et s’allonge la tête à côté du gaz ouvert en mimant le suicide, un bouquet de fleurs dans la main gauche. L’écran coupe au noir et nous entendons la voix hors-champ annoncer « bang ! », puis une série d’explosions.
2Le tournage de ce film en noir et blanc a été réalisé au cours d’une nuit par une équipe de trois personnes, dont Akerman, et il se déroule dans la cuisine de ses parents à Bruxelles (Rich, 2016, p. 17). Akerman explique dans un entretien avec B. Ruby Rich que cela est dû au fait que les frais de location de la caméra pour la nuit étaient moins élevés que de jour et qu’elle a pu utiliser une pellicule 35 mm pour le même prix que du 16 mm (2016, p. 17). Ce contexte de production peut être associé à ce qu’Alisa Lebow appelle une « esthétique oppositionnelle » : ces formes de travail cinématographique qui reflètent la réalité des circonstances économiques et sociales et, en même temps, démontrent que le budget ne détermine pas l’apport de l’œuvre (1993, p. 19). Akerman illustre avec Saute ma ville la manière dont la contrainte ou le besoin peut devenir une esthétique à part entière : le fait que son film est tourné la nuit, en noir et blanc et dans la cuisine des parents – trois contraintes des conditions du tournage – donne au film un air d’intimité – la cuisine familiale – et de fugacité – la nuit – qui renforcent l’impression d’un film tourné aux marges de l’industrie cinématographique. La pellicule a par ailleurs attendu dans un laboratoire pendant quelques années avant que le film soit diffusé pour la première fois (Schmid, 2022, p. 47). Saute ma ville se lit ainsi comme un film fondé sur l’opposition et la résistance, des notions qui seront associées à notre usage du terme « queer ».
3Les contraintes qui pèsent sur ce tournage autofinancé deviennent des spécificités esthétiques qu’Akerman conserve dans ses œuvres financées, notamment son film le plus connu, Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975), qui se déroule pour l’essentiel dans la cuisine et qui oblige le spectateur à assister à une série de tâches ménagères réalisées par la protagoniste en temps réel. Saute ma ville est influencé par des références filmiques américaines et françaises – Akerman cite Charlie Chaplin et Pierrot le fou (1965) de Jean-Luc Godard (Brenez et Akerman, 2011) – en même temps qu’il fait preuve du refus de reproduire ce qui a déjà été fait ou de se conformer aux références cinématographiques existantes, notamment en ce qui concerne le choix d’objet amoureux. En effet, la dédicace « pour Claire » fait apparaître une relation qui n’est pas hétérosexuelle.
4Chantal Akerman affirme avoir réalisé Saute ma ville six mois après Mai 68 (Brenez et Akerman, 2011). Selon l’artiste, ce soulèvement n’a rien changé du point de vue de la liberté sexuelle des femmes et, s’il a inspiré Saute ma ville, Akerman ne se considère pas pour autant comme « emblème de l’émancipation » (Brenez et Akerman, 2011). Ce film, où Akerman queerise la logique de la cuisine – un espace qui en principe se prête à la production et à l’organisation –, constitue un exemple clé parmi les œuvres d’Akerman s’appuyant sur des modes d’antiproductivité et de refus2. Dans la mesure où la cuisine constitue un lieu associé à l’ordre, la désorganisation de cet espace dans Saute ma ville peut être lue comme une force qui, dans les termes de Jack Halberstam dans The Queer Art of Failure, « ouvr[e] une brèche dans la positivité toxique de la vie contemporaine »3 (2011, p. 3 ; notre traduction). Selon Halberstam, c’est l’échec qui sert de « brèche » et il s’intéresse à ce que cet échec fait (p. 3). Avec Saute ma ville, Akerman met en scène plusieurs formes d’échec, à commencer par ce qu’elle interprète comme l’échec qu’est Mai 68.
5Au lieu de représenter une forme d’« émancipation » productive, la protagoniste détruit la cuisine – la structure – et sa propre personne, générant une histoire qu’il faudrait déchiffrer. En ce sens, la forme et le contenu de Saute ma ville s’avèrent illisibles. Jack Halberstam considère que l’illisibilité constitue une force permettant de résister aux illusions de progression ou de réussite sociale et qui représente le « refus de la représentation ordonnée » ou « cohérente »4 ([1998] 2018, p. 184 ; notre traduction). Saute ma ville accentue ces résistances à l’ordre et à la cohérence. Une série de refus entrepris par la protagoniste cède à un refus plus définitif : celui de vivre, l’auto-anéantissement. Au lieu de se soumettre à la logique d’un ordre linéaire, de la préparation d’un plat ou de la tâche de convertir le sale en propre, la protagoniste choisit de détruire la cuisine et, ensuite, son être. Mathias Lavin remarque que Saute ma ville illustre « l’inversion » de l’ordre des plats et que « la perte du goût des aliments et celle de la sociabilité vont de pair » (2022, p. 69 et p. 76). En effet, la cuisine apparaît comme un espace social et Saute ma ville peut être lu à travers ce prisme. Cette cuisine même devient symbolique d’un rapport en particulier, le rapport à « Claire », qui menace la protagoniste. Pour cette raison, et d’autres que nous développerons au cours de cet article, c’est le seul film qu’Akerman identifie comme « queer » :
[…] Saute ma ville, qui, je le pense maintenant, est mon film le plus queer. Saute ma ville, pour moi, est le contraire de Jeanne Dielman : l’histoire d’une fille qui répond à sa mère, qui explose les normes qui confinent les femmes aux tâches féminines, qui casse tout dans la cuisine, et qui fait tout de travers – et pourtant, malgré tout, c’est une histoire d’amour : le film porte une dédicace.5 (Lebovici et Akerman, 2011-2012, § 10 ; notre traduction.)
6Peut-être à son insu, l’usage que fait Akerman du terme « queer » évoque la négativité queer. En renversant la cuisine en un lieu de désorganisation, de destruction et même de mort, le film joue avec des possibilités ludiques et dangereuses au-delà de la conformité et de la lisibilité. Le court-métrage témoigne de l’urgence du point de vue de la protagoniste de sortir de la cuisine et de queeriser son milieu en faisant tout « de travers » – le mot qu’elle utilise dans cet entretien en anglais est « crooked », qui porte les sens de « corrompu » et de « courbé ». Akerman affirme que Saute ma ville est queer parce que « pourtant, malgré tout, c’est une histoire d’amour » (nous soulignons). Marion Schmid suggère que « les tourments de l’amour adolescent » sont secondaires à « la visualisation d’une profonde perturbation intérieure »6 (2010, p. 20 ; notre traduction). Mais, comme c’est le cas ailleurs dans l’œuvre d’Akerman, il existe une histoire d’amour là où il y a simultanément la réalisation de formes d’(auto-)destruction – et c’est cet aspect qu’Akerman qualifie de « queer ».
7Le fait qu’Akerman oppose Saute ma ville à Jeanne Dielman est intéressant parce que ces deux films nous paraissent davantage complémentaires qu’opposés. Jeanne Dielman montre quelques jours dans la vie d’une femme au foyer dont le mari est mort. Jeanne s’occupe de la maison soigneusement et se prostitue avec des clients qui arrivent chez elle l’après-midi. Au cours du film se produit une série d’évènements imprévus (notamment une lumière oubliée, des pommes de terre brûlées), elle jouit lors d’un des rendez-vous, poignarde le client et s’assied à table pendant sept longues minutes avant que le film ne coupe. Lorsqu’Akerman avance que « lutter contre le plaisir est la résistance de Jeanne, c’est sa manière d’exister, sa jouissance par rapport à l’obligation du plaisir »7, elle sous-entend que la jouissance serait meurtrière (Lebovici et Akerman, 2011-2012, § 22 ; notre traduction). L’une des histoires représentées par Saute ma ville serait ainsi, dans les termes de Jacques Lacan, « le lien du sexe à la mort, à la mort de l’individu » (Lacan, [1964] 2014, p. 168). C’est dans Jeanne Dielman qu’Akerman évoque le plus explicitement la notion lacanienne selon laquelle le sexuel est le lieu d’un certain auto-anéantissement, mais dans Saute ma ville la protagoniste passe à l’acte. La jouissance apparaît explicitement comme la force meurtrière de Saute ma ville, un film qui saisit parfaitement les ruptures présentes au sein du rapport amoureux. Akerman met en avant l’étrangeté – ou la queerité – de cette « histoire d’amour » fondée sur le refus du rapport, du plaisir et de la vie commune.
Négativité queer
8Ces types de refus sont caractéristiques de la branche des théories queers nommée « négativité queer » qui, tout comme l’œuvre d’Akerman, est située à cheval entre les contextes anglo-américain et francophone. Anne-Emmanuelle Berger considère que les « théorie(s) du genre », théories queers incluses et rassemblées sous cette désignation, sont le résultat d’un dialogue continu entre la France et l’Amérique du Nord (Berger, 2013, p. 9). La négativité queer, en particulier du point de vue de Lee Edelman, puise considérablement dans des textes ou des notions francophones, à commencer par l’œuvre de Lacan. Akerman, quant à elle, quitte Bruxelles pour déménager à Paris à la fin des années 1960 avant de partir à New York au tournant des années 1970 et une large partie de son œuvre est réalisée aux États-Unis, notamment sa première installation, qui est conçue à la demande du Walker Arts Center à Minneapolis (Atherton, 2022, p. 179).
9La négativité queer, parfois appelée « thèse antisociale », considère que la sexualité est, non pas un cadre qui structure l’identité, mais une force désorganisatrice. Elle rassemble une série de textes théoriques, pour la plupart influencés par la psychanalyse, qui rejettent la conception positive d’une identité queer et, à la place, exploitent les liens entre le désir et la pulsion de mort. La première mise en œuvre de la négativité queer est attribuée à l’auteur américain Leo Bersani pour son essai de 1987 Le rectum est-il une tombe ? Dans ce texte, l’auteur rompt avec une lecture optimiste qui glorifie les effets libérateurs d’une identité sexuelle pour rejoindre une approche qui voit l’individu « défait », plutôt que complété, par la sexualité. Ce que Bersani appelle l’« inestimable valeur du sexe » correspond à sa capacité « anti-communautaire, anti-égalitaire, anti-éducati[ve], anti-amoureu[se] »8 ([1987] 1998, p. 60). Leo Bersani s’oppose à ce qu’il nomme la « réinvention rédemptrice du sexe » en proposant à la place la thèse selon laquelle le sexe provoquerait une forme d’« aversion »9 (p. 58 et p. 14). Le théoricien refuse que le sexuel consiste en un espace de plaisir purement bienfaisant et, à travers sa lecture de Sigmund Freud, considère que le sexuel correspond à la « jouissance d’une dissolution des limites » et à une « souffrance extatique »10 (p. 65). Dans sa lecture de Bersani, Robyn Wiegman situe ce dernier au tournant d’une nouvelle question que la négativité queer continue d’irriguer :
La sexualité est-elle principalement une forme de solidification sociale […] ou est-elle le locus du désordre du social, le lieu où le concept même du « social », tout comme la composition des sujets qui le constitueraient, se font avoir par les fictions de la cohérence qui, autrement, les entretiendraient ?11 (Wiegman, 2017, p. 220 ; notre traduction.)
10Que ce soit dans Saute ma ville ou ailleurs dans son œuvre, Akerman ne propose pas de résolution ou d’affirmation quant à l’identité ou la sexualité. Ces représentations sont plutôt situées par rapport à la deuxième proposition de Wiegman : elles apparaissent comme « le locus du désordre du social ». Saute ma ville démontre cette thèse avec d’autant plus de force : la dédicace « pour Claire » ne précède pas une histoire d’amour conventionnelle, mais introduit une série d’actes destructeurs et suicidaires qui finissent par mettre fin au social à tout jamais. En cela, cette « histoire d’amour » résonne avec la contribution d’Edelman, qui puise dans la théorie lacanienne afin de consolider sa thèse selon laquelle « [l]a queerité ne peut jamais définir l’identité, elle ne pourra toujours que la dérégler »12 ([2004] 2016, p. 28). Par « dérégler », Edelman entend un sens proche du terme de Bersani, qui est celui de « dissolution » : en effet, il décrit le queer comme « le lieu de la pulsion de mort de l’ordre social »13 ([2004] 2016, p. 10).
11La pulsion de mort, pour Edelman, désigne ce qui « dissout les scléroses de l’identité qui nous permettent de nous connaître et de survivre tel.le.s que nous sommes »14 ([2004] 2016, p. 28). En refusant de « survivre tel.le.s que nous sommes » – car Edelman refuse que l’individu puisse accéder à une connaissance de soi –, le queer selon Edelman accepte toutes les incohérences, les contradictions, la vulnérabilité et la mortalité qui définissent l’individu et ses rapports (à lui-même, à sa sexualité, à l’autre). Le queer représente la « dissolution » de ce qui est prétendument stable. Dans la mesure où il est porteur du refus de « survivre », Edelman considère que le queer s’établit contre la reproduction du futur puisqu’« il ne peut y avoir de futur pour les queers »15 ([2004] 2016, p. 44). Lee Edelman nomme la promesse du futur « l’Enfant », cette figure inexistante mais symboliquement signifiante sur laquelle la société occidentale et capitaliste est fondée et contre laquelle le queer s’établit (2004, p. 13). Dans la continuité de la pensée d’Edelman, la pulsion de mort devient une pulsion queer.
12Comme nous pouvons le voir dans les théories de Bersani et d’Edelman, l’une des contributions les plus significatives de la branche « négative » de la pensée queer est l’insistance sur l’irrésolution et le manque de finalité. Lee Edelman traduit l’argument lacanien selon lequel « il n’y a pas de rapport sexuel » par la « résist[ance] à l’impératif de résoudre l’antagonisme structurel du symbolique »16 (Berlant et Edelman, 2013, p. 1-2 ; notre traduction). Le film d’Akerman partage ce refus de toute forme de « résolution » et construit ainsi un récit axé sur l’improductivité, l’échec et l’illisibilité, surtout en ce qui concerne l’« histoire d’amour » « pour Claire »17. Jean-Luc Nancy reformule la remarque de Lacan ainsi : « [L]e sexuel de tout rapport (langagier, social, affectif, esthétique) se trouve dans sa dimension d’inaccomplissement. Il y a sexe là où il n’y a pas production, résultat, position d’un terme quelconque. » (2006, p. 33-34, italiques de l’auteur.) Il s’agit d’une explication qui décrit parfaitement la situation présentée dans Saute ma ville dans la mesure où celle-ci insiste sur l’« inaccomplissement » des actes et où elle semble traiter de manière indirecte l’« histoire d’amour ». Au lieu de montrer une relation amoureuse ou sexuelle entre femmes, le film propose une vision pessimiste de l’« émancipation » sexuelle : dans cette histoire d’amour, elles ne vécurent pas heureuses et n’eurent pas beaucoup d’enfants.
13Jean-Luc Nancy démontre que Lacan, au lieu de situer le rapport sexuel comme purement négatif, lui attribue un rôle (de ce qui n’est rien, de ce qui ne produit rien). C’est cette notion qu’Edelman reprend lorsqu’il propose que le terme « queer » occupe cette place du « non […], l’espace dans lequel une telle négativité a lieu, toujours »18 (Berlant et Edelman, 2013, p. 36-37, italiques de l’auteur ; notre traduction). Dans la suite de sa production théorique, publiée sous le titre de Bad Education, Edelman démontre en quoi le terme « queer » n’est pas un espace purement nihiliste (2023, p. 2-3, p. 43, p. 195, p. 254). Ainsi, pour mettre Akerman et Edelman en dialogue, « malgré tout », malgré cette négativité, malgré cette apparence de refus, c’est ici que l’histoire d’amour apparaît, simultanément révélée et recouverte par les mots « pour Claire ». Nous allons voir en quoi cette « histoire d’amour » s’écarte d’une représentation idéalisée afin de mobiliser la négativité queer à deux niveaux : en tant qu’histoire d’amour qui queerise la représentation de l’idéal du « couple » et en tant qu’histoire d’amour dans laquelle le désir « pour Claire » provoque le désordre.
Une « histoire d’amour » queerisée : contourner « l’obligation du plaisir »
14Saute ma ville raconte son histoire d’amour à travers deux écrits : les mots « pour Claire » avec lesquels le film commence et la lettre que la protagoniste trouve dans sa boîte aux lettres. Ces écrits ne sont pas facilement lisibles. Saute ma ville peut sembler une étrange « histoire d’amour » : la dédicace est couramment oubliée dans la littérature existante consacrée au contenu du film. La lettre que la protagoniste reçoit n’est jamais montrée clairement à la caméra bien que les pages floues apparaissent deux fois : l’espace d’un instant lorsqu’elle les transperce avec la poignée du placard et à la fin du film lorsqu’elle les brûle, détruisant la lisibilité du contenu, l’objet de la lettre et la relation que cet objet représente. En affichant la lettre de manière qu’elle en soit trouée, la protagoniste montre, paradoxalement, l’importance de cette relation jusqu’au point de la détruire. Un détail est visible pourtant : Marion Schmid observe que le nom « Chantal Akerman » apparaît sur l’enveloppe de cette lettre, qui « deviendra l’instrument de son auto-destruction » (2022, p. 58). En effet, dans les dernières minutes du film, la protagoniste retire la lettre de la poignée, soulève les fleurs et les emporte hors champ. Nous découvrons plus tard qu’elle a collé les pages au-dessus de la gazinière. Il devient évident que la lettre est significative parce que sa dernière action est de la brûler, avant de mimer le suicide, accompagnée dans le plan par les pages roussies et les fleurs qu’elle tient à la main. Dans la mesure où la lettre représente la relation à l’autre, c’est « Claire » qui « devien[t] l’instrument d[’]auto-destruction » de la protagoniste.
15Cette fin attribue une importance démesurée à la lettre ainsi qu’à celle qui l’a écrite. En effet, les fleurs et la lettre, des signes amoureux, accompagnent le geste suicidaire de la protagoniste. Janet Bergstrom écrit que le film « se termine par un geste romantique qui, à [s]on avis, n’a d’équivalent dans aucun des films ultérieurs d’Akerman »19 (2003, p. 104 ; notre traduction). L’autrice lit le film à travers la relation entre Akerman et sa mère, une femme juive polonaise qui est revenue des camps, en soutenant qu’il s’agit « en quelque sorte [d’]une lettre d’amour, mais aussi […] [d’]un cri de désespoir et [d’]une demande d’attention »20 (2003, p. 103 ; notre traduction). Notre analyse ne se situe pas tant en opposition à celle de Bergstrom qu’en complément : notre objectif est d’apporter une lecture de l’histoire d’amour qui est souvent mise de côté et qui est pourtant inscrite dès l’ouverture du film. Le « geste romantique » de ce film se matérialise à travers la fin malheureuse à laquelle le récit condamne l’histoire d’amour « pour Claire ». Saute ma ville refuse de conclure sur l’idée qu’un individu peut être comblé par l’amour ou par la cohérence d’une identité sexuelle.
16En parlant du film Je, tu, il, elle (1974), tourné six ans plus tard, Akerman explique les raisons pour lesquelles elle montre la violence dans une relation amoureuse entre femmes. Elle affirme que « si c’est violent, c’est parce que c’est une relation passionnée et une relation contradictoire »21 (Akerman et Martin, 1979, p. 40 ; notre traduction). Tandis que, dans Je, tu, il, elle, Akerman met en scène les deux amantes, dans Saute ma ville, l’absence de l’objet d’amour – la mystérieuse « Claire » – déplace notre attention sur les objets et sur le déroulé du film, dans lesquels la « violence » de la relation est transposée. Le rapport à ces objets est « violent » et « passionné ». La lettre est à la fois affichée comme un document important et déchiré par ce même acte. La protagoniste se nourrit avant de se saboter en se couvrant le visage d’un produit alimentaire. Elle sollicite les différentes fonctions de la cuisine mais simultanément inonde celle-ci, la brûle et la fait sauter. Les usages inhabituels que le spectateur découvre peuvent être lus comme des manières queers de concevoir sa place par rapport aux objets et aux autres, ce que Sara Ahmed a théorisé sous le terme d’« usage impropre [improper use] » : ces rapports queers qui sont en décalage avec un « bon » rapport ou un rapport « approprié » ([2018] 2024, p. 38). En priorisant ces relations non productives aux objets, la protagoniste indique sa préférence pour ces rapports qui n’ont pas d’objectif, qui sont « crooked », « de travers », voire ces rapports qui nuisent.
17En effet, l’histoire d’amour qu’Akerman propose dans Saute ma ville est caractérisée par la contradiction et l’ambivalence. Dans son texte Love/Desire, Lauren Berlant remet en cause la véracité de ces histoires d’amour qui représentent le rapport amoureux comme une relation qui comble et qui produit l’« épanouissement » de l’individu :
Ces versions de l’amour ont tendance à renier l’ambivalence érotique et établissent à la place un récit d’amour – une séquence temporelle dans laquelle l’antagonisme érotique ou l’angoisse est surmonté par des évènements qui mènent à l’épanouissement.22 (Berlant, 2012, p. 24 ; notre traduction.)
18Dans Saute ma ville, Akerman refuse de mettre en scène ce type de « récit d’amour ». Au contraire, c’est un récit très étrange – l’une des significations portées par le terme « queer » – qu’Akerman propose, une histoire d’amour qui conserve toutes les contradictions, incohérences, affects négatifs et autodestructeurs du désir sans les faire passer en une image lissée et idéalisée de la réciprocité amoureuse. La promesse d’un terrain partagé est tout de suite refusée par le fait que Claire – un prénom, pas une personne – n’apparaisse pas dans ce récit. L’« ambivalence » et l’« antagonisme » sont conservés dans les actes de la protagoniste qui alternent entre absurdité et intentionnalité, comme s’il s’agissait, dans Saute ma ville, d’une transposition de l’érotique en désordre domestique. L’angoisse n’est clairement pas « surmontée » dans ce récit d’amour où l’« épanouissement » ne vient pas, si ce n’est par la mort et par le fait de tout détruire en faisant sauter l’appartement. Akerman dépeint la manière dont l’amour peut être aussi destructeur que le désir – ou, du moins, elle montre que les deux sont à l’origine d’« effets troublants [unsettling effects] » qui voient l’individu, au mieux, affecté, ou, au pire, détruit (Berlant, 2012, p. 90 ; notre traduction). En représentant l’objet d’amour comme un objet qui a la capacité négative de nuire, de détruire, Akerman propose une histoire d’amour dans laquelle l’autre femme n’est pas assimilée au sein de l’idéal que serait le « couple », mais reste toujours représentative d’un danger pour l’indépendance de l’individu. Au lieu d’instaurer l’autonomie de la protagoniste, Akerman met en avant sa vulnérabilité dans cette histoire d’amour qui ne recule pas devant les traumas qui l’environnent, mais, comme nous le verrons, les place au centre du récit. Le film illustre l’« antagonisme » et l’« ambivalence » de l’histoire d’amour qui crée du désordre dans la vie quotidienne. Dans Saute ma ville, Akerman montre en quoi le désir et l’amour détruisent toute image de stabilité ou cohérence et laissent la protagoniste avec rien d’autre qu’une lettre, des fleurs, une cuisine désordonnée et, à la fin du film, rien du tout.
19Il convient de rappeler cette remarque d’Akerman à propos de Jeanne Dielman : « lutter contre le plaisir est la résistance de Jeanne, c’est sa manière d’exister, sa jouissance par rapport à l’obligation du plaisir » (Lebovici et Akerman, 2011-2012, § 22 ; notre traduction). Il existe quelque chose de très queer dans l’idée qu’il faudrait « lutter contre le plaisir », tout comme le fait de refuser « l’obligation du plaisir » (nous soulignons). En effet, ce qu’Akerman appelle la « résistance » de Jeanne devient une manière par laquelle l’artiste refuse la résolution, la continuité et la productivité. Il en est de même dans Saute ma ville, où Akerman met en scène une série de « résistances » : à la logique de la cuisine, à Claire, et, enfin, à la vie. Par le fait d’associer cette « résistance » à la « jouissance », le discours d’Akerman résonne avec une lecture lacanienne. Selon Lacan, la jouissance est ce qui doit être repoussé, car meurtrière, et pourtant elle est continuellement recherchée par l’individu. La psychanalyste Silvia Lippi explique cela clairement dans l’extrait suivant :
Le désir, partagé entre le désir de l’Autre et ce qui lui fait obstacle, représente pour le sujet la barrière de la jouissance en même temps que la voie d’accès à cette dernière. C’est le caractère paradoxal du désir qui le fait échapper à tout contrôle, qui le fait basculer dans la catégorie de l’impossible, qui montre les failles de la logique. (2013, p. 25.)
20Ce « paradoxe » qu’est le désir est mis en avant dans Saute ma ville, où le déroulé d’actes dans la cuisine évoque ce qui « échappe à tout contrôle », ce qui « bascule dans […] l’impossible » et ce qui « montre les failles de la logique ». Cela se voit dans les objets qui tombent du placard, l’eau versée de partout, les tâches ménagères irréalisées et la tentative de contrôler la fuite – d’eau, de gaz, ce qui semble symboliser de manière sinistre ce qui est refoulé, l’irrépressible. En fait, il est possible de lire tous ces gestes comme une manifestation de la tentative paradoxale de contrôler ce qui ne peut qu’être désordonné et ce dont la protagoniste tente d’empêcher le débordement. Il est aussi possible de tisser des liens entre la nécessité de l’obstacle dans le désir et le fait que la protagoniste crée des distances avec l’objet d’amour : d’abord par la porte, définitivement fermée et par laquelle rien ne doit déborder, ensuite par l’acte de brûler la lettre, indicateur de son refus d’y répondre et, enfin, par l’acte de se suicider, qui établit la protagoniste comme éternellement inaccessible, à jamais « basculée dans la catégorie de l’impossible ». Autrement dit, il est question de mettre en place des obstacles, une « barrière » qui protège l’individu contre la jouissance. Comme l’affirme Lippi, cette barrière est le désir. De cette manière, Akerman met le désir au centre de Saute ma ville.
Désordre dans la répétition
21Une scène de Saute ma ville est incluse dans l’autoportrait vidéo Chantal Akerman par Chantal Akerman (1998), où l’artiste diffuse une série d’extraits de son œuvre. La scène de Saute ma ville choisie est celle où la protagoniste cire ses chaussures de plus en plus vigoureusement jusqu’à atteindre la jambe et le genou. L’image qui la précède montre Jeanne en train de cirer soigneusement les chaussures de son fils. Alisa Lebow commente l’ordre des images en écrivant que « l’enfant [Akerman] canalise les gestes de la mère et se les approprie, extériorisant par ses actes l’hystérie absolue qui est masquée par les gestes extrêmement contrôlés de la mère »23 (2016, p. 57 ; notre traduction). Selon Lebow, l’organisation des séquences fait que les gestes d’Akerman représentent « une extension de l’acte, menée à sa conclusion logique, ou illogique »24 (2016, p. 57 ; notre traduction). Cette configuration est en effet plutôt « illogique » : le choix de positionner cette séquence après celle de Jeanne indique le fait que la répétition ne correspond pas à l’image précédente.
22Freud comprend la répétition comme une tentative de maîtriser et de se réapproprier les rapports traumatiques : elle permet à l’individu de prendre la position de sujet dans les histoires où il a auparavant été objet ([1920] 1990, p. 54). Par conséquent, la reconstitution de scènes familières peut être une manière par laquelle l’individu se confronte au sens traumatique qui leur était attribué auparavant. Dans le film Jeanne Dielman, Ivone Margulies remarque que les répétitions – ou, précise-t-elle, les images que l’on pense voir se répéter – créent une « accumulation progressive en tant que différence [progressive accumulation as difference] » (1996, p. 144 ; notre traduction). Autrement dit, le fait de regarder le même geste se répéter encore et encore rend le spectateur sensible aux différences. En ce sens, la répétition de gestes de la part de la protagoniste dans Saute ma ville peut être une manière de désorganiser – plutôt que de reproduire – ce qui venait auparavant.
23Il s’agit ainsi d’une répétition queerisée, modifiée, corrompue. La reconstitution de la même scène démontre que la protagoniste de Saute ma ville ne réussit pas cette répétition. Tandis que le geste de Jeanne s’inscrit dans une démarche (re)productive – elle cire les chaussures de son fils qu’elle « vit pour servir [lives to serve] » (Lebow, 2016, p. 57 ; notre traduction) –, la protagoniste de Saute ma ville glorifie l’inutilité obstinée de son geste et sa dissemblance comparée avec celui de la mère. Silvia Lippi écrit : « la répétition apporte du changement, de l’inattendu » (2013, p. 198). C’est exactement ce que cette deuxième représentation du geste nous montre. La reconstitution de la scène révèle à quel point la deuxième image s’établit contre l’organisation de la cuisine comme lieu de productivité. Dans la cuisine, la protagoniste de Saute ma ville vide les gestes de leur sens et de leur but habituel : la lettre est trouée plutôt que lue, les poêles sont jetées par terre plutôt qu’utilisées, l’eau noie le sol plutôt que de le laver et le gaz sert à tuer plutôt qu’à faire à manger. Cette référence ne passe pas inaperçue : Bergstrom remarque que dans Saute ma ville Akerman « choisit le gaz pour se tuer [chooses gas to kill herself] » (2003, p. 103 ; notre traduction). Freud estime que la répétition peut être une manière de se confronter aux traumas et il est difficile de ne pas lire ce geste comme une tentative de la part d’Akerman de se confronter à l’Histoire.
24À la lumière du premier extrait de Jeanne Dielman, les images tirées de Saute ma ville prennent tout leur sens. Elles représentent l’impossible réconciliation avec l’utilité du geste de Jeanne. Elles définissent une force queer résolument associée au refus de « “se battre pour les enfants” [“fight […] for the children”] » (Edelman, [2004] 2016, [p. 3] p. 9) – un argument d’autant plus choquant que la protagoniste jouée par Akerman est à peine majeure. Il est question non pas de prendre l’argument d’Edelman à la lettre – « l’Enfant » n’existe pas –, mais plutôt de considérer la possibilité qu’une telle approche complexifie la période appelée « enfance », en soulignant que celle-ci n’est pas non plus exemptée de traumatismes. Cette proposition prend tout son sens lorsqu’on prête attention aux discours d’Akerman qui elle-même considère qu’elle est « né[e] vieil enfant » à cause de l’héritage de la Shoah ([2013] 2021, p. 41). Le texte autobiographique duquel cette expression est tirée, Ma mère rit, témoigne d’une résistance au fantasme selon lequel l’enfance constituerait un lieu privilégié ou innocent. La répétition de cette séquence où les deux protagonistes cirent des chaussures représente l’impossibilité de reproduire ce que la mère a fait avant elle. En effet, Akerman affirme qu’« un vieil enfant ne fait pas d’enfant » ([2013] 2021, p. 41). Dans Saute ma ville, et plus généralement dans l’œuvre d’Akerman, le queer représente un espace permettant d’échapper aux obligations maternelles et familiales. Il permet à la protagoniste de détruire la cuisine, de ne pas correspondre à sa logique, de résister à son ordre. En même temps, il constitue une force destructrice et non pas quelque chose de désirable.
25Enfin, c’est à travers la répétition échouée du geste de la mère que la protagoniste dans Saute ma ville s’établit comme sujet désirant. Cette protagoniste qui ne réussit pas à répéter le geste de la mère, qui ne priorise pas l’Enfant, rencontre la jouissance que le queer, selon Edelman, « incarn[e] [embod[ies]] » ([2004] 2016, [p. 25] p. 38). Il faudrait peut-être lire la fin du film non pas comme un suicide réel, mais comme la suite logique de cette rencontre avec la jouissance meurtrière. Vu de cette manière, le film représente un sujet qui découvre ce que Bersani nomme la « jouissance d’une dissolution des limites ».
26La manière dont Akerman comprend le terme « queer » démontre qu’elle s’intéresse aux usages s’appuyant sur le « faire » plutôt que sur l’« être ». Cette approche résonne avec la position antiproductive prise par la négativité queer et, notamment, par la théorie d’Edelman qui constitue un cadre fructueux permettant de relire le récit Saute ma ville à travers ses effets destructeurs. La négativité queer ressort dans ce film qui refuse de raconter une « histoire d’amour » conventionnelle, renverse la fonction productive de la cuisine et mobilise des répétitions destructrices. Ces forces négatives axées sur la désagrégation et la perturbation, plutôt que sur l’épanouissement, caractérisent le queer dans ce film et plus largement dans l’œuvre d’Akerman. La sexualité telle qu’elle apparaît dans l’œuvre d’Akerman joue un rôle clé dans cette démarche : elle ne permet pas d’affirmation positive de soi, elle n’est pas non plus productive et, comme l’approche d’Edelman, elle sabote l’affirmation d’une identité fixe ou lisible. Notre lecture s’est intéressée principalement à la manière dont le paradoxe et l’absence permettent au queer de ressortir à travers ce court-métrage, où les effets meurtriers de la jouissance l’emportent sur la dimension utopique. Sont peut-être seuls dignes d’intérêt dans cette histoire d’amour la fin malheureuse, l’échec relationnel et le désir destructeur.