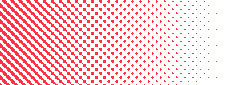Devenir pages roses
1Les amoureux des dictionnaires, les passionnés d’Astérix ou les inconditionnels d’Acta fabula sont certainement familiers d’une rubrique un peu délaissée aujourd’hui : les pages roses du Petit Larousse, qui se présentent depuis leurs origines, avec le Nouveau Dictionnaire de la langue française de Pierre Larousse paru en 1856, comme un florilège de citations ou de locutions principalement latines, dûment traduites et paraphrasées. Présentes dans toutes les éditions du Petit Larousse illustré de 1906 à nos jours, les pages roses représentent en quelque sorte la mémoire spectrale de la littérature et de la culture antiques pour un locuteur francophone qui les aurait oubliées ou ignorées : bribes de grands auteurs latins (grecs parfois), expressions lexicalisées, formules consacrées par l’usage juridique ou religieux… Avec les rubriques qui se sont ajoutées à ces pages au fil du temps (les proverbes à partir de 1980, les mots historiques depuis le début de ce siècle), le lecteur peut avoir le sentiment de disposer d’une sagesse des nations portative, ou du moins d’un répertoire des lieux communs de la culture française.
2Songer à un éventuel devenir-pages-roses de la littérature de langue française, voilà qui pourrait en quelque sorte caractériser la perspective de ce trentième numéro de Fabula-LhT. Dans ce devenir-pages-roses, on peut voir un processus de réduction de la mémoire littéraire : celui par lequel les textes du canon se désagrègent en un ensemble de citations, de références ou de clins d’œil qui irriguent les discours sociaux pour y figurer autant de synecdoques de la culture littéraire. Mais la réduction ne signifie pas nécessairement la perte – et le devenir-pages-roses peut aussi s’interpréter comme un processus de transmission de la mémoire littéraire, où une simple expression suffit à renvoyer à une œuvre entière ou à la figure d’un auteur : je dis « roseau pensant » et, hors de l’oubli où les a reléguées ma lecture ancienne, miraculeusement se lèvent les Pensées de Pascal.
La notion de formule
3À la confluence de la littérature, de la langue et du discours circulent ainsi des expressions marquées du sceau du déjà-lu, du déjà-dit ou du déjà-entendu, et qui donnent plus largement le sentiment de participer, plus ou moins familièrement, à une culture commune. Ainsi se dessine un terrain propice à l’étude des clichés et des stéréotypes (Amossy et Herschberg-Pierrot, 2021), des lieux communs (Plantin, 1993), du figement lexical (Anscombre et Mejri, 2011), des petites phrases (Krieg-Planque et Ollivier-Yaniv, 2011) ou encore des phrases sans texte (Maingueneau, 2012). Mais ce qui est plus précisément en jeu dans ce numéro de Fabula-LhT, c’est une interrogation sur la capacité des citations ou des expressions littéraires à se fondre dans la langue et dans les discours. Il s’agit, autrement dit, d’aborder la littérature comme un discours aux prises avec l’interdiscours social1, un discours ouvert et poreux qui échange avec les discours politiques, médiatiques, journalistiques, scientifiques, religieux, philosophiques ou ordinaires, des mots et/ou des expressions plus ou moins figés, ces récurrences discursives fonctionnant à la fois comme clins d’œil, points de ralliement et lieux de débat.
4À ce titre, la notion de « formule » telle qu’elle a été définie en analyse du discours paraît tout à fait pertinente. Voilà pourquoi nous avons choisi de consacrer ce dossier à la « littérature en formules », c’est-à-dire à la capacité du discours littéraire à diffuser des formules dans les discours sociaux, et réversiblement à recycler des énoncés tout faits.
5Mais qu’est-ce au juste qu’une formule ? La réponse revient ici à Alice Krieg-Planque (2009), qui a fait de ce terme un concept pleinement opératoire en analyse du discours, en le présentant comme
[...] un ensemble de formulations qui, du fait de leurs emplois à un moment donné et dans un espace public donné, cristallisent des enjeux politiques et sociaux que ces expressions contribuent dans le même temps à construire. (p. 7)
6Caractérisée par son figement (elle se stabilise), sa réduction (elle permet d’abréger), son caractère discursif (elle fonctionne en discours, elle en est l’outil et le produit), sa capacité à devenir un référent social (elle est partagée par une communauté d’acteurs) et sa dimension polémique (elle fait l’objet de débats, de négociations et de reformulations souvent stratégiques), la formule permet de repérer des ensembles discursifs qui, pour un temps au moins, fonctionnent sur le mode du dialogue et/ou du conflit, instituant ainsi un type autant qu’un objet de discours.
7Dominique Maingueneau aborde aussi ce phénomène à travers la notion de « surassertion » (2004), qui intervient lorsqu’un énonciateur prélève un fragment dans un texte-source (une phrase, le plus souvent), le reconfigure afin d’accentuer son degré de généralité et l’exhibe dans son propre discours comme argument d’autorité.
Les formules littéraires : du livre à l’agora
8Les formules littéraires se distinguent volontiers par leur composition : il s’agit souvent de petites phrases ou de groupes infinitifs, là où l’analyse des discours politiques ou médiatiques s’occupe plutôt de substantifs ou de syntagmes nominaux réduits (« purification ethnique », « fracture sociale », « mondialisation »). On pourrait à cet égard ranger les formules littéraires parmi les énoncés qu’A. Krieg-Planque décrit comme des « figements d’ordre mémoriel » (2009, p. 66), qui correspondent à des expressions toutes faites ou à des combinaisons phrastiques transmises culturellement, comme les slogans et les petites phrases.
9De fait, certaines formules ont pu traverser, voire durablement marquer la littérature, jusqu’à devenir des référents sociaux ou des lieux communs dont l’origine compte finalement moins que l’usage : « odi profanum vulgus », « écraser l'infâme », « science sans conscience », « willing suspension of disbelief », « je ne te hais point », « le petit chat est mort », « le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas »… Autant d’énoncés dont la fortune a largement dépassé les lectorats respectifs de leurs auteurs originaux.
10Pour s’en tenir à un seul domaine, le genre poétique fournit par exemple toute une série de formules littéraires qui sont entrées dans la phraséologie de discours critiques, polémiques, politiques ou philosophiques : « écrire un poème après Auschwitz », « la poésie doit être faite par tous », « Je est un autre2 », « habiter poétiquement le monde3 », « un bon poète n’est pas plus utile à l’État qu’un bon joueur de quilles4 »… Remarquons en passant que ces exemples incitent précisément à penser l’articulation de la pratique, de l’éthique et du poétique, ce qui infirme l’idée d’une séparation tranchée entre le champ littéraire, le débat politique et l’opinion publique : de telles formules représentent peut-être, de ce point de vue, le signal même de l’intersection entre la Cité et la République des Lettres.
11Ces quelques exemples suggèrent également combien peut s’exercer une capillarité entre la littérature et différents types de discours qui lui servent alors de chambre d’échos. Capillarité d’autant plus puissante qu’une formule littéraire se révèle chargée d’implications politiques : tel est le cas de « La poésie doit être faite par tous », phrase qui a très vite été associée par les avant-gardes à l’idée d’un communisme du génie, d’une abolition de la propriété littéraire, d’une collectivisation du travail poétique ou d’une éducation culturelle du peuple5. Cette capillarité est exemplairement illustrée par la circulation, la reprise et parfois la dilution de références littéraires dans le discours social, médiatique ou politique — particulièrement en France où les responsables politiques se parent volontiers d’un vernis lettré. Ainsi, en 2021, le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure critiquait « l’insoutenable légèreté » du président de la République face aux morts du Covid, tandis que Jean-Luc Mélenchon, alors président du Parti de Gauche, affirmait en 2010 être « le bruit et la fureur », syntagme qui lui est encore associé.
12Dès lors, même si la circulation d’une formule se fait au prix de surinterprétations, de déformations, de trahisons du texte original, et même de tentatives d’instrumentalisation du texte littéraire au profit de causes hétéronomes, ce sont précisément ces mécanismes qui sont significatifs. Une formule se construit au fil de ses décontextualisations et de ses recontextualisations, s’enrichit d’interprétations diverses voire contradictoires, et devient le marqueur d’un débat dont les enjeux dépassent bien souvent le cadre littéraire. Mais à travers un bref énoncé, c’est parfois toute l’évolution du rôle social de la littérature qui peut être étudiée.
Une mémoire en devenir
13Ainsi les formules convoient à leur insu des discours référés à une mémoire à court, moyen ou long terme. Tout en prenant part à un débat contemporain dont il s’agit de redéfinir les termes, les usagers des formules littéraires font référence à une histoire ou à une tradition dans laquelle ils s’inscrivent pour se légitimer ou au contraire pour se prévaloir de leur radicale nouveauté. En ce sens, les formules littéraires font appel à la notion de « mémoire discursive », élaborée en analyse du discours politique par Jean-Jacques Courtine à partir des travaux de Michel Foucault, et selon laquelle « toute formulation possède dans son “domaine associé” d’autres formulations, qu’elle répète, réfute, transforme, dénie…, c’est-à-dire à l’égard desquelles elle produit des effets de mémoire spécifiques » (Courtine, 1981, p. 52), et qui peuvent convoquer le temps long de l’Histoire. Cette notion a été retravaillée par Sophie Moirand dans son ouvrage sur Les Discours de la presse quotidienne (2007), qui soutient que les discours médiatiques ne sont pas des énoncés éphémères, mais qu’ils sont au contraire devenus « un lieu de construction des mémoires collectives des sociétés actuelles » (p. 2). À l’appui de son analyse, elle convoque le dialogisme de Bakhtine et l’idée que les mots eux-mêmes ont une mémoire, façonnée par leur constant dialogue avec ceux des siècles passés et leur interaction avec la parole d’autrui. Forgée dans la perspective des discours d’actualité, cette approche s’avère particulièrement appropriée à la réception des formules littéraires, qui convoquent la mémoire parfois cumulative des dits et des écrits antérieurs, qu’elle soit consciente ou non, affichée ou intériorisée.
14Sur le long terme, la formule participe de ce que Dominique Maingueneau et Frédéric Cossutta appellent les « discours constituants » (1995). La formule du discours constituant se pose « en surplomb » des autres paroles, mais dans le même temps participe aux échanges. Initialement issus de la littérature, de la religion, de la science, de la philosophie, les formules comme les discours constituants s’immiscent dans les discours politiques ou médiatiques. La surmédiatisation contemporaine, ainsi que l’exacerbation de l’espace public provoquée par les espaces numériques, semblent aujourd’hui mettre sur un pied d’égalité les formules et les discours constituants provenant de sources multiples : littéraires, officielles, citoyennes, etc. La définition même de la formule littéraire pourrait donc être remise en discussion, dans le contexte d’une confusion des genres discursifs.
15Il n’en reste pas moins que la réception des formules littéraires n’a rien de prévisible : certaines ne durent que le temps d’une saison puis tombent dans l’oubli, tandis que d’autres réussissent à s’imposer, jusqu’à devenir des proverbes ou des séquences figées. Cette réception, du reste, se comprend bien plutôt comme un usage ou un recyclage : les formules entrent dans des stratégies argumentatives, elles participent de la constitution d’une identité narrative, et peuvent constituer un ingrédient de choix pour le storytelling (Salmon, 2007). À cet égard, elles doivent être appréhendées dans leurs enjeux rhétoriques et communicationnels. Mais la formule littéraire a sans doute ceci de spécifique que son efficacité provient aussi de son inventivité, de sa capacité à ressaisir le réel sous le prisme d’une métaphore vive, pour reprendre le titre de Paul Ricoeur. Cette réinvention participerait ainsi d’une « manipulation de la vérité » selon Patrick Charaudeau (2020), mais sous la forme d’un « mentir-vrai » tel qu’Aragon le pratique.
16Telles sont les considérations, issues de l’analyse du discours, qui ont guidé la préparation de ce numéro consacré à « La littérature en formules ». Les différentes contributions qui le constituent sont issues de chercheurs et de chercheuses travaillant sur différents siècles et avec des approches relevant de l’histoire littéraire, de l’histoire des idées, de la stylistique, de la linguistique ou de l’analyse de discours. Elles adoptent un format varié, les unes analysant une formule précise, les autres proposant une enquête plus large à partir d’une œuvre ou d’un auteur. Elles se répartissent en trois grands temps, chacun développant un aspect particulier des formules littéraires.
De la littérature à la langue
17La première partie de ce numéro examine le fonctionnement des formules littéraires en allant de la littérature à la langue. Elle se focalise sur l’interaction entre langue et discours littéraire. D’un côté en effet, celui-ci contribue, à travers la circulation de formules, au figement d’énoncés et à leur lexicalisation ; en retour, les œuvres littéraires présentent volontiers des tentatives de défigement et de remotivation d’énoncés stéréotypés.
18En ouverture, Marc Escola nous invite à un voyage en compagnie de Molière et à bord de la fameuse galère évoquée par Géronte dans Les Fourberies de Scapin. Réplique devenue très tôt populaire et proverbiale, « Qu’allait-il faire dans cette galère ? » a circulé depuis le xviie siècle dans des contextes littéraires aussi différents qu’inattendus, et il n’est pas jusqu’à l’emploi figuré de galère et galérer qui ne semble en avoir gardé le souvenir. Cette popularité et cette plasticité laissent néanmoins dans l’ombre les origines possibles de l’expression, sur lesquelles M. Escola enquête également. À son tour, l’article de Françoise Rubellin s’intéresse aux origines d’une expression lexicalisée : tomber amoureux, que les dictionnaires du xviiie siècle imputent comme un néologisme à Marivaux, mais qui apparaît en réalité dans le théâtre de Regnard dès la fin du xviie siècle. À travers cet exemple d’une métaphore devenue catachrèse, Fr. Rubellin interroge aussi les méthodes d’investigation lexicologiques et les possibilités – ou les limites – induites par l’exploration d’immenses corpus textuels numérisés. Avec l’étude que Jérémie Alliet consacre à quand même chez Balzac, on assiste à une lexicalisation exemplaire dont La Comédie humaine est à la fois le produit et l’outil : alors que cette locution adverbiale est originellement une conjonction de subordination à valeur concessive (analogue à quand bien même ou à même si), et alors qu’elle est issue du discours de l’aristocratie légitimiste française qui accepte du bout des lèvres la Monarchie de Juillet, Balzac va populariser le syntagme quand même en contribuant à lui donner son sens contemporain. Concluant cet aller-retour entre langue et discours littéraire, Laetitia Gonon montre, à partir d’une méthodique étude de corpus, comment le xixe siècle français s’est approprié le to be or not to be de Shakespeare. Romans, poésie, correspondances, journaux, chroniques théâtrales, économiques ou politiques : la formule, traduite ou non, et souvent adaptée, apparaît dans tous ces types de discours, perdant peu à peu son statut de référence littéraire pour devenir un topos argumentatif (l’évocation d’un dilemme) voire un poncif dont l’époque prend d’ailleurs souvent une conscience parodique.
La littérature comme mémoire des discours
19Un deuxième ensemble d’articles s’intéresse à la littérature comme mémoire des discours. Il s’agit de comprendre comment les œuvres littéraires, dans une perspective diachronique, contribuent à la transmission de stéréotypes et au façonnement d’une mémoire discursive qui sert souvent de cadrage ou de présupposés aux débats sociaux et médiatiques.
20Remontant à l’Antiquité latine, Thomas Murphy montre combien la formule « homo sum… » de Térence s’est retrouvée, dès Cicéron et jusqu’à la Renaissance, employée dans des contextes philosophiques et religieux éloignés de sa portée comique initiale, mais qui renouvellent la réflexion sur l’humanisme. C’est encore d’une réplique théâtrale qu’il est question dans l’article de Charline Granger : « C’était pendant l’horreur d’une profonde nuit », qui ouvre le songe d’Athalie dans la pièce de Racine. À partir du xviiie siècle et jusqu’à aujourd’hui, la formule circule au théâtre, dans les chroniques, dans la presse, dans les chansons, avec des reprises sérieuses et d’autres franchement parodiques, mais qui toutes essaient de retenir de l’intertexte racinien ses effets émotifs et dramatiques. Une trajectoire assez similaire se dégage de l’étude que Tsoyag Paloyan consacre au parallèle établi par La Bruyère entre Corneille (censé peindre « les hommes tels qu’ils devraient être ») et Racine (qui, lui, « les peint tels qu’ils sont »). Le destin de cette formule est paradoxal : tout en faisant florès dans l’enseignement, sa validité n’a cessé d’être remise en cause au fil des siècles, tout en essaimant dans les discours les plus variés. Car l’efficacité de cette formule tient peut-être moins aux œuvres qu’elle mentionne qu’à sa structure oppositive, apte à dialectiser les personnes, les valeurs et les situations les plus variées. Toujours en lien avec l’univers théâtral, mais du côté du mélodrame cette fois, Florence Fix montre combien l’expression tirée d’un vers de Musset, « faire pleurer Margot », cristallise à elle seule toute une série de débats sur la représentation de la sentimentalité, sur le lien de la fiction au pathos, et au fond sur la légitimité d’une littérature des émotions associée, à tort ou à raison, à une dimension populaire. Enfin, Benoît Monginot aborde l’univers romanesque contemporain avec Les Années d’Annie Ernaux, qui se réfèrent fréquemment à des formules (politiques, publicitaires, médiatiques) qui ont traversé l’espace public du second xxe siècle. En rapportant ces énoncés, l’autrice les intègre à une triple entreprise : critique, puisqu’il s’agit d’en démonter les rouages et parfois de dénoncer certaines petites phrases politiques ; ironique, avec un regard distancié et parfois désenchanté sur ces mots dont l’efficace s’est souvent estompée ; mémorielle, puisque ces formules sont associées à des moments de vie individuelle mais surtout à de profondes mutations sociales seulement visibles a posteriori.
La littérature comme terrain polémique
21La dernière partie de ce numéro s’attache à l’une des caractéristiques les plus singulières des formules : leur capacité à être un objet de débat et à devenir le champ d’une véritable lutte sémantique entre leurs énonciateurs. C’est ainsi qu’on peut envisager la littérature comme terrain polémique : en contribuant à la propagation, à la légitimation ou à la dilution d’une formule, il arrive que le discours littéraire participe pleinement aux polémiques politiques et idéologiques d’une époque.
22On le voit par exemple dans le cas de l’exclamation « Les cons ! », que Sartre a attribuée à Daladier à la fin du Sursis, et qui pourrait bien être apocryphe : l’article de Laurent Broche montre minutieusement comment la légende sartrienne est peu à peu devenue un mot historique, et du moins un référent inévitable dans les débats passionnés qu’engendre cette formule, objet d’interprétations contradictoires et de détournements en tout genre. Dans le contexte des sciences humaines, Alice Krieg-Planque et Françoise Simonet-Tenant offrent une étude croisée de deux formules ayant pour point commun de pointer la question du biographique, dans les études littéraires (avec le « pacte autobiographique » défini par Philippe Lejeune) et dans les sciences sociales (avec l’« illusion biographique » évoquée par Pierre Bourdieu). Souvent reprises, glosées, disqualifiées ou requalifiées, ces formules cristallisent des enjeux souvent polémiques qui interrogent le rapport du récit au réel, au-delà de leur apparente opposition. Délaissant le terrain de l’histoire personnelle, l’article de Karine Abiven reprend pour finir le chemin de l’Histoire collective, en abordant les chansons polémiques et satiriques de la Fronde. Ce corpus présente des formules versifiées qui, du fait de la pratique du timbre, condensent non seulement des références à l’actualité, mais aussi la connaissance d’airs antérieurs, tout en dessinant en creux la délicate question de l’articulation entre l’écrit et l’oralité. Les formules participent ainsi de la construction de l’événement historique comme de sa mémoire.
*
23Les contributions réunies dans ce numéro de Fabula-LhT se sont ainsi prêtées au jeu qui consiste à réduire la littérature en formules. Et à ce jeu-là, force est de constater que les œuvres, les textes ou les genres ne constituent plus des catégories véritablement opératoires : cette littérature en formules se disperse en une série d’énoncés prêts à devenir détachables, mémorisables et malléables pour mieux plonger dans le grand bain de la prose du monde. Un tel devenir a peut-être pour horizon la fin de la littérature – mais une fin heureuse, où le discours littéraire serait une substance vague et soluble dans les discours sociaux, sous forme de proverbes, de sentences, de mots d’ordre ou de petites phrases qui nous permettent de savoir comme une évidence, sans que l’on connaisse toujours l’origine de ces expressions, que l’enfer c’est les autres, qu’il faut cultiver notre jardin et que longtemps certains se sont couchés de bonne heure.