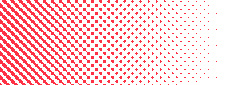Ni Cendrars, ni Kadiiski Ou Que la légendaire Légende de Novgorode n’a pas besoin d’auteur. Fiction théorique
1Je m’appelle Daniel Siselius1. Le lecteur jugera peut-être que j’aurais pu ne me nommer que plus tard, et en passant – ou même qu’une telle information est inutile. Ce n’est pas loin d’être mon avis. Car quel rôle serai-je amené à jouer dans l’histoire toute littéraire que je vais conter, sinon celui, très impersonnel, de la raison critique – et cet autre encore, tout aussi impersonnel, quoique plus mystérieux, de génie de la narration2 ?
2La raison critique n’a ni nom, ni âge (seuls le contestent les jeunes sceptiques inhumains, c’est-à-dire ennemis de l’homme, j’entends ceux qui, jugeant Nietzsche un peu timide à leur goût dépravé, ont décrété que l’homme était mort). Elle échappe au temps et survit aux corps, aux flétrissures séniles et à la corruption définitive, quoique éphémère comme la santé qui la précède, qui s’ensuit. De cela je suis convaincu. Mais cela n’empêche pas que la raison critique doive s’incarner, si le lecteur me permet d’user de ce mot aux allures équivoques, et qui, en l’occurrence, prend des airs paradoxaux, dans des esprits plus ou moins dignes d’elle. Le mien n’est pas le plus capable de l’accueillir ; admettons toutefois qu’à force d’honnêteté intellectuelle j’aie gagné le droit de jouer le rôle glorieux de la critique raisonnable dans une affaire d’aussi modeste portée que celle que je vais à présent exposer.
3Cette ouverture est bien maladroite, et sans doute m’est-elle inspirée par un démon véritablement démoniaque, par un vice vicieux comme ces cercles dont on ne parvient pas à sortir, par cette vaine gloire dont les plus saints et les plus sains esprits ne surent entièrement se défaire, et que Grégoire le Grand a eu bien tort de retrancher de la liste des péchés capitaux. Le lecteur doit s’impatienter, et s’agacer. Le génie de la narration ne se fera pas désirer beaucoup plus longtemps. Qu’il me soit permis de noter encore que j’ai l’honneur d’exercer depuis une dizaine d’années les fonctions de président de la section pragoise de la Société Bohémienne des Lettres Francophones, et que c’est à ce titre que je m’autorise à évoquer ici la figure incandescente de Blaise Cendrars – car c’est de lui, du brûlant citoyen de la confédération cosmique, qu’il sera question, et plus exactement de la légendaire Légende de Novgorode, de l’or gris et du silence.
4Faut-il croire Blaise Cendrars quand il prétend être l’auteur des Séquences ? Ne s’attribue-t-il pas abusivement l’œuvre d’un jeune homme séduisant, mais timoré, bravache, mais bourgeoisement, helvétiquement convenable, et qui, ayant eu l’audace d’écrire quelques poèmes, n’eut pas celle de les publier, et les confia à un pseudonyme qui devait finalement sortir de son rôle superficiel et purement nominal, pour faire concurrence jusque dans sa chair au jeune imprudent, et le forcer à être l’autre ? C’est une question que je préfère laisser en suspens. Elle m’effraye, et me confirme dans ma conviction que je ne suis cendrarsien que par passion, c’est-à-dire malgré moi. De telles discussions entrouvrent des portes qu’il me semble préférable de laisser closes, et (j’ose à peine l’avouer) je ne suis pas loin d’approuver Barbe-Bleue d’avoir puni ses désobéissantes épouses... Il est des vérités qui ne sont pas bonnes à connaître, ou que seuls les poètes et les prêtres devraient apercevoir. Le malheur est que les poètes et les prêtres n’aiment guère la solitude, et qu’ils publient, pour le malheur des curieux, des découvertes qui devraient, à mon sens, rester hermétiques.
5Toujours est-il que, dès ses Séquences encore presque adolescentes, Cendrars fait figurer en tête de sa bibliographie cette œuvre réduite à l’état de fantôme, cette Légende de Novgorode, de l’or gris et du silence dont le titre même justifie, à mon sens encore une fois, l’existence, ou l’inexistence. Je me rends compte que je viens d’utiliser par deux fois cette expression : à mon sens, qui trahit à quel point il m’est difficile de rester dans mon rôle critique et rationnel, emporté que je suis par la redoutable vertu d’entraînement du verbe cendrarsien (ou du verbe tout court, car je suis de ces humanistes méfiants qui jugent par trop orientale la mystique johannique duλόγος – les premiers commentateurs du quatrième évangile ne sont-ils pas en effet de ces valentiniens qui voyaient dans Sophia, fille indiscrète du Père inconnaissable, la première coupable, celle dont le désir de savoir a engendré le mal ? Imaginations exécrables, comme toutes celles qui font du savoir un péché…)
6Mais je me perds en digressions, et me contredis qui plus est, décourageant jusqu’au lecteur le mieux disposé en ma faveur. De la Légende de Novgorode, nulle trace, donc, jusqu’à ce jour de 1995 où Kiril Kadiiski, poète bulgare, en retrouve chez un bouquiniste sofiote un exemplaire en tous points conforme à la description physique qu’en donne Cendrars. À vrai dire, ce Kadiiski ne m’inspire qu’une confiance très médiocre, et je ne crois guère à l’authenticité de sa Légende. Il n’est pas encore temps toutefois que je présente mes Animadversions sur Kadiiski – n’anticipons pas, et reprenons le fil déjà suffisamment enchevêtré de notre récit.
7Kadiiski, une fois le poème russe retrouvé (la tentation est grande d’écrire : une fois le poème russe composé), le traduit en bulgare. Je dois avouer à ce propos que cette histoire de publication originale du poème dans une version traduite m’a toujours semblé controuvée. Mes amis érudits et francophiles ne me suivent pas sur ce point : il ne voient pas, disent-il, ce que peut avoir d’invraisemblable ce scénario – c’est un des mots favoris de mon bien-aimé camarade Joseph Hájek, et il fait fureur dans notre petit cercle, au point que j’ai entendu l’autre jour Ferdinand, le garçon du Café Závist où se tiennent nos réunions, s’exprimer en ces termes (il se pique de parler français, et ne s’en sort, ma foi, pas trop mal) : « Je crains, Messieurs, de ne pouvoir satisfaire aujourd’hui votre désir de slivovice (c’est un alcool de quetsche dont certains d’entre nous raffolent). Nous sommes en pleine pénurie : c’est là un scénario qui m’afflige. » J’accorde volontiers à mes raisonnables compagnons que ce scénario n’a rien d’illogique : Sauser le bourlingueur (que ce terme me paraîtrait laid, si je ne l’empruntais pas à Cendrars lui-même !) écrit en Russie, quelque part entre l’Europe orientale et l’Asie, dans une ville ou dans un train quelconque entre Prague et Samarkande, un poème ardent qui entame la consomption du trop simple Frédéric. Sauser l’intrépide s’est choisi deux ombres tutélaires : un poète symboliste et un trafiquant (et je dois reconnaître que ce double choix me semble d’un snobisme que je jugerais désagréable et irresponsable chez tout autre que chez lui). Rémy de Gourmont préside à la création de la Légende, comme à celle de toutes les œuvres de Cendrars. Quant à Rogovine le superbe, il prend paternellement en main la traduction et la publication de la première œuvre du brûlant poète3. Soit : je ne suis pas convaincu. Il manque à tout cela le parfum de la vraisemblance. Le lecteur me répondra (je l’entends d’ici, le lointain lecteur, indigné de me voir manquer aux devoirs de la raison après avoir abusé du pouvoir discrétionnaire que me confère ma position de génie de la narration), il me répondra, comme mes amis me répondent, que je me fie trop exclusivement à mon intuition, et que rien n’est plus sujet à caution que mon intuition ; que je bafoue (le terme est sévère, lecteur, mais je conçois ton irritation) la logique ; et que c’est précisément parce qu’il semble déraisonnable, parce qu’il est un peu fou (je prête au lecteur une expression de Joseph Hájek, mon bénévoleami, une expression qui ne lui va pas, une expression trop frivole, qui lui échappa un jour où lui-même était, à mon avis, un peu fou, ou affolé du moins par nos débats cendrarsiens) que ce scénario est plausible. Mes amis ont l’habitude d’invoquer la psychologie tourmentée du poète. Mais précisément (voilà que je m’emporte à présent, sans égard pour le repos de mon esprit !), cette psychologie tourmentée m’apparaît comme un cliché – c’est du chiqué !, du chiqué, de la fausse joaillerie4 qui ne peut éblouir que les prétentieux et les naïfs (Joseph fait partie, si l’on veut, de ces derniers, quoique son ingénuité ne soit que le résultat d’un excès d’équilibre mental qui l’empêche de concevoir les états spirituels pathologiques dans leur véritable subtilité, et qui fait de lui une proie facile pour les grossiers imposteurs qui voudraient se faire passer pour des aliénés, des forcenés, des détraqués, et dont l’extravagance n’est que la parure et le fonds de commerce).
8Pardonne-moi, Joseph, cette période véhémente : j’ai l’air de te faire reproche de cette candeur que j’honore chez toi par-dessous tout – et je fais passer, ce que tu excuseras peut-être moins facilement, Cendrars pour un hâbleur et un escroc. Il faut dire, pour ma défense, que cette histoire n’est pas claire ; et toi-même, Joseph, tu me confias, un jour que la controverse avait été plus vive que jamais, ta lassitude, et ton envie de te retirer sur ces cimes glacées loin desquelles, Goethe l’a dit, et tu as raison d’ajouter foi à sa parole, il n’y a point de repos.
9Nous voici loin, à nouveau, de Kadiiski – de Kadiiski qui, une fois le poème retrouvé, traduit en bulgare et publié à Sofia5, l’envoya à Miriam Cendrars, à l’irréprochable enfant du poète, auteur d’une biographie6 de son père où sans doute la piété filiale l’emporte sur le discernement – mais qui osera médire de cette douce plénitude de l’amour d’une fille pour son père, de cet humble et auguste tableau qui apaise l’esprit fatigué des nasillardes et finalement déplaisantes insinuations de l’ironie ? La diligente Miriam s’empresse, après en avoir dirigé la restitution en français7, de publier la Légende si longtemps silencieuse chez Fata Morgana8 (ce pacte avec la Dame de l’Île, avec la régente de la réserve surnaturelle – mes jeux de mots, que je considère comme un plaisir coupable, ont toujours un certain succès auprès de mon commode ami Joseph – d’un Moyen Âge volontairement crédule, n’eût sans doute pas déplu à Cendrars).
10Seulement – c’est là, je crois, ce qui rend raisonnable ma perplexité à l’égard de la miraculeuse trouvaille de Kadiiski – l’original, très vite, est accaparé par un collectionneur. De cet amateur de plaquettes rarissimes, de pièces uniques (mais pas forcément authentiques, me souffle un esprit persifleur), je ne sais rien. Je puis donc l’imaginer librement – et je dois dire que les portraits que je fais de lui sont rarement flatteurs. Cet exercice me réjouit, et j’y mets une certaine verve. Je le vois superbe, mais affligé d’une tare essentielle, d’une défectuosité constitutive. Je l’imagine en radjah – car il doit être immensément riche – entouré de syllabaires et de lexiques, et désespérant d’arriver jamais à se familiariser avec une autre langue que celle que lui a transmise sa nourrice ; en comte transylvanien – inutile que je développe cette vision, qui n’est pas de première main ; en négociant hambourgeois, brutal, qui entretient une créature peu jolie (il le sait) et qu’il violente ; en diplomate bulgare – apprécie, lecteur, la causticité des italiques – enfin, truculent et partisan. La dernière image n’est sans doute pas la plus fausse. Je suis convaincu en tout cas que le collectionneur invisible est animé par l’esprit de négation ; qu’il est une sorte de Grand-Duc, d’avare trésorier désireux de confisquer les savoirs, de bibliothécaire maudit ennemi de l’homme. Qui peut dire, d’ailleurs, si Blaise Cendrars n’a pas désiré un tel sort pour le premier-né de ses poèmes ? Qui sait s’il ne l’a pas offert au Dieu cornu, à l’idole au nom de feu, en signe d’ardente allégeance ? L’imagination a si peu de peine à se représenter le poète jetant un à un les exemplaires de son poème dans l’âtre vorace – ah ! qu’elle est pénible, et vraisemblable, cette vision : le recroquevillement du papier, dont on dirait qu’il essaie d’échapper à l’avidité des flammes, la fumée noire qui monte des feuilles humides, le remugle de néant qui s’en dégage – et dans la face animale du poète, dans ce visage arrogant qui serait grossier s’il n’était superbe, qui serait fruste si ses lignes brutales n’étaient pas en même temps princières, le pli dédaigneux des lèvres, leur fierté souveraine. Vision détestable, à vrai dire, vision primitive et divine, vision d’un autre temps – mais n’est-ce pas justement le rôle du poète, que de se substituer au victimaire, que de tromper l’homme altéré de sacrifices, que d’assouvir – bien innocemment – le désir de monstruosité qui, hélas, ne cessera jamais de tourmenter l’humanité ? De telle manière que d’abominable, la vision devient réconfortante : car il est tonique, ce spectacle de l’humanité rusant avec elle-même, de l’homme se jouant du monstre qui l’habite ; car elle est fortifiante, cette idée que dans l’économie de la civilisation, il y a place pour une fausse monnaie plus précieuse que l’or de coupelle le plus impeccable.
11Toutes ces rêveries n’empêchent pas que La Légende de Novgorode ait disparu une deuxième fois. Cela ne contribue pas à pacifier des esprits déjà considérablement échauffés par la controverse. Cette question que Claude Leroy a osé poser, au grand dam de Bruno Roy : « La Légende de Novgorode est-elle une nouvelle Chasse spirituelle9? », cette question pourtant bien légitime, semble agir à la façon de ces fièvres des tropiques, dont la ténacité triomphe de tous les remèdes. Une fois engagé dans le débat, nul ne semble plus capable de s’apaiser ; il n’y a plus de mesure, de prudence, de modération qui tiennent ; il faut se prononcer pour ou contre Kadiiski et sa découverte ; vénérer, ou jeter l’anathème ; être brûlant ou glacé : car les tièdes...
12Je ne parviens guère moi-même à garder mon calme. Je regrette à présent de m’être autorisé à écrire ces lignes peu obligeantes pour Kiril Kadiiski. Que le lecteur me permette de faire amende honorable. Je n’ai aucune raison d’éprouver une quelconque antipathie pour Kadiiski. J’ai même toutes les raisons de l’admirer : soit il a en effet découvert l’original de la Légende, et dans ce cas je lui dois une lettre d’humbles remerciements au nom des cendrarsiens de Bohême ; soit il a écrit la Légende – et je dois reconnaître que, si tel est le cas, il ne s’est pas montré indigne, loin de là, de Cendrars. Reste cette troisième hypothèse : que la Légende de Kadiiski soit bien un faux, mais qu’il ne soit pour rien dans la supercherie. C’est bien possible au fond ; et cette supposition n’a rien d’infamant pour lui.
13Me voici rentré dans le rôle si exigeant de la raison critique, ou de la critique raisonnable. Je ne remplis mon emploi que bien maladroitement ; cependant, j’aurai l’audace d’affirmer, non sans quelque malice, que d’autres ne s’en seraient pas mieux tirés que moi. Ils sont pourtant bien plus savants que moi ; et beaucoup mieux placés pour juger. D’ailleurs, je ne voudrais pas me montrer injuste envers eux, comme je l’ai été envers Kadiiski. Tous n’ont pas cédé à la frénésie ; et ceux même qui se sont montrés un tant soit peu trop impétueux, sont très vite revenus à une attitude plus paisible. Voici donc les arguments des uns et des autres. Pour Oxana Khlopina10, la Légende publiée chez Fata Morgana n’est pas celle de Cendrars. Elle avance des arguments de trois sortes – poétiques, historiques, typographiques –, que j’estime globalement convaincants. Les preuves poétiques qu’elle donne de l’inauthenticité du texte ne sont pas décisives à mon sens : le pathétique flamboyant de la Légende ne l’empêche pas de s’apparenter à l’ « épopée cocasse et héroïque11 » qu’annonçait Cendrars. Cependant, certains indices historiques sont éloquents : il n’y a pas eu d’Hôtel d’Angleterre à Pétersbourg avant 1925 ; de plus, l’orthographe du prétendu original russe est post-révolutionnaire ; enfin, certains passages de la Légende relèvent étrangement de l’auto-plagiat par anticipation. Reste la question des polices, et notamment de la police du titre (qui porte le beau nom d’Izhitsa, emprunté à une locomotive soviétique), bien trop récente. Je dois confesser que la typographie ne me passionne guère ; et que le recours à des arguments de cet ordre m’apparaît comme un pis-aller. D’ailleurs, d’après Atanas Tchobanov (un jeune et fougueux linguiste qui s’est lancé à son tour dans la querelle), rien ne garantit que c’est avec Izhitsa que le titre a été composé12. Curieux monde que celui de la typographie, où tout est gémellité, ambiguïté, équivoque. Kiril Kadiiski et Bruno Roy affirment, qui plus est, que la page de garde de la « version Fata Morgana » n’est pas exactement un fac-similé, qu’il s’agit d’une reconstitution, ou d’une imitation, ce qui invaliderait l’argument typographique13. Mais ceux-là sont juges et partie... Qu’on me permette de mentionner encore quelques-uns des épisodes de cette dispute : en 2007, Raphaël Stainville, avec le sans-gêne propre aux journalistes, s’empare de la thèse d’Oxana Khlopina, et la transforme, par un tour de prestidigitation comme seuls les gens de son métier savent en faire, en une charge violente contre Kadiiski14. Ce dernier répond, comme il se doit ; seulement sa réponse est un peu emphatique à mon goût. C’est l’honneur de la Bulgarie qui est en jeu, déclare-t-il ; c’est la dignité du pays qu’on offense15. Soit ; je ne vous cache pas que de telles péroraisons me semblent peu nécessaires. Bruno Roy, de son côté, a tenu à défendre la réputation de sa maison. Cela se comprend. Il avait d’ailleurs des arguments à faire valoir : le « papier fragile et jauni » de la plaquette retrouvée par Kadiiski ; le fait que les polices d’ordinateur ne sont, pour la plupart, que des répliques des polices de plomb. Fallait-il pour autant qu’il s’en prenne à Claude Leroy ? Et qu’il conclue son plaidoyer pro domo (voilà une locution latine doublement bienvenue16) par cette question si oratoire qu’elle en devient creuse : « Qui manipule qui17 ? » Beaucoup de bruit pour rien : qu’on me pardonne cette référence prévisible à Shakespeare. On ne saurait mieux résumer l’impression que me laisse cette polémique18... Au moins était-elle fondée ; au moins les arguments des parties adverses reposaient-ils sur des faits. Car à l’éloquence des avocats a succédé la faconde des théoriciens. Ces derniers tiennent pour entendu que La Légende de Kadiiski est une mystification ; et que c’est Kadiiski lui-même qui est l’auteur du poème. Une seule question demeure : Pourquoi ? Pourquoi Kadiiski a-t-il écrit une fausse Légende ? Ils n’ont même pas l’esprit de donner la seule réponse recevable, la seule réponse aussi qui soit à l’honneur de Kadiiski, qui en fasse un personnage sympathique. S’il a bel et bien fabriqué une Légende factice, ça ne peut être que par goût du canular ; ça ne peut être que pour s’amuser (de manière bien inoffensive) aux dépens des bonnes gens. Je n’oserais pas moi-même me lancer dans une entreprise de cette sorte ; je craindrais de passer à mes propres yeux pour un marchand de fumée ; et surtout, de blesser la bonne foi de quelque âme crédule. Il n’en demeure pas moins qu’il est plus que probable que Kadiiski soit un farceur ; et que ce Kadiiski-là est le plus intéressant des Kadiiski possibles.
14Ce n’est pas l’avis de certains universitaires. C’est leur ôter le pain de la bouche que de se contenter d’une explication aussi peu subtile. Voyons donc ce que produit leur subtilité. Ce sera, pour les esprits mordants, l’occasion de rire – d’un rire amer, je n’en doute pas ; aux autres, ce qui va suivre semblera simplement navrant. Le génie de la narration, lecteur, n’est pas tout-puissant ; il est bien loin d’être absolument libre, et rien ne l’apparente à l’aigle qui trace, sur le ciel d’un bleu rare, des lettres cruelles et vertigineuses. Le génie de la narration te ressemble bien plus que tu ne le penses, fraternel lecteur ; son œuvre est une lutte, comme la tienne ; la matière ne lui obéit pas plus qu’elle ne t’obéit ; elle ne sent pas, soudain docile, la main du maître sur son encolure. Je ne peux faire que ce qui suit ne soit pas arrivé (quoique de tels événements soient si dépourvus d’intérêt, qu’on peine à croire qu’ils sont « arrivés »). Ce qui vient est bien insipide ; mais c’est « ce qui vient »...
15Deux jeunes universitaires se sont donc emparés de l’affaire. Je dis deux jeunes universitaires. Deux jean-foutre eût été plus exact (le mot qui échappe à ma plume a échappé à celles de Flaubert, de Martin du Gard, d’Aragon ; m’autorisant de la jurisprudence littéraire, je me passe cette incartade). Car mes sentiments à l’endroit de l’Université sont ceux de la dévotion et de la tendresse. Je voue le plus grand respect à cette pacifique institution, à ce beau fruit de l’esprit de savoir et d’éducation. Les deux individus en question ne sont que des usurpateurs ; mais les usurpateurs sont hélas de plus en plus nombreux. Je voudrais avoir le courage, la sainte audace de les chasser du temple19. Qu’elle est belle, cette scène : les marchands qui ploient l’échine, les torses, certains d’une pâleur cadavéreuse, les autres olivâtres, qui sortent des tuniques qui se défont, l’effort pour sauver les lourds paniers d’osier qu’on devine remplis de monnaie d’argent, et au centre de tout cela, le fouet levé du Dieu en colère...
16Je suis bien trop peu virulent pour agir de la sorte. Que mes mots me servent de glaive ! Je n’en pourrai faire plus dans le sens de la violence. Je ne nommerai pas les deux jeunes gens. Je laisserai leur nom dans l’ombre charitable du silence. Je n’indiquerai pas non plus les références de leurs essais. Il faut pourtant que je rapporte leurs idées sur l’affaire qui nous occupe. (Il me vient un doute. Plus j’y songe, plus leurs positions me semblent, l’une comme l’autre, extravagantes. Peut-être sont-ils, eux aussi, des plaisantins ? Peut-être suis-je, moi aussi, une « âme crédule » ? Je donne peut-être dans un panneau tendu à l’intention des candides ; tant pis !)
17Le premier de ces deux universitaires anonymes (anonymes par ma faute, par la faute de ma sévérité de critique raisonnable) veut croire que Kadiiski n’avait rien de mieux à faire que de démontrer aux partisans de la lecture strictement textuelle que le mépris du contexte ne mène qu’à des méprises. « Les textualistes, écrit-il, se sont fourvoyés. Leur attitude envers le texte relève purement et simplement du fétichisme, pour ne pas dire de l’idolâtrie. Ils confondent l’image d’un faux dieu avec l’essence du vrai Dieu. Ils confondent le texte avec l’œuvre, la forme avec le sens. Ce n’est pas ainsi que la littérature fonctionne. L’idée même de l’œuvre littéraire varie avec le temps. Pour savoir non seulement ce qu’une œuvre veut dire, mais aussi en quoi, ou plutôt comment elle est une œuvre, il convient de la replacer dans son contexte de production et de réception. Robbe-Grillet ne fait pas œuvre comme Marcel Proust. Marcel Proust ne fait pas œuvre comme Gustave Flaubert. Quant à Cendrars, il ne fait œuvre ni comme Flaubert, ni comme Proust, ni comme Robbe-Grillet. Telle est la leçon que Kadiiski a voulu administrer aux textualistes plus soucieux de rétablir le texte absolu, de découvrir une virgule oubliée ou d’effacer un point superfétatoire que de comprendre en quel sens l’auteur a fait œuvre (si c’est bien l’auteur qui a fait œuvre). » Celui qui a écrit ces lignes – et quelques autres en sus – est doué d’une certaine agilité d’esprit. Sa pensée, toutefois, n’est pas claire. Il se montre bien cavalier par moments. Je ne crois pas que le texte soit à l’œuvre ce que la forme est au sens. Je ne crois pas non plus que la critique textuelle, qu’il attaque bien durement, puisse être assimilée au textualisme. La critique textuelle s’occupe de l’histoire d’un texte ancien, elle en juge les différentes versions, et, loin de chercher à établir le « texte absolu », pour citer notre jeune docteur, elle essaie de comprendre la leçon de l’œuvre. Le critique textuel n’a qu’un seul ennemi : le Copiste, ce diable simplificateur, qui confond le tracé sacré de l’écriture avec les lignes vaines de l’arabesque, qui confond le dédale des signes avec la fantaisie des volutes et des ornements. Le textualiste, de son côté, a tant d’adversaires qu’on serait tenté de le plaindre. C’est à vrai dire le monde entier qu’il affronte, car c’est au monde qu’il veut arracher le texte. Je crois par conséquent que notre jeune ami a, malgré sa science, manqué de perspicacité en cette occasion ; ce dont (le lecteur indulgent ne me contredira pas) on ne saurait lui tenir rigueur. Faisons preuve de clémence : c’est là vertu royale.
18Alors, pourquoi m’être laissé aller, sans la moindre vergogne, à tenir des propos injurieux à l’égard de notre docte camarade ? C’est que son impudence m’irrite. Il ne se contente pas de mêler dans un même mépris textualisme et critique textuelle. Il pousse l’effronterie jusqu’à prendre parti pour Kadiiski contre Cendrars ! Lis, lecteur, ces lignes spécieuses, ces propos outrecuidants : « Au fond, Kadiiski est infiniment supérieur à Cendrars, comme tous les épigones sont supérieurs à leurs maîtres. Écrire en épigone, c’est agir en iconoclaste, c’est tenter – et réussir, dans la plupart des cas – une démonstration par l’absurde ; c’est désacraliser le texte, et proclamer la mort de l’auteur-Dieu. C’est prouver qu’une œuvre, aussi belle soit-elle, n’a pas de valeur propre ; et qu’elle reste sans portée si elle n’est l’œuvre que de son auteur. Une œuvre doit être le produit de son temps, ou ne pas être. C’est un compliment empoisonné que celui qu’André Gide fait à Francis Jammes20 : floraison miraculeuse et absurde au regard de l’histoire littéraire, l’œuvre de ce dernier était destinée à se faner bien vite. » Il ose s’en prendre à Cendrars, et au doux Francis Jammes de surcroît, au nom d’une théorie captieuse. Immonde amphigouri, ignoble galimatias !
19Le second ne vaut guère mieux. Celui-là, je crois, est tout à fait fou – ou alors il se moque du monde, ce qui est en somme bien possible, mais n’excuse rien, car il n’a pas d’esprit. Il prétend qu’en écrivant cette œuvre par trop prémonitoire, et en l’attribuant à Blaise Cendrars, Kadiiski aurait voulu appuyer par une preuve fabriquée de toutes pièces les théories de Michael Riffaterre. Voici une idée, n’est-ce pas, saugrenue à souhait ; et qui témoigne d’un dérèglement à peu près complet de l’entendement. Notre spéculateur ne s’arrête pas en si bon chemin. Riffaterre, d’après lui, est du complot. Il aurait soudoyé Kadiiski « afin que ce dernier forge une pièce à conviction qui vienne à l’appui de l’idée qu’il se fait de la production du texte ». Les mots me manquent devant de telles aberrations, et je préfère laisser la parole à leur auteur : « Au fond, les preuves manquaient à Riffaterre ; ses théories étaient belles, peut-être, mais invérifiables. Riffaterre se réclame de Saussure, dont il transforme, par un tour de passe-passe, l’hypogramme en paragramme (le paragramme étant une matrice beaucoup plus souple que l’hypogramme). Mais qui peut prétendre réduire – pour prendre un exemple qui ne soit pas excessivement en la défaveur de Michael Riffaterre – À la Recherche du temps perdu à un paragramme, ou à la diffusion d’un paragramme ? Proust, c’est vrai, a écrit des œuvres prémonitoires : L’Indifférent, certains passages de Contre Sainte-Beuve, Jean Santeuil. Luc Fraisse, c’est vrai, a consacré sa thèse au rôle du Fragment expérimental dans le processus de la création proustienne21. Mais des fragments annonciateurs, il y en a plusieurs. En admettant même de penser la création en termes d’enveloppement-développement, il y aurait plusieurs matrices concurrentes : voilà qui est curieux. Riffaterre a donc voulu démontrer que sa théorie fonctionnait. Il lui fallait une preuve éclatante, indiscutable, il lui fallait quelque chose qui manifestât que l’œuvre entier d’un écrivain pouvait émaner ou découler d’un paragramme. Il commanda donc à Kadiiski sa Légende de Novgorode, de l’or gris et du silence. Ce poème qui contient tant de vers futurs de Cendrars est une démonstration magistrale : le titre est le paragramme ; le poème est un premier état du développement (ou de l’explication) du paragramme ; et l’œuvre poétique complet de Cendrars n’est que le vaste déploiement de tous les possibles contenus, impliqués dans la matrice22. » Il va de soi que les lignes qui précèdent témoignent d’une compréhension très limitée de la pensée de Riffaterre. Le reste est à l’avenant : un torrent d’inepties, un fleuve abondant d’insanités et de divagations. Notre inventif théoricien n’ignore pas ce que son propos peut avoir de surprenant. Il prévient les objections : pourquoi Riffaterre n’a-t-il pas écrit lui-même le poème ? Et d’abord, connaissait-il Kadiiski ? « Riffaterre aurait pu, c’est vrai, écrire le poème lui-même, puis le faire "découvrir" par Kadiiski. Sans doute cela lui a-t-il paru dépasser ses forces ; habile théoricien, il lui manquait ce que ceux qui ne savent rien de la poésie appellent la fibre poétique. Ce qui ne fait pas de doute, c’est que Riffaterre a fait écrire La Légende par Kadiiski. J’ai pu (grâce à la complaisance de quelques amis bien placés pour me rendre ce service) avoir accès à la correspondance des deux hommes, qui se sont rencontrés en 1986 à San Francisco, où Riffaterre présidait la 11ème Rencontre annuelle de la Semiotic Society of America, tandis que Kadiiski remplissait une quelconque mission diplomatique, à laquelle il fait quelques allusions rapides dans ses épîtres. » L’usage de ce dernier mot comme un synonyme de lettre me paraît trahir une grande vulgarité intellectuelle. Mais passons. Au lecteur qui se demanderait pourquoi il ne produit pas ces « épîtres », notre fantaisiste répond dans une note : « Ces lettres, je ne peux ni les publier, ni les citer : elles sont la propriété des ayant-droits de Michael Riffaterre. »
20Je n’honorerai ce commentateur délirant d’aucun jugement. Je préfère faire sans plus tarder mention d’une hypothèse qui me paraît bien moins farfelue que les précédentes. Elle a été proposée par Antonín Horák, secrétaire perpétuel de l’Académie de Moravie, et, en quelque temps, elle est devenue classique, ou peu s’en faut. Je pense avoir un certain mérite à reconnaître la pertinence de cette hypothèse – c’est du moins ce que le démon de la présomption me chuchote à l’oreille. Car, au risque de passer pour un vieillard acrimonieux, je ferai un aveu de plus au lecteur : cet Antonín Horák ne m’est pas sympathique du tout. Je ne suis pourtant nullement ennemi de l’humanité. Je suis un vieil homme, oui, mais en aucune façon misanthrope. Je crois être d’un commerce agréable. J’ai le sentiment que mes amis sont heureux de me voir, quand je les rejoins au Café Závist, ou quand nous nous retrouvons au Divočák, où nous prenons parfois nos dîners. Néanmoins, et malgré toute l’estime intellectuelle que je lui accorde, rien ne fera que j’apprécie un homme comme Antonín Horák. Horák est un fils de la montagne. Français, il s’appellerait Dumont. Si vous tenez à vous faire un ennemi mortel, rappelez-lui qu’il est né à Pec pod Sněžkou, en Basse-Silésie, non loin du plus haut sommet du pays. De la Basse-Silésie et de la montagne, Horák ne veut plus entendre parler. Il s’est mis en tête qu’il était morave par le droit du sang. Il se rêve en descendant lointain des margraves. Que lui importe que la généalogie lui donne tort, qu’aucun arbre ne témoigne de cette filiation ? La généalogie n’est pas une science exacte ; elle ne tient pas compte des enfants naturels. L’Académie de Moravie imite les us et les façons du Quai Conti. Horák s’est donc vu remettre, lorsqu’il a fait son entrée parmi les Immortels d’Olomouc23, une épée, sur laquelle il a fait graver les armes de Moravie : d’azur, à l’aigle échiquetée d’argent et de gueules, becquée, languée, membrée et couronnée d’or. Je mentionnerai encore ceci, que Horák a quatre fils, et qu’il les a nommés Conrad, Vladislav, Premysl et Jobst.
21Voilà que je me mets à faire des personnalités. Je ne m’étonnerais pas que le lecteur se fâche. Sans doute réclame-t-il l’hypothèse. Qu’on la lui expose sans plus tarder ! Pour ne pas perdre un instant de plus, je me contenterai de donner quelques extraits du bref article que Horák a consacré à L’Affaire Cendrars. Le texte a d’abord paru dans la revue académique Písemnictví (Lettres, 55ème année, juillet-septembre 2008, p. 39-46). Il a ensuite été repris dans un volume rassemblant, sous le titre Sbírka úvah (Recueil de réflexions, Prague, Schwarzenberg, 2015), quelques essais récents de Horák. Les fragments suivants ont été traduits par mes propres soins. J’ai été particulièrement attentif à ne gommer aucune des imperfections de l’original. Les redondances sont nombreuses, les approximations et les platitudes aussi ; je n’en suis pas responsable.
22« L’Affaire Cendrars*24 – je dis l’Affaire Cendrars* comme on disait, il y a un peu plus d’un siècle, l’Affaire Dreyfus* – a fait couler beaucoup d’encre ces deux dernières décennies. Chacun a présente à l’esprit la question qui agite les cendrarsiens depuis quelque vingt ans maintenant : La Légende de Novgorode*prétendument découverte par Kiril Kadiiski […] est-elle un faux ? […]
23À vrai dire, depuis quelques mois, personne ne semble plus se poser la question. La Légende de Novgorode*est un faux, c’est un fait établi. Je n’en ai, de mon côté, jamais douté. Encore fallait-il des preuves : nous les avons. […]
24À la question initiale s’est donc substituée une question nouvelle. Cette question nouvelle, on ne pourra probablement jamais y répondre ; les conjectures sont notre lot. Beaucoup de théories fort astucieuses ont été échafaudées, principalement par quelques docteurs de l’Université française. Ces tentatives de réponses me semblent, pour la plupart, témoigner d’une compréhension fort riche du problème. [Suit un résumé des deux hypothèses que nous avons exposées plus haut.]
25Toutefois, aucune de ces démonstrations ne me satisfait pleinement ; et je n’ai pas résisté à la tentation d’inventer ma propre hypothèse. Ma modestie dût-elle en souffrir, j’avoue qu’elle me semble bien plus susceptible d’emporter l’adhésion que celles que je viens de résumer. Mon idée est la suivante : Cendrars, on s’en souvient, a voulu prouver à Gustave Le Rouge, en puisant dans son Docteur Cornélius la matière de Kodak, qu’il était poète malgré qu’il en eût25. Le résultat est probant : peu de poèmes sont aussi vivants que ceux qui composent le recueil des Documentaires26cendrarsiens. Chaque fois que je lis l’une de ces pièces, j’ai le sentiment de croquer à belles dents dans la chair d’un fruit lointain. Cendrars a donc, si l’on me passe l’expression, réussi son coup. Je ne sais pas si Le Rouge a été convaincu. En tout cas, nous le sommes. […] À mon avis, de même que Cendrars a tenté de persuader Le Rouge qu’il était capable d’écrire de la poésie, de même Kadiiski a voulu prouver (post mortem) à Cendrars qu’il aurait pu écrire la Légende de Novgorode, et que Frédéric Louis Sauser n’était pas si mauvais poète que la Prose du Transsibérien a bien voulu le laisser entendre27. […] Qu’a fait Kadiiski ? Il a sélectionné dans les poèmes connus de Cendrars des vers ou des segments de vers28 qui auraient pu figurer dans La Légende de Novgorode (à quoi il a rajouté, pour que la supercherie ne soit pas trop visible, quelques envolées de son cru). Ce faisant, qu’a-t-il montré ? Non seulement que Blaise Cendrars aurait pu écrire la Légende ; mais qu’il l’avait bel et bien écrite, sans s’en rendre compte. [...] »
26Je confesse volontiers que l’idée de Horák me paraît fort belle. Mais je dois confesser aussi que le bon sens humaniste m’oblige à juger ces débats posthumes bien compliqués, et bien sinistres. Je crains que nos ingénieux collègues n’offensent les mânes de Cendrars. Car, disent les douze tables, ceux que la mort a pris seront divins aux yeux du vivant ; mais le culte qu’on leur vouera sera exempt de toute pompe. La terre sera leur seule demeure, que l’herbe et les fleurs feront fastueuse. Les pensées qu’on leur adressera seront simples, et les mots que l’on dira pour eux seront sans éloquence29. Je voudrais donc que soit clos ce débat sacrilège. D’ailleurs, qu’importe que la Légende soit l’œuvre de Cendrars ou de Kadiiski ? Cendrars, quand un ami le sommait de dire si, oui ou non, il avait voyagé avec le Transsibérien, ne savait lui répondre que par cette rude pirouette : « Qu’est-ce que ça peut te faire, puisque je vous l’ai fait prendre à tous !30 » Et Kadiiski, si un tribunal des lettres lui imposait de répondre à la question que nous nous posons tous (à la question que moi aussi je me pose, malgré moi), se déroberait peut-être à son tour en ces termes : « Que vous importe que la Légende de Novgorode soit l’œuvre d’un mystificateur suisse ou d’un imposteur bulgare, du moment que je vous l’ai fait lire à tous ? »
27Voilà, lecteur, l’histoire peu palpitante que j’avais à conter. J’ai tenu, tant bien que mal, mon rôle de génie de la narration. Sans doute, j’ai mené mon navire d’une main bien incertaine ; plus d’une fois, la barre m’a échappé, d’un geste brusque, meurtrissant la chair de mes doigts ; plus d’une fois, j’ai manqué d’avoir l’épaule démise par les incartades du gouvernail. Mais le navire est arrivé à bon port. Je n’oublie pas non plus que je m’étais engagé, non sans témérité, à parler au nom de la critique raisonnable, ou de la raison critique. Je ne suis pas bien sûr de ne pas avoir échoué. La plupart des jugements que j’ai portés sur les uns ou sur les autres m’ont été, quoi que j’en aie, dictés par les passions amères. Je me suis réclamé, plusieurs fois, d’un bon sens humaniste qui m’abandonne pourtant bien souvent. Si j’ai fait preuve, de temps à autre, de modération, ou de retenue (je n’ose écrire : de sagesse), ce n’est qu’après avoir cédé à la colère, ou à l’esprit d’hostilité. Qu’y faire ? L’homme est une créature médiocre, qui ne doit d’être divine qu’à la conscience qu’elle prend, parfois, de sa propre faiblesse.
28Bibliographie
29CENDRARS Blaise, Legenda za Novgorod. Poema otkrita i prevedena ot Kiril Kadijski, [La Légende de Novgorode. Poème découvert et traduit par Kiril Kadiiski],Sofia, Nov Zlatorog, 1995.
30CENDRARS Blaise, La Légende de Novgorode [1907 ?], Paris, Fata Morgana, 1996.
31CENDRARS Blaise, La Légende de Novgorode, dans Poésies complètes, Paris, Denoël, 2005, p. 325-333.
32CENDRARS Blaise, Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France [1913], dans Poésies complètes, Paris, Denoël, 2005, p. 19-34.
33CENDRARS Blaise, Bourlinguer [1948], dans Œuvres complètes, volume 11, Paris, Le Club français du livre, 1970.
34CENDRARS Blaise, Le Lotissement du ciel, précédé de Bourlinguer, Paris, Denoël, 1949.
35CENDRARS Blaise, Moravagine, suivi de Pro domo : comment j’ai écrit Moravagine, Paris, Grasset, 1956.
36Cendrars Miriam,Blaise Cendrars. L’Or d’un poète, Paris, Gallimard, 1996.
37CENDRARS Miriam, Blaise Cendrars. La Vie, le Verbe, l’Écriture, Paris, Denoël, 2006.
38Cicero Marcus Tullius,De legibus, Cambridge, J. Hall, 1881.
39Gide André, « Francis Jammes », dans Feuillets d’automne, Paris, Mercure de France, 1949, p. 85-98.
40Fraisse Luc,Le Processus de la création chez Marcel Proust : le fragment expérimental, Paris, Corti, 1989.
41Kadiiski Kiril, « Entretien », en ligne, disponible sur :
42http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=75642, dernière mise à jour le 5 juillet 2007, dernière consultation le 20 février 2016.
43Khlopina Oxana, Blaise Cendrars, une rhapsodie russe, thèse de doctorat en littérature française, Université de Paris-X Nanterre, 2007.
44Lacassin Francis, « Les Poèmes du Docteur Cornélius », dans Gustave Le Rouge, Le Mystérieux Docteur Cornélius, Paris, Laffont, « Bouquins », 1986, p. 1181-1247.
45LEVY Alexandre, « Quand La Légende de Novgorode devient polémique (suite) », en ligne, disponible sur : http://alest.blogs.courrierinternational.com/tag/Légende+de+Novgorode, dernière mise à jour le 6 juillet 2007, dernière consultation le 20 février 2016.
46MANN Thomas, L’Élu, dans Romans et nouvelles. III, traduit de l’allemand par Louise Servicen, Paris, Librairie générale française, 1996.
47Riffaterre Michael,La Production du texte, Paris, Seuil, 1979.
48Savelli Dany, « Examen du paratexte de la Légende de Novgorode découverte à Sofia et attribuée à Blaise Cendrars », dans Revue de Littérature comparée, numéro 313, 2005, p. 21-33.
49Sávova, Lioubov, « Entre parole et silence : la traduction-restitution d’un poème perdu de Cendrars. », dans Les Cahiers du Ceracc, numéro 2, 2003, en ligne, disponible sur : http://www.cahiers-ceracc.fr/savova.html, dernière mise à jour le 4 janvier 2004, consulté le 20 février 2016.
50Stainville Raphaël, « Un faux Cendrars au goût bulgare », dans Le Figaro littéraire, 28 juin 2007.