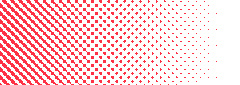1La thèse que je soutiendrai est que les quelques indications, disséminées dans son œuvre, que Bergson a données sur la lecture des philosophes permettent de prétendre que les textes philosophiques sont – et donc les siens aussi – littéralement illisibles. Que l’exercice, pédagogique par excellence, de la lecture des œuvres philosophiques – et donc de la sienne propre – est pour le moins placée sous le signe d’une extrême difficulté. Je m’appuierai principalement pour étayer cette proposition paradoxale sur « L’intuition philosophique », conférence, à tous égards déconcertante, que Bergson prononça en 1911 à Bologne devant ses collègues professeurs de philosophie et qu’il recueillit vingt-trois ans plus tard dans La Pensée et le mouvant, le dernier livre qu’il ait publié.
2Mais il importe peut-être avant de rappeler les propositions surprenantes avancées dans cette conférence, de dire un mot de la conception, elle aussi très particulière, que Bergson se fait de la pensée en général et des rapports existant selon lui entre elle et les idées qui l’expriment ; qu’il se fait aussi des mots et phrases assemblés pour les consigner. Car il n’y a pas, pour lui, de réelle et fiable adéquation entre la pensée d’un philosophe et les idées grâce auxquelles on peut espérer pouvoir en dire quelque chose. « Les idées, dit Bergson, sont simplement les représentations qui surgiraient dans l’esprit à chaque instant du mouvement de la pensée si la pensée s’arrêtait ; mais elle ne s’arrête pas » ; elles ne font, précise-t-il, qu’« exprimer métaphoriquement en quelque sorte, les allées et venues de l’esprit1 ». Or avons-nous autre chose, un professeur de philosophie dispose-t-il d’autre chose que de cette expression métaphorique lorsqu’il doit, pour initier ses étudiants à la pensée de Spinoza, ou de Berkeley, ou de Plotin (je cite trois philosophes volontiers commentés par Bergson) ? Lire la philosophie, à en croire ce texte, consisterait donc à interpréter la suite de métaphores en quoi consiste l’œuvre d’un philosophe et à en donner ce qu’on serait tenté d’appeler le sens propre si le reste des propositions de Bergson ne nous décourageait de penser que la chose soit possible.
3Lorsqu’une métaphore se présente au lecteur d’un poème ou à l’auditeur d’un discours, celui-ci n’est pas en peine ordinairement de la déchiffrer, elle est seulement perçue comme un ornement, une manière de dire les choses qui pourraient en effet être dites autrement, plus simplement, sans artifices, en tout cas sans elle. S’agissant du texte philosophique, les choses sont beaucoup plus compliquées, puisque, on va le voir, ce sens propre est postulé par Bergson comme réellement hors d’atteinte. L’expression métaphorique, condition nécessaire de l’énonciation philosophique, est donc une sorte de fatalité, s’il est vrai que le propre dont l’œuvre qu’on lit est l’expression figurée n’a pas d’autre biais que la figure pour se faire connaître.
4« Laissez donc de côté les reconstructions artificielles de la pensée, considérez la pensée même », insiste Bergson dans « l’âme et le corps ». Or, « la pensée même », la pensée nue, la pensée sans ornements, la pensée sans figures, quels moyens avons-nous de l’appréhender ? Rien d’autre au vrai que ces « reconstructions artificielles », auxquelles les philosophes ont consacré tous leurs soins, sans connaître précisément l’intuition à laquelle ils répondaient, ou à laquelle ils se conformaient, ou s’accordaient ou s’efforçaient de s’accorder sans le savoir.
5Telle est du moins la thèse défendue dans « L’intuition philosophique », à laquelle je viens à présent. Dans le texte de cette conférence, où Bergson parle à ses collègues de l’enseignement de la philosophie, il reprend l’idée de l’inadéquation entre la pensée et les idées d’un philosophe, allant jusqu’à dire que « l’expression conceptuelle » dont ils usent et qu’ils élaborent patiemment, précautionneusement, avec toute la rigueur et l’exactitude possibles, est « nécessairement symbolique ». C’est dans cette conférence dont les propositions théoriques, discrètement radicales, sont presque impensables, que Bergson identifie la pensée du philosophe à ce qu’il appelle son « intuition ». Toute la difficulté des enseignants de philosophie vient de la distance qui sépare les hypothèses, propositions, énoncés, exposés, idées, systèmes philosophiques divers et sophistiqués, de l’intuition à laquelle ils donnent une forme appréhendable mais auxquels cette intuition ne saurait en aucun cas être identifiée : « Ce serait se tromper étrangement, dit Bergson, que de prendre pour un élément constitutif de la doctrine ce qui n’en fut que le moyen d’expression2 ».
6La première partie de sa conférence évoque en termes très vraisemblables le travail quotidien de l’enseignant de philosophie qui, pour donner à ses étudiants une idée de la doctrine ou du système d’un grand philosophe, s’efforce de reconstituer la cohérence des courants de pensée de son temps, les affinités, les dissensions, les désaccords qu’il pouvait avoir avec les doctrines, avec les penseurs, avec les artistes ou les grandes personnalités de son époque ; qui passe une bonne partie de son temps d’enseignement, parfois tout son temps, à rapprocher son auteur d’un autre auteur, à identifier une source, à établir une influence, à le distinguer de ses contemporains.
7Cette méthode ordinaire d’enseigner, qui est ce qu’on appelle, sans trop y penser, ni y prendre autrement garde, « lire un philosophe », Bergson entend d’abord en montrer la relativité, tout au moins faire prendre conscience à ses collègues de son insuffisance. Car cette manière de faire ne tient aucun compte d’une expérience de lecture qui, sans être du tout celle qui prévaut dans les classes, diffère de celle qui consiste, pour rendre compte d’une pensée, à seulement l’expliquer :
À mesure que nous cherchons davantage à nous installer dans la pensée du philosophe au lieu d’en faire le tour, nous voyons sa doctrine se transfigurer. D’abord la complication diminue. Puis les parties entrent les unes dans les autres. Enfin tout se ramasse en un point unique, dont nous sentons qu’on pourrait se rapprocher de plus en plus quoi qu’il faille désespérer d’y atteindre.
8C’est cela précisément qui me fait dire que le texte philosophique est pour le philosophe Bergson proprement illisible, à moins qu’on considère l’acte de lecture comme une activité condamnée par nature à l’approximation3. Ce « point unique », qui seul importe à ses yeux, mais que la lecture ordinaire des textes ne permet ni d’apercevoir ni d’appréhender (nous pouvons seulement « sentir qu’on pourrait s’en rapprocher ») est pourtant ce que tout enseignant de philosophie devrait avoir à cœur de connaître et de faire connaître.
9La difficulté, ou plutôt l’impossibilité d’y parvenir, tient à deux choses : d’abord l’extrême simplicité de ce point mystérieux – une simplicité qui s’oppose à l’extrême complexité de l’appareil conceptuel auquel le commentateur ordinaire identifie spontanément la pensée d’un philosophe (« Et ce point est quelque chose de simple, d’infiniment simple, de si extraordinairement simple que la philosophe n’a jamais réussi à le dire ») ; ensuite l’impuissance et l’ignorance du philosophe lui-même quant à la nature, peut-être même à l’existence de ce point (« Quelle est cette intuition ? Si le philosophe n’a pas pu en donner la formule, ce n’est pas nous qui y réussirons »).
10Une seule chose paraît donc certaine, à ce stade de la réflexion, et elle est négative : l’écrit d’un philosophe n’est certes pas ce dont doivent se préoccuper ses lecteurs au premier chef, puisque les textes qu’il nous a laissés ne nous importent qu’autant qu’ils renseignent sur l’intuition qui les incite et qu’ils ne font que transcrire. Or, si cette transcription est « symbolique », toute lecture d’un texte philosophique – et donc de Bergson lui-même – devrait procéder par décryptage, ou déchiffrement, elle devrait elle-même consister en une transcription, et serait donc, par hypothèse, non pas exactement une restitution, mais une interprétation.
11Car s’il faut en effet « désespérer » d’atteindre à ce point unique et mystérieux, dont il est entendu qu’aucune lecture ne donnera jamais la formule, quelle attitude, du coup, adopter devant un texte philosophique ? Comment l’aborder, c’est-à-dire au fond, comment le lire, et même à quoi bon le lire s’il est entendu qu’on ne touchera jamais, par lui, à l’intuition dont pourtant il émane ? On peut supposer que l’enseignement de Bergson a constitué, tout au long de sa carrière4, une illustration de la méthode de lecture qu’implicitement il revendiquait. Une méthode qui sans doute lui disconvenait profondément, puisqu’elle était vouée à l’indirect, et que lui ne voyait de salut que dans l’immédiateté, mais dont la conférence de 1911 peut nous donner une idée. Bergson y énonce en effet quelques-uns des principes de ce que devrait être selon lui une lecture des textes de philosophie.
12Le premier de ces principes est une sorte de « concept », ou « notion », ou « image », ou « symbole », ou « outil » – on voit que le vocabulaire lui-même pose problème dès lors qu’on veut bien admettre les prémisses de Bergson – qu’il nomme « image médiatrice ». Et l’on comprend, à cette précaution que je me sens obligé de prendre pour seulement retranscrire ces deux mots, que les lecteurs de Bergson puissent avoir le sentiment d’être sans cesse au rouet.
13Essayons de dire les choses simplement.
14Lorsque Bergson prétend que l’expression conceptuelle dont usent habituellement les philosophes est symbolique, se considère-t-il lui aussi comme un philosophe usant d’un langage inadéquat, au moins d’un langage inapte (puisque conceptuel) à dire l’intuition ? Si oui, il faudrait admettre que l’œuvre de Bergson est de part en part performative et il s’agirait alors, pour les lecteurs de bonne volonté, de ne pas prendre au pied de la lettre ces assertions dérangeantes et de s’efforcer d’établir de quelle intuition elles sont ou seraient l’expression symbolique. Sinon, il faudrait se demander à quel type d’énonciation peut bien avoir recours Bergson si ce n’est la conceptuelle.
15J’ajoute que dans l’un et l’autre cas, la question se pose nécessairement de savoir si les œuvres de philosophie sont toutes écrites (pour reprendre la formulation de « L’âme et le corps ») « métaphoriquement en quelque sorte », autrement dit si l’expression qu’elles mettent en œuvre est (pour citer cette fois « L’intuition philosophique ») « nécessairement symbolique », ou si elles le sont seulement en partie, et, dans ce dernier cas, s’il existe un moyen – et même s’il est souhaitable – de faire le départ entre les textes ou les passages des textes écrits selon une logique et une écriture conceptuelles et les autres.
16La question est d’autant plus délicate que Bergson, qui n’a cessé à la fois de recourir à des métaphores et de commenter ce recours5, a énoncé à ce propos une hypothèse qui ne contribue pas précisément à faciliter les choses.
17Lorsqu’il décide dans les années 20 de rassembler les textes qui formeront La Pensée et le mouvant, il rédige deux textes, qu’il présentera comme deux parties d’une même introduction, dans lesquels il s’explique sur sa méthode et où il fait le point sur l’usage de la métaphore en philosophie. Il est frappant de constater d’ailleurs qu’il ne sépare jamais, ni dans cette double introduction ni nulle part dans son œuvre, la question épistémologique de la question pour lui cruciale de l’expression. Elle n’est évidemment pas à ses yeux un ornement, mais il n’est même pas sûr qu’elle soit exactement une métaphore. Ce texte confondant ferait presque dire que la langue philosophique est naturellement métaphorique – ou que, cela revient pratiquement au même, la métaphore, à strictement parler, n’existe pas. La difficulté de statuer vient d’une contradiction fondamentale, ou, si l’on veut, d’une fatalité épistémologique que résume parfaitement l’énoncé suivant : « L’intuition ne se communiquera d’ailleurs que par l’intelligence ». Ce qui implique, si on lit bien, qu’un langage philosophique adéquat n’existe sans doute pas (le langage est par nature inadapté à l’entreprise philosophique6), mais qu’un langage qui ferait (tant bien que mal) l’affaire emprunterait à la fois à l’intuition et à l’intelligence. C’est cette double exigence qui rend nécessaire et légitime ce que Bergson nomme précisément une « transposition » :
Comparaisons et métaphores suggéreront ici ce qu'on n'arrivera pas à exprimer. Ce ne sera pas un détour ; on ne fera qu'aller droit au but. Si l'on parlait constamment un langage abstrait, soi-disant « scientifique », on ne donnerait de l'esprit que son imitation par la matière, car les idées abstraites ont été tirées du monde extérieur et impliquent toujours une représentation spatiale : et pourtant on croirait avoir analysé l'esprit. Les idées abstraites toutes seules nous inviteraient donc ici à nous représenter l'esprit sur le modèle de la matière et à le penser par transposition, c'est-à-dire, au sens précis du mot, par métaphore. Ne soyons pas dupes des apparences : il y a des cas où c'est le langage imagé qui parle sciemment au propre, et le langage abstrait qui parle inconsciemment au figuré7.
18C’est l’un de ces textes qui rendent tellement problématique à mes yeux la lecture de Bergson – pour ne nommer que lui (car si on le créditait de la moindre vraisemblance, c’est toute la philosophie qui devrait être relue à son aune). S’il est relativement aisé d’admettre que la métaphore dont usent si fréquemment les philosophes, loin d’être un tour, ou un détour, est au contraire la seule manière qui vaille de s’exprimer pour qui veut faire sa place à l’intuition, qui incite l’écriture de la philosophie, il est beaucoup plus difficile de penser que toute expression à première vue non métaphorique est en réalité « une transposition, c’est-à-dire, au sens précis du mot, une métaphore ». Pour prendre immédiatement un exemple8, comment lire, dans la Critique de la raison pure, les pages que Kant consacre au jugement synthétique a priori, s’il est vrai que les énoncés qui établissent son existence et démontrent sa pertinence sont la « transposition » d’une réalité d’un autre ordre – de quelque ordre qu’il s’agisse, d’ailleurs ? On peine d’ailleurs à imaginer les critères qui permettraient de comprendre les principes qui ont présidé à la transposition. Et pourtant, se fier à leur énoncé sans soupçonner qu’ils sont une transposition serait à en croire Bergson, une erreur méthodique fatale. On voit que la lecture de tels textes, pour peu qu’on souscrive à ces prémisses, est de l’ordre de l’impossible.
19C’est à cette fin, on peut le croire, que Bergson forge donc cet outil étrange qu’il nomme, assez mystérieusement il faut en convenir, « image médiatrice ». Précisément située entre cette intuition précieuse et hors d’atteinte qui devrait être l’unique préoccupation du lecteur d’un texte philosophique, et l’appareil conceptuel produit par le philosophe et auquel on identifie à tort sa pensée9, l’image médiatrice est présentée par Bergson comme une sorte de fantôme, et c’est précisément parce qu’elle « hante » l’esprit du philosophe qu’elle est un outil possible pour le lecteur de bonne volonté, sa présence récurrente faisant signe vers l’intuition qu’elle imite. Voici ce texte :
Ce que nous réussirons à ressaisir et à fixer, c’est une certaine image intermédiaire entre la simplicité de l’intuition concrète et la complexité des abstractions qui la traduisent, image fuyante et évanouissante, qui hante, inaperçue peut-être, l’esprit du philosophe, qui le suit comme son ombre à travers les tours et les détours de sa pensée et qui, si elle n’est pas l’intuition même, s’en rapproche beaucoup plus que l’expression conceptuelle, nécessairement symbolique, à laquelle l’intuition doit recourir pour fournir des « explications ». Regardons bien cette ombre : nous devinerons l’attitude du corps qui la projette. Et si nous faisons effort pour imiter cette attitude, ou mieux, pour nous y insérer, nous reverrons, dans la mesure du possible, ce que le philosophe a vu10.
20Pour donner une idée de ce que pourrait être une lecture répondant à ces principes – et à cette exigence – Bergson prend dans cette conférence un exemple assez parlant, celui d’un texte réputé difficile, et pourrait-on ajouter, qui ne donne pas le sentiment d’être le moins du monde métaphorique : celui de Spinoza. S’adressant – il faut le rappeler sans cesse – à des collègues enseignants de philosophie dont le travail est d’aider les étudiants à lire Spinoza, il entreprend de caractériser ce qui fait très souvent les délices des lecteurs et des commentateurs professionnels qu’ils sont, à savoir l’aridité sèche, la complication pesante d’un texte écrit non pas poétiquement mais, comme on sait, more geometrico. À propos des concepts canoniques de L’Éthique, Bergson évoque, non sans humour
ces choses énormes qui s’appellent la Substance, l’Attribut et le Mode et le formidable attirail des théorèmes avec l’enchevêtrement des définitions corollaires et scolies, et cette complication de machinerie et cette puissance d’écrasement qui font que le débutant, en présence de L’Éthique, est frappé d’admiration et de terreur comme devant un cuirassé du type Dreadnought.
21Or, il faut bien reconnaître que le travail de lecture des professeurs de philosophie consiste ordinairement à mettre en relation, et à restituer la logique abstraite de ces concepts fondamentaux du spinozisme, sans rien soupçonner de simple ni de léger sous leur apparence austère. La thèse de Bergson est double.
22D’une part il n’y a pas de mesure commune entre cette intrication conceptuelle ardue et la simplicité de l’intuition de Spinoza, et l’on doit donc pouvoir formuler à propos de L’Éthique quelques propositions simples, voire très simples, qui pour rendre compte de son apport, ne recourent pas à son vocabulaire conceptuel. Même s’il est plutôt surprenant de lire sous la plume de Bergson qu’il y a chez Spinoza « quelque chose de subtil, de très léger et de presque aérien, qui fuit quand on s’en approche, mais qu’on ne peut regarder, même de loin, sans devenir incapable de s’attacher à quoi que ce soit du reste, même à ce qui passe pour capital, même à la distinction entre la Substance et l’Attribut, même à la dualité de la Pensée et de l’Étendue », on se dit qu’on tient là l’un de ces principes de lecture mystérieux – et plutôt difficiles à mettre en œuvre – dont « L’intuition philosophique » veut nous donner l’idée11.
23D’autre part – et cette conséquence inattendue n’est pas moins surprenante – s’il est vrai que la reconstruction historique, contextuelle, conceptuelle n’approchera jamais la simplicité de l’intuition, il faut encore admettre que le spinozisme n’a rien à voir ni avec ses interlocuteurs du moment, ni avec son temps, ni même avec ses concepts, eux-mêmes nécessairement datés. Ce qui fait dire à Bergson que « plus nous remontons vers cette intuition originelle, mieux nous comprenons que si Spinoza avait vécu avant Descartes, il aurait sans doute écrit autre chose que ce qu’il a écrit, mais que Spinoza vivant et écrivant, nous étions sûrs d’avoir le spinozisme tout de même ». Voilà qui contrevient de façon spectaculaire aux pratiques de lecture ordinaire des textes philosophiques, à l’école ou ailleurs !
24Il est un autre principe de lecture que suggère ce texte de Bergson, décidément très riche, c’est celui de l’empathie. On aura peut-être noté la curieuse formulation qui ouvre la réflexion sur la lecture : « Et si nous faisons effort pour imiter cette attitude, ou mieux, pour nous y insérer, nous reverrons, dans la mesure du possible, ce que le philosophe a vu » (je souligne). Le mot d’empathie ne fait pas encore en 1911 partie du vocabulaire théorique, et Bergson parle plutôt, lorsqu’il évoque la démarche d’écriture du philosophe, de « sympathie » : « La règle de la science est celle qui a été posée par Bacon : obéir pour commander. Le philosophe ne commande ni n’obéit ; il cherche à sympathiser. » Ce mouvement de sympathie est exactement le même que celui qui est requis du lecteur de bonne volonté. Pour bien lire un texte, il faudra donc renoncer à en faire le tour (à rester à l’extérieur et à en dire les contours), il faudra « imiter » l’attitude de son auteur, et « s’insérer » dans l’épaisseur vivante de son texte. C’est ce que Bergson appelle « s’installer dans la pensée du philosophe ». Le contact avec l’œuvre philosophique, pour être fructueuse, doit être fréquent, sans cesse renouvelé, on voit qu’il doit ainsi opérer « une imprégnation graduelle ». Seul en effet ce frottement, seul ce commerce étroitement rapproché est susceptible de faire lire autrement les œuvres de philosophie. On songe, lisant cela, à la manière de certains commentateurs ou critiques littéraires12 et l’idée vient à l’esprit que pour Bergson il n’est pas impossible que la lecture des textes philosophiques doive être conduite selon les mêmes principes que celle des romans ou des poèmes.
25Les lecteurs de Bergson savent en effet qu’il fait très souvent référence aux œuvres d’art (à la peinture, à la poésie, à la musique), lors même que c’est de l’écriture de la philosophie qu’il est question.
26Car les règles de composition du texte philosophique, le processus de son élaboration – et partant de sa lecture – sont nécessairement affectés par l’intime conviction que l’intuition plutôt que le conceptuel est ce qui est en jeu dans l’exercice de la philosophie. La question de l’expression, on l’a vu dans l’Avant-propos des Données immédiates de la conscience, est au cœur de l’entreprise philosophique de Bergson. Comme un poète, comme un romancier, comme un dramaturge, le philosophe est donc confronté à la question de l’imitation, soit de la mimesis.
27Voici par exemple quelques considérations sur le rapport que le philosophe peut entretenir avec les mots lorsqu’il écrit :
Les mots auront beau alors être choisis comme il faut, ils ne diront pas ce que nous voulons leur faire dire si le rythme, la ponctuation et toute la chorégraphie du discours ne les aident pas à obtenir du lecteur, guidé alors par une série de mouvements naissants, qu’il décrive une courbe de pensée et de sentiments analogue à celle que nous décrivons nous-mêmes. Tout l’art d’écrire est là. C’est quelque chose comme l’art du musicien13.
28Autrement dit, si le langage du philosophe diffère du langage ordinaire ce n’est pas à la manière du langage des savants ou des philosophes « techniques ». Non. Ce serait plutôt à la manière du langage poétique, celui d’un Claudel par exemple qui disait : « Les mots que j’emploie, ce sont les mots de tous les jours et ce ne sont pas les mêmes14. » Les mêmes, car le philosophe selon Bergson n’a pas à forger un langage propre – tout lecteur de Bergson est frappé par l’absence chez lui de tout jargon ; et pourtant différents, s’il est vrai que le langage quotidien, dont a vu qu’il est pour la philosophie, si on le laisse fonctionner selon la loi de la communication ou de la science, un outil imbécile, doit être travaillé poétiquement. Pour qui douterait que le philosophe doive, écrivant, se faire artiste, au moins se comporter en artiste, il n’est qu’à lire ces quelques considérations sur l’écriture philosophique :
C’est quelque chose comme l’art du musicien ; mais ne croyez pas que la musique dont il s’agit s’adresse simplement à l’oreille, comme on se l’imagine d’ordinaire [… Il s’agit de tout autre chose que d’une harmonie matérielle des sons. En réalité, l’art de l’écrivain consiste surtout à nous faire oublier qu’il emploie des mots15.
29« L’harmonie [que cherche le philosophe, dit-il encore, est une certaine correspondance entre les allées et venues de son esprit et celles de son discours, correspondance si parfaite que, portées par la phrase, les ondulations de sa pensée se communiquent à la nôtre et qu’alors, chacun des mots, pris individuellement, ne compte plus ».
30Or l’enseignant de philosophie, ni d’ailleurs le simple lecteur du texte de philosophie, ne sont habitués à observer « la chorégraphie du discours », leur réflexe n’est certes pas de faire abstraction des mots que le philosophe a, pensent-ils ordinairement, choisis avec une rigueur et une exactitude comparables à celles du savant. Quelle est donc cette philosophie qui doit « faire oublier qu’[elle emploie des mots » ? et surtout, comment faut-il la lire si dans l’énoncé ourdi par le philosophe les mots ne sont pas ce qui importe, si le mot ne compte plus ! La tâche du commentateur, on le voit, est presque impossible ! Plutôt que de prêter attention aux mots (réellement insignifiants), il devra se montrer sensible aux intervalles qui les séparent, à ce qui les traverse, à ce que « l’ondulation de la pensée » leur communique. Dans un texte bien peu cité des Deux sources de la morale et de la religion, Bergson nous donne pourtant quelques indications. Elles sont précieuses, puisque, caractérisant l’écriture de la philosophie qui répondrait à ses attentes, il nous livre aussi quelques principes de lecture. Principes quelque peu dérangeants, on va le voir, et surtout assez difficiles à mettre en œuvre. On déconseillerait en tout cas à un élève de terminale de se risquer à en faire l’épreuve dans son commentaire de texte philosophique le jour du bac…
31Cette écriture, la chose ne surprendra plus à ce stade de la réflexion, « consiste à remonter, du plan intellectuel et social, jusqu’en un point de l’âme d’où part une exigence de création ». Le philosophe n’est donc pas un homme qui combine des idées, qui les reprend en les modifiant, ou en les revivifiant ; c’est un créateur. Cela implique pour le lecteur un effort constant d’attention non pas au sens des mots, mais à leurs sonorités, à leur étymologie, à leur éventuel retour, aux variations dont ils sont l’occasion ou le prétexte, à la configuration du discours, à l’ordonnancement des parties et même peut-être à la succession des textes et des ouvrages, sur laquelle Bergson tient des propos tout aussi insolites16.
32Parlant de cette écriture qu’il ne cesse dans les dernières années d’appeler de ses vœux, il semble que Bergson parle avant tout de sa propre exigence, de sa propre inquiétude, peut-être même de sa propre incertitude. La comparant à l’écriture ordinaire des textes, il dit de cette écriture, qui sera certes aussi difficile à lire et à interpréter qu’elle a été difficile à produire, qu’elle est « moins sûre, incapable de dire quand elle aboutira et même si elle aboutira ». La tentation – incroyable tentation pour un philosophe ! – pourrait se faire jour, dit-il, de « forger des mots, créer des idées » ; « mais, ajoute-t-il aussitôt, ce ne serait plus communiquer, ni par conséquent écrire ». Si la tâche est si ardue, et si improbable, c’est précisément parce que le seul langage à disposition est le langage existant, qu’il faudra donc assujettir au projet philosophique. Il s’agit si l’on veut, de partir de mots existants, peut-être d’idées déjà formulées, et sans les mutiler, sans les nier, d’inventer des mots non pas exactement nouveaux mais fonctionnant sur une logique différant de celle du dictionnaire, et ainsi de faire que puisse s’apercevoir – se lire aussi, à qui serait doué d’un œil critique et philosophique aigu – des idées nouvelles. Tâche tout simplement « irréalisable », à en croire Bergson lui-même. Mais qui répond à une nécessité épistémologique implacable, et qui n’adviendra pas sans une certaine violence : « Il faudra violenter les mots, forcer les éléments ». « Le succès, précise-t-il, ne sera jamais assuré ; l’écrivain se demande à chaque instant s’il lui sera bien donné d’aller jusqu’au bout ».
33Faut-il préciser que le langage bergsonien passe rarement (en fait, ne passe jamais) pour un langage violent, et que cette violence, cette incertitude qu’elle accompagne et qui la justifie, que Bergson dit souhaitables, nécessaires et même salutaires, passent le plus souvent et aux yeux de la plupart des lecteurs savants, presque complètement inaperçues ?
34Ce qui appartient en propre à Bergson, me semble-t-il, c’est la tenue simultanée d’un discours philosophique original auquel, sans doute, l’histoire de la philosophie a fait depuis longtemps sa place – une place qu’elle réévalue d’ailleurs régulièrement, comme elle le fait de toute œuvre qui compte ; mais en même temps d’une réflexion sur l’écriture et la lecture des textes philosophiques dont elle n’est en réalité pas séparable. On a vu que la première phrase de cette œuvre propose la prise en compte de cette intrication comme un programme. La solidarité, selon moi non fissible, de ces deux discours pose des problèmes dont l’importance n’est que très rarement notée, quand elle l’est, par les commentateurs, même spécialistes de Bergson. Cette omission, ou cette ignorance, en tout cas cette sous-évaluation se fait évidemment et avant tout aux dépens de Bergson lui-même, qui est donc lu, on peut le prétendre et craindre de le prétendre avec raison, comme il n’aurait pas aimé qu’on le lise, c’est-à-dire comme s’il n’avait jamais rien dit qui vaille pour lui contre l’écriture abstraite, conceptuelle, logique, intelligente ; comme s’il n’avait jamais prôné une autre lecture que celle qui se conforme aux schémas valant pour l’énonciation scientifique ou la simple communication sociale. Mais la réduction de cette œuvre à sa dimension strictement spéculative, laissant de côté la délicate question de savoir ce qu’elle doit à l’intuition à la promotion de laquelle il n’est pas exagéré de dire qu’il a consacré son œuvre, empêche aussi de poser, grâce à lui, la question plus générale de la lecture des textes philosophiques. Question cruciale pour une discipline qui sans jamais le prétendre nûment s’est toujours comportée comme si l’appareil de langage édifié pour l’expression de ses thèses ne devait compter pour rien dans leur appréhension et leur évaluation. Qu’il existe une textualité philosophique, il n’est plus possible d’en douter si on veut bien lire Bergson – si on veut le lire bien. Qu’elle réclame du coup une autre lecture de ces textes, il me semble que c’est le chantier que Bergson a ouvert pour nous et que ce serait lui manquer grièvement que de continuer à l’ignorer.