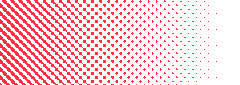L’absente de toutes bibliothèques. Disparitions en série dans la littérature contemporaine.
1Qui donc en veut à l’œuvre littéraire au point de chercher à toute force à lui faire passer l’arme à gauche ? Les faits parlent d’eux-mêmes ; Henri Lefebvre publie en 2004 sous le titre Les Unités perdues1un inventaire qui court sur quelque cent six pages :
« Assassin, espérance des femmes, opéra de vingt minutes, composé en 1919 par Paul Hindemith •Le roman Theodor de Robert Walser • Les lettres de Milena Jesenska à Franz Kafka • Heinrich von Kleist brûle le manuscrit de Robert Guiscard, duc des Normands et tente de s’engager dans l’armée napoléonienne quand le poète Wieland lui fait part de son admiration pour ce texte • Disparus, les poèmes de Robert Creeley qui jonchaient, les nuits d’ivresse, le parquet de la maison de Brautignan à Bolinas ; celui-ci les ramassait le matin et les disposait dans un bol sur son piano « pour la postérité » disait-il •Le Journal d’Annemarie Schwarzenbach, détruit par sa mère •La Confusa, comédie de Miguel de Cervantes •Jean Giono tourne en 1933 et en 1937-1938 quelques fragments de films poétiques, sans personnages ; ces documents n’existent plus […] »
2Le livre, entièrement constitué d’un inventaire de ces disparitions en série, déploie une litanie de textes fantômes et autres pièces « inachevées, disparues, détruites ou parfois même jamais réalisées2 ». Et il suffit de jeter un œil à la littérature contemporaine pour crier à la conspiration, ou du moins à l’association de malfaiteurs. Dans Œuvres (2002), Édouard Levé donne à lire un texte programmatique, qui énumère « des œuvres dont l’auteur a eu l’idée, mais qu’il n’a pas réalisées3 » ; Jean-Yves Jouannais propose un catalogue d’Artistes sans œuvres4(1997), qui a été l’occasion d’un dialogue épistolaire et de jeux de citation mutuels avec Enrique Vila-Matas, lui-même auteur de Bartleby et compagnie5(2002), roman dans lequel un écrivain ayant renoncé à la littérature entreprend d’écrire sur ces « écrivains négatifs » qui, comme le personnage de Melville, ont préféré s’abstenir. À ces inventaires pourraient s’ajouter des œuvres structurées autour de l’exposition d’une absence, tel que Banlieue (1990) de Paul Fournel, texte en forme de page blanche, uniquement constitué de son péritexte et dont le principal mérite est de ne pas exister. Dans Un ABC de la barbarie, Jacques-Henri Michot (1999), empruntant aux stratégies romanesques où un éditeur rapporte les circonstances dans lesquelles il est entré en possession d’un manuscrit perdu, superpose quant à lui deux ouvrages encyclopédiques avortés : un dictionnaire des « bruits », stéréotypes et expressions courantes véhiculés par une langue quotidienne barbare, et une liste de titres et de citations d’artistes ou de penseurs, tandis que les notes en bas de page tissent en filigrane le roman absent d’une amitié entre les trois auteurs fictifs de ces projets. Ainsi le topos de l’œuvre perdue ou illisible, longtemps mobilisé comme ressort narratif chargé de lancer l’enquête et d’ouvrir la fiction, dans ses marges, à un possible non actualisé au sein du texte, se voit-il érigé en un tout de l’écriture : l’auteur ne cherche nullement à combler cette lacune ou à en détourner le lecteur, mais uniquement à la recenser ou à la délimiter. Il donne ainsi lieu à de nouvelles formes littéraires dans lesquelles la disparition supplante le récit, au lieu d’en constituer le point de départ ou le point de fuite.
3Une telle hécatombe a tout lieu d’inquiéter les études littéraires, d’autant que les œuvres, comme le père d’Hamlet, ont une fâcheuse tendance à revenir sous forme de fantômes pour réclamer leur dû, et que la discipline a été confrontée à de notables précédents – ainsi Roland Barthes préférait-il l’auteur mort plutôt que vif, et n’hésitait pas à le pousser gentiment dans la tombe6. Malgré l’absence de corps, il n’est pas interdit de chercher à cerner le coupable, de s’efforcer de dégager des mobiles et de reconstituer le réseau possible des complicités. C’est une telle enquête que l’on se propose de mener ici afin de sonder la présence obsédante des œuvres fantômes dans la production et la théorie contemporaines. Absentes de tous musées et de toutes bibliothèques, elles manifestent l’importance d’un régime ontologique des œuvres, la virtualité, qui se trouve singulièrement valorisé dans l’imaginaire artistique et littéraire actuels, et qui n’est pas sans menacer de désintégration l’ensemble de la bibliothèque.
***
I. Trois suspects, et autant de permutations
1. Des écrivains qui écrivent à peine
4Si les écrivains sont légitimement les premiers suspects, il n’est pas aisé de délimiter clairement leurs motivations, pas plus que leur part de responsabilité dans cette affaire ; d’autant qu’ils s’attachent à brouiller les pistes, et à se présenter moins comme auteurs (au double sens de responsables d’un acte et d’écrivains) que comme de simples greffiers chargés de tenir le registre de ces disparitions dont on peut commencer, avec eux, par dresser une petite typologie. Entre le panthéon réel des œuvres accessibles et la pure absence, les limbes de la bibliothèque s’échelonnent selon différents degrés d’existence, comme autant de rayonnages où classer les textes fantômes. Tous ne sont pas incompatibles avec une actualisation, mais celle-ci se voit toujours reléguée dans un autre temps que le présent : elle peut appartenir au passé, comme dans le cas des œuvres détruites, brûlées ou perdues qu’énumère Henri Lefebvre ; ou bien elle peut être repoussée dans un futur hypothétique, dans le cas des projets d’Édouard Levé. Après la parution du livre, l’artiste et écrivain a d’ailleurs réalisé une partie de ces œuvres en puissance, leur faisant ainsi quitter le musée fantôme pour rejoindre des lieux d’exposition réels. À l’autre extrémité du spectre se situent les œuvres à qui toute possibilité d’actualisation a été et reste refusée, car incompatible avec les données du monde actuel. On compte parmi elles les œuvres mortes-nées, qui n’ont jamais quitté les méandres d’un cerveau créateur, comme la Vita Nova ébauchée par Roland Barthes ou la poésie de Jacques Vaché, que commente J.-Y. Jouannais. À cela s’ajoute la masse des textes qui auraient pu exister dans d’autres mondes, si l’histoire avait suivi un cours différent. Pour Marcel Cohen, nos bibliothèques comportent ainsi « de grands trous invisibles » :
Sur les murs du Panthéon, à Paris, on trouve les noms de 560 écrivains français tués entre 1914 et 1918. Sous cette liste, une seconde mentionne 197 auteurs tués pendant la Seconde Guerre mondiale. On ne peut pas croire que ces écrivains auraient laissé la littérature française dans l’état où nous l’avons trouvée. À la lueur des textes qu’ils auraient écrits, nos propres livres feraient sans doute pâle figure. En ce sens, nous sommes tous des survivants et cette condition ne va pas sans une part d’arriération. Si l’on ajoute les pertes subies par les littératures allemande, américaine, russe, anglaise, italienne, japonaise, nos bibliothèques sont remplies de « fantômes » que nous en ayons ou non conscience : « fantôme » est le mot désignant la fiche placée dans les rayonnages en lieu et place d’un livre prêté7.
5Cette petite typologie de l’absence est donc tendue entre deux pôles, qui correspondent aux deux visages du fantôme. L’une, du côté de la perte, est tournée vers un passé qui revient sur le mode de la hantise ; l’autre privilégie dans le spectre sa capacité d’échapper au couple présent/absent au profit d’un troisième mode d’existence, qui relève de la potentialité et permet la projection d’un désir. Si des auteurs comme Sebald ou M. Cohen regardent les œuvres fantômes d’un œil mélancolique, elles renferment pour d’autres, au rang desquels P. Fournel, E. Vila-Matas et É. Levé, un horizon infini de possibles. Il n’est sans doute pas entièrement anodin que ces deux approches se manifestent également dans la théorie littéraire française, à travers deux tendances qui modifient actuellement le paysage des études littéraires : d’un côté un intérêt marqué pour le rapport que la littérature entretient à l’histoire, au témoignage, au document, et qui réfléchit la manière dont la production littéraire traite de la violence historique ; de l’autre un courant théorique et critique qui prend acte des bouleversements que la seconde moitié du vingtième siècle a fait subir aux notions d’auteur, d’œuvre et de texte, et envisage l’œuvre comme matrice de développements potentiels, lieu de déploiement d’une activité créatrice, qu’elle soit interprétative ou fabulatrice.
6Mais cette disparition des œuvres dissimule aussi un second effacement, qui tient à l’activité de l’écrivain, singulièrement réduite. Les Unités perdues en est l’exemple le plus radical, qui reconduit la disparition dans son propre processus d’écriture, celui-ci étant limité au rassemblement d’œuvres perdues. Comme chez J.-Y. Jouannais et P. Fournel, le texte littéraire se transforme en dispositif de ressassement et d’exposition de l’absence d’œuvre avec une affinité marquée pour une esthétique des ruines, à mi-chemin entre le jeu borgésien et la mélancolie sebaldienne. Ce qui est mort et revient sur le mode fantomatique, c’est l’idée même de production littéraire au sens traditionnel du terme, supplantée par un syndrome de Bartleby qui semble contaminer les écrivains eux-mêmes. L’auteur, déjà moribond depuis la fin des années soixante, renonce alors à ses prérogatives habituelles et se replie sur les formes caractéristiques du métadiscours littéraire, largement exploitées avant cela par Borges. É. Levé et H. Lefebvre produisent des inventaires ou des catalogues, P. Fournel mime tous les stéréotypes du discours critique (de la note en bas de page à la préface apocryphe et au dossier pédagogique censément rédigé par un inspecteur académique), tandis que l’ouvrage de J.-Y. Jouannais joue de l’hésitation en produisant un essai hybride, que prolonge le dialogue avec le roman d’E. Vila-Matas. Si le fantôme est cet être insituable qui transgresse la limite censée distinguer le monde des morts de celui des vivants, l’œuvre fantôme, quant à elle, semble brouiller le partage entre écriture et commentaire. Et si les écrivains miment les formes du discours scientifique, c’est peut-être en suivant cette nouvelle piste qu’il convient de se demander à qui profite le crime.
2. Des critiques qui écrivent plus que de raison
7Entendu comme mode d’existence entre la présence et l’absence, le fantôme intéresse l’ontologie du littéraire – et avec elle le discours théorique et critique. Le brouillage n’est pas le seul fait des écrivains : en témoignent les réflexions menées dans le domaine des sciences humaines dont certains représentants, à l’image de Roger Chartier, se lancent dans des enquêtes qui n’ont rien à envier à un récit de chasse au trésor ou d’énigme policière8. Au sein des études littéraires, il semble avoir franchi une nouvelle étape avec la théorie des textes possibles, qui invite, dans la lignée des « contre-enquêtes » menées par Pierre Bayard, à « traquer dans les œuvres déjà faites la trace de scénarios abandonnés ou de livres qui restent à écrire9 ». Cette proposition théorique ébranle la stabilité qui semblait garantie par la publication d’un texte unique et invite à invoquer les récits fantômes. Les pratiques critiques auxquelles elle donne lieu entérinent le passage à un nouveau mode de consommation littéraire, dans lequel l’œuvre existe selon un double régime, effectif et virtuel, avec un appel à dépasser le texte donné pour se livrer à l’exploration de ces multiples versions possibles qu’avaient jusqu’à présent dissimulées la croyance en l’unicité de l’œuvre et le respect pour les choix de son auteur. Si une telle critique est créative, ce n’est pas tant parce qu’elle propose un nouveau texte destiné à supplanter l’original, que parce qu’elle instaure entre les variantes une hésitation, un va-et-vient propre au fantôme, dont on ne sait jamais à quel monde il appartient en propre. Comme les œuvres évoquées plus haut, elle envisage d’abord le texte littéraire comme un espace à investir par le lecteur, lequel n’est pas cantonné au déchiffrement, mais convié à participer activement à l’élaboration de l’œuvre. Alors que les écrivains, d’É. Levé à H. Lefebvre, s’attellent à des tâches (recenser, cataloguer, lister ou décrire) qui sont traditionnellement l’apanage du scientifique (de l’entomologiste, de l’archéologue, de l’archiviste), les critiques littéraires s’affranchissent du rôle qui leur est traditionnellement assigné en tant que producteurs d’un discours second et revendiquent cette liberté nouvellement conquise : « Voici que le théoricien se dit capable, non seulement de lire ce qui est, mais de produire un nouveau texte. Voilà brouillé le partage des tâches entre l’auteur inventeur et le théoricien lecteur10 », écrivent Marc Escola et Sophie Rabau. On tient là, de toute évidence, ce qui ressemble à un mobile, lequel n’a rien d’inédit dans l’histoire des actes criminels : l’usurpation de l’autorité. Dans son célèbre article de 1968, Roland Barthes affirmait que la mort de l’auteur se payait d’une naissance du lecteur. Celui-ci, largement émancipé depuis, et avec une louable tendance à l’ingratitude, poignarde aux yeux de tous le texte qui l’a nourri, et place sur le trône son propre rejeton.
8Il existe néanmoins une différence de taille entre la méthode de lecture amorcée par la critique des textes possibles et les espaces ouverts par les œuvres fantômes. Dans le premier cas, les théoriciens disposent d’un texte qui constitue une version à partir de laquelle élaborer la leur, en repérant les endroits où le texte dysfonctionne et semble laisser entrevoir une solution alternative à son déroulement. Dans les catalogues élaborés par J.-Y. Jouannais, E. Vila-Matas, É. Levé ou H. Lefebvre, le lecteur ne dispose d’aucun texte de départ, mais uniquement de pistes, de descriptions lapidaires et d’idées vagues à partir desquelles imaginer l’œuvre absente. Ces ouvrages radicalisent en quelque sorte la proposition des théoriciens qui tiennent le texte pour incomplet et, laissant la place vacante, devancent leur travail consistant à le questionner comme totalité close. Si l’actuel n’est jamais qu’un possible parmi d’autre, pourquoi ne pas s’en dispenser ? Il est donc nécessaire de distinguer entre le texte fantôme (perdu, inachevé, simplement évoqué au détour d’un autre texte) et le texte possible (construit par le commentateur à partir d’un texte existant dont il présente une version alternative). Dans les deux cas, on a affaire à un texte qui n’est pas pleinement réalisé dans l’œuvre lue, mais à construire par le lecteur ; la différence tient au rapport que le texte produit (effectivement ou virtuellement) par le commentateur entretient au texte « original » : rapport de concurrence pour l’un, de simple complémentarité pour l’autre. Alors que le critique des textes possibles doit batailler avec une version donnée, que d’aucuns répugnent à voir dépossédée de sa primauté, les textes fantômes le laissent en paix : ils ne lui opposent pas de variante actualisée qu’il lui faudrait contester, mais uniquement un titre ou une amorce de description.
9Ce faisant, néanmoins, ils lui coupent aussi l’herbe sous le pied, en le privant du matériau textuel dont il nourrit ses analyses. Ils posent ainsi la question suivante : si tout texte est toujours lacunaire et partiel, jusqu’à quel point une œuvre peut-elle être constituée de blancs ? Au-delà de la seule théorie des textes possibles, la question interpelle l’ensemble des théories de la lecture, dans lesquelles le manque joue un rôle fondamental. Roman Ingarden a ainsi montré que les objets fictifs, contrairement aux objets réels, ne sont que partiellement caractérisés : certaines de leurs propriétés (la couleur des yeux d’un personnage, par exemple) sont indéterminées. Il existe ainsi dans la fiction des « lieux d’indétermination » (« Unbestimmtheitsstellen ») qui impliquent de la part du lecteur qu’il contribue à la constitution du monde fictif en l’investissant de son imagination, c’est-à-dire en le « concrétisant11 » – comme y invitent les textes programmatiques d’É. Levé et d’H. Lefebvre. Wolfgang Iser parle quant à lui de « blancs » (« Leerstellen ») entendus comme des « discontinuités » textuelles, qui exigent du lecteur une activité intense de production du sens du texte12, là où Michel Charles identifie des « éléments fantômes13 », cachés mais suggérés, et qui fondent le processus d’interprétation.
10Il y a donc une nécessité du manque, qui participe de l’efficacité du texte fictionnel et qui est la condition d’une critique des textes possibles14. Mais ces blancs ne fonctionnent comme tels que s’ils sont limités et viennent trouer un texte existant. Dans le cas des catalogues d’œuvres fantômes, l’absence de trame narrative interdit la collecte d’indices destinés à combler le manque ; d’où la nécessité, pour pallier cette carence, d’en passer par d’autres méthodes – et pour cela de sortir du texte. C’est à une telle tâche que s’est attelé Roger Chartier dans Cardenio entre Cervantès et Shakespeare, qui propose une enquête à partir d’une pièce perdue de Shakespeare, dont ne subsistent que quelques indices. Encore l’entreprise n’est-elle envisageable que pour des œuvres qui ont effectivement existé et qui ont laissé des traces, ou que l’on peut tenter d’inférer à partir de leur contexte littéraire, éditorial, culturel, historique et politique d’émergence. Une telle démarche se situe au-delà de la critique des textes possibles : cette dernière, si elle cèle la tombe de l’auteur, ne touche pas à la notion de texte, qui en constitue la pierre angulaire.
3. Des artistes qui pensent au lieu de faire
11Si ce n’est donc pas non plus du côté des défenseurs des textes possibles que l’on aurait intérêt à faire disparaître les œuvres, d’où vient alors cette fâcheuse tendance à vouloir s’en passer ? Une nouvelle piste se dessine avec É. Levé, dont la particularité est d’être un agent double, à la fois écrivain et artiste plasticien. L’ensemble de son œuvre entretient des affinités avec les artistes regroupés sous l’étiquette problématique de « conceptuels », qui ont valorisé l’idée au détriment de la pratique plastique et procédé à la dématérialisation de l’objet d’art. L’art conceptuel au sens strict, selon certains historiens de l’art, propose une auto-investigation de l’art en tant que concept : il travaille à la définition de l’art et de ses conditions d’exposition et de diffusion, suivant le projet défini par Joseph Kosuth d’« Art as Idea15». On peut néanmoins lui associer un ensemble plus vaste de pratiques, arts d’« idées » faisant usage du langage, comme celui de Lawrence Weiner, dont certaines œuvres consistent tout entières en propositions écrites. Celles-ci (par exemple le fait de lancer une balle dans les chutes du Niagara) peuvent ou non être réalisées, suivant la célèbre définition de Sol LeWitt dans ses Paragraphs on conceptual art :
In conceptual art the idea or concept is the most important aspect of the work. When an artist uses a conceptual form of art, it means that all of the planning and decisions are made beforehand and the execution is a perfunctory affair. The idea becomes a machine that makes the art16.
12Le mot employé par LeWitt, « perfunctory », renvoie à une activité de routine, de pure forme ou accessoire. Il concerne l’exécution de l’œuvre, mais pourrait aussi s’appliquer à l’objet : si l’exécution est de pure forme, alors le résultat est en quelque sorte accessoire – il est la trace inessentielle d’une idée essentielle. C’est ce que manifestent plusieurs œuvres de Lawrence Weiner, lesquelles prennent la forme d’un énoncé qui peut changer de forme (les lettres sont de taille variable et les mots peuvent être traduits), et qui constitue la « machine » linguistique permettant de faire exister un objet ou une action sur le mode virtuel. L. Weiner énonce d’ailleurs le principe d’équivalence entre œuvre réalisée et non réalisée17, principe que prolongent Œuvres d’É. Levé ou les trajectoires des artistes recensés par J.-Y. Jouannais. Cela permet à l’artiste de réaliser des variantes d’une même œuvre – variantes qui, contrairement aux textes possibles, ne s’opposent à aucun original – et de produire des œuvres virtuelles qui excèdent tous les musées où l’on pourrait vouloir les circonscrire.
13Dans les arts plastiques, le devenir fantôme de l’œuvre passe ainsi par le recours à un autre médium que ceux qui leur sont traditionnellement dévolus : le langage. La question se pose nécessairement de façon différente en littérature, puisque le principe de substitution n’implique pas de changement de médium, mais un régime énonciatif différent18. Banlieue, Les Unités perdues ou Œuvres ne donnent pas à lire des fictions ou des poèmes, mais des catalogues et des métadiscours qui en cernent l’absence, discours de substitution qui confèrent aux textes et autres œuvres évoqués une existence fragile, puisqu’ils n’existent plus ou pas encore. Comme nombre d’œuvres conceptuelles (au sens large), ces ouvrages contiennent virtuellement beaucoup plus qu’une œuvre réalisée, puisqu’ils ne figent l’idée sous aucune de ses formes potentielles. Chaque récepteur comble le manque sur le mode fantasmatique, et il existe ainsi autant voire plus d’œuvres que de lecteurs, ces projections pouvant être multiples, contradictoires, ou évoluer au cours des lectures. Ce qui fait œuvre, c’est précisément le dispositif de convocation et de révocation simultanées d’œuvres virtuelles ou perdues.
14Si l’art conceptuel peut donc faire office de précédent dans l’affaire des œuvres disparues, il faut bien admettre, à l’issue de ce rapide passage en revue des suspects et de leurs potentiels complices, qu’aucun coupable ne se dégage nettement, mais plutôt un réseau de tendances à la déstabilisation de la notion d’œuvre, qui traverse aussi bien la littérature et les arts que le discours théorique. Ce qui apparaît avec le plus d’évidence, c’est que personne n’est à sa place : tandis que l’œuvre fantôme manque en rayon, l’écrivain joue au critique et le critique à l’écrivain, quand ce n’est pas l’artiste qui joue au philosophe19. Si disparition de l’œuvre il y a, elle ne va toutefois pas sans bénéfices. Théoriques, tout d’abord, puisque le « fantôme » ne serait finalement que le nom d’un brouillage, que de telles œuvres donnent à penser, entre discours littéraire et métalittérature, entre littérature et art contemporain. Mais les bénéfices se comptent surtout du point de vue de la pratique, et des nouveaux usages que cette disparition occasionne. L’œuvre virtuelle est valorisée en tant qu’elle offre un terrain d’action plus vaste à l’imagination, et convoque des acteurs multiples. Auteur, critique, lecteur : tous sont invités à collaborer pour investir l’absence. La production d’œuvres fantômes rejoint ainsi des réflexions d’Yves Citton sur les textes possibles, qui appelle de ces vœux un changement de paradigme dans les études littéraires, délaissant l’herméneutique pour un usage du texte littéraire valorisé en tant que champ de virtualités à explorer et privilégiant la notion d’équivoque20. Et c’est sans doute cette séduction exercée par le manque qui explique aussi une tendance à la disparition très largement répandue dans l’art de la fin du vingtième siècle, des œuvres enfouies de Jochen Gerz (Monument contre le fascisme, 1986, Monument contre le racisme, 1990), Daniel Spoerri (Déjeuner sous l’herbe, 1983) ou encore Sol LeWitt (Buried Cube Containing an Object of Importance but Little Value, 1968) aux œuvres souvent inaccessibles et parfois englouties du Land Art (Spiral Jetty de Robert Smithson, 1970 ou l’œuvre « négative » de Claes Oldenburg, Placid Civic Monument, 1967), en passant par les photographies invisibles d’Alfredo Jaar (Real Pictures, 1995) ou les œuvres volées données à lire par Sophie Calle (Fantômes, 1989). Travaillant l’image en tant qu’elle subsiste dans la mémoire, ces pratiques instaurent un régime d’existence des œuvres où l’image mentale supplante les tableaux et les sculptures du passé, selon une logique propre à l’érotisme – suggérer plutôt que livrer, et activer ainsi le fantasme par une image voilée. Ces textes indéterminés et autres œuvres flottantes sont ainsi susceptibles de continuer à accueillir toutes les projections, sur le modèle des villes ou des bateaux fantômes, qui séduisent avant tout d’avoir été désertés par les humains et d’offrir un espace vacant à investir sur le mode fantasmatique.
15Mais le fantôme est aussi ce qui fait retour. Dans ce jeu de chaises musicales où tous les acteurs échangent leurs rôles, outrepassent leurs prérogatives habituelles ou préfèrent y renoncer, on en vient à se demander si, derrière la liste des disparus, se trouve bien une victime. Dès lors, l’enquête ne serait pas complète si elle n’interrogeait pas ce que ces pratiques, subversives en apparence, laissent en réalité indemne.
II. Un jeu de massacre (et ses prolongations)
1. Leurres de la disparition
16Revenons-en au corps du délit – ou plutôt à l’absence de corps : la disparition des œuvres, érigée en principe d’écriture par certains écrivains contemporains, implique-t-elle réellement chez eux une disparition de l’œuvre littéraire en tant qu’idée ? Rien n’est moins sûr ; la subversion dont il est question dans les pratiques fantômes concerne moins l’ontologie du littéraire et de l’œuvre d’art que ses modes de production et de consommation. Ce que ces écrivains subvertissent, ce sont les pratiques d’écriture et de lecture, un partage des tâches et des disciplines artistiques héritées du vingtième siècle. L’œuvre inexistante ou illisible conditionne un nouveau type d’activité du côté du récepteur, mais celle-ci repose fortement sur l’idée d’œuvre, qui reste relativement stable. Le parallèle avec l’anecdote rapportée par Stanley Fish dans Is there a Text in this Class ? est ici éclairant : professeur de linguistique à la State University of New York à Buffalo, il donne successivement, pendant l’été 1971, deux cours, dans la même salle, à deux groupes d’étudiants. À l’issue du premier cours, il choisit de laisser au tableau une liste de noms de linguistes (originellement des consignes de lecture) qu’il se contente d’encadrer et de surmonter de l’inscription « p. 43. ». Fish sait que les étudiants du second groupe ont longuement étudié la poésie religieuse anglaise du xviie siècle, qu’ils sont par conséquent rompus au déchiffrement des symboles chrétiens et des significations sermonnaires parfois cryptées de ce genre de poèmes. Une fois le second groupe installé, il leur présente la liste précédemment citée comme un poème du type de ceux qu’ils ont étudiés et demande aux étudiants de l’interpréter – ce qu’ils font, dit-il, sans difficulté particulière21. Si l’implémentation de la liste de noms de linguistes comme poème fonctionne (pour reprendre le terme proposé par Nelson Goodman), c’est qu’elle repose sur la connaissance, partagée par la communauté interprétative des étudiants, de certains traits propres au concept de « poème », et c’est cette idée préalable qui va leur permettre non pas de « décoder » le poème mais de le « faire22 ». Le texte hermétique (qu’il soit authentique ou, comme chez S. Fish, apocryphe) mobilise chez le lecteur des réflexes similaires au texte fantôme : il nécessite la convocation exacerbée d’un savoir, qu’il stabilise du fait même de cet usage. Prenons un des exemples inventoriés par H. Lefebvre : « Le 26 mai 1924, Virginia Woolf note dans son journal “ Ma pensée est tout occupée par Les Heures” ; le roman ne sera jamais écrit23 ». Ne disposant pas de traces du manuscrit perdu, le lecteur ne peut qu’induire son contenu à partir d’une idée générale qu’il se fait de l’œuvre de Woolf. Faisant l’hypothèse d’une proximité avec d’autres ouvrages de l’écrivaine, il privilégiera les recoupements aux différences, le même à l’autre. Plusieurs versions possibles de l’œuvre coexistent ainsi bien virtuellement, mais ce sont des versions d’un même modèle. Alors que l’œuvre actualisée aurait pu entièrement transformer la réception critique de Virginia Woolf, l’œuvre fantôme ne peut que la conforter. De façon similaire, on peut s’interroger sur ce que la subversion des rôles engagée par la critique des textes possibles implique en retour de stabilisation de certaines notions. Si le texte effectivement produit par un auteur ne limite plus le discours critique, cette pratique reste fondamentalement adossée à l’idée de texte, héritée du structuralisme. Mais cette nouvelle critique semble aussi difficilement dissociable de la notion de fiction, et entérine ainsi la prééminence dans la production et les études littéraires du récit fictionnel, qui constitue un cadre hors duquel elle peut difficilement fonctionner24.
17Plus encore, l’ensemble de ces pratiques littéraires laisse inchangée l’idée d’œuvre littéraire, dont la présence en négatif ne fait qu’accentuer les contours. C’est là que se mesure toute la distance avec certaines œuvres conceptuelles : jeter une balle en caoutchouc dans les chutes du Niagara, par exemple, qu’on réalise le « statement » ou non, n’a pas grand-chose en commun avec le fait de produire une sculpture ou un tableau. Au contraire, la bibliothèque fantôme, qui prolonge sur le mode virtuel la bibliothèque réelle, ne bouscule guère la notion d’œuvre littéraire. Jean-Yves Jouannais, qui s’intéresse aux plasticiens autant qu’aux écrivains, propose bien de considérer comme de la littérature l’activité purement passive d’un Armand Robin, « poète des ondes » exclusivement consacré à l’écoute des ondes courtes radio :
Armand Robin ne sera pas un poète de la déclamation, de la profération. Son lyrisme, il en viendra à le concevoir sur le mode de l’inversion. En place de l’inspiration, il privilégiera l’information ; à l’énonciation, il préférera la réception, et sacrifiera l’augmentation de l’égo à un insatiable curiosité pour autrui […] sa poésie fut ces heures, ces jours, ces nuits consacrées à la seule écoute25.
18On mesure toutefois la difficulté pour les études littéraires à intégrer une telle « poésie de l’écoute radiophonique », tant la discipline semble indissociable de la notion de corpus.
19Ainsi la disparition se voit-elle retournée en une stabilisation, voire en une sacralisation de l’idée d’œuvre littéraire. Judith Schlanger, dans Présence des œuvres perdues (2010), montre comment les récits de la perte des œuvres participent d’un retour de l’œuvre en gloire. Ces histoires souvent mythiques et exemplaires collaborent à la construction d’un imaginaire et mettent en scène la glorification des œuvres à travers l’épisode souvent provisoire de leur déchéance ou de leur oubli, que rémunère un sauvetage héroïque ou une redécouverte miraculeuse26. La litanie des œuvres perdues s’inscrit dans la continuité de ces mythes et de cette célébration. Dans celle-ci, comme en témoigne l’ouvrage d’H. Lefebvre, même le récit de la perte est devenu accessoire. Comme ces héros dont l’histoire est aujourd’hui si célèbre que leur nom suffit à mobiliser le mythe, elle se réduit à une idée, un mot, une phrase – et miraculeusement se lève l’absente de toutes bibliothèques.
2. D’autres victimes possibles : quelques suggestions
20Les badauds qui s’attendaient à voir le sang couler seront déçus ; mais rien n’interdit d’appeler de ses vœux d’autres transgressions. Dans un appel aux chasseurs de primes et autres nettoyeurs de la littérature, amateurs ou confirmés, critiques ou écrivains, on finira par quelques suggestions destinées à les lancer aux trousses de nouvelles victimes possibles. Au musée des tortionnaires de l’œuvre littéraire, on compte déjà en effet une poignée de précurseurs, dont les productions visent à déstabiliser la notion de texte et à faire sortir l’œuvre de ses gonds.
21Au premier rang des victimes figure le texte dans sa permanence, déjà bien égratignée par la théorie des textes possibles et dont la liquidation s’accompagne d’une réflexion sur la notion de support. Les Cent mille milliards de poèmes de Raymond Queneau déchiquetaient la page en quatorze bandes (une par vers), pour donner au lecteur la possibilité de reconstituer 100 000 000 000 090 poèmes virtuels à partir de dix sonnets actualisés27. L’écrivain de science-fiction William Gibson est allé plus loin en produisant un texte destiné à devenir fantôme après n’avoir été lu qu’une seule fois. Agrippa, A Book of the Dead, publié en 1992 à l’initiative de l’éditeur Kevin Begos et de l’artiste Denis Ashbaugh, est un poème électronique distribué sous la forme d’une disquette programmée pour s’auto-encrypter après la première utilisation28, tandis que le livre d’artiste vendu avec la disquette est constitué de papier photosensible, de façon à provoquer l’effacement progressif des images et des mots une fois le livre ouvert et exposé à la lumière. On a là un dispositif destiné à produire littéralement une œuvre fantôme, qui ne subsisterait que dans la mémoire, sur le modèle d’une performance appliquée à la littérature. Moins radicale peut-être, mais tout aussi séduisante, l’entreprise d’Orhan Pamuk questionne quant à elle le langage comme médium privilégié de l’œuvre littéraire. Paru en 2006, Le Musée de l’innocence est une œuvre double. Le projet inclut d’abord un roman, de facture très traditionnelle, qui retrace l’histoire de Kemal, amant malheureux de Füsun et doté d’une tendance compulsive à la collecte de petits objets quotidiens qui lui rappellent l’aimée. À la fin du récit, le héros finit par acheter la maison où la jeune femme a vécu ainsi que l’ensemble de son contenu pour y ériger un musée à la gloire de son amour perdu29. Mais la particularité de l’entreprise d’O. Pamuk est d’avoir abouti à l’ouverture d’un musée réel, qui actualise le musée fictif. En 2012 a en effet ouvert dans le quartier stambouliote de Çucurkuma, où se déroule l’histoire, un Musée de l’innocence qui expose les objets dont il est question dans le livre sous forme de 74 vitrines, une par chapitre, réparties sur les quatre étages de la petite maison où auraient vécu Füsun et les siens30. Ces vitrines se lisent comme un roman, et il n’est nullement nécessaire au visiteur d’avoir lu l’œuvre écrite pour apprécier le musée. On pourra objecter que la question se pose de savoir si de telles œuvres sont encore de la littérature. Cela revient à se demander si la littérature peut survivre au texte, comme l’art contemporain a survécu à l’objet d’art – et sans doute s’agit-il là d’une question centrale pour les écrivains de demain.
22À côté du texte, la langue constitue une autre victime possible. Je ne mentionnerai ici que l’exemple de la poétesse et théoricienne Lily Robert-Foley, dont le travail questionne la langue comme donnée stable, et joue avec son étrangeté. Dans m, elle rassemble des poèmes qui confrontent les deux versions, anglaises et françaises, du roman auto-traduit de Samuel Beckett L’Innommable/The Unnamable 31, dans le but d’explorer un « tiers texte », texte fantôme qui hante la lecture du texte en traduction et qu’elle théorise dans sa thèse de doctorat32. Elle poursuit cette expérience de défamiliarisation de la langue et d’invocation de textes fantômes dans Jiji33. Dans ce roman d’amour, les lettres des mots sont progressivement supprimées ou substituées les unes aux autres au fil des chapitres, jusqu’à produire un texte quasiment illisible. Le dispositif mis en place joue de la virtualité, puisque le lecteur substitue au roman actualisé une autre version de celui-ci, écrite en anglais ordinaire, qu’il reconstitue mentalement à travers différentes manipulations destinées à remettre de l’ordre dans la lettre du texte. À l’histoire racontée se superpose ainsi un second récit : celui de l’apprentissage d’une langue fantôme, de plus en plus difficile à déchiffrer. Le lecteur apprend aussi à lire autrement, plus lentement, en s’habituant aux échanges opérés entre les lettres, tandis que s’il commençait par la fin il serait incapable de déchiffrer le texte qu’il a sous les yeux. Contre les histoires d’amour prêtes à l’emploi, la lecture se transforme en un vaste jeu de permutations où vacillent la stabilité de la langue et des représentations, mais aussi les définitions de l’œuvre littéraire. L’idée défendue est bien celle d’un texte et d’une langue qui ne constituent pas des données figées, mais qui s’élaborent selon un processus constant de transformation et d’altération.
23Un troisième angle d’attaque, par lequel on clora la liste non exhaustive des coups bas portés à l’œuvre littéraire, est l’angle institutionnel. Dans le domaine de l’art contemporain, la notion de « critique institutionnelle » est associée aux travaux d’artistes qui, dans les années 1960 et 1970, ont jeté un regard critique sur les conditions d’exposition et de circulation des œuvres, sur le rôle du cadre muséal, médiatique et marchand dans la production artistique, afin d’en subvertir le conditionnement34. Elle invite à s’interroger sur l’ensemble des conditions et des acteurs qui permettent à l’œuvre d’exister comme telle et suppose d’envisager la production artistique comme un fait historique, économique et social, articulé à un ensemble de données contextuelles. À certains égards, les œuvres qui jouent avec les fantômes, comme Les Unités perdues, et dans une moindre mesure Artistes sans œuvres, peuvent apparaître comme le signe d’un enfermement du littéraire dans un discours méta-artistique, qui ne pense pas suffisamment la possibilité d’un dehors, et peut toujours être accusé de confiner au jeu formel ou au dandysme. Dès que l’on touche à l’idée d’œuvre, pourtant, on touche aux rapports de pouvoir, aux questions d’autorité, aux idéologies. C’est ce qu’ont bien compris les théoriciens des textes possibles, et Roland Barthes avant eux. Mais une œuvre n’est pas qu’un texte, et les rapports de pouvoir sur lesquels son existence repose ne concernent pas uniquement ces deux entités abstraites que sont l’auteur et le lecteur. Banlieue l’expose sur le mode ludique, en faisant dysfonctionner cette machinerie discursive avec laquelle on fait (aussi) les œuvres : les discours de légitimation que constituent les préfaces, postfaces, avertissements et autres critiques, qui inscrivent le texte (absent) dans une sphère socio-économique (le monde de l’édition) et un système de valeurs culturelles. Paul Fournel montre ainsi, si le doute était encore permis, que la littérature n’est pas qu’une idée et une bibliothèque de textes, que l’œuvre est avant tout le produit de choix qui interagissent avec un dehors – social, économique, culturel, idéologique.
24L’exemple invite à envisager la littérature comme fait pluriel, selon une approche qui ne serait pas seulement textuelle, mais anthropologique, historique, politique. Comme le rappelle Y. Citton dans son article consacré aux textes possibles, le virtuel, ou le fantôme, ne sont pas des concepts qui doivent nécessairement être limités au texte, y compris au sein des études littéraires. Les élargir à la dimension d’une critique institutionnelle, ce serait prolonger la remise en question de la primauté de l’auteur sur son texte, en réfléchissant de manière plus large aux lois qui régissent le partage de la parole, de la création et de l’autorité. Car la tradition théorique et critique n’a pas seulement trop longtemps bâillonné le lecteur : avec lui, et parfois à travers lui, elle a réduit au silence les femmes, les minorités culturelles et sexuelles, raciales et sociales. Il n’est pas interdit de penser une critique institutionnelle des possibles littéraires qui, envisageant au-delà du texte la littérature comme fait culturel, prenne le relais de cette première émancipation.