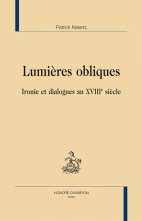
« Les francs-tireurs de la subversion ». L’ironie dialoguée des Lumières
1Le colossal ouvrage de Patrick Neiertz, issu de la refonte d’une thèse de doctorat soutenue en Sorbonne, s’inscrit dans une double filiation intellectuelle à la fois implicite et pleinement revendiquée. D’une part, le rire en littérature, après une période de relatif désaveu critique, est un objet d’étude désormais à la mode, comme en témoignent les récents (et excellents) livres de Bruno Roche1 et de Nathalie Grande2 qui ont traité respectivement du rire des libertins dans la première moitié du xviie siècle et du rire « galant » dans la seconde. P. Neiertz transforme légèrement cette perspective (à savoir poser la question, protéiforme et fluctuante, du rire à une période et à un groupe historique donnés) pour lui privilégier une approche hybride et génériquement orientée, c’est-à-dire en se donnant l’ambitieux mandat de lier un concept aux contours flous (l’ironie littéraire) à une forme particulière (le dialogue) à l’époque des Lumières. D’autre part, P. Neiertz fonde l’essentiel de ses remarques préliminaires et définitoires dans l’héritage conceptuel du poéticien Philippe Hamon3, à qui il emprunte d’ailleurs la formule qui lui sert de titre. Le philosophe Vladimir Jankélévitch4 et Pierre Schoentjes5 sont également au nombre des figures tutélaires de l’ironie convoquées par Lumières obliques. Ironie et dialogues au xviiie siècle. P. Neiertz puise chez Jankélévitch, entre autres concepts, le rapport entre l’émergence de l’ironie littéraire et l’élaboration d’une conscience critique. Cet alliage entre ironie et conscience moderne fonctionne très bien pour les catégories du libertinage et de la philosophie (catégories d’ailleurs spontanément juxtaposées à l’esprit des Lumières), mais grince lorsque l’on envisage dans le même souffle la parodie et le comique. La subversion qui découle de ces derniers n’est assurément pas du même ordre. C’est là le reproche principal que nous pouvons formuler au sortir de Lumières obliques,qui pêche peut-être par un trop grand désir d’exhaustivité : il semble parfois un peu artificiel de faire tenir ensemble des phénoménologies ironiques si contrastantes (parodie, comique, philosophie, libertinage) et des genres littéraires aussi variés qu’instables (théâtre, dialogue, roman).
L’ironie, mode d’emploi
2Le principal écueil qui traverse la plupart des travaux sur le phénomène large et tentaculaire de l’ironie en particulier (et du rire en général) concerne en effet son insaisissable définition. P. Neiertz, plutôt que d’offrir une définition de l’ironie aux critères précisément circonscrits, suggère plutôt une longue rétrospective des différentes acceptions historiques du terme et des diverses expressions diachroniques du phénomène ironique, placées sous quatre regards à la fois unificateurs et totalisants. Que disent l’histoire littéraire, la linguistique, la psychologie et la philosophie de l’ironie ? Après un survol des définitions de l’ironie sous l’Ancien Régime, qui écartèlent sans résolution le concept entre une figure de rhétorique et une figure de pensée, P. Neiertz propose un détour par la linguistique moderne selon laquelle « l’ironie procède d’un système de valeurs » (p. 26). De nature d’abord rhétorique, l’énoncé ironique s’accompagnerait aussi d’une morale souterraine. La psychologie (notamment la pyschocritique telle que pratiquée par Charles Mauron) s’intéresse à l’ironie en ce qu’elle est une « conscience du moi » et le « reflet de ce moi renvoyé par la société » (p. 42). Enfin, la philosophie fait de l’ironie un instrument (moderne) d’introspection et de remise en cause des valeurs établies.
3Ces quatre regards décrivent en quelque sorte l’ontologie de l’ironie et les multiples façons de l’appréhender conceptuellement. Mais dans le détail des pratiques, qu’est-ce qui distingue le persiflage, la satire, la médisance, la raillerie, des exemples de sous-espèces comiques parmi tant d’autres évoquées dans l’ouvrage, de l’ironie littéraire ? Sur ce point, P. Neiertz demeure obscur et opte pour une définition aussi générale que poreuse. L’exercice devient encore plus périlleux lorsque l’ironie est affublée de toutes les étiquettes comiques : est-ce de l’ironie simplement parce qu’on en donne le nom ? L’ironie parodique n’est-elle pas que de la parodie, l’ironie satirique que de la satire ? Ces effets de concomitance forcée entre l’ironie et la gamme du comique rendent effectivement floue la frontière censée les séparer. À ce compte, il semblerait que tout ce qui participe, de près ou de loin, à la nébuleuse comique serait aussi potentiellement de l’ironie. Qu’il s’agisse de galimatias, d’amphigouri, de calembour ou plus simplement d’humour, toutes ces modalités du discours comique, pourtant fort distinctes dans leurs principes comme dans leurs procédés, se placent, chez P. Neiertz, sous la qualification rassembleuse de l’ironie. La fédération du phénomène comique au sens large sous l’égide (restreinte) de l’ironie n’est, en revanche, pas suffisamment appuyée chez P. Neiertz pour qu’elle s’y substitue aussi systématiquement. Cependant, ces problèmes taxinomiques écartés, P. Neiertz livre une somme véritablement originale et foisonnante sur la « phénoménologie ironique » à l’époque des Lumières, livre absolument incontournable pour tous les spécialistes de la question générale du rire en littérature et de l’ironie en particulier.
4Trois niveaux d’ironie se distinguent à l’époque des Lumières : l’ironie explicite, tacite et incertaine. L’ironie explicite s’inscrit dans la filiation du comique rabelaisien et de l’esprit de gaieté, sa propriété la plus nominale étant de « multiplier les signaux permettant d’identifier l’inversion sémantique ou morale produite par l’auteur et faciliter son explication contextuelle » (p. 55). Quant à l’ironie tacite, elle diffère de l’ironie explicite en ce qu’elle est à la fois plus cryptée et plus oblique, et exige du récepteur un haut degré de complicité. L’ironie incertaine apparaît plus mystificatrice encore, c’est-à-dire que les intentions de l’auteur demeurent troubles et parfois impénétrables, autant pour les contemporains que pour les générations d’exégètes qui ont suivi. De toutes les caractéristiques définitoires proposées par P. Neiertz (l’indéfinition irréductible de l’ironie, son obliquité, sa plus-value de sens), la capacité de subversion de l’ironie est celle qui semble la plus féconde, et qui fonde par ailleurs le parti-pris de l’ouvrage. Le modèle de fonctionnement tripartite de l’ironie (explicite, tacite, incertaine) proposé par P. Neiertz promet plus qu’il n’est opératoire : ces trois niveaux ne sont pas systématiquement repris dans le reste de l’ouvrage.
5Puisque l’ironie est un concept évolutif, P. Neiertz problématise longuement son statut au temps des Lumières afin de déterminer, en somme, si le xviiie siècle est effectivement l’âge d’or de l’écriture oblique (titre traditionnellement accordé aux écrivains romantiques). La « littérature-miroir » du xviiie siècle, siècle de tensions et d’accrochages plus que de mouvement, d’autoréflexivité plus que de liberté triomphale, adopte naturellement l’obliquité puisque « la veine ironique est la conséquence technique des champs de tension » (p. 99) qui animent les institutions sociales de l’époque. Les tensions sont culturellement nombreuses : lutte de la vertu et du vice, culte des émotions et exaltation de la nouvelle science, reconnaissance de la dignité bourgeoise, etc. En conséquence, les ironistes prendront pour cible tout ce qui correspond à un ordre passéiste et aliénant, l’ironie servant, au fond, d’arme critique et de subversion généralisée.
6Cette première partie de l’ouvrage, autrement de très grande qualité, autant du point de vue de l’érudition vertigineuse que du commentaire critique, pâlit légèrement en regard de la suite : beaucoup trop longue, elle lance de façon cursive hypothèses et conclusions péremptoires6. Les nombreux portraits que P. Neiertz esquisse de l’histoire et du contexte socioculturel de l’époque des Lumières (en partie justifiés, il est vrai, puisqu’ils explicitent la situation contextuelle propre à l’intelligence du phénomène ironique) ne sont cependant pas toujours nécessaires ou éclairants, surtout parce qu’ils perdent trop souvent de vue l’objectif général établi par l’auteur lui-même, c’est-à-dire démontrer le lien intime qui unit la modalité comique qu’est l’ironie et le genre discursif qui l’accueille et la problématise.
7Pour démontrer ce lien, P. Neiertz structure son ouvrage selon quatre grands mouvements qui correspondent à autant de catégories permettant de distinguer positivement l’ironie : l’ironie parodique, l’ironie comique, l’ironie philosophique et l’ironie libertine. Ces registres modulés de l’ironie permettent en retour de circonscrire quatre cibles particulières de subversion : le sublime tragique, la comédie, l’honnête homme et l’honnête galanterie. Ces combats délimités, P. Neiertz propose une méthodologie fondée sur deux principes directeurs. Le premier, conforme à la conception linguistique de l’ironie, suppose de ne pas dissocier le contexte de l’énonciation ironique de sa phénoménologie. Le deuxième s’applique au corpus de textes dialogiques observés par P. Neiertz. La notion de dialogue (et de dialoguiste) est saisie dans son acception la plus friable : « le dialogisme est un procédé si naturel aux écrivains des Lumières qu’il s’insère assez librement presque partout » (p. 118). Genre, forme littéraire, procédé : le dialogue se réduirait au fond à la notion large, diffuse et dépersonnalisée de « discours ». Le vaste corpus analysé par P. Neiertz, réuni sous la bannière unificatrice des « genres dialogués », comprend à la fois des pièces de théâtre (consacrées comme roturières) et des dialogues (philosophiques, libertins ou encore amphigouristiques). Cette prolifération de textes, dont l’agrégation ne va pas toujours de soi, n’est pas soumise à une analyse systématique (la plupart des textes étudiés ne sont mobilisés qu’une fois dans la démonstration), si bien que la monstruosité du corpus effraie plus qu’elle ne permet une généralisation opératoire du propos. Ce corpus monstrueux est par conséquent diversement maîtrisé par P. Neiertz. Très à l’aise avec les minores (Jean-François Pannard, Louis Le Maingre de Boucicault, Fonpré de Fracansalle…), les commentaires sur les canoniques Marivaux, Voltaire, Diderot, Crébillon et Beaumarchais, par exemple, déçoivent parce qu’attendus et consensuels.
Le sublime travesti. L’ironie parodique
8Le premier registre de l’ironie analysé par P. Neiertz est celui de la parodie. L’ironie parodique a pour cible générale et conceptuelle la notion, profuse et difficilement définissable de l’âge classique jusqu’aux Lumières, de « sublime » tragique, qu’elle subvertit selon différentes méthodes. Cette section, comme celles qui lui succèderont, fait un usage pour le moins oblique de l’ironie, c’est-à-dire que l’ironie parodique n’est bien souvent que parodie. Divisée en quatre chapitres, cette section s’intéresse à la diachronie du phénomène parodique (à travers un faisceau de courants divergents comme le burlesque, le galimatias et l’amphigouri) pour en montrer la profonde ambivalence : la notion de sublime est certes une cible universelle, mais elle motive en même temps la critique des parodistes qui jugent les auteurs dramatiques de l’époque incapables de l’atteindre. Si « l’ironie qui inspire l’opération de travestissement burlesque des parodistes est une des catégories les plus singulières de l’ironie des Lumières » (p. 123), elle l’est surtout parce qu’elle a pour objet la littérature elle-même. Cette autocritique de l’univers des lettres, de ses codes les plus sclérosés et de ses principales figures passe d’abord par les jeux de langage. Car l’ironie est avant tout distorsion, décalage, distanciation, qu’elle soit sémantique ou rhétorique.
9La tragédie burlesque concilie et combine la carnavalisation du langage et la parodie dramatique déjà pratiquée. Sous-genre vertigineux où l’autoréflexivité littéraire prime, « le burlesque est un échappatoire par le rire à un système de contraintes culturelles quand celui-ci est devenu institutionnel » (p. 196). Au contraire des autres manifestations de l’ironie des Lumières, l’ironie parodique institue un genre littéraire véritablement nouveau. Le travestissement des textes-sources constitue une critique littéraire détournée :
En fait, la cible des parodistes reste étonnamment constante au cours du siècle : c’est l’art dramatique, ses techniques d’écriture et de composition ; les dilemmes moraux qui le tendent (la fidélité, l’honneur, le courage, le sens du bien public) ; les masques qui, depuis toujours, au propre et au figuré, cachent les vérités des caractères tragiques ; enfin, l’excessive dualité qui scinde vices et vertus et crée un écart artificiel entre la représentation et le monde réel. (p. 251)
10Même si le débat sur la parodie est d’ordre moral — entre les « admirateurs des beautés sérieuses » et les « jouisseurs des plaisirs malins » (p. 283) —, il reste que l’ironie parodique se place sur le terrain de l’esthétique, en cherchant à renouveler la critique théâtrale et les procédés dramaturgiques dominants :
L’ironie parodique est un instrument de connaissance, en un temps où l’acquisition de connaissances nouvelles est un support de la liberté de pensée, comme elle sera, au siècle suivant, un des tremplins de la mobilité sociale. C’est pourquoi le corpus des parodies a une valeur sémiologique très supérieure à son rang parmi les productions littéraires. […] La distanciation ironique ne peut avoir pour effet un théâtre de la distanciation dans une société chérissant un rapport aussi constant avec la représentation, sociale tout autant que scénique. (p. 348‑349)
11Au final, la subversion du modèle dramaturgique de la tragédie par la parodie « ne semble viser que l’empêchement du sérieux empathique » (p. 247), et n’ambitionne pas de réformer les mœurs ou les mentalités. L’ironie parodique n’appartient peut-être pas autant à l’ironie conçue comme obliquité et conscience critique qu’elle n’emblématise une technique particulièrement féconde de réécriture et de manipulations intertextuelles diverses.
L’ironie comique & Marivaux
12Le deuxième grand ensemble ironique qu’ausculte P. Neiertz est celui du comique qui subvertit les codes et canevas stéréotypés issus de la comédie (plus classique que gréco-latine). L’ironie comique serait donc une « auto-subversion de la comédie » (p. 356) qui procèderait du besoin « de participer à l’examen critique de la société sans renier l’impératif de plaire et distraire » (p. 357). Cette partie repose sur un corpus à la fois démesuré et cohésif : quatre-huit pièces comiques du siècle sont passées en revue en regard de leur traitement du topos du mariage comique, auxquelles il faut aussi ajouter les trente-cinq comédies de Marivaux — qui hérite, poids historique oblige, d’un chapitre autonome. Il aurait été attendu qu’une telle dispersion de textes appelle une synthèse originale qui dépasse la généralisation et les raccourcis interprétatifs. Si les commentaires concernant le passage dramaturgique imposé du mariage sont éclairants et toujours adroits, les pages finales sur Marivaux détonnent. La spécificité de l’ironie comique serait-elle essentiellement marivaudienne ? Peut-on déduire aussi globalement une ironie particulière (l’ironie comique), valable pour toutes les comédies comiques du xviiie siècle, à partir d’un cas tout aussi particulier (celui de Marivaux) ? Il demeure que le paradigme de l’ironie comique semble beaucoup plus l’affaire des dialogues marivaudiens que celle de ses homologues.
13Le premier des trois chapitres de cette sous-partie s’attache à la définition des principaux termes de la controverse sur la comédie à l’époque des Lumières. Historique et scolaire, cette longue digression présente la vision des polémistes chrétiens, pour qui la comédie « oppose le rire du monde à l’effroi de la damnation » (p. 375) et celle des philosophes, incarnée principalement dans le discours critique de Rousseau, pour qui « la vis comica est antinomique de la virtu » (p. 375). Si les griefs diffèrent dans leurs principes, tous sont cependant d’avis que le théâtre comique doit se réformer pour qu’il corresponde davantage aux mœurs du temps. En effet, la querelle sur les spectacles fait naître, dans le paysage critique et dramaturgique, le « drame bourgeois », c’est-à-dire qu’une offre de comédie sérieuse voit le jour, à côté des comédies où le farcesque triomphe sans commune mesure et des tragédies larmoyantes tout aussi suspectes parce que suscitant des passions démesurées. La théorisation du drame bourgeois cristallise l’enjeu de la querelle, axée désormais sur le problème de la « vertu ». La sensibilité vertueuse, pierre de touche de l’esthétique théâtrale des Lumières, nuance les austères classements aristotéliciens des genres théâtraux, séparant radicalement tragédie et comédie, pour lui préférer un terme médian, celui du drame bourgeois. Quelle place peut alors prendre l’ironie dans ce contexte où les débats internes sur les dialogues dramatiques font rage et créent des clivages souvent irréconciliables ? Pour P. Neiertz, « le principal ennemi de l’ironie comique aura été l’esprit de sérieux » (p. 389) qui saisit tout le siècle. Arme critique et offensive, l’ironie comique s’empare du sujet le plus canonique de l’histoire de la comédie, de Térence jusqu’à Beaumarchais : le mariage. L’ironie comique du xviiie siècle se distingue de celle du siècle précédent parce qu’elle privilégie désormais, non pas la seule critique de caractères, mais bien la satire des structures mêmes de la psychologie collective. C’est dans cette perspective que sont analysées trois modulations de l’hymen comique, toutes trois révélant les tensions qui animent le corps social : le mariage arrangé, l’union déséquilibrée et l’amour conjugal. Ces topiques de la comédie permettent aux dramaturges de mettre en scène les travers de la société du xviiie siècle (la noblesse en perdition comme l’arrivisme caricatural des bourgeois), en mobilisant toutes les ressources poétiques du discours ironique : double-entendre, persiflage, antiphrase sont au nombre des procédés employés par les ironistes.
14Enfin vient Marivaux. P. Neiertz fait de l’ironie marivaudienne un véritable principe dramaturgique : « la construction de l’action dramatique chez Marivaux est fondée sur l’obliquité (ou la distorsion) initiale de l’échange verbal entre les personnages » (p. 479). Plus précisément, le paradigme qui ordonnance la production théâtrale de Marivaux est une variation sérielle sur « l’ironie de malentendu » (p. 489), qui se caractérise par « la distanciation trilogique », « la création de champs de tension entre les actants » et « l’adéquation instable entre le discours et la réalité » (ibid.). Plus académiques, accompagnés d’une bibliographie critique beaucoup plus substantielle qu’ailleurs, les commentaires de l’œuvre marivaudienne éclairent le phénomène de l’ironie dialogique d’une lumière à la fois déterminante et extrêmement singulière. L’ironie marivaudienne problématise et exploite en effet jusqu’à la boursouflure la relation triangulaire propre à la phénoménologie ironique. Méthodologiquement plus serrée, cette partie montre que Marivaux, en dépit de canevas dramatiques archétypaux, utilise l’aporie du dialogue pour refléter la société équivoque de son temps (incommunicabilité, incompréhension et incertitude ambiantes).
15Comme pour l’ironie parodique, l’ironie comique qu’observe P. Neiertz n’est qu’accessoirement ironique. Fonctionnant par le tacite et le détourné, le dialogue comique des Lumières (outre Marivaux) fait la part belle au comique de caractère et de situation, déjà modus operandi de la comédie du xviie siècle, et cible les vices en attaquant leurs origines structurelles et sociales. Car le non-dit de la comédie n’est pas l’apanage des Lumières, et constitue un code herméneutique depuis longtemps consommé par les générations successives de spectateurs de théâtre. Si « l’ironie comique est un langage qui permet au théâtre du xviiie siècle de refléter la société et de donner implicitement à penser sur elle sans déroger à la nécessité de plaire » (p. 452), il convient de nuancer que ce langage est, peut-être, constitutivement celui de la comédie et non spécifiquement celui des dialogues des Lumières. P. Neiertz offre néanmoins un tableau exhaustif et brillamment commenté de la comédie à l’époque des Lumières, notamment par le recours attendu à Marivaux, point d’aboutissement du dialogisme ironique. Il va sans dire que l’ironie comique n’a pas de prétention abusivement subversive, c’est-à-dire qu’elle prône au fond la stabilité sociale plus qu’elle ne souhaite la désarticuler, au contraire de l’ironie philosophique dont le champ de bataille est beaucoup plus politique.
L’ironie philosophique à l’ombre de l’honnête homme
16Troisième catégorie distinctive de l’ironie des Lumières, l’ironie philosophique crée une rupture de ton : nettement plus contestataire que la parodie et le comique, elle change aussi de forme, voire de genre. Dans les deux parties précédentes, l’ironie dialogique (par une extension très peu glosée et peut-être exagérée de la notion-genre « dialogue ») relevait essentiellement du texte de théâtre. P. Neiertz le réemploie ici dans son sens plein et le plus direct : le dialogue d’idées. Le dialogue d’idées (ou philosophique), qui mime la sociabilité conversationnelle de l’époque tout en se réclamant d’un genre millénaire, accueille volontiers l’écriture oblique :
L’ironie philosophique est un des moyens rhétoriques que la pensée des Lumières utilise pour contester la censure, ridiculiser la doxa et discréditer les tenants du statu quo religieux, politique, social ou scientifique. (p. 521).
17Trois grands mouvements rythment l’examen de l’ironie philosophique par P. Neiertz : une série de courts dialogues (classés comme « entretiens et promenades ») sont d’abord analysés avant de faire place aux figures imposées que sont Voltaire et Diderot, héritant chacun de chapitres indépendants.
18L’ironie philosophique, tout en investissant d’autres formes, change aussi de cible : la subversion n’engage a priori plus seulement des genres littéraires (tragédie, comédie), mais bien une catégorie concrète de la société : l’honnête homme. Un assez court prologue conceptualise la figure de l’honnête homme, mélange anthropologique d’honnêteté et de politesse, vertus personnelles et sociales héritées du Grand Siècle et que l’ironie philosophique souhaite subvertir, mais non détruire, « c’est-à-dire l’inciter à se retourner pour mieux examiner en face les fondements de sa morale respectueuse et conformiste » (p. 537).
19Les textes (jugés d’emblée mineurs par l’auteur) qui composent le corpus éclectique des « entretiens et promenades » dépouillés est un échantillonnage parmi quelques centaines de dialogues de l’époque, répertoriés selon leur intention ostensiblement ironique (à savoir plus satirique que rhétorique, et plus divertissante que réflexive). À l’inverse des dialogues proprement philosophiques, les « entretiens et promenades » sont nativement légers, conçus pour le divertissement mondain, et ne sont philosophiques qu’accessoirement. D’autre part, le second terme construisant l’appellation « entretiens et promenades » suggère, dans la poétique implicite du sous-genre ainsi constitué, un mouvement entre différents lieux de sociabilité (salons, cafés, châteaux, etc.) où joutent joyeusement les interlocuteurs. Cette attention accordée aux lieux d’échange permet en filigrane toute une satire de la faune qui les peuple : hypocrites, arrivistes, ridicules, religieux déconfits et nobles pathétiques sont parmi les cibles fétiches des ironistes. Derrière l’esprit allègre des « entretiens et promenades » s’échafaude aussi une réflexion de nature philosophique qui « concerne l’environnement immédiat du lecteur, la société qui l’entoure, ici et maintenant » (p. 572).
20Les minores qui prennent place dans le corpus des « entretiens et promenades » n’ont assurément pas la réputation historique de Voltaire qui, de manière métonymique, en vient à incarner l’ironie : « son talent pour le second degré lui vaut aujourd’hui cette rare consécration littéraire de l’épithètisation dans le langage courant » (p. 575). L’ironie voltairienne « met les ressources d’une rhétorique des figures au service de la réfutation, de la satire et parfois du sarcasme » (p. 576). La stylistique ironique de Voltaire, qui doit beaucoup aux legs humoristiques de Swift et de Pascal, « allie l’humour à la polémique intellectuelle » (p. 600). Voltaire cible en premier lieu le christianisme (en particulier le jésuitisme) en dénonçant obliquement l’infâme tout en offrant un texte parfaitement drôle. L’ironie voltairienne, souvent facétieuse et réjouissante, est pourtant des plus ambivalentes : « l’intentionnalité transcende la causticité, l’idéologie évite au rire d’être à lui-même sa propre fin » (p. 614). L’ambivalence de l’ironie de Voltaire apparaît nettement dans l’étude diachronique de ses dialogues d’idées (segmentés en quatre périodes par P. Neiertz), où la diversité des techniques se confronte à l’incroyable stabilité du combat contre toutes les formes de l’oppression (préjugés, fanatisme, intolérance). Parmi le florilège des dialogues voltairiens étudiés, le cas du Dîner du Comte de Boulanvilliers retient assurément l’attention. Faux clandestin, le texte est traversé d’une subtile et progressive ironie servant entre autres la déconstruction des tabous religieux les plus tenaces.
21À l’ironie voltairienne succède l’ironie diderotienne, ou plutôt l’humour, « c’est-à-dire le constat amusé d’un écart résiduel incompressible entre le sens et le réel, qui en constitue la singularité » (p. 654). Diversement saisi par la critique contemporaine jusqu’à nos jours, « l’objet littéraire Diderot » est rétif à tout essai de totalisation. L’un des vecteurs d’entrée dans l’œuvre diderotienne est celui du sens de l’humour, révélateur de la logique de contradiction de la pensée qui innerve les dialogues de Diderot. Contradiction qui prend racine dans le conflit entre le raisonné et le ressenti ; contradiction qui est ensuite reprise par le double processus de mystification et de démystification du lecteur. Exploratoires, les dialogues de Diderot ne sont pas tant traversés par l’écriture oblique que par l’humour qui « imprègne de scepticisme souriant leur message philosophique » (p. 688), message qui procède à la dislocation de la figure de l’honnête homme et à la contestation de l’obscurantisme institutionnel.
L’ironie libertine & pessimisme cynique
22Dernière modulation de l’ironie du xviiie siècle, l’ironie libertine correspond peut-être plus au siècle des Lumières que ses variantes précédentes, historiquement hybrides : « dans ses valeurs référentielles, ses procédés narratifs et sa rhétorique, l’ironie libertine reflète plusieurs traits culturels exclusifs du xviiie siècle » (p. 723). L’ironie libertine (qui s’adresse aux sens et à l’esprit) étrille et subvertit l’honnête galanterie, remettant ainsi en question le conservatisme des passions et les préjugés millénaires endiguant le bonheur. Pour P. Neiertz, sans véritable nuance, « la plupart des textes libertins qui nous sont parvenus sont ironiques » (p. 724). Cette évidence du corpus ne se retrouve pas forcément dans l’analyse phénoménologique de l’ironie libertine, qui apparaît surtout comme une « ambiance de la narration » (ibid.).
23P. Neiertz procède à l’archéologie de l’honnête galanterie, de ses sources bibliques (Saint Paul, Saint François de Sales) jusqu’aux moralistes chrétiens de l’âge classique (Bourdaloue, Bossuet), retenant les principaux arguments qui serviront les ironies des libertins des Lumières (condamnation du plaisir et utopie de la chasteté au premier chef). En réaction, les textes libertins auront comme traits élémentaires l’impiété et la licence. À ce moment de l’exposé, P. Neiertz prend soin de noter l’irréductibilité définitoire du « libertinage », catégorie à l’infinie diversité de nuances (indécision terminologique qui rappelle en souterrain la notion même d’ironie). Une constante, cependant : l’ironie libertine vise les institutions religieuses plus que la religion en soi.
24Qui dit libertinage dit aussi Crébillon. L’ironie libertine de Crébillon, à mi-chemin des Lumières, serait de l’ordre de l’euphémisme, « qui fonde le minimalisme de l’énoncé sur la certitude que la capacité à lui restituer le sens totalement déshonnête et subversif de ses sous-entendus est parfaitement maîtrisée par l’interlocuteur (et le lecteur) » (p. 799). Plus le siècle avance, plus la ligne de démarcation entre l’illicite et l’admis s’atténue. C’est dans cet entre-deux qu’émergera le théâtre de Beaumarchais (et particulièrement le triptyque du « roman de la famille Almaviva ») qui est, en définitive, beaucoup plus libertin qu’ironique — P. Neiertz procède en fait à une analyse dramaturgique plutôt classique où le principe ironique ne trouve pas toujours sa juste place. Chez Beaumarchais, « l’ironie est dans la disconvenance entre le cours naturel des choses […] et le souci des apparences » (p. 840). Après la vitalité égayante du libertinage honnête, dont Crébillon et Beaumarchais sont les plus célèbres avatars, l’ironie libertine se mue en fin de siècle, avec Laclos et Sade, en fatalité cynique.
25Reprenant à son compte les thèses de Jankélévitch, P. Neiertz comprend le cynisme comme mimant « l’obscénité du mal moral pour le faire haïr à travers la haine que la société porte à sa propre personne » (p. 857). Laclos en serait le premier représentant, et Les Liaisons dangereuses — d’ailleurs, un roman épistolaire est-il un « dialogue » ? — l’archétype. Véritable synthèse de l’ironie des Lumières, Les Liaisons dangereuses utilisent toutes les ressources de l’écriture oblique : « le pastiche, la parodie, la raillerie, le persiflage, la mystification, la contre-vérité, l’euphémisme, le double-entendre, la mention intertextuelle » (p. 867). L’ironie de Laclos, qui montre à la fois le faste et l’interdit de l’entreprise libertine et sa dérive corollaire, mène finalement à une sorte de pessimisme philosophique et de fatalisme cynique sur lequel rebondira Sade à l’envi. En revanche, faire de l’ironie une clé herméneutique de l’œuvre polymorphe de Sade ne va pas nécessairement de soi, et P. Neiertz préfère parler à juste titre « d’humour noir ». Partant, l’ironie ambiguë et cynique de Sade « se situe au-delà des combats de l’ironie libertine » (p. 915), détruit les bienséances classiques et appelle une métaphysique du mal.
Arts de l’obliquité
26Pour Patrick Neiertz, la « raison d’être de l’ironie est de combattre la généralité normative : à l’intangibilité des normes, elle oppose le mouvement dialectique qui va des valeurs aux actes et ajuste la conduite de l’honnête homme à l’intégrité de sa conscience » (p. 941). Il devient alors plus net que l’ambition de P. Neiertz n’est pas seulement d’échafauder une poétique du dialogue, rénovée au xviiie siècle par l’énonciation ironique, mais bien de tirer les conséquences à la fois littéraires, esthétiques et socioculturelles de l’ironie dans la pensée multiforme des Lumières. Cet aperçu forcément lacunaire de l’immense œuvre de P. Neiertz ne rend peut-être pas assez compte de l’encyclopédisme des commentaires et de l’intelligence des analyses : le lecteur averti ne se laissera pas décourager par la monumentalité de l’ouvrage et trouvera en Lumières obliques. Ironie et dialogues au xviiie siècle un livre foisonnant.

