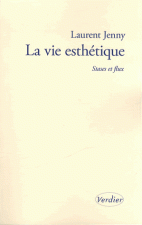
Esthétique & vie mêlées
1Dans le dernier et peut‑être le plus beau texte de Corps du roi, « Le ciel est un très grand homme », Pierre Michon rapporte un exemple singulier d’irruption de l’art dans la vie : la poésie comme prière — comme prière « impréméditée », pour employer un adjectif de Montaigne. « Impréméditée » dans la mesure où, à l’occasion de deux événements si symboliquement opposés, la mort d’une mère et la naissance d’un enfant, un poème « s’imposa » à chaque fois à l’auteur : pour la mère La Ballade des pendus de François Villon, pour l’enfant Booz endormi de Victor Hugo :
Quelque chose me vint qui était de l’envie de prier, de clore, de m’ouvrir. Assis sur mon lit, tranquille, souriant si on souriait quand on est tout seul, j’ai dit d’un bout à l’autre à haute voix Booz endormi. Je l’ai dit comme il doit être dit, dans le calme, l’acceptation de tout, l’espérance contre toute raison, la gloire qui vient toujours1.
2Dans cet exemple, quoiqu’émouvant, l’irruption de l’art dans la vie reconduit encore une forme d’opposition entre les œuvres et le vécu. Certes, le poème peut venir secourir, seconder une expérience, il peut venir revêtir le moment ; il ne s’y mêle pas davantage. Il tombe et « s’impose », mais sa carrière reste encore celle de la remémoration ou de la récitation. Laurent Jenny s’est intéressé dans La Vie esthétique aux autres devenirs des œuvres que nous fréquentons ou aimons : des destins plus subtils, plus prégnants, on dirait presque plus ordinaires s’ils n’étaient pas aussi difficiles à démêler (l’auteur admet d’ailleurs le caractère « évasif » de son sujet, p. 15). Il y a un devenir esthétique des œuvres en dehors des usages qu’on nomme généralement artistiques : écouter une musique, se rendre dans un musée, lire, etc. Le travail des œuvres sur nous est à la fois plus complexe et plus global ; et de fait, l’art perdrait une grande partie de son retentissement dans notre vie s’il demeurait confiné au cadre des conduites artistiques.
3C’est donc en « termes d’échanges, d’interpénétration et de circulation » (p. 13) que l’auteur envisage d’éclaircir ce que l’art modèle ou configure dans notre existence quotidienne : ces traces esthétiques « qui affectent notre vision, notre perception et notre intelligibilité du monde » (p. 15). Non plus le poème qui, jamais dépossédé de son intégrité, de sa forme, de son usage conventionnel, vient s’imposer en nous, mais comment un poème peut « infléchir nos perceptions » (selon l’expression de Marielle Macé2) ou façonner notre sentiment des choses. Aussi la thèse de l’auteur procède‑t‑elle à double titre à une reconsidération quasi phénoménologique de l’art : non seulement le poème ne se réduit pas à une « machine verbale3 » (mais encore à une matrice de sensations, à une expérience de reconfiguration sensorielle, à un retentissement psychologique ou affectif), mais le vécu même de l’art ne se limite pas, nous l’avons dit, à une réception d’usage : il peut imprégner toute notre vie affective et perceptive.
Le style & le quotidien
4On peut lire cet essai de deux manières. La première consiste à l’inscrire au croisement de deux problématiques, deux foyers conceptuels qui occupent actuellement les débats : la question du style et la préservation de l’ordinaire. Concernant le style4, L. Jenny s’intéresse précisément aux mises en forme de nos expériences provoquées par l’art. Ces stylisations sont nombreuses : une ville ou un quartier peuvent être reconfigurés sentimentalement (par exemple dans la « psychogéographie » situationniste, analysée au chapitre « Dispositifs sensibles ») ; des tableaux peuvent se profiler en surimpression aux paysages réels, « s’évader hors de leur cadre et occuper notre vie mentale bien au‑delà de leur contemplation » (p. 57) ; la musique également distille en nous des ambiances perceptives, des « scénarios énergétiques » (p. 44) qui peuvent informer notre perception du temps et des choses, s’associer même, en les colorant, à certains événements et à certains lieux. Bref, l’art a la vertu de procurer des manières aux choses : manières plus ou moins subtiles, diverses, originales, mais qui nous permettent une appropriation plus riche et plus singulière du vécu. Il offre de « nouveaux traitements perceptifs » (p. 67).
5S’il y a, par exemple, un texte‑Verlaine, il existe également une manière verlainienne de domestiquer le vécu, une façon verlainienne de se rapporter à ses propres langueurs, à la pâleur (ou la « fadeur », dirait Jean‑Pierre Richard5) des paysages, à « l’heure exquise » (La bonne chanson) de certaines soirées. C’est là le devenir non textuel de l’œuvre. Dans une note additionnelle à l’édition de 1962 de Nadja, citée par L. Jenny (p. 102), André Breton remarquait ainsi le « pouvoir d’incantation » que Rimbaud exerçait sur sa perception des choses :
Pour moi le monde extérieur composait à tout instant avec son monde qui, mieux même, sur lui faisait grille : sur mon parcours quotidien à la lisière d’une ville qui était Nantes, s’instauraient avec le sien, ailleurs, de fulgurantes correspondances. Un angle de villas, leur avancée de jardins, je les « reconnaissais » comme par son œil, des créatures apparemment bien vivantes une seconde plus tôt glissaient tout à coup dans son sillage, etc.
6D’où une autre phénoménologie de l’influence artistique, qui n’irait pas chercher l’impulsion d’une œuvre uniquement dans d’autres œuvres, mais dans la vie elle‑même.
7Quant à la préservation de l’ordinaire, ou pour mieux dire la restitution des conditions normales, habituelles de l’expérience, l’auteur poursuit avec d’autres (notamment avec M. Macé dans un livre complémentaire à celui‑ci : Façons de lire, manières d’être) le projet de rendre à l’expérience esthétique toute sa physionomie ordinaire, toute son inscription dans le vécu quotidien. Selon la formule désormais fameuse de Gilles Deleuze dans Différence et répétition6, « il n’y a pas d’autre problème esthétique que celui de l’insertion de l’art dans la vie quotidienne. » Rappelons que des études littéraires (Michael Sheringham, Traversées du quotidien7) à la philosophie (Bruce Bégout, La Découverte du quotidien8), le quotidien fournit aujourd’hui un espace d’enquête particulièrement important.
8Mais on peut lire également cet essai sans l’indexer à un parti pris et sans connaissance du contexte que nous venons d’esquisser : le lire tout simplement comme essai, au sens propre du terme. De l’essai, l’auteur endosse par exemple la posture de l’amateur à la Montaigne, on dirait presque de l’honnête homme : « guère expert en musique » (p. 39), spécialiste mais aussi collectionneur en littérature, tirant parfois ses arguments d’anecdotes personnelles, La Vie esthétique est un ouvrage tout autant théorique qu’il est singulier, littéraire, écrit (on se souviendra ici de la formule de Roland Barthes concernant l’essai, où « l’écriture le dispute à l’analyse9 »). De l’essai également, l’auteur rejoint l’esprit d’une conversation sur le vécu : il s’agit à chaque fois de partir de l’expérience commune, pour ne pas dire banale, et de citations d’auteurs pour tirer un scénario théorique. Scénario théorique, et non doctrine ou système : à plusieurs reprises, l’auteur se montre défiant à l’égard des analyses trop surplombantes :
Il me semble en effet que les descriptions de l’expérience esthétique proposées par les théoriciens, sont à la fois exagérément abstraites, pauvres et éloignées de nos usages réels de l’art dans la vie (p. 15, souligné par l’auteur)
9N’allons pas croire pour autant que l’auteur disqualifie toute théorie : il s’agit davantage, toujours dans un esprit essayiste, d’une modération des prétentions. Il n’y a sur ces sujets de théorie valable qu’à hauteur du vécu ordinaire.
10En ce sens, le livre de L. Jenny réussit sans doute ce que l’auteur attribue à l’art : il nous informe, certes, en empruntant ses exemples aussi bien à Stendhal qu’à Paulhan, à Proust qu’à Deleuze, mais il nous forme également, il entraîne nos sens à se montrer plus sensibles à ces transfusions, à chercher en nous‑mêmes ces traces mentales de l’art. Nul doute qu’une telle réussite doit beaucoup à une écriture, à un ton, à une sorte d’allégresse de projet, où l’auteur échange anecdotes personnelles, exemples littéraires et arguments théoriques sans jamais sacrifier l’abstraction (une thèse est bien défendue) et l’évocation (une expérience est bien partagée).
L’art dans la vie, la vie dans l’art
11« Il y a en nous une seconde vie de l’art », résume en une très belle formule l’auteur (p. 84). Du chemin entre l’art et la vie, L. Jenny a donc choisi un sens : descendre des œuvres à l’expérience ; comment l’art passe dans la vie, la travaille, la configure. On songerait alors volontiers à une suite, qui questionnerait pour ainsi dire le sens inverse : la seconde vie de notre passé, de nos souvenirs, de nos expériences dans l’art. Car des transfusions imprécises, imperceptibles à première vue, mais opérantes, déterminantes, qui se jouent entre l’art et la vie, on peut en trouver dans les deux sens.
12Dans Illusions sur mesure, Gérard Macé s’interroge par exemple sur les raisons ou les motifs qui l’entraînent bien souvent vers l’esthétique japonaise. Pourquoi une préférence si marquée et si sentie pour les jardins japonais ? Il ne tarde pas à tisser quelques liens, aussi précaires qu’ils puissent être, entre l’univers féminin de son enfance, les objets de sa mère et l’imaginaire japonais :
Le goût que l’on développe par la suite est fidèle à ces impressions d’enfance, mais il change de registre : filtré par d’autres expériences, il se déplace sur une échelle des valeurs dont l’art donne la mesure, et se travestit quelquefois pour ne pas être impudique. Je ne suis pas loin de penser que mon émotion devant tant de choses au Japon, dont l’esthétique est à la fois si légère et tellement maîtrisée, est la résurgence d’une émotion encore vive devant les étoffes, les écheveaux de laine et la chevelure féminine ; devant les outils de la couture et du tricot qui se mêlent dans le souvenir aux accessoires de la beauté, de même que les instruments de l’écriture à ceux du maquillage10.
***
13Il ne s’agit pas de pointer ici une faiblesse ou une lacune de La Vie esthétique : on pourrait seulement se demander si le livre de Laurent Jenny, par sa méthode et son style, argumentatif et autobiographique, n’ouvre pas la possibilité d’une enquête complémentaire, qui irait à contre‑courant de la première pour cerner autrement ce mélange de l’art et de la vie. Car autant notre perception et nos conduites sont notamment le fruit d’un « héritage de lectures, d’écoutes et de regards » (p. 16), autant nos préférences esthétiques, notre entraînement auprès de certains œuvres plutôt que d’autres sont sans doute configurés par un mémento de sensations passées, d’impressions d’enfance dont les goûts, pour employer l’expression de G. Macé, manifestent la « résurgence ». Il y a la résonance des œuvres dans notre vie : il y a inversement résonance de notre personne, de notre existence, de nos souvenirs, de notre passé dans le mouvement passionnel qui nous attache à certains paysages, certains textes, certaines musiques, certains tableaux. Roger Grenier rapportait, dans un livre sur Tchekhov11, la phrase d’un ami : « Tu devrais lire Tchékhov. Il me semble que c’est une littérature pour toi. » Il ne se trompa pas. Toute la question serait en retour, après les réponses fortes données par L. Jenny sur l’effet de l’art dans la vie, de comprendre ce lien, « évasif » lui aussi, entre un homme et les paysages esthétiques qu’il ressent les plus près de lui — et qui, pour reprendre une phrase de Michaux, lui font dire : « Ici, il y a pour moi.12 » C’est en tout cas le prolongement qu’on voudrait lire après l’espace de réflexions — de réflexions sur soi, sur notre rapport à l’art — qu’a si brillamment ouvert La Vie esthétique.

