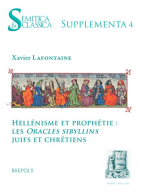
Quand une prophétesse païenne annonce la révélation biblique en hexamètres : analyse poétologique des Oracles Sibyllins
1La monographie de Xavier Lafontaine, issue de sa thèse de doctorat, est le couronnement de plusieurs années de recherche combinant sciences religieuses et philologie classique1. Son but est, comme le titre l’indique, de décrire l’articulation entre la culture grecque et une collection de prophéties d’inspiration biblique, placées sous « l’autorité2 » de la Sibylle3. Pour ce faire, il propose, en partant de ce qu’il identifie comme un « phénomène littéraire, celui de la réécriture des matériaux narratifs liés aux traditions bibliques » (p. 6), une analyse littéraire des modalités linguistiques et poétiques de l’élaboration de ces λόγοι oraculaires. Face à la variété des sibyllistes ayant vécu à des époques différentes et dont les discours reflètent, dans leur « dialogue conscient avec les formes littéraires grecques » (p. 115), « les goûts et les attentes des communautés où les Oracles Sibyllins ont vu le jour et circulé » (p. 113), il identifie des « marqueurs textuels qui permettent de construire les parentés génériques, à travers l’ensemble du « corpus » qui nous est parvenu, en soulignant les continuités formelles qui traversent ces textes sans trop en niveler la diversité » (p. 12).
2S’inscrivant explicitement dans la lignée de Jane Lightfoot4 qui avait déjà noté que le contenu des Oracles Sibyllins était plus étudié que la manière dont les sibyllistes s’expriment, Xavier Lafontaine « éclaire les stratégies littéraires de mobilisation du matériau biblique » (p. 6) en utilisant la théorisation genettienne de l’intertextualité basée sur les notions d’hypertexte et d’hypotexte5 ainsi que les travaux sur la tradition scolaire (paideia) des progymnasmata rhétoriques, la théorie ancienne de la paraphrase, et leur importance dans la formation des élites cultivées6 et par conséquent dans celle des sibyllistes. L’utilisation de Genette s’articule par ailleurs avec un rejet explicite de l’approche de la Quellenforschung : l’Auteur insiste en effet sur la notion de « dialogue conscient avec le texte d’origine » (p. 117) que sous-entendrait le terme d’hypotexte, dialogue qu’il oppose à la Quellenforschung « qui identifie les sources sans poser de manière aussi explicite la question des enjeux littéraires de la reformulation ».
3Dans son organisation globale, l’ouvrage de Xavier Lafontaine est constitué de deux parties. Dans une première, définitoire et au titre explicite (« Inscription générique des Oracles Sibyllins »), l’Auteur s’attache « à mettre en valeur les caractéristiques communes d’un genre littéraire à part entière, celui de l’oracle sibyllin » (p. 113) : sont ainsi étudiés et décrits tour à tour la source du discours — la Sibylle —, le contenu de son enseignement ainsi que les liens de ce dernier avec la poésie didactique et la littérature sapientiale et enfin le rapport à l’histoire, décliné dans une analyse de la trame eschatologique et de l’utilisation de la paradoxographie. Faisant suite à cette étude transversale, la deuxième partie offre une analyse détaillée — inscrite dans le prolongement d’une présentation méthodologique qui rappelle les définitions antiques de la paraphrase — des paraphrases d’épisodes bibliques et des modalités de reformulation qui ont guidé leur rédaction. Dans un souci de clarté, l’Auteur traite les épisodes de manière chronologique et non selon l’ordre des Oracles, commençant donc par les « Prophéties des premiers temps » (cosmogonie, anthropogonie, Chute, Déluge, Babel, Éxode, Exil) avant de se concentrer sur les « Prophéties évangéliques ».
La Sibylle : une persona hybride et polymorphe
Une mise en scène pseudépigraphique
4Au cœur de l’entreprise de définition du « discours sibyllin7 » se trouve la source de la parole mise en scène par les rédacteurs : la Sibylle, une prophétesse d’origine païenne à l’autorité bien établie. Les Oracles Sibyllins ont tous en commun la mise en œuvre du même procédé pseudépigraphique : ils font parler — fictivement — cette figure, emblématique dans le monde gréco-romain, de la divination. Faisant la synthèse de plusieurs modèles, cette Sybille judéo-chrétienne est héritière à la fois des prophètes bibliques d’Israël, de ceux qu’on retrouve dans les compositions apocalyptiques d’époque hellénistique et impériale « dans lesquelles une figure privilégiée, tirée du passé biblique, transmet des révélations sur les fins dernières ou les mystères célestes » (p. 44) et des figures oraculaires de la tradition grecque (Hélénos, Tirésias, la Sibylle virgilienne, Cassandre etc.).
5Autre élément unificateur étudié par Xavier Lafontaine, l’énonciation fait l’objet d’un développement éclairant qui permet non seulement de spécifier les oscillations complexes entre les « différentes postures énonciatives s’exprimant derrière le masque de la Sibylle » (p. 25), mais aussi de démarquer les Oracles Sibyllins des autres collections prophétiques (fragments orphiques, Oracles Chaldaïques) ou d’autres productions dans laquelle la Sibylle joue un rôle (l’Oracle de Baalbek, la Sibylle tiburtine).
« Une biographie plurielle » (p. 29)
6La présentation des traditions biographiques concurrentes vient, quant à elle, rappeler le processus de stratification de ces poèmes dont les divers rédacteurs s’étalent sur plusieurs siècles : Or. 3 établit ainsi, par exemple, un lien de parenté par alliance entre la Sibylle et Noé, le patriarche vétéro-testamentaire, constructeur de l’arche, en faisant sa bru. Or. 2 et 7 esquissent le portrait d’une Sibylle ἀναιδής repentie, incarnation de la débauche sexuelle qui « se donne comme exemple des comportements que sa prédication prétend amender » (p. 37), dans une sorte d’invitation à l’émulation protreptique.
Le genre de la Sibylle : une fausse question
7« La Sibylle est-elle une femme ? » (p. 48). La question est posée par Xavier Lafontaine qui, à contre-courant d’autres études récentes majeures sur les Oracles Sibyllins, choisit de temporiser l’importance du critère du genre de la personnalité oraculaire. Contrairement à Stewart-Lester qui affirme qu’ « Il existe des liens étroits et récurrents entre prophétie, violence divine et corps des femmes et ces liens s’inscrivent dans une logique historique particulière constituant la vraie prophétie8 » , lui considère que la violence prophétique infligée à la Sibylle serait « dans la continuité des prophètes bibliques forcés de prophétiser, ainsi que dans celle des figures oraculaires juives et chrétiennes » (p. 49) et que l’on pourrait presque « se demander si une Sibylle est vraiment une femme » et « si elle participe encore au système d’opposition binaire genré qui prévaut dans les sociétés patriarcales anciennes et modernes » (ibid.). En effet, l’auteur rappelle, pour appuyer sa démonstration, que « le texte n’explicite jamais la qualité genrée de la Sibylle » (ibid.) : les éléments biographiques évoqués dans Or. Sib. 3 et Or. Sib. 1 qui font d’elle la belle-fille de Noé seraient plutôt à analyser comme « un jeu littéraire qui consiste à bibliser tout en rationalisant les origines mythiques de la Sibylle. […] Faire entrer la Sibylle dans la parenté de Noé relève[rait] donc davantage d’une métaphore du projet poétique à l’œuvre dans les Oracles Sibyllins (une autorité païenne prophétise la vérité du dieu biblique) » (ibid.). Enfin, s’éloignant des conclusions d’Hannah Tervantko9 qui identifie une perception dégradée de la prophétie féminine dans les sources juives d’époques hellénistique et romaine (les femmes devineresses échoueraient davantage et elles auraient plus de mal à se faire reconnaître comme médiatrices légitimes de la volonté divine), Xavier Lafontaine voit, au contraire, dans la Sibylle des Oracles une « prophétesse véridique » (p. 50) dont la parole « n’est pas montrée comme dysfonctionnelle ».
Une esthétique de l’ἀσαφεία (l’obscurité)
8La Sibylle hybride et polymorphe est la source d’un discours relevant d’une esthétique de l’obscurité qui instaure délibérément une « aura de mystère oraculaire », « amenant le destinataire à engager une démarche herméneutique pour identifier l’allusion » (p. 126). Cette ἀσαφεία (« obscurité »), qui est véhiculée par l’ambiguïté linguistique, la non-linéarité du récit ou encore le recours fréquent aux énigmes numérologiques, est mise en tension avec les principes de clarté et d’évidence (σαφήνεια, ἐνάργεια) : l’analyse des passages mentionnant l’épisode vétérotestamentaire du Déluge est un bon exemple. Dans le deuxième chapitre de sa deuxième partie, consacré à l’étude des prophéties des premiers temps, Xavier Lafontaine offre une lecture précise de trois oracles (Or. sib. 3. 820-829, 4.47-53 et 7.7-15) qui lui permet d’affirmer en bilan que « cet épisode emblématique du châtiment divin et du salut du juste est traité de manière à jouer sur l’évidence et l’obscurité : l’obscurité passe par la condensation extrême de l’épisode, les périphrases et la rupture de la linéarité chronologique ou logique du récit. L’évidence, elle, est assurée par des mots-clefs qui relient immédiatement la paraphrase à son référent biblique : le cataclysme d’eau, l’arche et le juste unique » (p. 155).
9Les procédés mettant en œuvre cette esthétique affectée de l’ἀσαφεία dans les Oracles Sibyllins contribuent néanmoins à instaurer une véritable « connivence avec leur public idéal, lequel est amené à reconnaître des épisodes fondateurs de sa culture travestis en prophéties émanant d’une autorité réputée étrangère » (p. 296) ; le référent biblique n’est « masqu[é] » que pour être rendu « d’autant plus manifeste » (ibid.). Dans le jeu des allusions, des constructions circulaires, des périphrases contournées, les « silences » du texte sont autant d’invitations à la reconnaissance lancées aux destinataires, participant par là même à la construction d’une identité collective.
Préoccupation eschatologique et exigence éthique : une interprétation de l’histoire au service de l’exhortation parénétique
Un « mode didactique » au croisement entre littérature de sagesse, compositions apocalyptiques et poésie grecque
10Sans pour autant être « nécessairement présentée comme un sage dont l’auditeur devrait émuler la vertu » (p. 59) contrairement aux traditions sapientielles hellénistiques qui présentent des modèles de maître de sagesse10, la Sibylle, instrument divin soumis à une violente possession inspirée, enseigne des « normes de comportement à imiter ou des vices à éviter sub specie aeternitatis » (p. 60) ; elle exhorte et appelle à la conversion en brandissant la menace eschatologique du Jugement dernier contre lequel elle met en garde. Empruntant à la fois à la littérature de sagesse qui « cherche à transmettre aux agents humains des moyens de s’orienter dans leur vie grâce à l’expérience concrète de la morale pratique » (p. 60) et à la littérature apocalyptique qui « présente l’accès à la sagesse comme médié par des révélations ou des êtres d’origine surnaturelle, l’orientation dans la vie terrestre [étant] conditionnée à l’observance de principes transcendants » (ibid.), le discours sibyllin est associé par Xavier Lafontaine à un « mode didactique » qui « enseigne un savoir lié à un domaine technique identifié […] : la connaissance des fins dernières et de l’action d’une divinité dans l’histoire ». Tout cet enseignement, enfin, est inséré dans un régime versifié qui « renonçant aux formes de composition en prose telles qu’on les connaît par les recueils sapientiaux ou la littérature apocalyptique juive » (p. 61), émulerait la poésie didactique grecque d’un Hésiode ou d’un Aratos.
Une esthétique catalogale donnant forme à des motifs d’exhortation éthique récurrents
11Cette visée morale poussant son destinataire à l’adoption d’un certain comportement se caractérise formellement par des motifs récurrents et une esthétique catalogale. Le contenu de l’éthique, objet de prédication, prolonge le Décalogue : l’avarice et le gain indu sont dénoncés ; le vol et l’adultère, de même que l’appât du gain, sont condamnés ; l’avidité est désignée comme source de querelles et de conflits ; les destinataires sont incités à préférer la raison et la sagesse à l’arrogance et à la démesure, et la piété est sans surprise valorisée. Donnant forme à cette édification éthique, l’usage du catalogue rappelle, non seulement Homère, Hésiode et les poètes hellénistiques mais aussi la composition des récits dans les lettres du Nouveau Testament11.
Parler d’histoire sub specie aeternitatis
12Néanmoins, — et c’est ce qui fait, en partie, la spécificité de cette production oraculaire —, derrière la veine didactique et la parénèse, se trouve en permanence une trame eschatologique : « l’exhortation morale s’insère dans le canevas d’une histoire orientée vers un Jugement dernier qui sanctionnera la valeur morale des individus et du groupe (comme peuple) en fonction de leurs actions » (p. 85). En expliquant que les malheurs prédits sont liés aux « dévoiements de l’humanité pécheresse » et en illustrant le schéma impiété-châtiment, le discours sibyllin, inspiré par la divinité de la révélation biblique, appelle son destinataire à « amender son comportement pour ne pas s’exposer à ce mécanisme rétributif » (p. 93). Les prophéties des premiers temps qui paraphrasent les récits bibliques de l’anthropogonie et de la Chute dans Or. Sib. 1, 3 et 8 offrent aussi, en même temps qu’une étiologie du mal, un premier exemple de châtiment divin invitant au respect des commandements.
Exhorter en terrifiant : parénèse et paradoxographie
13Formellement, la description des phénomènes extraordinaires visant à apeurer dans un but de parénèse emprunte à la paradoxographie12, ce genre — dont le nom est issu d’un néologisme tardif d’origine byzantine13 — dans lequel sont recensées des anecdotes surprenantes, qui sortent de l’ordinaire, des curiosités de la nature, des faits merveilleux et inouïs : les mirabilia ou admiranda latins et les θαύματα ou ἄπιστα grecs. Face au nombre important de descriptions de signes annoncés par la Sibylle dans les Oracles, Xavier Lafontaine propose de les considérer comme « des motifs littéraires jouant du goût contemporain pour le merveilleux et le spectaculaire ». Les rédacteurs auraient ainsi recours à « toute la gamme des phénomènes inspirant l’effroi aux mortels [conflagrations cosmiques, troubles interstellaires etc.] pour faire prendre conscience à ces derniers de l’omnipotence de la divinité » (p. 105).
Paideia, hexamètre et remplois : une logique de l’Usurpation
14Entrelacs complexe d’intertextualités qui se superposent, les Oracles Sibyllins sont foncièrement hybrides. Intégrant la matière des épisodes bibliques, qu’ils paraphrasent sur un mode caractérisé par ce que Xavier Lafontaine désigne par le terme d’« allusion », dans la trame de prophéties présentées comme prononcées par une Sibylle fictive, le corpus oraculaire reformule son hypotexte dans une « matrice formelle grecque » (p. 217). L’étude de cette dernière, dont le titre de la monographie rend compte avec le terme d’hellénisme, est au cœur de l’entreprise de l’auteur qui mobilise les outils de l’analyse littéraire pour dresser un tableau précis des interactions multiples des oracles avec la culture classique, la paideia, inculquée à l’école14 aux élites impériales.
15L’usage, en premier lieu, de l’hexamètre dactylique, ainsi que le « remploi (usurpare) de motifs ou d’expressions hérités de la tradition classique appliqu[és] à des réalités proprement juives ou chrétiennes » (p. 9) font ainsi l’objet d’une étude serrée. Dans le deuxième chapitre de la deuxième partie, consacré aux prophéties des premiers temps, Xavier Lafontaine propose ainsi une lecture de détail de Or. Sib. 3.820-829, dans laquelle il montre comment l’Ulysse homérique et les Argonautes d’Apollonios de Rhodes ont pu servir de modèles pour la caractérisation de Noé. Dans ce même chapitre, la maîtrise des œuvres hésiodiques et homériques déployée par le rédacteur dans Or. Sib. 1.1-123 est méthodiquement prouvée : dans ce récit de la Création et du Déluge « intégré dans une trame historique qui reconfigure les généalogies données par la Genèse pour la croiser à la mythologie grecque » (p. 156), le mythe des races hésiodique, la description des Hécatonchires et des enfants de la Nuit dans la Théogonie ou encore celle des Cyclopes odysséens offrent des hypotextes auxquels le discours sibyllin emprunte beaucoup. Les paraphrases évangéliques ne sont d’ailleurs, au demeurant, pas en reste. Les hymnes homériques et hellénistiques avec leurs images, leur vocabulaire et le style hyperbolique avec lequel les théophanies y sont décrites servent de modèle à Or. Sib. 6 tandis que les songes prémonitoires des Tragiques se lisent en filigrane dans Or Sib. 8.
16Ainsi le dialogue littéraire « conscient » (p. 117) qui aboutit au « corpus » des Oracles Sibyllins est-il élucidé par Xavier Lafontaine. Les « contours de l’univers mental » (p. 297) des rédacteurs successifs et des destinataires sont dessinés, laissant voir la prégnance de « la langue et [d]es catégories esthétiques de la παιδεία [utilisée] sous le masque d’une autorité dont la source d’inspiration est détournée et placée du côté de la divinité biblique, suivant la logique de l’Usurpation » (ibid.).
*
17Hellénisme et prophétie : les Oracles Sibyllins juifs et chrétiens offre une contribution extrêmement stimulante qui marque un jalon important dans le renouveau des études sur le corpus des Oracles Sibyllins. L’effort de définition générique déployé aboutit à une analyse stylistique et formelle précise de l’objet délimité. Les cadres théoriques de la paraphrase — ainsi que son inscription dans la rhétorique ancienne — et de l’intertextualité genettiennes servent une étude qui, en les établissant comme témoins à part entière de la poésie hexamétrique, montre l’erreur du jugement sévère qui réduisait jusque-là ces productions poétiques à de mauvaises imitations des vers homériques et hésiodiques. Xavier Lafontaine confirme méthodiquement l’intérêt certain qu’il y a à lire ce corpus oraculaire pour qui veut voir un exemple représentatif — et complexe — de paraphrases bibliques versifiées dont la composition et les éléments formels prouvent la familiarité des rédacteurs successifs avec les formes poétiques grecques liées à la formation scolaire commune, cette fameuse paideia si centrale pour comprendre les périodes hellénistiques et impériales.
18Dans cette perspective, on regrettera seulement que les paraphrases scripturaires en hexamètres des ive et ve siècles de notre ère, comme la Métaphrase des Psaumes des Pseudo-Apollinaire, les Homerocentones de l’impératrice Eudocie ou encore la Paraphrase de l’Évangile selon Jean de Nonnos de Panopolis, n’aient pas été réellement exploitées — voire mentionnées. Certes, elles sont postérieures aux Oracles et la monographie se concentre de manière compréhensible sur ce qui a pu servir d’hypotexte aux différents rédacteurs mais elles auraient servi de prolongements et de contrepoints pertinents vu les caractéristiques thématiques et formelles qu’elles partagent avec le corpus sibyllin et ce, d’autant plus que l’auteur ne rechigne pas, ailleurs, à ces excursus « anachroniques » qui permettent de dresser un tableau plus précis de l’antiquité d’époque impériale. On notera par ailleurs quelques coquilles ayant la particularité surprenante de concerner toutes Nonnos de Panopolis : devenu poète du vie siècle à la p. 104 (au lieu du ve, bien établi15), sa gigantomachie finale est avancée au chant 38 (p. 109) et elle oppose un certain « Dionysios », (sic., ibid.) aux Géants, au lieu du fils de Sémélé ; enfin, la Paraphrase (unique) de l’Évangile de Jean se lit au pluriel et sans la précision du nom de l’évangéliste dans l’index des sources antiques (p. 356). Ces quelques imprécisions n’enlèvent cependant rien à la qualité et à l’intérêt sans conteste de cette contribution qui vient nourrir non seulement le champ des études bibliques mais aussi celui des études classiques.

