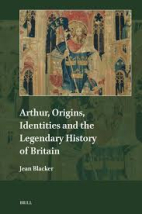
Origines, transmissions et écriture de la légende arthurienne aux XIIe et XIIIe siècles
Une question de méthode
1Parmi les travaux de recherche de son autrice, cette somme paraît à la suite d’une traduction anglaise du Roman de Brut de Wace parue en 20231 et pour laquelle Jean Blacker a écrit l’introduction et réalisé les notes. Aussi, Wace est un poète médiéval sur lequel la chercheuse américaine a écrit un certain nombre d’articles et prononcé plusieurs interventions, dont la plus récente portait sur les écritures hagiographiques de la Vierge Marie et du roi Arthur dans la Conception Nostre Dame (env. 1130-1153)2 et le Brut (env. 1155)3. Ce dernier poème peut être vu, avec sa source latine, comme la pierre angulaire de l’écriture de la légende arthurienne au milieu du xiie siècle, car il n’est pas qu’un texte historiographique, mais « un canal central de la tradition latine vers les traditions historiques vernaculaires françaises et anglaises4 ».
2Le Roman de Brut est à la fois un récit fondateur et une extension de la mythographie latine de Geoffroy de Monmouth (1137) :
[...] he tries to reconcile Galfridian chronological structures with those found in Bede and the Anglo-Saxon Chronicles, and to what extent, and in what ways — including his emphasis on the evolution of language — Wace invents his own particular blend of historiographical traditions. (p 240)
[...] il tente de réconcilier les structures chronologiques galfridiennes avec celles trouvées chez Bède et les Chroniques Anglo-saxonnes, et de comprendre dans quelle mesure et de quelles manières — y compris en mettant l’accent sur l’évolution du langage — Wace invente son propre mélange particulier de traditions historiographiques.
3Dans une perspective historique et d’analyse précise sur les textes, à l’instar de l’étude conjointe publiée par W.R.J. Barron et Glyn S. Burgess sur Le Voyage de Saint Brendan5, l’autrice démontre les différents liens existants entre l’Historia de Geoffroy, sa Variant Version, le Brut de Wace, et les autres Brut versifiés, en vieil anglais et en gallois, restituant à chacun des différents textes médiévaux la façon dont les figures, les épisodes, les thèmes et les motifs ont été transmis au courant du xiie et du xiiie siècle.
4L’introduction établit les singularités du corpus principal : Jean Blacker indique de façon précise les textes « fondateurs », s’il en est, et entremêle les différents modèles de réécritures celtiques, bibliques, latines, ou historiographiques. La méthode utilisée est celle de la comparaison avec les mythographes de la tradition arthurienne : Gildas, Bède et « Nennius », comme ici, avec l’épisode de l’arrivée des Troyens en Albion : « Nor did Geoffrey take his description of Trojan foundations from Bede, although the latter provides more details of early Britain than Gildas » [« Geoffrey n’a pas non plus pris sa description des fondations troyennes de Bède, bien que ce dernier fournisse plus de détails sur les débuts de la Grande-Bretagne que Gildas. »] (p. 44).
5Son autrice voit dans ces textes arthuriens « différents ensembles d’identités de groupe, définissant différemment la polarité de soi et des autres — “nous” et “eux”6 », qui soulèvent « la question de l’historicité d’Arthur, une question à laquelle les générations successives d’érudits et de vulgarisateurs ont souvent répondu de manière hésitante ou retentissante, souvent de manière nouvelle7 ». À cet égard, nous regrettons la polarisation trop importante sur cette figure, qui ne permet pas de prendre en compte les autres figures possédant des épisodes et des motifs en commun dans les trois textes et dans leurs continuations. Ce choix écarte de façon irrémédiable la lecture qui voudrait faire de la littérature arthurienne de la première moitié du xiie siècle un objet d’étude seulement historique ou mythographique, où le lecteur pourra trouver des éléments du contexte social ou historique du haut Moyen Âge, voire du Moyen Âge central anglais.
6En séparant chacun des textes en deux chapitres distincts (à l’exception des Brut en vers qui possèdent leur propre chapitre), l’autrice peut déployer divers degrés d’analyse, en répartissant à la fois les épisodes en sous-chapitres et les domaines de type comparatistes ou stylistiques en deux parties distinctes. Les deux premiers chapitres sont ainsi dédiés à l’« Historia Regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth » (partie 1 : p. 28-90 et partie 2 : p. 91-153) ; le chapitre 3, à la « First Variant Version » (p. 154-238) ; les chapitres 4 et 5, au « Roman de Brut de Wace » (partie 1 : p. 239-258 et partie 2 : p. 259-382) ; et le chapitre 6, à la « Tradition des Brut anonymes en vers » (p. 383-485).
L’Historia Regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth
7Dans une première partie qui retrace le parcours biographique du chroniqueur gallois, ce chapitre propose une introduction aux auteurs contemporains de Geoffroy, et envisage les intentions et la réception de l’Historia en reprenant les premiers épisodes du mythe (la descriptio de la Bretagne ; l’arrivée de Brutus ; la fondation mythique du peuple breton ; l’Adventus Saxonum et la dormition d’Arthur) que Geoffroy a simultanément tirés de Gildas, Bède et « Nennius ».
8Jean Blacker s’évertue à détailler chaque épisode, correspondant à un thème d’origine celtique, et le lie à une source textuelle ou à une réutilisation par un contemporain de Geoffroy (Guillaume de Malmesbury et Henri de Huntington), abordant, épisode par épisode, les éléments qui se retrouvent dans les différentes sources du haut Moyen Âge (vie-ixe siècle) et celles contemporaines à Geoffroy : la descriptio de la Britania ; d’Enée à Brutus jusqu’à Trinovantum (Londres) ; le roi Leir et ses filles ; Belinus et Brennius ; les différents dirigeants venant entre Belinus et Lud ; la rénovation de Londres par Lud et la rébellion de Cassibellanus contre Jules César ; les héritiers de Cassibellanus et la conversion au christianisme de Lucius.
9La seconde partie est surtout dédiée aux deux moments de la légende, telle qu’elle aussi présente chez Gildas le Sage : l’Adventus Saxonum et la suite des événements après la disparition d’Arthur. D’autres épisodes sont analysés très précisément dans ce chapitre : l’épisode de Vortimer, avec la trahison de son épouse, Ronwen, et l’invasion de la Bretagne par Hengist et Horsa ; puis, le règne tyrannique de Vortigern et l’épisode de la tour effondrée avec Merlin encore enfant (les prophéties de Merlin) ; et enfin, l’épisode de la reconquête du royaume par Uther, son frère Pandragon, et Ambrosius Aurelianus. Si l’analyse est précise, et souvent exhaustive, nous regretterons cependant que l’étude ne cherche pas davantage à explorer des pistes concernant les ponts à établir entre l’Historia et l’évocation de ces épisodes dans la poésie héroïque galloise, ou même avec le fameux liber vetustissimus, dont la trace a été perdue dans les abîmes du temps : alors que ce texte est évoqué par Geoffroy au début de sa mythographie, Jean Blacker a fait le choix d’éluder la question ainsi :
In the Historia Brittonum which is Geoffrey’s fullest source (except for the liber vetustissimus, whose existence we are not going to argue here), as noted above, Ambrosius is a bit of a garbled figure, including one story in chapters 40-42 in which Ambrosis plays the role later played by Merlin in Geoffrey’s HRB (p. 101)8
Dans l’Historia Brittonum qui est la source la plus complète de Geoffroy (à l’exception du liber vetustissimus, dont nous n’allons pas discuter ici l’existence), comme indiqué ci-dessus, Ambrosius est un personnage un peu tronqué, y compris une histoire dans les chapitres 40 à 42 dans laquelle Ambrose joue le rôle joué plus tard par Merlin chez Geoffroy dans le HRB.
10La suite concerne très largement le roi Arthur en tant que figure, et ses attributs ; « le roi Arthur et ses précédents dans Gildas, Bède et l’Historia Brittonum » (p. 107-111) ; « le roi Arthur chez Guillaume de Malmesbury et Henri de Huntington » (p. 111-113) ; « le roi Arthur : Geoffroy de Monmouth, panorama » (p. 113-131). Cette dernière partie développe les apports du texte de Geoffroy : on peut notamment relever le fait qu’Arthur porte maintenant le titre de « roi » (« rex ») et qu’il ait fait l’objet d’un couronnement. Ses armes sont aussi décrites, à commencer par son bouclier qui a pour nom Prydwen (nom que Geoffroy reprend de la tradition poétique galloise), sur lequel il ajoute l’image peinte de la Vierge Marie. D’autres épisodes sont mis en exergue comme celui d’Arthur en Gaule contre Frollo, suivi des festivités à la cour (similaires à celles de Tintagel dans l’épisode de la rencontre d’Uther avec Ygerne) ou celui du voyage d’Arthur et Keu, qui en viennent à combattre un géant hideux au Mont-Saint-Michel. Il est également question des plans d’Arthur contre Lucius Hiberius, dernier empereur de l’Empire romain d’Occident, de la trahison de Mordred et de celle de Guenièvre, du retour à Londres et de la bataille sur les rives de la rivière de Camblan et, enfin, de la mort d’Arthur, de son passage en dormition, et des rois qui suivirent, notamment Constantinus, fils de Cador, duc de Cornouailles, et Cadwallader, dernier roi de Bretagne.
11Jean Blacker termine ce chapitre en analysant la façon dont Geoffroy de Monmouth s’évertue à construire une identité multiple pour un peuple Anglais qui ne devait pas, à l’évidence, se reconnaître dans cette histoire très « bretonne ». La chercheuse montre en quoi le lexique choisi par le chroniqueur gallois permet la construction de cette identité à plusieurs niveaux, notamment en s’adressant à l’aristocratie normande installée à Londres. Wace, de cette façon, n’aura aucun mal à translater ce lexique pour l’adapter à un public sensible aux chansons de geste, pour ce qui est de la petite noblesse anglo-normande, et à l’élégie ou aux lais celtiques, pour la partie anglo-galloise, disposant de fiefs à la frontière galloise occidentale de l’Angleterre. Ainsi, la chercheuse effectue un travail de socio-linguistique appliqué qui souligne, en partant notamment des travaux de l’historien Alex Woolfe9, la façon dont Geoffroy de Monmouth s’adresse de la même manière aux seigneurs écossais, à qui il souhaite porter un message de ralliement à la couronne d’Angleterre. Nous ne saurions à cet égard que regretter l’absence des travaux d’Amaury Chauou (2000-2001)10, dont ceux portant sur la thèse de l’« idéologie des Plantagenêts », qui mettent en exergue des points importants de la propagande identitaire prônée depuis Mathilde l’Emperesse, à partir de son mariage avec Geoffroy V, comte d’Anjou, qui a déjà montré sa volonté propagandiste au sein de « l’espace angevin ».
La First Variant Version : une histoire d’adaptation
12Ce texte en latin a fait couler beaucoup d’encre, et nous l’avons traité en essayant au mieux de présenter les enjeux que constitue cette version pour les recherches en littérature arthurienne11. Encore faudrait-il pouvoir dire de quelle version de quel texte nous parlons ici. Comme dans le reste de l’ouvrage, Jean Blacker a choisi de présenter aussi précisément que possible les différents points de vue sans forcément prendre position.
13Mais, le fait très simple de placer ce chapitre 3 avant celui concernant le Roman de Brut, dans un ouvrage qui adopte la trame chronologique pour analyser ces textes, relève d’une position forte, qui était celle défendue par Robert A. Caldwell (1956)12 et qui consiste à affirmer que la First Variant Version (ou Variant Version uniquement) serait une adaptation de l’Historia de Geoffroy, alors que nombre de passages, relevés par Pierre Gallais dix ans après Caldwell (1966)13, tendent plutôt à démontrer qu’il s’agit d’une adaptation en prose latine du Brut. Aussi l’ouvrage reprend-il chaque épisode de la première partie de la mythographie (Vulgate) pour démontrer que la FV est bien un texte qui tire son origine de l’Historia Regum Britanniae (p. 154-182). Les passages mis en évidence sont ceux sur lesquels Pierre Gallais mettait le doigt dans son article, cité plus haut : l’Adventus Saxonum, le roi Arthur, sa dormition, et la fin des rois.
14Or, tout comme Hans-Erich Keller (1977), Jean Blacker omet d’ajouter que la FV et le Brut ne possèdent pas certains éléments présents dans l’Historia, comme les lignes de déploration après la mort de Bedoer ou celle de Kei (HRB, X, 362-65), ainsi que la joie éprouvée par Colgrin et Baldulf lors de leurs retrouvailles (HRB, IX, 41-42). Manque également la référence à la succession rapide des premiers engagements lors de la bataille de Langres (HRB, X, 342-49), lors de laquelle, selon les autres textes, la mêlée règne pendant un moment. Tous ces éléments relèvent de choix stylistiques d’amplification wacienne, adoptés par le remanieur de la FV.
15Les dernières parties de ce chapitre qui concernent la dimension politique de la FV (p. 219-238), avec, comme point d’accroche, les références multiples à la présence saxonne des envahisseurs, comme moteur d’un certain renouvellement, exposent les projets politiques et identitaires de Wace plus que n’importe lequel des mythographes arthuriens : tout comme Brutus avait combattu les géants primitifs de l’âge archaïque d’Albion, les rois saxons combattent les sauvages Bretons. C’est une analyse qui a au moins l’estime de proposer une explication à l’importance que les Anglo-Normands (en quête d’une identité composite et « insulaire ») accordent aux légendes de la matière de Bretagne au courant du xiie siècle. Le chapitre s’achève sur une conclusion en demi-teinte, qui nous fait de nouveau affirmer qu’il aurait pu être placé après les chapitres qui concernent le Brut de Wace (chap. 4 et 5) : « Suffice it to say that the FV does not share Geoffrey’s pro-Briton stance, and that in its absence, what remains is at least a veneer of pro-English sentiment » [« Il suffit de dire que le FV ne partage pas la position pro-britannique de Geoffroy et qu’en son absence, ce qui reste est au moins un vernis de sentiment pro-anglais »] (p. 238).
Le Roman de Brut de Wace
16Tout comme Jean Blacker l’avait fait pour l’Historia de Geoffroy, elle propose deux chapitres pour analyser en détail le grand poème épique qu’est le Brut de Wace : le premier concerne les rapports entre l’Estoire des Engleis de Geffrei Gaimar14 et le Brut de Wace (p. 239-258), le second analyse sur le plan narratif et schématique le Brut.
17L’Estoire des Engleis de Gaimar raconte la partie « saxonne » de la légende. La chercheuse fait du poème anglo-normand la source principale pour le Brut, un choix qui n’est pas sans fondement : en effet, nombre de traits, particuliers à Wace, se retrouvent chez Gaimar. Une analyse du prologue (retrouvé parmi les lacunes) fait notamment remonter l’Estoire à une source antérieure, et est certainement commune aux deux poètes anglo-normands. Ainsi, dans sa conclusion (« L’épilogue de l’Estoire des Engleis »), la chercheuse reprend-elle l’argument exposé par Ian Short dans son édition (appendix, p. 354-355) en affirmant :
He [Ian Short] speculates that Gaimar may have written the longer epilogue with its plethora of details in response to objections to an earlier version, though he concludes that “there are no grounds for postulating that the shorter epilogue pre-dates the longer”. (p. 258)
Il [Ian Short] suppose que Gaimar a peut-être écrit l’épilogue le plus long avec sa pléthore de détails en réponse aux objections à une version antérieure, bien qu’il conclue qu’« il n’y a aucune raison de postuler que l’épilogue le plus court est antérieur au plus long ».
18Le chapitre 5 décompose chaque épisode depuis le mythe de la fondation de la Bretagne par Brutus et ses compagnons, après le massacre des géants. Parmi les thématiques mises en avant par la chercheuse, figurent l’importance du langage et le changement des toponymes, décrit par Wace, l’identité bretonne et le thème du séparatisme ethnique. Elle rappelle ensuite l’Adventus Saxonum, les épisodes liés au roi Arthur (sa naissance, ses conquêtes et batailles, ses relations avec les Écossais, la création de la Table Ronde, la cour et ses fêtes, la campagne romaine et la dernière bataille d’Arthur à Camlann, l’« Espoir Breton ») et, revient enfin sur l’histoire de Gormund et sa conversion au christianisme par Augustin, sur les derniers rois et Cadwallader.
19Jean Blacker met particulièrement en exergue le rôle politique que prend la légende arthurienne pour les Plantagenêts et pour la petite noblesse anglo-normande, en se servant du langage comme arme de propagande, parvenant à cette observation qui résume bien l’ensemble du propos et des extraits choisis :
In the Brut, there are essentially three forms of naming: first, through express socio-political will of the rulers; second, by evolution or as Wace puts it “corruption” over time; and third, through mispronunciation by ruling foreigners, which can be considered simply a sub-category of evolution, often a result of colonization. (p. 275)
Dans le Brut, il existe essentiellement trois formes de dénomination : premièrement, par volonté socio-politique directe des dirigeants ; deuxièmement, par évolution ou, comme le dit Wace, par « corruption » au fil du temps ; et troisièmement, à cause des erreurs de prononciation des dirigeants étrangers, qui peuvent être considérées simplement comme une sous-catégorie de l’évolution, souvent le résultat de la colonisation.
20Ensuite, le chapitre se porte sur la figure principale d’Arthur, analysée au prisme du Brut de Wace dans lequel il cumule les deux fonctions indo-européennes qu’on lui connaît : celles du guerrier et du roi (p. 289). Il est dommage que d’autres figures ne soient pas plus explorées, comme celles de Merlin, d’Uther, d’Ygerne ou même les chefs saxons Octa et Eosa, alors que Wace amplifie pourtant les épisodes qui leur sont dédiés. Le développement se borne ainsi à la naissance, au couronnement, aux batailles d’Arthur, à ses relations avec Écossais, à ses conquêtes, à la création de la Table Ronde, à la cour et à ses festivités. Jean Blacker indique l’amplification riche en détails réalistes à laquelle procède Wace ; le chapitre cite très largement la scène présente dans le ms. K (Brut, v. 10 543-588) qui correspond à la copie dite de « Guiot » (BnF fr. 794). Il montre aussi le lien qu’un tel réalisme entretient avec la naissance de l’amour courtois au milieu du xiie siècle.
21Quelques passages sont comparés avec la FV pour expliquer que Wace se base sur l’adaptation latine. Une telle lecture aurait pu être inversée et ces analyses autour de la FV auraient gagné en pertinence si elles avaient été placées après le chapitre 5 et non au chapitre 3, comme c’est le cas dans l’ouvrage.
22Nous saluons l’analyse très pertinente proposée autour de l’épisode d’Arthur au Mont-Saint-Michel, dans lequel Wace indique de nouveaux détails qu’il tire à la fois de la tradition poétique galloise (avec la barbe tranchée de Rithon au dénouement de l’épisode), et du folklore populaire normand, en attribuant au Mont Tombelaine le nom du lieu de la tombe d’Eleine, mère de Lancelot dans la tradition romanesque arthurienne tardive (Hoel, dans la mythographie arthurienne antérieure) et forteresse tenue par les Anglais au xiie siècle en avant-poste du duché breton.
23La fin du poème de Wace (v. 13 275-13 298) rend patents les rapports politiques et intertextuels qui lient le Brut à une lecture plus idéologique de la légende arthurienne à Londres au milieu du xiie siècle, par une partie de la petite noblesse anglo-normande et anglo-galloise. C’est ce dont témoigne la construction mythique contemporaine d’Henri II, de l’« Espoir Breton », qui perdurera jusqu’au xxe siècle, et qui fait signe vers cette mythologie renouvelée et aisément instrumentalisable par les différents camps politiques régionalistes (anarchistes autonomes, comme nationalistes bretons).
24La dernière partie du chapitre, centrée sur Gormund, montre en quoi le roi saxon s’oppose au roi Arthur. L’analyse d’un personnage comme Merlin (Ambrosius Aurelianus) aurait cependant permis d’apporter un autre regard sur la figure des chefs dans l’évolution des mythographies. En effet, la question de la barbarie d’un Arthur ou d’un Uther se pose à partir du moment où la violence des mêlées décrite s’applique aussi aux rois arthuriens.
25Jean Blacker achève cet ensemble sur le Brut en rejoignant les conclusions de la thèse d’Amaury Chauou, soutenue en 2000, selon lesquelles les chansons de geste, chroniques et autres poésies héroïques du milieu du xiie siècle, composées à Londres ou en Normandie, sont avant tout des œuvres de propagande au service des Plantagenêts. L’important pour Henri II était de s’appuyer sur la petite noblesse pour gagner en pouvoir, une pratique ne perpétuera pas son fils Richard I, dit Cœur de Lion (1189-1199), ni Jean sans Terre (1199-1216). Ce pouvoir est incarné par la Table Ronde qui offre
a message of tolerance and equanimity for men and women of all ranks and groups, particularly for the primarily French-speaking ruling class which doubtless enjoyed many advantages over the native English and British populations: everyone’s linguistic heritage and culture are important — in an ideal world there would be no place for feelings of cultural superiority, certainly not as a justification of privilege and power to the detriment of others. (p. 382)
un message de tolérance et de sérénité pour les hommes et les femmes de tous rangs et de tous groupes, en particulier pour la classe dirigeante majoritairement francophone qui jouissait sans aucun doute de nombreux avantages par rapport aux populations natives anglaises et britanniques : l’héritage linguistique et la culture de chacun sont importants — dans un monde idéal il n’y aurait pas de place pour les sentiments de supériorité culturelle, et certainement pas pour justifier des privilèges et du pouvoir au détriment des autres.
La tradition des Brut anonymes en vers
26Le dernier chapitre de ce vaste ouvrage fait l’examen complet de l’ensemble des continuations du Brut de Wace, dispersés en huit fragments. En partant des continuations ou adaptations qui ont un rapport narratif direct avec la mythographie d’origine, ces huit fragments constituent un ensemble composite et offrent quatre nouvelles versions qui demeurent toujours en attente d’éditions anglaise et française. Il s’agit du Brut de Munich (Munich, Bayerische Staatsbibliothek C. Gall. 29), du Brut Royal (Londres, British Library Royal 13.A.XXI), du Brut Harley (Londres, British Library Harley 1605) et du Brut Egerton (Londres, British Library Egerton 3028).
27Ces différents fragments concernent des passages très divers du récit complet d’origine, allant de la victoire de Cunedagius sur Marganus, au mariage d’Enée et à l’arrivée d’Uther à Tintagel. Ils relatent aussi l’attaque d’Humber jusqu’à la prédiction (partielle) de Merlin du règne d’Uther, la mort du roi romain Lucius jusqu’à l’arrivée d’Hengist, le début du règne d’Uther jusqu’aux épisodes de Loth, Bedivere et Key. Mentionnons aussi l’assemblement de Stonehenge, le couronnement d’Arthur et la bataille contre Colgrinus ou encore la poursuite des Saxons à travers le Somerset. Tous ces fragments ont presque tous en commun de ne pas disposer des prophéties de Merlin en décasyllabes ou même de celles en octosyllabes. Pour cette raison, leur place même dans le Brut de Wace pose aujourd’hui question.
*
28De Arthur, Origins, Identities and the Legendary History of Britain nous soulignerons la très grande érudition dont fait preuve Jean Blacker : la grande qualité de cet ouvrage encyclopédique et analytique repose sur sa capacité à croiser l’ensemble des lectures comparatives (ou duméziliennes), historiques et sociologiques, romanistes et plus largement linguistiques ou stylistiques. Tout lecteur des grands poètes épiques arthuriens du xiie siècle doit absolument se plonger dans cette somme abyssale.
29Nous soulignerons l’apport précieux et riche des trois appendices (p. 497-514) qui proposent des schémas linéaires des différents manuscrits et fragments du Roman de Brut de Wace, mais aussi des fragments rassemblés des Brut anonymes versifiés, ainsi qu’une liste comparative des douze batailles d’Arthur relatées dans les différents textes mythographiques. La bibliographie (p. 515-557), très riche, recense même des références peu connues dans les domaines stylistique et linguistique médiévaux. Parmi les plus récents, mentionnons les travaux de Francesco Di Lella (2018-2019)15. L’index des personnages (p. 558-565) est précis et utile à la recherche par occurrences.

