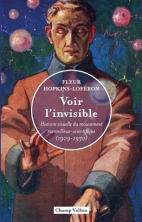
Invisible Spectrum
1L’essai que Fleur Hopkins-Loféron consacre au merveilleux-scientifique s’ouvre sur une citation de Maurice Blanchot qui dessine efficacement les intentions de l’autrice : « On dit que les critiques sérieux dédaignent la SF : je les soupçonne en cela de modestie. Ils préfèrent traiter de haut un genre qu’ils n’ont pas les moyens de connaître et qui, de toute manière, n’a pas besoin de leur jugement » (p. 5).
2Renvoyée à la paralittérature et à la littérature de genre dite « mineure », à rebours de la littérature dite « blanche », sérieuse et par conséquent adulte, la science-fiction a mauvaise presse. Jugée de piètre qualité à moins de se remémorer les mots tendres de Julien Gracq pour Jules Verne (« mon primitif à moi1 »), celle-ci passe pour un réduit bien peu confortable dont il parait difficile de s’échapper.
3La science-fiction française semble elle-même bien pauvre en comparaison de sa cousine anglo-saxonne, et la vitalité du postmodernisme américain ou britannique, qui permet à des auteurs comme Thomas Pynchon ou Martin Amis2 d’utiliser des éléments science-fictionnels sans pour autant être cantonnés au genre, parait, a contrario, le signe d’une liberté artistique séduisante.
4Un nom revient, Verne, une fois de plus, régulièrement considéré comme un horizon indépassable3 ; preuve que Blanchot avait sans doute raison de ramener la science-fiction à la question de la (mé)connaissance tout en la validant comme objet d’étude ; preuve, s’il en fallait une, que la science-fiction française, quelle que soient le cadre qu’on lui oppose, est trop souvent résumée à une ligne droite qui relie, de loin en loin, l’écrivain nantais au groupe Limite apparu en 1986-87 (Emmanuel Jouanne, Jacques Barbéri, Antoine Volodine, et al.) sans rien, ou presque, entre ces productions.
5C’est bien ce malentendu que Fleur Hopkins-Loféron, docteure en histoire de l’art et chercheuse dans le domaine des imaginaires scientifique, pseudoscientifique et occulte du xxe siècle, prend soin de dissiper dans son essai, et l’autrice d’entreprendre d’identifier, de faire connaître et de cartographier un pan du patrimoine français et européen victime d’une « amnésie populaire » (p. 345) : le mouvement dit merveilleux-scientifique de 1909 à 1930.
Qu’est-ce que le merveilleux-scientifique ?
6Ces noms dont la chercheuse explore le corpus font les belles heures des libraires spécialisés et des bouquinistes, et bien que quelques-uns aient été récemment republiés4, leurs œuvres demeurent, malgré tout, largement épuisées. Une poignée d’auteurs de romans populaires : Maurice Renard (1875-1939), auteur des Mains d’Orlac (1920) qui fait figure de chef de file, J.-H. Rosny aîné (1856-1940), Jean de La Hire (1878-1956), auteur de Joë Rollon, l’autre homme invisible (1919), Gustave Le Rouge (1867-1938), père du Mystérieux Docteur Cornelius (1912‑1913) ou encore Guy de Téramond (1869-1957).
7Le mouvement se caractérise par une tension entre le merveilleux et la science. Là où Jules Verne, encore lui, fonde son récit sur une invention (le Nautilus du Capitaine Nemo de Vingt Mille Lieues sous les mers (1869) ; la Ville flottante du roman éponyme (1870) ; l’Albatros de Robur-le-Conquérant (1886), etc., le merveilleux-scientifique s’appuie sur une hypothèse. Il doit « être crédible et donc prendre l’apparence du vrai » (p. 28) au moment où la science côtoie le surnaturel et le charlatanisme (fakirisme, magnétisme, transmission de pensées et autres renvois à la parapsychologie et aux pseudosciences) sans que la frontière soit encore tout à fait lisible.
8De cette seule hypothèse doit suivre un récit cohérent. En validant la science (aujourd’hui réfutée) derrière l’optogramme et autres machines nécrotiques, censées faire de l’œil un appareil photographique, Auguste de Villiers de L’Isle-Adam imagine « une scène fantastique imprimée sur [la] rétine » (p. 300) d’une morte (Claire Lenoir, 1867/1887) ; en s’inspirant des travaux d’Hanna Rose Shell sur le camouflage et le mimétisme, Jo Valle conçoit, quant à lui, des soldats invisibles (« L’Uniforme invisible », 1915).
9L’article de Maurice Renard « Du roman merveilleux-scientifique et de son action sur l’intelligence du progrès » (revue Le Spectateur, octobre 1909) fait office de manifeste et popularise le terme de « merveilleux-scientifique » tout en distinguant le mouvement de la « scientifiction » d’Hugo Gernsback (1926) ou de la science-fiction traditionnelle5 et autres « romans d’aventures scientifiques » et « romans d’hypothèse ».
Une archéologie du savoir et une histoire visuelle
10Le passage du xixe au xxe siècle qui voit s’éteindre Réalisme et Naturalisme, et où Victor Hugo lui-même finit de regarder tourner les tables6, est, d’abord, le lieu d’une incroyable vitalité scientifique. Citons, pêle-mêle, la découverte des rayons X, l’invention du laboratoire photographique, du microscope, du télescope ou de la TSF. Autant de trouvailles, ici commodément rangées en chapitres, qui piquent l’imaginaire et interrogent l’idée de regard, de dévoilement, d’hermétisme, mais aussi, et peut-être surtout, notre façon d’adresser l’univers et ses frontières — cet « invisible » qui sert de titre à l’autrice, et qui ne cessera de gagner en visibilité, y compris sur scène7, tout en conservant une part considérable de mystère.
11En créant de nouveaux outils ou régimes optiques, en établissant de nouvelles disciplines et, donc, de nouveaux champs de recherche, la science ouvre un œil neuf sur la médecine et la compréhension du corps humain, sur l’infiniment petit comme sur la profondeur du cosmos. Les microbes, dont Louis Pasteur dévoile l’omniprésence dans les années 1870, suscitent l’écriture de nombreux romans ou nouvelles (Une invasion de Macrobes d’André Couvreur, 1909, Un homme chez les microbes de Maurice Renard) et éveillent l’imagination. La littérature comme expérience de pensée se plait dès lors à décrire ce monde, le nôtre, qu’on pensait seulement empli d’air et de lumière, en réalité peuplé d’un fouillis de corpuscules, de bacilles, de micro-organismes et d’ondes impossible à voir. Le merveilleux-scientifique, rappelle Fleur Hopkins-Loféron, participe « de l’histoire critique du roman populaire autant que d’une étude de la construction historique du regard » (p. 13) — ce que viennent confirmer les nombreuses illustrations en noir et blanc ou en couleur qui émaillent le volume, couvertures et illustrations, vignettes et publicités.
12La qualité de Voir l’invisible, sans aucun doute l’un des essais les plus remarquables publiés récemment, doit beaucoup au talent d’écriture de l’autrice qui tisse des liens organiques entre éléments scientifiques et œuvres littéraires, sans que ces dernières ne soient renvoyées à la simple illustration ou au commentaire savant — un écueil que de nombreux essais peinent, aujourd’hui encore, à éviter.
13Fleur Hopkins-Loféron revient ici à une part essentielle du travail du chercheur en littérature : fouiller, trier, cataloguer puis faire connaître (le corpus étudié est particulièrement riche et reste, d’abord, une étonnante invitation à lire), le regard de l’enquêtrice participant, en ce cas, à la mise au jour d’un certain nombre d’œuvres majeures et poursuivant le métier de Joseph Altairac, « mentor et ami », disparu en novembre 2020. L’essai, qui ouvre de très nombreuses pistes de recherche, reste, à ce titre, aussi fascinant à lire qu’édifiant.

