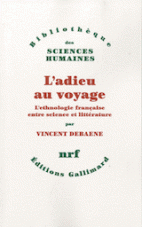
Adieux à l'Adieu ?
1En intitulant mon exposé « Adieux à L'Adieu », je souhaitais exprimer différents mouvements à la fois divergents entre eux et intrinsèquement contradictoires. Il y avait d'abord le sentiment personnel d'un nécessaire dépassement et le besoin de passer à autre chose ; on est parfois un peu encombré par ses écrits, à la fois parce qu'on s'y reconnaît trop et parce qu'on ne s'y reconnaît plus. Mais j'ai agrémenté mon titre d'un point d'interrogation, car au fond, ce livre, je ne le renie pas du tout ; je le signerais encore aujourd'hui dans sa presque intégralité. Ce qui a changé, peut‑être, c’est l’urgence de certains questionnements, brûlants pour moi quand j’écrivais, et qui aujourd’hui ont perdu de leur acuité. Par ce titre, je voulais surtout redire ce que je disais déjà dans la conclusion de l'ouvrage, à savoir que la formule « l'adieu au voyage »ne doit pas s'entendre comme un geste de clôture et de conclusion, et encore moins comme la qualification d'un moment historique (comme on a pu dire que la connaissance du globe ou l’invention du tourisme de masse marquaient la « fin des voyages ») ou d’un moment théorique (comme on a pu parler, en anthropologie, de « fin de l’exotisme »). Redoubler la formule, dire adieu à l'adieu, c'est une façon de conjurer la tonalité mélancolique inévitablement associée à la notion d'adieu ; c'est une façon de redire que l'adieu au voyage ne désigne pas une fin ; il constitue un moment interne à l'expérience du terrain ethnographique, à la fois fin et début, à la fois abandon et réinvention de soi.
2Ce titre était inspiré de la formule de Claude Lévi‑Strauss à la fin de la grande péroraison mélancolique qui conclut Tristes tropiques : « Adieu sauvages, adieu voyages ». Il est important à mon sens de réinscrire cette formule dans le parcours de Lévi‑Strauss qui, après Tristes tropiques, n'allait pas renoncer à l'anthropologie, mais au contraire écrire Le Totémisme aujourd'hui, La Pensée sauvage, les quatre tomes des « grandes » Mythologiques (1964‑1971), puis ce qu'il a appelé les « petites » Mythologiques (La Voie des masques ; Histoire de Lynx ; La Potière jalouse). Autrement dit encore une fois, dire « adieu au voyage », c'est certes rejeter la pratique du voyage et le genre du récit de voyage et, plus profondément, se défaire d'un mode de subjectivation (la construction de soi dans un face‑à‑face avec l’autre) et d’une façon de raconter l’histoire (la déploration nostalgique de la disparition des différences) — mais ces abandons sont des préalables : ils ouvrent la possibilité d'un recommencement.
3Plutôt que de vouloir redresser, bien vainement, la réception de mon livre, je préfère — sept ans après la publication — insister sur quatre points. Dans trois cas, il s'agira de souligner des éléments qui sont déjà présents dans l'ouvrage mais sur lesquels il me semble que je n'ai pas assez insisté. Dans le quatrième cas (qui sera en fait mon troisième point), il s'agira d'indiquer un manque.
Première remarque
4Mon travail a d'abord consisté à repérer dans l'anthropologie française une sorte de tradition que j'ai commodément appelée « des deux livres », à savoir la publication, par l'ethnologue, au retour de son terrain, d'un deuxième ouvrage, plus « littéraire », en supplément de la monographie savante attendue et qui, à la différence de cette dernière, paraît chez un éditeur généraliste (Gallimard, Grasset ou Plon). Les cas les plus célèbres sont ceux de Lévi‑Strauss et Michel Leiris, le premier lorsqu'il publie Tristes tropiques (1955) après La Vie familiale et sociale des Indiens nambikwara (1948), le second lorsqu'il fait paraître L'Afrique fantôme (1934) à côté de travaux ethnographiques qui vont devenir La Langue secrète des Dogons de Sanga (1948) et La Possession et ses aspects théâtraux chez les Éthiopiens de Gondar (1958). Mais il y en a beaucoup d'autres : Les Flambeurs d'hommes (1934) de Marcel Griaule à côté de ses études sur les jeux et les graffiti abyssins ; Mexique, terre indienne (1936) de Jacques Soustelle en supplément de ses deux thèses sur les Indiens otomi et lacandon ; Gens de la Grande Terre (1937)de Maurice Leenhardt en complément des trois tomes d'ethnologie néo‑calédoniennes, publiés par l'Institut d'ethnologie de Paris entre 1930 et 1935 ; L'Île de Pâques (1941)d'Alfred Métraux, qui paraît un an après une volumineuse Ethnology of Easter Island (1940), etc. Étudier ces doublons, c'était bien sûr l'occasion d'interroger concrètement et historiquement ce qui est à mon sens la frontière, sinon essentielle, en tout cas négligée, de la littérature à l'ère moderne, à savoir celle qui la sépare des discours savants.
5Mon livre porte précisément sur l'interprétation de ce phénomène de dédoublement pour la première génération de l'ethnographie française, celle qui a été formée par Marcel Mauss au début des années 1930, et prend pour objet, donc, les écrits de Michel Leiris, Marcel Griaule, Claude Lévi‑Strauss, Alfred Métraux, Maurice Leenhardt, Jacques Soustelle. Mais la tradition des deux livres se poursuit ensuite — et encore aujourd'hui — avec les récits autobiographiques de Georges Balandier, Georges Condominas, Pierre Clastres, Philippe Descola, etc. On pourrait donner des exemples plus contemporains.
6Or il y a un point sur lequel je tiens à insister, en particulier à l'intention des ethnologues qui, après un moment de silence plus ou moins hostile, se sont emparés de mon travail et de cette idée des « deux livres » : c'est que cette distribution ne constitue nullement une binarité figée, et qu'elle n'oppose aucunement des écritures, l'écriture contrainte et formatée de la science contre l'écriture sans règle et sans entrave de la littérature. Le véritable problème posé par la publication des deux livres ne tient pas au fait du face‑à‑face (qui trahirait l'impossibilité d'un discours unifiant et homogène, voire l'échec du projet anthropologique savant) ; il tient aux rapports entre les deux livres, à la variation de ces rapports, et à la dynamique dans laquelle ils sont pris. Toutes ces paires ne sont pas superposables, et toutes ces paires s'inscrivent dans des dynamiques singulières.
7Pour certains ethnologues, la publication de deux livres peut certes correspondre à une tentative de distribution entre le « subjectif » et l’« objectif » — mais l’objectif et le subjectif ne constituent pas des catégories figées, et ils ne se donnent pas comme tels dans l’expérience ; ils sont le résultat d’une élaboration et d’une négociation dans des configurations épistémologiques données, a fortiori pour l’ethnologie qui a pour principe de s’enraciner dans une expérience subjective et affective. Dans d'autres cas, le second livre se rapproche plutôt de ce qu'on désignerait volontiers de la formule anglaise de making‑of, c'est‑à‑dire le récit du processus (complexe, troublé, contingent, polyglotte, etc.) dont l'ouvrage savant est le résultat. Dans d'autres cas encore, la répartition est très clairement psychologique comme on l’observe avec le Journal de Malinowski, publié après sa mort, et qui a de toute évidence joué un rôle de « soupape de sécurité », selon l’expression de l’historien George Stocking, pendant le travail de terrain solitaire mené aux îles Trobriand pendant dix mois. Et on pourrait multiplier les variations.
8Il n'y a donc pas deux régimes de discours, d'un côté une science figée dans ses conventions et de l'autre une littérature qui accueillerait tout ce que la science interdit (la première personne du singulier, la fiction, le montage, l'expression de jugements, etc.) mais des expériences d'écriture locales dans des contextes historiques et épistémologiques donnés, et qui — j'y insiste — sont elles‑mêmes prises dans des trajectoires singulières. Pour introduire cette dimension dynamique et sortir de la fausse dualité entre « écriture scientifique » et « écriture littéraire », Claude Lévi‑Strauss offre un cas exemplaire : l’écriture de Tristes tropiques n’a nullement constitué un « à‑côté » ou une digression en dehors du travail savant. Au contraire, elle a été, en tant que processus à la fois formel et psychique, la condition du développement de la « seconde » anthropologie structurale consacrée aux mythes et à la logique des qualités sensibles, après l’étude des structures de parenté. Je ne veux pas dire que ce discours de savoir n’aurait jamais vu le jour sans cela, mais seulement qu’il fallait que Lévi‑Strauss, en tant que savant particulier à ce moment particulier de son histoire, « passe » par cette expérience d’écriture et de recomposition de soi — de son passé et de son identité — pour que son œuvre savante devienne possible1.
Deuxième remarque
9Parmi ces variations (du rapport entre les deux livres), il y en a un ensemble sur lequel je veux insister, plus encore que dans L'Adieu au voyage — à savoir les variations géographiques et nationales. Pour le dire très simplement, la question des rapports entre anthropologie et littérature ne se pose pas de la même façon en Suisse, en France, aux États‑Unis, en Grande‑Bretagne, en Russie ou au Japon. Ce n'est pas très étonnant si on considère que la plupart des littératures se sont constituées sur des bases nationales et que l'histoire — beaucoup plus récente — des sciences sociales est fondamentalement locale, tributaire des structures institutionnelles et des divisions du savoir propres à un espace donné à un moment donné de l’histoire. Pourtant, malgré ce constat assez élémentaire, on tend invariablement à considérer la question des rapports entre littérature et ethnologie comme un problème abstrait, général, et — au fond — épistémologique. On se demande en gros comment l’ethnologue doit écrire : comment faire pour dire l'étrangeté ? Comment intégrer la voix de l’autre à son propre discours ? L'ethnologue doit‑il faire preuve d'inventivité formelle ou au contraire se conformer aux règles traditionnelles de l'écriture savante ? Peut‑il s’inspirer des grandes œuvres de la littérature ? Et si oui, jusqu’à quel point ? Etc., etc.
10Or les rapports entre ethnologie et littérature ne seront pas les mêmes si l’ethnologie s’est construite contre le folklore, par exemple, ou si elle s'est construite contre la raciologie scientifique ; si elle s’est constituée contre la littérature exotique ou contre la science coloniale ; ils ne seront pas les mêmes si le modèle directeur était la philologie ou les sciences naturelles ; ils ne seront pas les mêmes si l’institution centrale à l’origine de la discipline était une société savante, une bibliothèque, un musée ou un département d’anthropologie dans une université.
11Les interrogations épistémologiques sont absolument légitimes, mais il est important de comprendre qu’elles ne prennent sens que dans un cadre conceptuel donné et au sein de traditions à la fois savantes et culturelles singulières. Ce ne sont pas seulement les réponses qui varient selon qu’on se situe en France, au Japon ou aux États‑Unis, mais la façon même de poser les questions. De là par exemple le caractère étrange, pour un anthropologue français, des travaux américains des années 1980 et 1990 sur l’écriture de l’ethnographie, qui paraissent vaguement exotiques, à la fois (et contradictoirement) naïfs et inutilement acerbes, à la fois d’une grande liberté de ton et épistémologiquement peu solides2. Il faut donc reprendre ici l’un des préceptes fondamentaux du structuralisme : pour vraiment éclairer les rapports entre ethnologie et littérature dans un espace donné, il ne faut pas se contenter des contrastes apparents, mais faire varier ces contrastes en envisageant les espaces voisins, autrement dit se pencher non seulement sur les différences, mais sur les différences entre les différences.
Troisième remarque
12J'en viens à ma troisième remarque, qui vise moins cette fois à préciser les choses qu'à indiquer une lacune de mon livre.
13Au fond, en inscrivant l’ethnologie dans une histoire longue des rapports entre discours savants et littérature depuis le xviiie siècle, je négligeais un troisième espace de discours qui est pourtant essentiel à la construction de l'anthropologie comme discipline, à savoir la parole indigène. Face aux développements nombreux et souvent peu satisfaisants sur la question des rapports entre ethnologie et littérature, je tenais à montrer que même si l’ethnologie apparaît singulière parce qu’elle s’occupe de « l’homme », ces rapports ne constituent en réalité qu’une variation au sein d’une histoire générale des relations entre science et littérature qui commence avec l'histoire naturelle (et peut‑être même avant), et qui se poursuit avec la botanique, l'histoire, la géographie, la sociologie, etc. Cette inscription historique était, je crois, nécessaire, mais elle avait un effet pervers. Car si l'anthropologie relève d'un schéma général dans ses rapports à la littérature, c'est un discours savant qui a tout de même pour spécificité de ne pas prendre appui seulement sur des observations, des analyses et des discussions intra‑disciplinaires ; il repose aussi sur des discours recueillis et interprétés.
14Je ne crois pas que cela remette en cause mes analyses dans L'Adieu au voyage en tant que telles, mais il faut maintenant compliquer cette histoire et y introduire — en plus, donc, des notions de science et de littérature — la question essentielle de la parole et de la perspective indigène, d'autant que cette parole peut elle aussi se faire littérature. Une réflexion conséquente doit donc embrasser le rapport des sciences sociales à la littérature non seulement comme modèle ou contre‑modèle, mais aussi comme source et comme objet. Il ne suffit pas d'envisager les hésitations du savant qui s'interroge sur sa propre parole ; il faut considérer ces hésitations au sein d'une négociation où la parole de l'autre, elle aussi, hésite et où son statut navigue entre trois pôles : tantôt simple source, tantôt discours savant (lorsque l'indigène se fait ethnographe, expert de sa propre société), tantôt littérature.
15Et là encore, il importe de saisir chaque situation dans sa singularité. Par projection de la doxa postcoloniale sur le passé colonial, on tend en général à imaginer que la littérature indigène s'est développée en réponse aux discours savants occidentaux. Empruntant son schème au titre de la célèbre synthèse The Empire Writes Back, l'approche historique envisage volontiers la littérature comme un discours de résistance et de réappropriation, contre une anthropologie conçue comme un savoir occidental, colonial, réifiant. Or, dans le cas français en tout cas, cette conception est tout à fait inexacte ou à tout le moins extrêmement simplificatrice. Les premiers auteurs de ce qu'on appelait jusqu'aux années 1950 la « littérature indigène d'expression française » étaient au contraire familiers du discours ethnologique et ont même souvent manifesté un grand intérêt pour la discipline. C'est un phénomène qu'on observe d'abord chez les premiers écrivains africains de langue française, qui ont souvent commencé leur carrière par des articles philologiques ou ethnographiques, parfois même comme informateurs des ethnologues : Paul Hazoumé, Ousmane Socé, Bernard Dadié, Abdoulaye Sadji, Fily Dabo Sissoko, Amadou Hampaté Bâ. Il y a là une conséquence de la formation, par la puissance coloniale, de ce qu'on appelait alors les « élites lettrées », auxquelles on demandait un « retour sympathique aux faits de la vie indigène »3. Mais cet intérêt pour l'ethnologie s'observe aussi chez les écrivains d'Afrique et des Antilles installés à Paris, soucieux quant à eux de retrouver, « avec l’aide des savants de race blanche et de tous les amis des Noirs », « la fierté d’appartenir à une race dont la civilisation est peut‑être la plus ancienne du monde »4. Les trois fondateurs de la « négritude » — le Guyanais Léon‑Gontran Damas, le Martiniquais Aimé Césaire, et le Sénégalais Léopold Sédar Senghor —, quoique très sensibles aux formes de domination et de réification portées par la science anthropologique, perçoivent le développement de l'ethnologie comme une chance à saisir et une voie à suivre. Dès 1934, Damas mène des expéditions ethnographiques chez les nègres bosh de Guyane, à la demande de Marcel Mauss ; Senghor est diplômé de l'Institut d'ethnologie de Paris en juin 1939 ; et dans la revue Tropiques, René Ménil, Aimé et SuzanneCésaire publient des pages de l'anthropologue allemand Leo Frobenius, s'interrogent sur la leçon qu'ils peuvent en tirer, collectent le folklore martiniquais et y recherchent des survivances africaines5.
16C'est cette articulation entre ces trois discours — littérature, parole indigène et discours savant — qui m'occupe à présent, car c’est une histoire dont nous héritons. L'état actuel des études littéraires et la séparation de fait entre une littérature française métropolitaine centrale et une bien mal nommée littérature « francophone » produite dans les anciennes colonies françaises s'enracine dans une histoire dont l'anthropologie est une composante essentielle car elle a contribué à une distribution politique de la parole.
Quatrième remarque
17Enfin, dernier point de cette « postface », je voudrais proposer une réponse retardée à une objection d'Antoine Compagnon, qui a dirigé la thèse à l'origine de mon livre. Dans ma thèse (et encore dans mon livre, quoique plus discrètement), j'insistais beaucoup sur l'idée — initialement empruntée à Gustave Lanson — d'une « dépossession de l'artiste par le savant ». Il s'agissait d'indiquer que depuis la fin du xviiie siècle, les sciences se sont progressivement emparé de domaines d'objets qui étaient autrefois le privilège de la littérature. En 1892, Lanson, qui était un esprit moderne et qui croyait dans le développement des sciences, voyait dans cette dynamique le facteur déterminant de l'histoire de la littérature française depuis Boileau :
À mesure que chaque science s’arme de sa méthode, elle échappe à la littérature, et l’on pourrait dater la naissance d’une science du jour où les objets qu’elle étudie ne sont plus matière d’invention poétique ou romanesque, ou même simplement d’exposition oratoire […]. Dès que l’homme peut espérer de connaître, le jeu ne l’amuse plus, et l’artiste est dépossédé par le savant6.
18Ainsi la littérature avait‑elle été privée tour à tour de la science physique, de l’histoire naturelle, de l’histoire, de la critique littéraire — qui toutes s’étaient constituées comme sciences en lui arrachant un territoire qui était autrefois le sien.
19Mais Lanson sauvait la littérature en lui réservant un ensemble d'objets qui, selon lui, demeureraient toujours inaccessibles à la science : la psychologie et les mœurs. Ces deux objets resteraient, selon ses mots, « le domaine inaliénable du romancier et du poète ». On voit bien pourquoi, dans cette perspective, les nouvelles sciences de l'homme — la psychologie, la sociologie, l'ethnologie — pouvaient constituer une menace pour la littérature. Elles la privaient de ce qui constituait son apanage et son ultime bastion : la connaissance de l'homme. Et je proposais donc de lire le rapport des écrivains à l'ethnologie comme une résistance à ce mouvement irrépressible d’annexion, par la science, de ce qui avait toujours été le domaine réservé de la littérature. C'est une façon très efficace de saisir, par exemple, les évolutions du rapport d'André Breton ou de Roland Barthes à l'anthropologie.
20Or Antoine Compagnon m'avait dit : « je me demande s'il n'y a pas là une forme de scientisme, une foi un peu trop grande dans l'avancée de la science. » Au fond, il me reprochait de prendre un peu trop au pied de la lettre ce diagnostic de Lanson et la péremption qu'il semblait imposer à la littérature. Et il me soupçonnait d'idéaliser quelque peu les pouvoirs de l'ethnologie. Treize ans après ma thèse, sept ans après la parution de mon livre, je dois répondre : point taken, comme on dit en anglais, et ce pour deux raisons. D'une part, j'ai en effet pris mes distances avec cette histoire des sciences un peu linéaire et naïve, selon laquelle, par ruptures épistémologiques successives, la science grignote le domaine de la littérature. Non seulement parce que, tout autant que l’histoire de la littérature, l’histoire des sciences connaît trop d'imprévisibles retours en arrière et d'improbables réhabilitations pour qu'on puisse la résumer à un tel mouvement linéaire, mais plus encore parce que de telles réhabilitations redéfinissent à chaque fois le domaine du connaissable — et qu’il n’y a donc pas un espace vierge donné à l’entendement comme ce qu’il y a à connaître et qui se trouverait progressivement « couvert » à la façon d’une terra incognita peu à peu explorée et topographiée. D'autre part et surtout, je me suis lassé de la métaphore spatiale et territoriale qui est un corollaire presque inévitable de la perspective historique. Aujourd'hui, il me semble que cette façon de poser le problème en termes cartographiques — ce qui relève du territoire de la littérature, ce qui relève de la science — a une pertinence certaine (d’abord parce que cela correspond souvent à la perception qu’en ont les acteurs eux‑mêmes), mais limitée, car elle programme les réponses. On se voit contraint de parler en termes de porosité, de rivalité, d'empiétement, etc. Cela « marche » dans une certaine mesure, comme d'ailleurs l'analyse en termes de champs, mais cela présuppose un point de vue d'historien et que l'on se situe dans l'après‑coup de la chose jugée, c'est‑à‑dire que l'on accorde un privilège de principe à un présent exhaussé au‑dessus des controverses d’autrefois.
21Or la fréquentation des ethnographes et la connaissance de l'histoire de la discipline ethnologique invitent à considérer avec circonspection le positionnement d’un chercheur qui, à l'abri derrière sa « neutralité axiologique » (ou à l’abri derrière un présent immunisé des effluves du passé), observe et analyse la formation et la circulation des valeurs chez « les autres » — que ceux‑ci soient éloignés dans le temps ou dans l’espace social. Aussi instructive soit‑elle, cette perspective cartographique, que partagent le sociologue et l'historien de la littérature, a un double défaut. D'une part, elle réifie les verdicts de l'histoire et essentialise ce qui n'est qu'en apparence un « état de fait » : une appréciation présente de la littérature passée7. D'autre part, elle situe le discours critique dans un ordre strictement descriptif, coupé des réalités qu'il décrit. Mais les minores et les grandes œuvres, les auteurs racisés et les auteurs consacrés, les livres méconnus et les ouvrages‑inscrits‑au‑programme ne constituent pas en tant que tels des donnés offerts à l'intelligence historique ou sociologique dont celle‑ci n’aurait plus qu’à rendre raison : cette intelligence participe de la même histoire que les écrits qu’elle prend pour objet. Elle leur doit ses catégories et ses cadres d’analyse, et pour s’en extirper, il lui revient de relire les textes non pas pour montrer la nécessité de la situation présente mais, au contraire, pour montrer qu’il eût pu en être autrement — et peut‑être même que telle œuvre oubliée, que tel ouvrage injustement catégorisé recèle des ressources pour dénaturaliser notre présent. De là le caractère très souvent duplice de la sociologie du champ littéraire qui, d'un côté, prêche le relativisme sceptique en mettant au jour les logiques de marginalisation ou l'insuffisante consécration des littératures non‑centrales, mais de l'autre côté, entérine comme un état de fait, par le geste explicatif lui‑même, un rapport entre marge et centre qui n'est qu'une version possible d'un conflit de valeurs. Du côté de la défense des dominés en apparence, c’est un discours qui, en la naturalisant, participe à la domination qu’il prétend dénoncer.
22Quoi qu'il en soit, il me semble plus fructueux à présent d'abandonner ce point de vue ex‑post. Je préfère ne pas postuler de grandes coupures entre les discours et m'intéresser aux expériences d'écriture telles qu'elles sont en train de se faire, dans le présent de leurs opérations, sans préjuger du genre de discours dont elles relèvent, sans préjuger non plus de la pérennité de leur « appartenance générique » ou de leur consécration, et avec la conviction que ces expériences sont potentiellement porteuses de déplacements, de réorganisations et qu’elles ne laissent pas notre présent intouché.
23Alarmé sans doute de ce « scientisme » qu’il percevait dans mon travail, Antoine Compagnon avait terminé ses observations le jour de ma soutenance en me disant qu'il me restait à faire une apologie de la littérature — et au vu de la perspective dans laquelle je m'étais placé, il avait raison : c'était une objection légitime. Quelques années plus tard, sa leçon inaugurale ici même s'interrogeait sur cette idée d'apologie de la littérature ; il y faisait référence au diagnostic de Lanson de dépossession de l’artiste par le savant, ainsi qu'aux considérations de Bonald sur « la guerre des sciences et des lettres ». Et en l’écoutant sur Internet après coup, je me suis demandé s'il n'y avait pas, dans cette volonté de répondre à la question « Que peut la littérature ? » (à lui le « scientifique » qui a tourné « littéraire »), un désir de répondre aussi à ces étudiants frottés de sciences sociales — car je n'étais pas le seul — qui, plus peut‑être qu'à la génération précédente, doutaient de la naturalité de la littérature et étaient sensibles à la fois aux caprices de l'histoire et aux formes de domination dont la littérature peut se faire l’instrument. Nous étions moins suspicieux qu'inquiets, mais nous l'étions plus profondément, peut‑être, qu'on ne l'avait été avant nous. Au fond, c’était la peur d’être déçus qui nous animait ; nous attendions beaucoup de la littérature, mais nous aurions voulu qu'elle s'impose avec plus d'évidence (nous étions au seuil de la carrière, à un moment où celle‑ci ne sert pas encore de contrefort dans les moments de doute). Comme Antoine Compagnon, je ne crois pas finalement que la littérature ait besoin d'une apologie ; les tentatives en ce sens ont toujours quelque chose de forcé et de vain, voire de franchement contre‑productif, car elles font naître le soupçon qu’elles prétendent conjurer. La littérature n’a pas besoin d’apologie car le mouvement se prouve en marchant. Mais sept ans après L'Adieu au voyage, sans avoir rien perdu de mon respect, de mon admiration parfois, pour le travail et le discours des ethnologues, je suis plus confiant, beaucoup plus confiant, dans les pouvoirs de reconfiguration de l'écriture.

