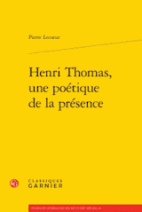
D’une mélancolie créatrice : Henri Thomas, écrivain de la présence
1L’essai rédigé par Pierre Lecœur, Henri Thomas, une poétique de la présence, propose de lire une version réécrite de sa thèse, la première publiée en France sur Henri Thomas, qu’il avait préparée sous la direction d’Éric Marty et soutenue en 2007 à l’Université Paris‑Diderot. Cet essai doit être salué en ce qu’il apporte une lecture érudite et méthodique d’une œuvre encore peu étudiée, mais qui jouit d’un incontestable regain d’intérêt, dont témoignent la tenue de colloques ou la parution de numéros de revues consacrés à Henri Thomas1. L’essai s’articule en deux parties dans une construction à la fois thématique et historique, que P. Lecœur justifie dans son avant‑propos comme reflétant l’évolution propre à l’écriture d’H. Thomas. Cette écriture, fondamentalement placée sous le signe de la mélancolie, se confronte d’abord à l’absence comme schème recouvrant deuil et errance, pour faire place à l’assomption poétique de la présence.
Des formes d’une absence omniprésente
2Thématiquement présente à travers les conduites d’errance, d’échec ou de dépossession, l’absence est singulièrement développée sous les diverses formes d’un deuil omniprésent dans les récits d’H. Thomas. Le sentiment de la perte détermine fortement une écriture mélancolique où se joue souvent une identification au disparu dans les années 1950 à 1970. Cette écriture est placée sous « la loi propre au deuil, qui s’accomplit par l’intensification des liens unissant le survivant au disparu » (p. 45). Plus qu’une « manière d’être », comme a pu le penser une certaine critique, la mort dans les récits thomasiens constitue avant tout un non‑événement, en ce sens que l’écriture semble toujours en escamoter les détails, au profit d’une présence diffuse (p. 50‑54). Le roman La Nuit de Londres permet à P. Lecœur de proposer une analyse approfondie de cette écriture orphique qui, à travers un discours labyrinthique, non seulement laisse le lecteur face à l’indécidable, mais surtout, selon l’auteur, vise à « indiquer (en le préservant) et [à] rendre hommage à un objet essentiellement absent » (p. 68). Dans les récits thomasiens, seuls certains personnages, dotés de l’« esprit de finesse » défini par Pascal comme une capacité à « voir la chose d’un seul regard, et non pas par progrès de raisonnement » (p. 74), sont en mesure de voir de tels objets, ces « presque rien » dont la vie et le récit conservent des indices, constituant autant de reliques, dont P. Lecœur rappelle la définition et le fonctionnement chez Freud et Pierre Fédida2 (p. 84‑85). Ces objets trouvent des équivalents dans certains mots des récits thomasiens, témoins eux aussi d’une mélancolie à l’œuvre. Mais, comme l’indique un critique, chez Thomas, « [...] si la littérature est évocatoire, c’est moins pour conserver ce qui fut, que pour en atténuer les effets, en vue de naître à autre chose3 ».
De la Terreur à l’épiphanie
3Dans la sous‑partie « Terreur et récit », P. Lecœur précise qu’il retient la définition de la Terreur proposée par Laurent Jenny4 plutôt que celle de Paulhan, soit la réflexivité du langage et la recherche de l’« assomption de la présence dans les signes » (p. 99), plutôt que l’hostilité à l’égard du langage. P. Lecœur étudie certaines formes que peut prendre la Terreur dans les récits thomasiens, notamment à travers la figure allégorique du chiffonnier qui s’oppose aux personnages d’écrivains superficiels qui préfèrent « raconter pour ne pas dire » (p. 100‑106). Thomas met en avant une nécessité éthique et esthétique qui l’amène à se confronter à l’« indicible », pour légitimer sa position d’écrivain à la marge revendiquant « qu’il n’est pas un auteur » (p. 120). Ne pas être auteur et pourtant écrire, telle est la problématique propre au témoin, dont la figure se retrouve souvent dans les récits thomasiens, et que P. Lecœur étudie en interrogeant le schème de la vision. P. Lecœur relève que chez Thomas, le témoin est souvent possédé par l’objet de la vision, aux limités de la cécité et d’une vision fascinée, celle qui caractérise en propre le voyeur, dont la contemplation du réel désassure la subjectivité. Parce que « témoigner, et plus généralement exprimer, c’est se soumettre à une double contrainte, celle du réel sans nom et celle du langage ; c’est être fidèle au caractère profus et indécidable du premier tout en acceptant la loi du second, qui est celle du sens » (p. 151), l’expérience du témoin sert une analogie avec celle de l’écrivain, et « fait de la Terreur au sens où l’entend Laurent Jenny, c’est‑à‑dire l’émergence d’un langage neuf, une manière d’être plus qu’une manière de dire » (p. 151‑152).
4Creusant les mécanismes de réflexivité de l’écriture repérables dans l’œuvre thomasienne, P. Lecœur porte son analyse sur la notion de « singulier », entendue comme « impliqu[ant] la valorisation du discontinu, de la rupture », mais également par « l’adhésion mélancolique à ce qui ne se reproduit ni ne s’articule » (p. 156). L’auteur repère dans les ratés et « accidents de la pensée5 » qui marquent la progression du récit thomasien « un rapport singulier au langage », réfléchi par trois phénomènes, que sont « la lecture fautive ou aberrante, la récurrence obsessionnelle de mots ou d’idées et le “blanc” ou l’interruption » (p. 158). Plus qu’à « un prolongement “pathologique” de la Terreur » (p. 165), P. Lecœur préfère associer ces phénomènes au « ressassement suggestif » caractéristique de l’écriture durassienne. La répétition de mots et la récurrence d’objets qui lui font écho dans la diégèse, ont toutes deux une portée incantatoire, visant le « surgissement d’autre chose [...] qui s’apparente à une présence », privilégiant « un usage poétique du langage » (p. 167‑168) et le discontinu au détriment de la cohérence discursive. L’échec du continu se trouve réfléchi dans celui de personnages marginaux, incarnant autant le singulier que l’idiotie6, dans Le Parjure particulièrement, où le refus du témoignage vise à « sauver le singulier des dangers [...] du simulacre » (p. 176). P. Lecœur qualifie encore le discours de narrateurs à la première personne d’« atopique, comme étranger à ses propres formes » (p. 179). Au croisement du singulier et du poétique, l’épiphanie relève d’« un mode de donation propre à ce qui s’impose sans s’articuler » (p. 180). Si elle ressortit aux caractéristiques de l’épiphanie mises en évidence par Dominique Rabaté7, déceptivité et prosaïsme, l’épiphanie thomasienne aurait en propre son « intransitivité », que traduit souvent sa localisation au sein d’une « impasse narrative » (p. 182‑183) ou d’« excursus descriptifs » portant « un fragment de réalité [...] à un niveau inhabituel de présence » (p. 187). Plutôt que de l’écriture proustienne d’un progrès herméneutique, P. Lecœur rapproche ces épiphanies de la « transcendance frustrée » que Genette souligne chez Flaubert8 (p. 190‑191). Cette poétique de l’épiphanie, plus qu’elle ne conteste le narratif, « fait entrer l’immobile dans le récit » dans un « face‑à‑face avec l’impossible » qui représente l’épreuve du héros thomasien, permettant « un approfondissement du rapport au monde », que tente de restituer un discours où le paradigme du « “fond de la vie”, du miracle d’être là » prime sur le syntagme (p. 194‑198). L’impasse narrative tend ainsi « vers autre chose », objet d’une « révélation singulière, c’est‑à‑dire accordée à la rétivité du récit à toute dimension téléologique », profondément ancrée dans une marginalité sociale, existentielle et vocale, « où [la vie] se donne dans sa présence » (p. 207‑208).
Une porosité phénoménologique, narrative & vocale
5La deuxième partie de l’essai explore « la vertu réparatrice d’un langage devenu objet, [...] qui dans un même temps promet la présence et l’accorde », et analyse une « écriture [...] hommage à [...] la matière même de la vie, insaisissable et déliée », telle que « perçue ou remémorée » (p. 213‑214). Dans l’entreprise de remémoration que l’écriture met en scène, s’effectue souvent la recherche « d’un état originaire et indivis de l’expérience d’être » propre à l’enfance, qui, naturellement, « suppose moins une démarche d’ordre historiographique que l’élaboration poétique d’une mythologie personnelle » (p. 215‑217). La (re)constitution d’un « “corps d’enfance9” indivis et profus » (p. 259) relève, comme dans la nouvelle « Le Vosgien », d’un « travail de ravaudage », qui passe par une anamnèse du passé ou par le « déploiement d’une plénitude actuelle » dans le « présent imaginaire » du roman (p. 224‑225). Se joue la recherche d’« un “point de départ” [...] qui s’associe presque systématiquement à la quête erratique des personnages » tendue vers « une fusion des sens et de la présence », localisée à l’origine du sujet ou dans « un moment dont la remémoration permettrait de ressaisir, de comprendre une expérience située dans un passé relativement proche, mais néanmoins opaque » (p. 225‑226). Se joue ici comme un « glissement de l’expérience de l’enfance à l’enfance de l’expérience », que l’écriture se donne pour tâche de restituer « tout en ménageant la surprise, le goût d’inédit qui lui étaient attachés » (p. 226‑227). P. Lecœur qualifie ainsi l’écriture thomasienne de « poétique de l’indistinction », marquée par la porosité, qui s’exprime autant dans la représentation atmosphérique de la vie intérieure, que dans « l’érosion subtile » des articulations de la narration (p. 229). P. Lecœur analyse l’écriture de « la vie intérieure » à travers l’usage d’un psycho‑récit, souvent en rapport métaphorique avec le paysage, et le recours à la parataxe ou à l’« accumulation de substantifs », repérable « dans la cadre de la saisie rétrospective » à l’œuvre autant dans les discours des personnages que dans ceux de la voix narrative, et qui ont pour effet de livrer une « charge d’affects » que le discours pourrait difficilement articuler. (p. 237‑242) La narration se caractérise par de nombreuses atteintes au principe de consécution, qui visent à estomper la succession des états d’âme. S’élabore ainsi une critique de la représentation de l’expérience intérieure au profit de « sa production pure et simple », privilégiant « les interstices de la trame événementielle ou langagière », et faisant glisser de la question : « Qu’est‑ce qui se passe ? » à la question : « Comment / quand est‑ce que cela se passe ? » (p. 250‑254).
6Le rêve d’une saisie totale de l’expérience que Thomas a eu enfant subsiste à travers un « impératif de saisie » auquel il a d’abord attaché une « dimension existentielle et morale », minorée après la guerre (p. 261). Si cette volonté d’une « prise de possession de la réalité » que Thomas attache au poème10, implique une « valorisation de la référence » et de la présence qui le distingue de la tendance autotélique des écritures de la modernité, P. Lecœur souligne que Thomas a toujours eu conscience de son caractère éminemment « déceptif », particulièrement visible dans les récits des années 1950 et 1960 (p. 262). Dans les années 1980, l’auteur voit une autre question se poser à l’écriture thomasienne : « Qu’est‑ce qui reste ? » (p. 264). Ce « reste » a partie liée avec le « schème du fond », le « fond de la vie » s’imposant progressivement dans des expériences singulières où « l’être [accède] à une incarnation ravissante », souvent « sur le mode de la chute ou de la dérive [qui] est le mode même du geste de saisie » (p. 265‑267). Cette saisie déceptive de la vie se relance sans cesse notamment « dans un imaginaire particulier de la matière », neige et poussière particulièrement, constituant un élément dans lequel « la présence originaire se donne comme [...] approfondissement de l’expérience de vie actuelle [...] et comme accomplissement en instance » (p. 271‑276). Elle se donne aussi à éprouver dans une écriture de la temporalité marquée par des atteintes à l’ordre ou à la durée du récit, comme l’ellipse centrale du Goût de l’éternel, exemplairement liée à son processus d’écriture, ou par des « changements de perspective » brutaux (p. 276‑288). Cette écriture rend « le temps sensible » et donne « un accès fugitif » à un « autre du temps », que Thomas nomme l’« éternel ». P. Lecœur en voit une origine possible dans L’Éthique de Spinoza, et souligne que Thomas l’a en partage avec Bonnefoy et Jaccottet, avec lesquels il correspondait (p. 289‑295).
7Autre modalité de la porosité, cette fois sur le plan vocal, ce que l’essayiste désigne par sympathie ou participation, qui se donne à lire particulièrement dans le choix que Thomas fait de la « consonance » dans son utilisation du psycho‑récit11 (p. 298). Cette écriture de la vie intérieure en sympathie s’exprime par l’usage du présent de narration, l’emploi du « on » et par le recours à l’apostrophe (p. 300). Ce troisième phénomène contribue à l’écriture d’un colloque intime, notamment dans Le Croc des chiffonniers, sans hiérarchie entre des monologues non systématiquement attribués, et dans lequel P. Lecœur relève un « colloque oblique » entre le narrateur et un personnage, un « autre de soi », qui constituerait pour Thomas le « point de fuite » de sa pratique de la « fiction de soi12 » (p. 300‑307). À travers la multiplication de relais de parole, P. Lecœur propose de lire « l’écriture d’une “quatrième personne du singulier13” en laquelle toutes les autres se mêlent » (p. 314). La sympathie se fait ainsi sentir dans « un élan, une passion » qui sont autant de modes d’un certain lyrisme, au sens réactualisé du terme, considéré comme un processus dynamique de questionnement sur l’énonciation et l’identité (p. 315). Signalé par un intertexte de poèmes, de Rimbaud à Corbière, et de chansons populaires, un lyrisme se donne à lire dans la phrase thomasienne, que P. Lecœur analyse pour mettre en évidence d’un côté une « deixis égarée » opposée à « la “fluence” du discours », et d’un autre la recherche d’une « hétérogénéité » qui, à l’inverse, l’épouserait, par le recours à la parataxe ou à une certaine cadence, moyens d’une « recherche dirigée vers l’Autre et vers l’intime » (p. 320‑324). Pour P. Lecœur, le lyrisme thomasien peut être lu à la fois comme lieu de réflexivité et de relance, caractéristique de la Terreur selon L. Jenny, et comme l’envers de la Terreur selon Paulhan, par la « confiance placée dans le langage » pour « dire la vérité sur un homme [...] dans un espace où l’évidence poétique et l’intensité de l’expérience prévalent sur les traits identitaires » (p. 332).
La « fiction de soi », de l’« impersonnel » à « la vie »
8Cet espace, dont Thomas « parl[e] comme de “l’impersonnel” » (p. 332), caractérise selon lui l’expérience poétique. P. Lecœur retrace l’histoire de ce « mot fétiche » pour Thomas, terme indissociable du poétique dans ses écrits, et titre d’un récit de 1950, inachevé mais auquel il n’a cessé de faire référence. Une telle « tentation de l’“impersonnel14” », s’inscrit d’abord dans la dimension morale caractérisant les premiers écrits de Thomas ; elle préside aux mouvements de disparition et d’annulation de soi repérable dans les récits et la correspondance de Thomas. Cependant, P. Lecœur n’y voit pas la quête d’une abstraction qui le rangerait du côté de Mallarmé et de Blanchot, il y repère plutôt une paradoxale « énergétique déployée au service de la création », que signalent les termes récurrents de « force », « santé » ou « vie », qui le rapprochent, ici encore, de Flaubert15 (p. 340). L’auteur approfondit son étude de l’« impersonnel » en en distinguant deux formes, éminemment indissociables :
Il semble donc qu’on puisse distinguer, d’une part, un impersonnel éprouvé, dans la présence dévorante d’une réalité où le sujet s’abîme : nous en parlerons comme de l’impersonnel vécu ; d’autre part, un impersonnel correspondant à l’espace, à la différence ou « différance » que le langage met entre le sujet et lui‑même : nous l’appellerons, après Thomas, « l’impersonnel du langage ».
9P. Lecœur l’analyse donc comme une « notion mixte, transitionnelle, dont la logique interne est celle du chiasme », notion bifide dont la « face de présence muette » entre en jeu avec la « face de langage dont la dimension salvatrice s’impose comme présence matérielle, magique » (p. 340‑342). En dernière analyse, « l’impersonnel est l’espace où le sujet fait accueil à l’autre, s’offre à sa présence. [...] l’autre y trouve reconnaissance en soumettant le discours du sujet à sa contrainte, mais dans le mouvement de l’expression, il se trouve assimilé par le sujet, [...] détourné » (p. 344). Une telle force de l’impersonnel ne peut qu’interroger la pratique de la « fiction de soi » par Thomas, particulièrement dans les derniers récits autobiographiques, selon P. Lecœur, où la prégnance de l’impersonnel vécu témoigne du travail de ce que Thomas appelle la « mémoire‑imagination » — les deux termes se soutenant de leur travail respectif, pour « à la fois “rejouer” et [...] comprendre une part fascinante de l’expérience personnelle, [...] exalter l’irréductibilité de l’impersonnel vécu et dans le même temps [...] le dissoudre dans le langage et la fiction » (p. 347‑348). À travers une analyse approfondie de la manière dont Thomas a investi deux figures marquantes de son passé, Emmanuel Peillet et Pierre Herbart, respectivement dans Une saison volée et Le Goût de l’éternel, P. Lecœur met en évidence « un processus de concentration » à l’œuvre dans l’organisation temporelle et l’amplification thématique, qui va jusqu’au renversement de ces figures fascinantes en figures fascinées, comme autant de « supports d’identification sur lesquels se projette la hantise d’une présence inaccessible ». Par ces procédés, « la mélancolie s’approfondit, [...] se dramatise, et dans le même temps, peut‑être, travaille à sa propre résolution » (p. 349‑358). L’examen de nouvelles tardives permet ensuite à l’auteur de mettre au jour les paradoxes de l’utilisation de la troisième personne, qui, bien que permettant une distanciation, n’aboutit pas à une révélation, car celle‑ci se trouve « concurrencée par le désir de voir se redéployer la compacité d’un présent, de s’engager dans le «“sans‑issue” d’une expérience » : « en s’effaçant comme sujet de l’énonciation, [l’énonciateur] égare celui qu’il fut pour mieux le rendre à l’inédit de son passé » (p. 364‑365). P. Lecœur souligne que la troisième personne permet à Thomas d’actualiser des « éléments fantasmatiques », comme « “se” voir disparaître », à travers les personnages de déserteurs. Il ne dissimule pas la « dimension narcissique » qu’il peut y avoir à se voir dans le regard de l’autre, celui de la mère dans Un détour par la vie, notamment, dispositif transgressif qui facilite le face‑à‑face avec le réel au sens lacanien (p. 367‑369). L’auteur en conclut que la « fiction de soi » ne vient pas en supplément aux éléments autobiographiques, « c’est une dimension qui s’accorde d’emblée avec les caractères propres à l’expérience de l’impersonnel [...] qui “dépasse” de toutes parts la représentation » (p. 370). Du « soi » au « il », de « ma vie » à « la vie », la fiction, en « rend[ant] hommage à une dimension de sa vie qui demeure plus ou moins secrète au sujet », fait se rejouer l’épreuve d’« une surprésence quasi écrasante qui le décentre » à travers des signes qui, eux‑mêmes, « suggèrent leur envers inaccessible » (p. 372‑376).
***
10L’essai de Pierre Lecœur met ainsi au jour un grand nombre de problématiques, souvent nouvelles et marquées par un effort de formulation propre. Cet essai multiplie des propositions de lecture sans jamais perdre de vue le désir qu’Henri Thomas a formulé de ne jamais être assigné et réduit à un sens. Il s’appuie sur un large corpus, des récits les plus connus à des nouvelles moins étudiées, en passant par les écrits personnels ou critiques de Thomas, et recourt à des axes d’analyse qui sollicitent aussi bien des corpus d’auteurs différents que des disciplines autres que la littérature, comme la psychanalyse.
11Si l’on peut retenir la pertinence avec laquelle P. Lecœur argumente une proximité de l’œuvre thomasienne avec celle de Flaubert plutôt qu’avec celle de Proust, il nous semble que certains points auraient mérité d’être traités plus en profondeur. Nous pensons là au concept et au contexte de la Terreur en littérature, au rapport à Bataille, ou encore à une lecture possible de Thomas avec Barthes, que P. Lecœur aborde à propos du discontinu mais pas de l’atopie, par exemple. Il faut enfin souligner un travail d’écriture qui s’approche au plus près de son objet, le réfléchissant dans la subtilité de sa propre phrase, très souvent avec finesse, parfois au risque de quelques répétitions. Cet essai propose une première lecture structurée de l’ensemble du pan romanesque de l’œuvre thomasienne, il appelle des travaux complémentaires, pour l’ouvrir, le compléter ou le contester, et pour le mettre en regard de son autre pan, la poésie, encore peu étudiée.

