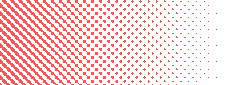« Roman » psychanalytique et écriture de l’histoire
1Le 2 avril 1974, France Culture proposait un entretien entre Pierre Barbéris et Georges Duby sur le thème « Littérature et société ». Aux propos de Duby sur le « document littéraire » comme « source d’informations » pour l’historien, Barbéris répondait :
Que le document littéraire ait valeur historique, c’est incontestable, et on pourrait en donner de nombreux exemples. Il n’en demeure pas moins qu’à partir du moment où on fait la lecture historique du document littéraire, le document littéraire ne cesse pas pour autant d’être intéressant en tant que littéraire, c’est-à-dire que la lecture de sa signification historique fait qu’il y a, malgré tout, un reste. C’est précisément sur la signification historique de ce reste que j’aimerais m’interroger.1
2Quelle est la signification historique du reste littéraire une fois que le questionnaire historique par contextualisations a été épuisé ? Le reste est ce qui s’entête, ce qui revient faute de pouvoir s’en débarrasser. Et qui ne peut être cantonné dans un lieu : il revient, à chaque fois entier, dans tous les lieux de savoir construits comme séparés de lui. Nous sommes déjà dans la « thèse » affichée par Michel de Certeau en tête de l’article « Le ‘roman’ psychanalytique. Histoire et littérature », « thèse » qui ouvre un espace où la question de Barbéris pourrait être déployée :
J’affiche tout de suite ma thèse : la littérature est le discours théorique des procès historiques. Elle crée le non-lieu où les opérations effectives d’une société accèdent à une formalisation. Bien loin d’envisager la littérature comme l’ « expression » d’un référentiel, il faudrait y reconnaître l’analogue de ce que les mathématiques ont longtemps été pour les sciences exactes : un discours « logique » de l’histoire, la « fiction » qui la rend pensable.2
3Voilà donc un reste qui aurait la particularité de permettre des opérations qui touchent à l’historicité de ce dont il a été écarté. À cette force, il faut ajouter que ce reste voyage : il vient dans des textes que l’institution littéraire ne qualifie pas de littéraires, il sort donc de la littérature, pour révéler la présence de la littérature, pénétrer de littérature, donc de « non-lieu » des lieux strictement – et en principe rigoureusement – constitués comme territoires où fixer le passé et lui conférer une signification. En ce sens, le reste est ce qui résiste à la figuration du passé dans le présent de l’historiographie : il manifeste la présence d’une absence, d’un « rien » donc, nous dit Certeau appuyé sur Mallarmé (« Et il faut qu’il n’en existe rien pour que je l’étreigne et y croie totalement. Rien – rien »). C’est pourquoi, de ce point de vue, « la distinction ne passe pas entre histoire et littérature, mais entre deux façons d’entendre le document : comme "autorisé" par une institution, ou comme relatif à un "rien" »3. C’est alorsl’écriture freudienne qui est utiliséecomme laboratoire où expérimenter l’historicité du reste littéraire, car « la conversion psychanalytique est une conversion au "littéraire" ». Et cela, précisément, parce que l’expérience d’une historicité dans la compréhension des troubles psychiques, transposée dans l’écriture qui en rend compte, remplace les « tableaux » de cas tels que les pratiquait Charcot. Le trouble se saisit comme récit de sa genèse et récit de ce récit, bref comme roman.
L’événement d’écriture
4Le récit freudien mobilise des modèles littéraires : tragédie pour saisir les configurations de rôles des instances psychiques, rhétorique pour en expliciter les actions, mais il est aussi un « geste » littéraire, voire poétique, en produisant des opérations théoriques et thérapeutiques à partir de la construction de récits biographiques. C’est à ce point que Certeau ramène, si l’on peut dire, la littérature à l’histoire. La biographie « introduit une historicité dans la littérature », mais l’usage qu’en fait la démarche freudienne la retourne contre le postulat individualiste de la conscience autobiographique du sujet, libre et maîtresse d’elle-même comme l’affirme l’éthique kantienne. Elle démasque ainsi le mythe de « l’éthique individualiste et conquérante de la bourgeoisie moderne ». « Ces romans biographiques seraient donc […] ce que le Don Quichotte de Cervantès a été, au début du xviie siècle, pour l’hidalguia [la noblesse] espagnole », écrit Certeau, et il ajoute : « La figure qui organisait les pratiques d’une société devient la scène où se produit son renversement critique. Elle définit encore l’endroit où elle disparaît. Elle n’est plus que le lieu de son autre – un masque ».4 On voit donc ici que pour expliciter l’impact historique d’une forme de récit historiquement située, la biographie, rien ne convient mieux qu’une analogie entre l’effet d’une pratique littéraire, celle de Freud, et une autre pratique littéraire située en un autre temps, celle de Cervantès dans le Quichotte. Le geste littéraire de Freud est reproduit par son commentateur qui, dans cette action, met au jour la capacité du reste littéraire à dire le temps et à faire histoire en le disant.
5Le détournement de l’individualisme biographique par la biographie et le détournement du roman de chevalerie par le roman sont des actes, des événements dans l’histoire parce qu’ils sont des événements d’écriture. Dans le cas de Freud, l’événement d’écriture, dont la densité historique est révélée par l’analogie établie avec le détournement opéré par Cervantès, tire sa spécificité du rapport entre la théorie qui justifie le recours au récit de vie et les événements qui viennent à la fois appliquer et désorganiser la théorie ; Certeau écrit « de ce point de vue, le roman, c’est le rapport que la théorie entretient avec l’apparition événementielle de ses limites ». De tels événements, quand ils surviennent, confirment la théorie qui les postule et sont aussi le « reste » qui lui échappe, venus d’un ailleurs pourtant insaisissable sans la théorie. Cette figure en tension trouve sens ailleurs que dans le modèle et l’expérience analytiques. Elle peut être « exportée » comme manière de faire, mais elle peut surtout permettre des jeux d’écho avec d’autres tentatives. Dans cette perspective, un texte comme celui qu’Yves Bonnefoy consacre à « L’événement poétique », publié en 1992, six ans après la mort de Michel de Certeau donc, peut être lu comme proposant une approche comparable de l’événementialité de l’événement d’écriture, c’est-à-dire du rapport dialectique entre la pensée de l’écriture et ce qui du dehors vient y faire rupture5.
6Dans cet article, Bonnefoy commence par évoquer la figure du poète tout à son projet, à sa vision de ce qu’il veut accomplir et son rapport à la langue, mobilisant d’abord un répertoire d’images qu’il agence. Puis il advient que le travail bouleverse et périme tout ce qui a permis son avancée. C’est cela l’événement : la langue travaillée dément le projet de travail, elle recompose le monde qui lui donnait vie, le « réseau entier » des tropes et des images qui lançaient le poème se trouve subverti par l’événement d’écriture du surgissement d’une image qui brise les autres, « réaction de l’écriture à quelque chose d’en dehors d’elle » car l’événement qu’accomplit l’écriture est provoqué par la survenue d’une présence depuis le dehors de l’écriture. Présence de la présence, victoire de la présence contre le rêve : c’est pour cela que « ces événements ont toujours du sens dans le devenir historique » précise Bonnefoy. Peut-être l’historien, d’ailleurs, « devrait-il reconnaître en eux, sinon ce qui mène l’histoire, du moins ce qui en éclaire les motivations aujourd’hui encore si mal comprises ». Deux exemples sont alors choisis comme terrain d’expérience. D’abord Le Cygne de Baudelaire où eros engage le poète dans sa rêverie par une première chaîne métaphorique, mais où c’est l’événement de la vision d’un cygne échappé de sa cage, « de ses pieds palmés frottant le pavé sec », un certain jour, au petit matin, en un certain lieu de Paris, qui ouvre l’espace d’une allégorisation du réel qui fait tenir ensemble un Paris perdu, des exilés, Andromaque devenue « femme d’Hélénus », les captifs, les vaincus « et bien d’autres encore » : l’événement situé a bouleversé par son surgissement l’entière économie des images6. Le deuxième exemple est emprunté à l’œuvre de Yeats : « Chez le poète irlandais autant que chez Baudelaire coule à flots serrés cette propension aux représentations esthétisées, aux symboles clos qui referme sur soi l’écriture, quels qu’en aient été les méandres ; et chez lui aussi sont nombreuses les situations où c’est, au contraire, l’être fini, l’existant hic et nunc, irréductible à toute écriture, qui apparaît et crie sa vérité propre, avec, à travers cela, un brusque affleurement d’unité vécue7. » Ici aussi, des figures qui organisaient des pratiques deviennent « la scène où se produit leur renversement critique ».
7L’événement d’écriture manifeste dans son registre la soudaine présence d’un dehors irréductible à la fiction de dehors que l’écriture est capable de produire. Des récits peuvent-ils donner à voir de telles « scènes » ? C’est le pouvoir que Michel de Certeau confère au Robinson de Daniel Defoe. Il faut pour en mesurer la puissance heuristique rapprocher les pages qui lui sont consacrées dans l’Invention du quotidien et dans « L’absent de l’histoire ». « Robinson devient maître en imposant une raison classificatoire et technicienne au désordre de l’île »8, mais ce roman d’une domination colonisatrice est aussi « le roman de l’écriture ». Il combine trois caractéristiques de la production scripturaire : le découpage d’un lieu propre (la page blanche ou l’île) ; la production d’un système d’objets par un sujet maître, « artefact d’un autre "monde", non plus reçu mais fabriqué ; le modèle d’une raison productrice s’écrit sur le non-lieu du papier » ; la transformation d’un monde « naturel » : le « jeu » scripturaire, production d’un système, espace de formalisation, a pour « sens de renvoyer à la réalité dont il a été distingué en vue de la changer »9. Et Certeau ajoute : « D’ailleurs chez Defoe, l’éveil de Robinson au travail capitaliste et conquérant d’écrire son île s’inaugure avec la décision d’écrire son journal, de s’assurer par là un espace de maîtrise sur le temps et sur les choses, et de se constituer ainsi, avec la page blanche, une première île où produire son vouloir »10. Le récit de la prise de possession de l’île rejoue le mythe de la domination scripturaire comme le récit de la tenue du journal rejoue celui de la colonisation solitaire de l’île par le naufragé.
8Et puis, comme on sait, survient l’événement de la découverte du « vestige humain d’un pied nu parfaitement empreint sur le sable » et « cinquante pages qui racontent les désordres de la "méthode", les irruptions du rêve, l’ambivalence d’une anthropophagie qui tour à tour fascine et fait horreur. L’éthique technicienne se change en un poème érotique et hallucinatoire de l’autre », une « parenthèse de déraison » qui se clôt avec la venue de Vendredi bientôt serviteur dévoué11. Cauchemar, rêve, hallucination, lapsus d’une trace qui dit l’absence de la présence qu’elle révèle : on retrouve ici le « théâtre » des concepts freudiens, mais c’est pour y voir revenir la figure de l’historien confronté à l’événement de sa rencontre avec les traces du passé, épreuve d’une « présence manquante » : « L’historien est à cette place aussi, devant la mer d’où vient l’homme qui a laissé des traces. Mais à la différence de Robinson, il sait que l’autre ne reviendra pas »12. Là aussi un reste demeure : passant à l’écriture, revenant à l’ordre de son savoir, l’historien ne peut ignorer tout à fait ce qui, dans son écriture, revient de la présence absente que les traces signifiaient, et cette « marque d’une altérité altérante » (dans le vocabulaire de Certeau) est aussi, comme chez Bonnefoy, la certitude de la présence d’un dehors irréductible à toute écriture. Pourtant la présence présente de Bonnefoy, que le sentiment de la finitude de ce qui est là présent impose, n’est pas la présence absente qu’éprouve, expérimente et théorise la psychanalyse, le théologien et l’historien Michel de Certeau13.
La citation
9L’historiographie pratique un usage apprivoisant des traces qu’elle examine : celui de la citation, que Certeau désigne comme « technique littéraire de procès et de jugement, qui assied le discours dans une position de savoir d’où il peut dire l’autre »14. La citation morcelle le dire de l’autre ; « le langage cité a ainsi pour rôle d’accréditer le discours : comme référentiel, il y introduit un effet de réel ; et par son effritement, il renvoie discrètement à une place d’autorité »15. La citation produit de la fiabilité : elle renforce à la fois la vraisemblance du récit dans lequel elle s’insère et elle valide le savoir qui permet d’y recourir. Elle vaut interprétation du passé au double sens du terme interprétation. D’une part elle est une ressource dans l’énoncé savant (ou supposé tel par la place qui le légitime) et, d’autre part, celui qui cite recouvre par son acte énonciatif les conditions d’énonciation du texte cité et, par là, l’interprète en le produisant, comme un musicien ou un chanteur interprète une partition. Dans le chapitre « Le langage altéré. La parole de la possédée », Michel de Certeau insiste sur l’ambivalence de la pratique citationnelle : à côté de la puissance de légitimation et donc d’autorité qu’elle confère au discours qui y recourt, à côté de l’altération du cité par la fragmentation et la domination, demeure « le danger d’une étrangeté qui altère le savoir traducteur ou commentateur », « la menace et le suspens d’un lapsus ». Le cité garde, latent, le pouvoir d’être « un revenant fantastique » : « dans cette position où il n’a plus de propre, il reste susceptible de ramener, comme en rêve, une inquiétante étrangeté : pouvoir subreptice et altérant du refoulé »16.
10Dans le choix des mots et des concepts, ici une porte s’ouvre à nouveau sur le texte ou le sous-texte freudien. Cette présence ne relève pas de l’ambivalence citationnelle, elle ouvre la porte sans entrer – sans capturer, fragmenter et délocaliser l’écriture de Freud. En fait, l’étape suivante consiste à retourner vers Freud la question de la pratique citationnelle, ce qui est accompli dans « Le "roman" psychanalytique. Histoire et littérature ». Certeau note d’abord comment dans Der Mann Moses [L'homme Moïse et la religion monothéiste], Freud « aux tournants importants de son analyse, autorise sa conception non pas, finalement, par des preuves, mais par la citation qui donne forme à sa pensée », par exemple par deux vers de Schiller, par un poème donc, « c’est-à-dire une écriture dont rien ne soutient la "vérité" sinon son rapport à elle-même ». Freud fait « fonctionner » la théorie poétique de Schiller dans sa propre démarche : il « exerce » cette théorie à des fins elles-mêmes théoriques en prenant appui sur « une fiction privée de référentialité expérimentale ». Ce faisant, il accomplit ce que Schiller dit. Quand Schiller dit ce qu’il fait avec les mots, « l’écriture freudienne fait ce qu’elle dit » : par la citation poétique elle perd l’autorité du savoir expérimental, de manière à produire sur un sol vierge de science la théorie de sa pratique. Si le geste théorique est audacieux, le choix de « l’autre » en la personne de Schiller, un auteur classique, donne à la citation une valeur symbolique d’autorisation qui tempère le risque et vaut assurance culturelle. Figure freudienne de l’ambivalence citationnelle : c’est aussi la technique de mise en scène du « rien » de la citation poétique qui permet de renforcer l’autorité du « faire théorie ».
11à la page suivante, Certeau emboîte le pas qu’il nous a fait voir dessiné dans l’écriture freudienne. Il s’appuie à son tour sur le « rien » du poème en citant les vers de Mallarmé que j’ai mentionnés en commençant. Le poème « autorise un espace autre, il est le rien de cet espace », nous dit-il, ajoutant « il en dégage la possibilité dans le trop plein de ce qui s’impose […]. Il refuse l’autorité du fait. Il ne s’y fonde pas. Il transgresse la convention sociale qui veut que le "réel" soit la loi.17 » La citation du geste « également esthétique et éthique » de Mallarmé – avec cette parenthèse : « la différence entre les deux n’est pas si grande, car l’esthétique n’est au fond que l’apparaître ou la forme de l’éthique dans le champ du langage » – permet un retour à l’historiographie et l’expression d’une rupture épistémologique dont la mise en pratique a précédé la formulation.
12L’historiographie pratique l’inverse du poème, écrit Certeau : « elle consiste à pourvoir de référentialité le discours, à le faire fonctionner comme "expressif", à l’autoriser par du "réel", afin de l’instituer comme supposé savoir. Sa loi, c’est d’occulter le rien, de remplir les vides ». Cette pratique est poussée à son comble par l’histoire littéraire qui « recoud méticuleusement le texte littéraire à des structures "réalistes" (économiques, sociales, psychologiques, idéologiques, etc.) dont il serait l’effet ; elle se donne pour fonction de restaurer inlassablement de la référentialité ; elle la produit ; elle la fait avouer au texte »18. Cette critique de l’historiographie n’en conteste évidemment pas les capacités heuristiques ; elle produit le geste « également esthétique et éthique » qui l’ouvre différemment à l’autre qu’elle vise. Cette différence est liée à une circulation dont la pratique a valeur théorique. à partir de l’analyse de la pratique citationnelle, Certeau est passé de l’objet historiographie à l’écriture freudienne pour revenir à l’historiographie. Dans ce parcours, il ne s’agissait pas d’ « appliquer » un usage freudien à valeur théorique à l’historiographie, mais de déplacer l’un par l’autre, par une pratique scripturaire et théorique qui emprunte à l’un et à l’autre et leur faire prendre distance à l’égard du pouvoir institutionnalisant de leur écriture propre, comme de la contrainte institutionnelle qui l’encadre et l’autorise.
Feuilletage, stratifications, subversions
13L’usage plus ou moins intensif de la citation construit un texte « feuilleté » où s’intercale un continuum explicatif ou narratif que traversent des extraits disséminés. Cette image du feuilletage, de la stratification, des couches empilées mais faillées permet une représentation du temps dans la figuration spatiale de la fabrication d’une écriture. Mais cette mise en image qui rend visible une expérimentation, si elle est présente de manière récurrente chez Certeau permet des opérations différentes et révèle des dispositifs textuels qui ne sont pas identiques. Pourtant, à chaque fois, l’image des strates superposées est destinée à montrer comment un ordre est attaqué par des forces qui le subvertissent sans le supprimer. La mise au clair d’une stratification, d’un ordre, serait donc comme l’antécédent dans un enthymème dont le conséquent est le brouillage de l’ordre. Le premier paragraphe de La Possession de Loudun en fournit l’exemple le plus simple, car formé de deux strates, un dessus et un dessous :
D’habitude, l’étrange circule discrètement sous nos rues. Mais il suffit d’une crise pour que, de toutes parts, comme enflé par la crue, il remonte du sous-sol, soulève les couvercles qui fermaient les égouts et envahisse les caves, puis les villes. Que le nocturne débouche brutalement au grand jour, le fait surprend chaque fois. Il révèle pourtant une existence d’en dessous, une résistance interne jamais réduite. Cette force à l’affût s’insinue dans les tensions de la société qu’elle menace. Soudain, elle les aggrave ; elle en utilise encore les moyens et les circuits, mais c’est au service d’une « inquiétude » qui vient de plus loin, inattendue ; elle brise des clôtures ; elle déborde les canalisations sociales ; elle s’ouvre des chemins qui laisseront après son passage, quand le flux se sera retiré, un autre paysage et un ordre différent.19
14« L’étrange » est donc une nappe souterraine. Il lui faut l’appel d’une crise pour se mettre en mouvement vers le jour. Alors les couvercles d’égout sautent, « le nocturne débouche brutalement au grand jour ». Des barrières, qu’on pensait solides, séparaient bien un dessus et un dessous, protégeant les caves, les rues, une ville. Elles cèdent. Parce qu’elles étaient déjà poreuses ? La « force à l’affût » s’était insinuée du bas vers le haut (il est vrai que sa matière, si elle est égout, venait de ce que le haut avait été refoulé vers le bas), dans des « canalisations sociales » travaillées de tensions et que la remontée brutale fait éclater. Le débordement soudain creuse des chemins qui changent le paysage. Une spatialité est construite en cadre transcendantal de l’événement, cadre qui en fait comprendre la temporalité, le « timing » en quelque sorte.
15Le retour, éventuellement brutal, du refoulé ne supprime pas pour autant la stratification comme modèle de représentation des rapports entre passé et présent, ni ne périme l’opérativité de la pensée qui s’appuie sur cette image des strates superposées. L’imaginaire géologique révèle des stratifications singulièrement compliquées par la survenue d’événements, de cassures, d’effondrements, d’inversions provoquées par l’érosion qui provoque aussi des disparitions, des lacunes qui se marquent dans le paysage comme traces d’une absence. Dans « La fiction de l’histoire. L’écriture de Moïse et le monothéisme »20, le rapport stratifié de la tradition et de l’historiographie freudienne présente de semblables complications. « La métaphore, moyen rhétorique » et « l’ambivalence, instrument théorique », au travail dans l’écriture de Freud, muent « chaque élément spatial en un volume où ils interfèrent ». « Des histoires différentes "subsistent" en un même endroit, comme dans la Rome fantasmée par Freud ». Et, de ce fait :
La fiction freudienne ne se prête pas à cette distinction spatiale de l’historiographie où le sujet du savoir se donne un lieu, le "présent", séparé du lieu de son objet, défini comme "passé". Ici, passé et présent bougent dans un même lieu, polyvalent. Et des "niveaux" du texte, aucun n’est le référent des autres. S’il y a méta-phore, elle caractérise un système de relations réciproques. Il n’y a pas d’élément stable qui arrête cette circulation et qui, en affectant à l’une des strates une valeur de "vérité", allouerait aux autres une fonction d’image, de substitut ou d’effet.21
16La stratification ne postule donc pas une hiérarchie où l’ancien dominerait le plus récent ou bien où le plus récent surplomberait l’ancien. Le « roman historique » de Freud donne au plus ancien, qu’on peut appeler tradition, la forme de présence d’une lacune tracée dans un paysage et qui, en tant que telle, revient et s’impose sans y avoir été invitée dans le récit qui en rend raison. Le rebut inassimilable, et pourtant absent, se trace ainsi dans le texte comme « inquiétante familiarité », présence indésirable mais sans qui la structure du paysage ne peut être comprise.
17D’autre part, la fiction des strates est douée d’une puissante vertu : les couches empilées s’offrent à la possible subversion de leur ordre par un événement – géologique, littéraire, politique, philosophique – susceptible en les désorganisant de donner à penser conjointement la stabilité d’une disposition et le chaos de son effondrement. Bref la structure apparemment fixiste des couches empilées se prêterait mieux à l’analyse des rapports entre structure et événement que, par exemple, le modèle théorique du champ littéraire qui repose pourtant sur le projet de tracer une dynamique des forces dans une durée indéterminée. La métaphore des couches empilées ne décrit pas le réel, mais permet, ou au moins facilite, l’opération réalisée par un récit pour l’atteindre. Elle sépare le tout et la partie et permet le retour au tout par la subversion des parties, mais sans supprimer la contestation préalable du tout par les parties. Ce détour par l’usage des strates, et leur travail, montre, je crois, la portée théorique d’une représentation stratifiée du réel. L’enjeu de la portée expérimentale de cette fiction, c’est de ne pas séparer pragmatique socio-historique et poétique, de tenir ensemble ces deux registres dans l’histoire conjoncturelle de leur association. Jules Verne comme Zola ont une place parfaitement cartographiée dans le champ littéraire du xixe siècle français, mais l’expérience de la plongée dans les textes par la fiction de la strate révèle un autre rapport au monde social que celui, cohérent et unifié, des rapports de force au sein du monde des littérateurs : elle saisit les traces morcelées de lieux de rencontre entre production socialisée du travail de l’écrit, mémoire et imaginaire d’expériences oubliées et mythe de la transcendance littéraire. Et surtout, elle permet de faire une place à l’événement désorganisateur autrement que comme l’effet d’une structure ou d’une structuration. La strate est clairement une fiction pour penser en même temps la présence de l’ordre et sa destruction ; elle ne peut être sérieusement transformée en tout, en chose dans l’histoire.
18Empilement de strates et accidents historiques qui en bouleversent l’ordonnance sont très présents dans les préfaces données par Michel de Certeau à deux rééditions de textes canoniques de la littérature du xixe siècle, d’ailleurs presque contemporains : La faute de l’abbé Mouret de Zola (1875) et Les grands navigateurs du xviiie siècle de Jules Verne (1879)22. Dans les deux cas, feuilletage, stratification et subversion de la régularité de l’empilement servent à pénétrer l’organisation scripturaire exhibée et cachée des deux œuvres, mais selon des modalités différentes.
19Dans le cas de l’abbé Mouret trois couches sont d’abord cartographiées : la plus superficielle est « la fiche médico-sociale » qui individualise le prêtre et « le classe parmi toutes les variantes de l’espère Rougon-Macquart » ; en-dessous : le thème du prêtre amoureux qui offre sa trame narrative au récit et rejoue « l’opposition millénaire entre l’amour sacré et l’amour profane » ; en-dessous encore, « une lutte qui affronte les énergies de la vie aux institutions de la mort », « grand combat de toujours ». « Une nouvelle Genèse, tumultueuse et cosmique, se déroule dans le décor primitif d’un village de Provence ». Dans ces profondeurs, « une vie prolifique pullule dans les décors construits par la volonté de la refouler ; elle les détermine déjà à leur insu ; elle s’insinue partout dans leurs entrebâillements ». L’énergie refoulée traverse les couches d’histoire et vient comme une lave s’étaler à la surface du récit, par une débauche de mots : Zola « pousse le langage à ses limites, il le dépense à l’extrême, il le brûle comme on claque de l’argent »23. Dans la suite de l’analyse, les « entrebâillements » se transforment en une brèche quand la stratification est en quelque sorte redressée pour passer de la verticale à l’horizontale des trois parties du roman (ou l’inverse d’ailleurs suivant la manière dont l’œil se représente les couches). D’un côté l’histoire, de l’autre la légende lyrique ou le mythe, entre les deux un mur avec une brèche qui les met en communication, avec des flux et des reflux qui relèvent de l’épopée et du tragique. Entrebâillements ou brèche : la remontée incontrôlable du refoulé traverse des formes solidifiées d’écriture.
20La stratification est plus feuilletée, avec des couches plus nombreuses et plus fines, dans la présentation du livre de Jules Verne. Elle sert explicitement à décrire la composition de l’œuvre. Les mouvements, les remontées, les recompositions qui la travaillent y sont moins dramatiques : elles restent sur le terrain de l’histoire. Leur traversée est toutefois plus complexe : il ne s’agit plus d’aller de la surface vers le plus profond à la rencontre de l’énergie dont la remontée va transformer le paysage du récit. C’est que la genèse de l’ouvrage révèle d’emblée la présence de trois couches : le texte de Verne est fondé sur les recherches et l’anthologie préparée par le géographe Gabriel Marcel recruté à cette fin ; celui-ci a lui-même compulsé, compilé, classé, cité un grand nombre de récits de voyage conservés à la Bibliothèque Nationale où il était employé. Mais chacune de ces trois couches se trouve pénétrée d’éléments allogènes, de reprises, et de discours contemporains que le hasard des pratiques et des histoires individuelles y a disséminé. Les récits, au sein de la série temporelle des récits de voyage, renvoient à des voyages effectués ou rêvés, eux-mêmes préparés et imaginés à partir de récits précédents : tel un rayonnage de bibliothèque « le récit empile des strates où s’inverse, tantôt sous forme de documents traversés, tantôt sous forme de mers et terres parcourues, la même aventure voyageuse : le narrateur écrit à côté du voyageur, qui suit un écrit, qui lui-même trace d’autres voyages »24. Dès lors, le retour de « l’autre », du refoulé du travail, de la présence et de l’imaginaire du prédécesseur, s’inscrit dans le récit selon deux modalités principales. Le morceau choisi, la citation, assumée ou non, est la première de ces figures revenantes : on le sait, en apparaissant la citation efface le corps d’où elle a été extraite. Ce sont des vestiges sertis dans le récit, porteurs parfois, eux-mêmes, d’autres vestiges encastrés, ce sont « des miroirs brisés où s’altère le passé qu’ils représentent » ; mise en reliques d’absents écrit Certeau : « l’œuvre définitive est faite de cette stratification reliquaire ». La seconde modalité est celle de la hantise. L’imaginaire, le rêve de voyage, mais aussi l’imaginaire spatial, cartographique par exemple, c’est-à-dire la fiction, hante les sources textuelles et se répand comme un fantôme passe-muraille dans les lieux visités par le récit. Par ailleurs, les fragments insérés, les morceaux découpés, les reliques, invitent le lecteur à une composition romanesque qui consisterait à chercher le corpus perdu dans l’œuvre, « à "remonter" des reliques jusqu’au corps absent pour en faire apparaître le fantôme ».
21à ce point, on rencontre Michelet. L’écriture de l’histoire s’ouvre avec deux pages sur Michelet et les premières lignes sont une citation de lui. Ouverture musicale et littéraire, car « est littéraire le langage qui fait entendre autre chose que ce qu’il dit »25. Au début de L’écriture de l’histoire parle donc Michelet. Il parle de son expérience du commerce avec les morts. Il a rencontré les ombres des morts et son travail les a rendues à leurs tombeaux, moins tristes. Michel de Certeau écrit : « les chers disparus entrent dans le texte parce qu’ils ne peuvent plus nuire ni parler. Ces revenants trouvent accueil dans l’écriture à condition de se taire pour toujours »26 : travail de l’historiographie. Mais Michelet se tient aussi sur une frontière, « celle où de Virgile à Dante, se sont construites des fictions qui n’étaient pas encore de l’histoire », une place où se rencontrent le fantasme de la présence de l’Autre et la nécessité de calmer les « morts qui hantent encore le présent et à leur offrir des tombeaux scripturaires » vides de leur altérité. Et l’historiographie contemporaine ne manquera pas d’enfermer Michelet, à son tour, dans un tombeau taillé pour lui, d’ « enterrer au plus vite celui qu’elle honore »27.
22Michelet parle, mais comment parle-t-il, et, au fond, de quoi ? Certeau se tourne vers Freud : « Un demi-siècle après que Michelet l’a dit, Freud observe qu’en effet "les morts se remettent à parler". Non plus comme le croyait Michelet, par l’évocation du "devin" que serait l’historien : "ça parle", mais à son insu, dans son travail et ses silences. Ces voix dont la disparition est le postulat de tout historien et auxquelles il substitue son écriture re-mordent l’espace d’où elles sont exclues et parlent encore dans le texte tombeau que l’érudition élève à leur place ».28
23« Ça parle », donc. Mais comment et de quoi ? On trouvera une figure de réponse, si j’ose dire, dans le roman de Pierre Michon Les Onze. Michon raconte l’histoire d’une peinture qui n’existe pas et qui représenterait les onze membres du Comité de salut public du temps de la Terreur. Michelet « a toujours dit et pensé que la vraie peinture d’histoire n’était telle que lorsqu’elle s’efforçait de ne pas représenter l’histoire ». L’imaginaire peinture des Onze représente bien l’histoire, mais au-delà du pacte mimétique de la représentation. Et cette peinture fait « chanceler » Michelet qui n’aurait alors plus été « maître de sa fiction », rencontrant la présence, il est capté par l’Autre, celui qui résiste à toute mise au tombeau historiographique, à tout exorcisme. Il faut la transgression littéraire qui transforme une peinture en vision, une vision en présence du passé, pour que se raconte la fable terrifiante d’une présence réelle de l’histoire, la légende d’un commencement sans fin de la force, des « puissances » qui « dans la langue de Michelet s’appellent l’histoire » : ce sont les derniers mots du livre de Michon29.