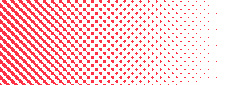Poème et théorème : nouvelles pastorales poétiques
Guillaume Artous-Bouvet : Jean-Claude Pinson, Pierre Vinclair, vous publiez tous deux en 2020 des ouvrages qui affrontent l’urgence écologique dans sa radicalité : Pastoral suppose la continuité d’un ostinato poétique survivant à l’instant hypercritique de la modernité tardive, quand Agir non agir se présente comme la contrepartie réflexive de l’« épopée totale » écologique mise en œuvre dans La Sauvagerie.
Mes premières questions prennent prétexte du sous-titre de votre ouvrage, Jean-Claude : « De la poésie comme écologie ». Comment la poésie peut-elle prétendre surgir comme une écologie, c’est-à-dire résonner dans sa différence et dans sa proximité avec un Logos de l’oikos, c’est-à-dire avec un discours de type philosophique sur notre « maison commune », la Terre ?
Si la poésie est écologie première, comme vous l’affirmez au début de votre livre, cela signifie-t-il que toute philosophie est écologiquement seconde (mode de séparation peut-être suggéré par votre diptyque, Pierre), et que, par conséquent, c’est aussi la logique de l’écologique que le geste poétique questionne en sa racine ?
La poésie, enfin, peut-elle croire refonder une écologie qui échappe aux déterminations traditionnelles du Logos ? Que reste-t-il dès lors au genre de l’essai, que vous choisissez tous les deux (avec Pastoral et Agir non agir), lorsqu’il s’agit d’assumer l’inquiétude pastorale ?
Jean-Claude Pinson : Il y a en effet un discours écologique de type philosophique aujourd’hui particulièrement florissant. En témoigne par exemple le volume Portraits de philosophes en écologistes publié par Hicham-Stéphane Afeissa aux éditions Dehors. Il y est question aussi bien de Heidegger que de Deleuze et Guattari, de Hans Jonas que d’Holmes Rolston III, Arne Næss ou Isabelle Stengers. Chez tous ces philosophes, il s’agit bien de discours, c’est-à-dire d’un usage du langage obéissant à des procédures où la rationalité argumentative est essentielle. Discours, autrement dit Logos, lequel signifie à la fois langage et raison, comme le veulent la plus ancienne tradition et la philosophie supposément achevée que propose le système hégélien.
Le poème, de son côté, n’est pas soumis à de telles procédures, la production d’une signification déterminée n’étant pas son affaire. Kojève, en bon défenseur hégélien du Logos philosophique, le dit très clairement : « il est généralement admis que le “contenu” intraduisible d’un discours quel qu’il soit appartient au domaine de la Poésie et ne fait pas partie de la Philosophie en tant que telle1 ». Il s’ensuit que si la poésie est écologie, ce n’est pas comme Discours au sens fort, au sens majuscule ; ce n’est pas comme Logos. Si elle est toutefois éco-logie, c’est-à-dire parole (plutôt que discours) où il en va de notre habitation de la terre, c’est selon des modalités (un jeu de langage) où la fonction discursive et logique tend à s’estomper. La musique, le chant — ou plus exactement la dimension « musaïque » — sont davantage essentiels à la poésie que la seule production sémantique. C’est vers la théorie de Rousseau relative à l’origine du langage qu’il faudrait ici se tourner ; ce sont les catégories de rythme et d’accentuation, de prosodie, qu’il faudrait mettre en avant. Ou encore, pour le dire avec Renaud Barbaras, l’énoncé poétique est celui où l’« archi-événement du langage », sa toute-puissance dans l’ordre humain, vient à être de l’intérieur contesté, mis à mal, « ensauvagé », par la résurgence en lui d’un « archi-mouvement » de la Nature qui ne cesse de le hanter quand bien même l’ordre habituel du discours cherche à effacer, oublier ce mouvement. Il va sans dire que toutes sortes de degrés intermédiaires sont possibles entre le pôle du pur discours (celui de la logique philosophique élevée au rang d’une mathématique sui generis) et celui du poème versant dans la pure glossolalie (Artaud, par exemple).
Comment toutefois soutenir, comme je le fais, que la poésie est « écologie première » ? Je l’entends en deux sens : au sens logique (ontologique) et au sens chronologique (historique).
Au sens logique : de par son type de parole (de par sa -logie propre), la poésie est entente pré-réflexive de la Nature. Elle se fait la chambre d’écho de la Nature comme bruit de fond primordial de tout ce qui est — de tout ce qui témoigne d’un mouvement, d’une poussée, d’un battement rythmique de la Phusis. Ce n’est pas seulement qu’elle parle de la Nature et l’évoque. C’est en son type même de langage que la poésie est, en quelque sorte et paradoxalement, Nature plus que Logos. En ce sens, elle est organiquement parente du chant des oiseaux. D’où l’intérêt d’une « zoopoétique » pour penser le continuum qui va du second à la première.
Les héritiers d’Aristote parlaient de « philosophie première » pour désigner la branche la plus haute de la philosophie, à savoir la métaphysique et l’ontologie, censées venir avant l’éthique, la politique ou l’esthétique. Il en va de même pour toute réflexion sur la poésie : l’examen de son ontologie propre doit venir « avant » toute approche textuelle, esthétique ou « poéthique ». C’est cette dimension ontologique que j’ai essayé de cerner au début de mon essai. Cette antériorité interne (interne à la poétologie) se double d’une précellence externe. En effet, en matière d’éco-logie, d’aptitude à faire entendre quelque chose de la Nature, la poésie, du fait de son jeu de langage propre, est « supérieure » à la philosophie. Elle regarde en amont, en arrière, témoignant d’une appartenance à la terre dont elle ne peut se séparer (d’où ce fond de mélancolie, sinon de nostalgie, qui fait de l’élégie une catégorie poétique essentielle). À l’inverse, le Logos (dont la philosophie est solidaire) est tourné en avant, vers la maîtrise et la mise à disposition idéalement totale de la Nature, au plan de la connaissance (au plan scientifique) comme au plan technique.
Ce à quoi il faut sans doute ajouter ce correctif que la philosophie, si elle creuse en direction des principes, de ce qui est supposé premier, fondamental, est toutefois en sa démarche foncièrement seconde. Elle vient toujours après coup, prenant, comme la chouette, son vol à la tombée de la nuit. Elle vient après l’action, après la bataille, après le poème épique qui d’abord en fait récit.
Au niveau diachronique, la poésie peut être dite première, antérieure, au regard cette fois d’une histoire de la raison. Le mythe, son type de parole, vient avant la philosophie et son ordre du discours. Parménide et son poème précèdent Platon renonçant à la poésie pour suivre Socrate. Historiquement, la Modernité peut être comprise comme cette « dialectique négative » qui mène à ce qu’Adorno et Horkheimer ont appelé une « autodestruction de la Raison ».
Je ne crois pas, enfin, que la poésie puisse « refonder une écologie qui échappe aux déterminations traditionnelles du Logos ». Ce n’est pas son affaire, mais celle, en effet, de l’essai ; lequel toutefois, selon moi, ne peut (ne doit) échapper à ces déterminations traditionnelles (rhétoriques) qui font de lui une modalité argumentative du Discours — cela n’empêchant pas toutefois un travail propre d’écriture (réussi ou non, le recours au fragment dans Pastoral procède ainsi d’une poétique délibérée de l’essai).
Par contre, il est bien du ressort du poème d’assumer cette « inquiétude pastorale » que vous pointez à juste titre. La philosophie, du moins en son aboutissement hégélien, s’est voulue dépassement, cautérisation totale de l’inquiétude existentielle. Le Savoir absolu de Hegel n’est autre, selon Kojève, que la Sagesse enfin atteinte, en même temps que « la Nature est définitivement domptée2 », que s’éteint la lutte à mort pour la reconnaissance et que l’Histoire prend fin. Ne reste plus que le « dimanche de la vie », lequel pourrait signifier, en ce qui concerne la littérature, qu’elle n’a plus, privée de tout aliment et visée tragiques, qu’à se complaire au jeu tout en surface des exercices de style. Tel est du moins selon moi l’enjeu fondamental du débat qui voit Bataille s’opposer à Kojève (et dans son dos Queneau)3. L’auteur de La Haine de la poésie refusant pour sa part la « mort de l’art » qu’implique la réconciliation (la Versöhnung) hégélienne. Plutôt que celui, sans tragique, de « la science ou du monde réel de l’utilité », Bataille prend ainsi le parti de l’intranquillité, choisit la part « maudite de l’existence », son « impossible ».
« Métier d’ignorance » avant tout, la poésie est, ontologiquement, du côté de l’incertitude et, éthiquement, du côté de l’inquiétude. C’est pourquoi, aujourd’hui que s’est dissipé le mirage du progrès sans fin, que la menace d’une catastrophe climatique se rapproche toujours plus dangereusement, elle est bien placée pour être aussi écologie dernière. En effet, quand la Sagesse du Logos, son prétendu Savoir absolu, a viré à la déraison et à l’ubris, c’est au poème qu’il incombe de faire entendre ultimement une autre voix (d’autres voix) et d’ainsi rappeler que la voie d’une autre sagesse, « pastorale » plutôt qu’impériale, eût été possible — est, peut-être, encore possible. Et la pensée philosophique ne peut que gagner à la fréquentation réflexive de la poésie. Elle y pourra puiser des raisons de ranimer sa part dissidente, en renouant par exemple avec ce qui, de l’héritage des Lumières, invite à laisser être la Nature plutôt qu’à la dompter, comme le voulait Rousseau (et à sa suite Schiller et Hölderlin).
Pierre Vinclair : Je suis très impressionné par la réponse de Jean-Claude, à laquelle je n’aurais rien à ajouter d’un point de vue proprement philosophique. Je crois comme lui que la poésie, d’une part, ne relève pas du discours et qu’elle ne suffit pas, à elle seule, à fonder quoi que ce soit ; que la philosophie, d’autre part, est toujours seconde, qu’elle vient après la bataille, et ne justifie elle-même quoi que ce soit que par des jugements réfléchissants permettant au mieux de voir clair dans un fait accompli.
Où je me permettrais d’exprimer une divergence, c’est peut-être sur l’expression même d’« écologie première ». Il me semble que l’écologie (poésie ou non) n’est pas première. Elle vient à la fin : c’est au bord du gouffre, et à vrai dire une fois que nous sommes déjà bien avancés dans la catastrophe, qu’elle apparaît, historiquement. Et il doit en être ainsi : si l’on veut bien entendre par écologie d’une part la connaissance des écosystèmes (et de leur équilibre) et d’autre part la définition de leur préservation comme objectif politique premier, ce sont une discipline et une pratique très tardives — les connaissances qu’elles supposent étant elles-mêmes extrêmement récentes. On sait que des espèces peuvent apparaître (et disparaître) depuis cent cinquante ans. On sait que les comportements humains peuvent avoir un effet sur la température de la Terre, et donc sur les équilibres géo-biologiques, depuis cinquante ans. L’écologie est donc plutôt une préoccupation dernière, chronologiquement ; la poésie qui lui correspond est par conséquent encore largement à venir. Voilà pourquoi c’est l’enjeu même du présent dans sa singularité, que de formuler des figures susceptibles de donner à penser la crise (la catastrophe) dans laquelle nous sommes, et mener à bien la transformation radicale de l’imaginaire politique et sociale indispensable si nous voulons en atténuer les dommages.
Aussi, je reprendrais volontiers la critique que fait Jean-Claude de la téléologie hégélienne, mais je lui appliquerais un tour d’écrou de plus — ou de moins ; en tout cas je n’irais pas jusqu’à dire que le poème serait par essence un objet pastoral auquel il « incomberait » de prendre la relève d’un Logos disqualifié. Le poème ne doit rien. Il peut servir à n’importe qui, à n’importe quoi (et les poèmes ont eu bien des fonctions, rituelle, politique, amoureuse, dans le cours des âges). Je ne veux pas dire pour autant que le poème est n’importe quoi : il y a bien quelque chose comme « le » poème (quelque chose rapproche les textes d’Homère de ceux de Villon, ceux de Du Fu de ceux de William Carlos Williams, ceux de du Bellay de ceux de Sharon Olds) mais cela ne suffit pas à déterminer un destin. Ce quelque chose c’est seulement, si l’on veut, une condition : le poème est un être de langue qui excite la pensée tout en se refusant à elle. Face au poème, l’esprit doit en effet descendre dans les mots (dans leur chair) et se faire immanent au plan de la langue ; il s’y promène, y récolte ce qu’il y peut, mais le piège se referme sur lui dès qu’il essaie de prendre du recul pour synthétiser en une idée ce qu’il y a perçu. Orphée descend dans l’enfer du poème ; s’il se retourne en remontant, il perd nécessairement Eurydice. Cette condition du poème — celle d’un corps de mots qui excite la synthèse gnomique tout en se refusant à elle — je l’appelle sa « sauvagerie » (avec des guillemets, par référence, mais en distinction, avec celle de l’animal). Mais cette « sauvagerie » ne suffit pas, me semble-t-il, à définir ce qui lui incombe. De même que rien n’incombe au pur-sang. Il est là, à brouter dans la prairie. On peut le contempler. On peut le chevaucher. On peut l’exploiter. Il ne doit rien. Et nous voilà, qui passons près de lui (il est un peu négligé, depuis quelques temps), le jour d’une marche pour le climat. Les purs-sangs sont partie prenante de la question : la destruction des écosystèmes les concerne aussi, d’une manière ou d’une autre. Peut-être peuvent-ils aussi nous aider — mais comment ? On ne sait pas trop, a priori. Allons-nous faire quelque chose de leur présence ?
Le rapport des poèmes à l’écologie est du même ordre : circonstanciel, contextuel, opportuniste, conditionnel. Il reste à prouver. Nous sommes acculés par la catastrophe en cours, nous cherchons désespérément et maladroitement quelque chose pour la combattre et voilà que nous tombons sur cette « sauvagerie » du poème : en ferons-nous quelque chose, pour cette situation, qui aurait pu ne jamais avoir lieu (la catastrophe elle-même n’était pas un destin) ? La plupart des gens répondent « non » à cette question (mais la plupart des gens n’ont pas perçu la « sauvagerie » du poème). À moi non plus, ça ne me semble pas évident, mais je n’ai que ça, je ne sais faire que ça (monter ce pur-sang), je dois essayer (le poème ne doit rien, mais moi, si) : j’engage donc toutes les forces du poème dans cette lutte. Qu’est-ce que maintenant cela veut-il dire ? Qu’est-ce qu’un poème « écologique » ? Comment un poème lutte-t-il contre le saccage des écosystèmes ? Contre le réchauffement climatique ? Cela ne va pas de soi. Doit-il faire, par exemple, de la nature son thème ? Parler des arbres, des oiseaux ? Peut-être cela développera-t-il, au moins dans l’esprit du poète et de son lecteur, une forme d’attention aux êtres vivants. Voilà un acte que peut opérer notre poème. Mais comment s’y prendre ? On réfléchit. Puis, quoi d’autre ? Décrire les autoroutes surchargées, la déforestation, la pollution ? Quel effet peut-on en espérer : éveiller les consciences ? Figurer le désastre, espérer un sursaut ? Pourquoi pas : mais comment faire ? On essaie. On essaie de comprendre ce qu’on a fait. Et puis quoi d’autre ?
C’est ici, on l’aura compris, qu’intervient me semble-t-il en propre le Logos (ou une sorte de philosophie), dans ce double mouvement qui ressemble un peu à l’usage qu’on fait de la raison dans un protocole expérimental : d’une part pour aider à formuler les questions, les objets de recherche, les directions à prendre. D’autre part pour revenir sur le travail accompli et le réfléchir, le comprendre, fournir des concepts à même de le styliser. C’est moins un travail de fondation qu’un travail de stratégie, où la raison sert à la fois à entrevoir des actions possibles, et à décrire l’effort accompli. Comme le coach de basket, qui donne des pistes sur sa petite ardoise pour orienter la marche du match, puis regarde la captation vidéo une fois qu’il est fini, pour comprendre ce qui a fonctionné. Mais ce n’est pas lui qui joue. Quoi qu’il en soit, ce sont deux usages du discours auquel les artistes en général (pas seulement les basketteurs, aussi les poètes) ont souvent eu recours : le manifeste (ce que nous croyons qu’il faut faire) et l’art poétique (la manière dont nous comprenons ce que nous avons fait).
J.-Cl. P. : La divergence entre nous vient d’abord, me semble-t-il, d’un problème de définition. Nous ne parlons pas en effet exactement de la même chose quand nous employons le terme d’« écologie ». Pierre prend le mot dans son sens le plus courant : l’écologie comme branche récemment apparue (« discipline et pratique très tardives ») du savoir, à mi-chemin des sciences du vivant et des sciences humaines. De mon côté, je revisite et modifie le sens du mot, le fait travailler pour l’accommoder à la poésie en général (d’où le « comme » de mon sous-titre). Décomposant le terme en ses deux segments, je l’entends comme éco-logie, i.e. type de parole où il y va de notre « maison » (habitation) terrestre, avec l’idée (la fiction) d’un « pacte pastoral » immémorial. Virgile donc, aussi bien que Vinclair ! Au risque (inhérent me semble-t-il à toute philosophie) d’une essentialisation.
Il y a ensuite une différence d’approche. Celle de Pierre est d’inspiration « pragmatiste » (au sens de la philosophie américaine). La mienne est davantage métaphysique et grevée, sans doute, de trop de spéculation germanique ! Il est révélateur, de ce point de vue, que Pierre parle du poème, là où je parle plutôt de la poésie. C’est l’action poétique aujourd’hui qui lui importe, tandis que mon approche est plus « contemplative », plus rétrospective que « progressive ». Vous le dites très bien, Pierre : votre souci est « stratégique », là où le mien est davantage « fondationnel ». J’ai toutefois tenté, dans Pastoral, de parer à ce risque « spéculatif » en faisant droit à la position (à l’antithèse) wittgensteinienne (p. 29, puis p. 35-37). Pas sûr que je sois parvenu à desserrer l’étau de l’antinomie. J’en suis là.
*
G. A.-B. : Permettez-moi un instant, sinon d’aggraver ce que vous désignez comme « divergence », du moins d’en souligner peut-être le contour, qui s’annonce, je crois, dans la différence des termes que vous utilisez : car si Pastoral semble faire signe vers l’unité « fondationnelle » d’un archi-mouvement ouvert à une reprise philosophique, la sauvagerie n’indique-t-elle pas plutôt le lieu principiel mais introuvable d’un chaos originaire soustrait quant à lui à toute tentative d’élucidation ? Doit-on donc penser — je grossis le trait — que vous rêvez d’une paix enfin reconquise, Jean-Claude, là où Pierre assume décidément qu’au commencement fut la guerre des choses et des êtres ?
P. V. : Si je comprends bien, vous ne nous demandez pas ici ce que nous avons fait, voulu ou cru faire, mais quel est l’imaginaire au travail derrière nos titres et concepts respectifs. Je n’ose pas m’aventurer dans de telles considérations d’herméneutique ! qui relèveraient plutôt des prérogatives du lecteur ou du critique. C’est pourtant clair que la question se pose : le face à face des termes pastoral et sauvagerie semble si dramatique ! Mais comme l’auto-herméneutique m’est interdite, au lieu de répondre franchement à la question et d’avouer qu’une fascination pour le chaos travaille l’emploi de ces catégories, je vais plutôt donner quelques éléments d’un do-it-yourself critique, grâce auxquels les lecteurs de bonne volonté pourront se faire une idée plus complexe de la réponse qu’on pourrait vous faire :
Agir non agir n’est pas un traité de philosophie : c’est un ensemble de réflexions nées de la pratique du poème, de considérations occasionnées par l’écriture de La Sauvagerie.
La Sauvagerie est composée de 499 dizains et d’un huitain. Le huitain, qui est au seuil de l’ouvrage, est de la main de Jean-Claude Pinson.
Cette place est due au fait que La Sauvagerie a été tout entière conçue comme une réponse au défi posé par Pastoral.
Si j’ai eu connaissance de Pastoral avant sa publication sous forme de livre, c’est qu’il est d’abord paru sous forme de feuilleton en 2018-2019 dans la revue Catastrophes dont je m’occupe.
Depuis 2016, je suis engagé dans la composition d’un vaste projet, très modeste et très ambitieux, qui consiste, plutôt que faire « de la littérature », à dire ce qui compte à ceux qui comptent. Dans ce cadre, la plupart des textes que j’écris sont adressés, comme des réponses à des questions. Une sous-branche géographique de ce projet — auquel s’intègre La Sauvagerie — touche à la composition de poèmes dans divers endroits du globe. J’ai ainsi commencé à écrire ce livre à l’été 2018 (alors que je recevais les premières réflexions de Pastoral de la part de Jean-Claude Pinson ayant généreusement accepté de les livrer à la revue Catastrophes) au Pays de Galles. C’est là que furent écrits la plupart des dizains de la première section du livre (qui en compte douze) et quelques autres, disséminés dans La Sauvagerie.
Le paysage du Pays de Galles semble aujourd’hui encore, c’est son charme, en grande partie façonné par l’agriculture. L’œil superficiel du vacancier, en tout cas, se félicite d’y trouver des exploitations à taille humaine, gondolées sur des collines en champs de couleurs bigarrées se jetant dans la mer dans une dramaturgie élégante, et prend en photo les vaches placides qui broutent à l’air libre dans de vastes prés.
Autre symptôme d’un monde presque disparu, le Pays de Galles compte de nombreuses librairies, et même une ville, Hay-on-Wye, presque entièrement dédiée au commerce des livres. C’est là que j’achetai The Country and the City, un essai de 1973 dans lequel Raymond Williams déconstruit le genre poétique classique de la pastorale, en montrant que la célébration de la nature qui s’y livre est en réalité une construction idéologique, d’abord destinée à faire plaisir aux princes en mettant en scène leurs valeurs féodales dans des décors champêtres en grande partie imaginaires — la réalité de la vie à la campagne étant tout sauf poétique.
Aux pages 55-56 de Pastoral, Jean-Claude Pinson écrit d’ailleurs :
Déconstruction. – Au plan théorique, la tradition poétique de la pastorale n’a évidemment pas échappé à la déconstruction. Celle-ci n’a eu aucun mal à pointer tout ce qui, dans les conventions et stéréotypes de cette tradition, dans son lexique et ses jeux de rôle obligés, pouvait relever de la construction mensongère, du bavardage trompeur. Pas eu de mal à montrer qu’elle n’est qu’une construction idéologique, qu’un artifice conduisant à essentialiser (« naturaliser ») ce qui n’est qu’un produit culturel contingent. C’est ce que s’est employé à établir un théoricien marxiste de la culture comme Raymond Williams, dans son livre The Country and the City (1973). En proposant, notamment à propos du mouvement des enclosures, le tableau idyllique d’une vie champêtre antérieurement synonyme de paradis perdu, la littérature « pastorale » se livre à une entreprise d’idéalisation mensongère. Elle détourne l’attention de la condition réelle des paysans afin de mieux faire oublier une exploitation qui, avec le développement du capitalisme industriel, a signifié un exode massif vers les grandes villes. Au revers du paradis pastoral, c’est l’enfer de la condition paysanne et de son devenir ouvrier et urbain qui se dévoile.
Si l’ensemble du projet a été conçu comme une réponse à Jean-Claude Pinson, un poème de La Sauvagerie lui est explicitement adressé. C’est le n° 440. Je ne me résous à prêter le flanc, en me citant, à l’accusation de vanité, que pour échapper à une plus grande faute déontologique, celle de l’auto-herméneutique que vous me demandez :
Pourquoi si peu de verbes exotiques
pour dire le tire-lire des oiseaux, d’arbustes
phylogénétiques aux sous-genres fleuris, de robustes
thyrses latinisants où s’enroulent les toponymes ?
mon poème naît dans le béton, connait
machines, croit bêtes et plantes sauvages
comme lui échappant aux taxinomies
niant les trompe-l’œil, méprisant les fétiches
pleurant sans conjurer les disparitions —
la pastorale leur est interdite.
J.-Cl. P. : J’accorde bien volontiers à Pierre Vinclair que la notion de pastorale est pour le moins ambiguë. Écrire un poème « pastoral » à la façon de l’abbé Delille (mettons), voilà ce que sûrement je m’interdirais. Si j’ai choisi cependant ce terme, c’est en tordant le sens le plus obvie qui est le sien — en distinguant le féminin (la pastorale) du masculin (le pastoral) (p. 26 de l’essai en question). Je l’ai fait en écho à la notion de « convention pastorale » avancée par Paul de Man dans un article de 1956 où il souligne, à travers cette expression, bien loin de l’aimable tradition bucolique du xviiie déconstruite par Raymond Williams, une constante ontologique de la poésie (c’est à Pierre Vinclair, je le dis au passage, que je dois la référence à l’ouvrage de Williams The Country and the City).
Bien d’autres motifs concourent au choix d’un tel titre : la réflexion sur un luxe à la fois pastoral et communal menée à partir de Vallès ; les références (trop allusives certainement) à l’intérêt de Marx pour la commune paysanne traditionnelle en Russie (mir) ou à la critique faite par Chayanov de la réforme agraire imposée brutalement par Staline.
D’autres raisons, moins « raisonnables », ont sans doute compté dans le choix final d’un tel titre. Notamment, liée à mon histoire personnelle, une idiosyncrasie sociologiquement bigarrée qui me rend particulièrement chers bien des aspects du monde paysan, des paysages aux modes de vie (attachement qui transparait par exemple dans les pages que je consacre à Pierre Michon ou à Jean-Loup Trassard). J’ajouterai encore que j’ai toujours aimé les titres qui laissent beaucoup de jeu dans l’interprétation qu’on peut en faire (un titre comme Sentimentale et naïve, appliqué à la poésie, est perçu immédiatement comme dépréciatif, alors que rapporté à Schiller — comme il s’avère à la lecture du livre qu’il doit l’être, il perd cette coloration négative).
Pour en venir maintenant à la question posée par Guillaume Artous-Bouvet, il y a bien en effet une sérieuse tension entre nos deux démarches, la guerre d’un côté, la paix de l’autre ; une tension (caricaturons un instant) entre le « bellicisme » du titre de Pierre Vinclair et l’« irénisme » de celui de mon essai.
1/ « Paix enfin reconquise » : si l’expression a pour moi une signification, ce n’est pas d’abord au sens d’une tranquillité de l’âme, mais au sens d’un monde harmonieux au plan politique, d’une société sans classe, égalitaire, où serait enfin réalisée l’utopie d’un monde libéré du besoin et de la misère. Dans cette perspective clairement marxienne, il se trouve que l’ardent et sombre xxe siècle fut pour toute une part de ma génération crépusculaire, à la fois un lever de soleil plein d’espoir et au final un désastreux naufrage.
J’ai d’emblée associé poésie et révolution, rapproché l’Âge d’or véhiculé par l’idylle poétique (disons Hölderlin) et ce que Derrida a appelé la « promesse émancipatoire » indéconstructible du marxisme (son messianisme étranger à tout dogmatisme). Dans Pastoral, j’évoque, emblématique de cette association du poétique (de la visée d’une vie poétique) et du politique, un tableau de Signac intitulé Au Temps d’Harmonie (L’âge d’or n’est pas dans le passé, il est dans l’avenir). Penser et pratiquer la poésie (la littérature) comme une « politique profonde », tel fut le sens dès le départ de mon entreprise, comme l’a bien vu récemment un critique4. Voilà pour le lever de soleil.
Si cet idéal demeure — doit et peut demeurer aujourd’hui opérant dès lors qu’on le modifie à l’aune de l’impératif écologique, il ne peut être pensé sans son envers, sans la dialectique négative qui historiquement l’a affecté au plus profond. On ne sait que trop en effet comment le rêve d’un Âge d’or a pu virer, dans l’expérience du communisme réel, au cauchemar le plus désastreux. En Union Soviétique, en Chine, mais aussi au Vietnam, comme en atteste le destin tragique du philosophe Tran Duc Thao5.
Loin du vrai théâtre des opérations (alors dénommé « zone des tempêtes »), ma génération, aussi radicaux qu’aient pu être ses engagements, n’a pas eu ici, dans l’Europe aux anciens parapets, sauf exception, à en subir les pires conséquences. C’est de loin et en mode somme toute mineur (du moins dans mon cas) qu’il nous fallut endurer l’échec de nos élans utopiques.
Ce que j’en retiens aujourd’hui, c’est que nous avons trop cédé à l’optimisme de la volonté et prêté trop peu d’attention au pessimisme de l’intelligence (pour reprendre la formule fameuse attribuée à Gramsci). Limiter ses lectures à la seule littérature marxiste-léniniste ne fut pas alors du meilleur secours. Il eût été préférable de se souvenir, par exemple, des Démons de Dostoïevski6.
2/ Au plan ontologique, l’archi-mouvement de la Physis n’exclut nullement le polémos héraclitéen père de toutes choses. S’il s’agit bien d’un archi-mouvement, cette ontologie doit être pensée en termes de « déflagration » plutôt que de repos. Le mot de « déflagration », emprunté à Merleau-Ponty, est repris par Renaud Barbaras pour penser une dimension foncièrement remuante et disparate de l’Être en même temps que sa contingence radicale (sa survenue perpétuelle et indéductible)7.
D’autre part, si la démarche qui est mienne dans cet essai est en un sens « fondationnelle », elle ne prétend nullement établir un savoir positif de l’originaire. Réflexive, elle constate au contraire, en écho à ce qu’écrit à ce sujet Agamben, que la dimension « musaïque » du langage poétique renvoie à quelque chose d’insituable et « hors d’atteinte ».
Il y a là, je le vois bien, deux intuitions (convictions, postulats — j’hésite quant au terme le plus adéquat) qui peuvent paraître contradictoires. D’une part l’affirmation d’un monisme : n’est que la matière, de la matière (Natura, Phusis), et tout étant est inscrit dans un Grand Tout auquel il appartient (d’où l’insistance sur la notion de continuum). Mais d’autre part, au plan cette fois gnoséologique, au plan de la connaissance, j’opte résolument pour une philosophie de la différence : pas de savoir absolu hégélien, pas d’identité du réel et du rationnel mais au contraire une « différence non-logique » irréductible (Bataille plutôt que Kojève).
3/ Par contre au plan proprement poétique (au plan textuel de l’écriture), je rejoins bien volontiers le plaidoyer de Pierre Vinclair pour la « sauvagerie ». Mes modèles sont ici tout sauf « classiques » : c’est vers le free-jazz que regarde le mode de composition de plusieurs de mes livres et la prosodie que je tente de faire tenir debout doit beaucoup au procédé du sdvig (de la déviation brusque, du dérapage, du déraillement imprévisible) expérimenté par les avant-gardes russes des années 1920. Mais je ne voudrais en la matière n’exclure rien. Le « truitage » cher à Georges Perros, pour le coup très « pastoral », me paraît non moins viable que le carnaval free8.
4/ Je dirais enfin que c’est surtout au plan « poéthique », au regard de ce mouvement par lequel le poème (l’œuvre littéraire en général) dessine les lignes de formes de vie dissidentes, au regard aussi d’une « poétique du dehors », que l’idée de paix peut prendre sens. C’est à ce niveau que le poème peut projeter en aval de lui-même, par un mouvement de protension, des esquisses de formes de vie apaisées parce que délivrées des obsessions de rendement, de productivité, de profit propres à l’homo œconomicus d’aujourd’hui ; des formes de vie où prévaut, non la « gouvernance par les nombres » (comme dit le juriste Alain Supiot), non la guerre prédatrice sans fin menée contre la nature pour s’approprier ses ultimes ressources, mais l’amitié avec elle (ou plutôt en elle), via l’attention esthétique et « l’érudition sensible » (Pessoa) qu’à son contact on peut cultiver.
*
G. A.-B. : Il est donc temps d’en revenir aux convergences :
Première résonance, celle qui s’entend d’une « sauvagerie » ou d’un « ensauvagement » du poème, témoin de quelque « appartenance » essentielle. Jean-Claude, vous insistez sur le fait que l’énoncé poétique est comme « “ensauvagé”, par la résurgence en lui d’un “archi-mouvement” de la Nature ». Pierre, vous notez quant à vous que la sauvagerie du poème est celle « d’un corps de mots qui excite la synthèse gnomique », c’est-à-dire savante, « tout en se refusant à elle ». D’où ma question, sans doute un peu brutale : tout poème est-il, doit-il être sauvage ? Et quelles seraient les procédures spécifiques de l’ensauvagement ?
Deuxième écho, celui qui tient à la conscience d’une urgence qui renverse l’ordinaire des téléologies philosophiques — et philosophico-politiques —, et qui constitue la poésie comme « écologie dernière », parole au point brûlant du péril, dictée par « la menace d’une catastrophe climatique qui se rapproche toujours plus dangereusement », pour reprendre vos termes, Jean-Claude. Quelles seraient d’après vous les formes possibles de cette poésie du « bord du gouffre », de cette « poésie de catastrophe » qui, selon vous, Pierre, est « encore largement à venir », dès lors qu’elles ne sauraient simplement répondre à la déduction d’une « histoire littéraire » classique ?
À cette double question, j’ajoute une troisième direction, en espérant ne pas trop aggraver la tresse de notre dialogue : Jean-Claude, vous pointez le fait qu’entre la discursivité philosophique pure et sûre d’elle-même, et l’inquiétude ensauvagée du poème, il y a place pour le genre tiers de l’essai, qui suppose comme vous le dites « un travail propre d’écriture », tel que vous avez pu le mettre en œuvre dans Pastoral. Doit-on alors donc considérer l’essai comme la modalité proprement stratégique, pour reprendre le terme de Pierre, de l’intervention réflexive à l’époque du péril écologique, à l’instant, donc, où le geste philosophique de fondation semble peut-être sinon désarmé, du moins pris de vitesse par le surgissement de la menace ?
P. V. : Ce sont des questions cruciales, pleinement politiques. Car nous sommes au bord du gouffre (et ce nous ne nous englobe pas seulement « nous, les Occidentaux », ce qui serait déjà pas mal, mais « nous, les humains » et même « nous, les vivants ») et nous allons périr. Or, au moment où, les uns et les autres, plus ou moins affolés, plus ou moins conscients de la catastrophe, commençons à entendre, et à relayer, la question : « Que faire ? Mais que faire ? », à ce mo-ment-même, donc, voilà qu’avancent quelques olibrius pour prendre la parole face au public (c’est bien cela, publier un livre). Or donc, cette agora est placée à l’intérieur d’une automobile qui fonce à toute allure vers l’abîme comme dans La Fureur de vivre. Et que sont-ils venus proclamer ? « Frères humains, sœurs panthères, cousins plancton… écrivons des poèmes ! » C’est parce que le cœur de ce que proposent les poètes, eu égard aux enjeux, ne peut pas ne pas paraître grotesque, me semble-t-il, qu’ils doivent le défendre et l’expliquer dans l’essai — qui s’impose comme le parcours de l’ensemble des médiations intellectuelles grâce auxquelles devient crédible et même finalement évidente, une équation a priori contre-intuitive. L’essai a donc bien une visée fondationnelle (mais, si j’ose dire, « stratégiquement fondationnelle » : la métaphysique est une branche de la pragmatique, les prêtres le savent bien) puisqu’il s’agit de légitimer quelque chose. Moins pour le fonder en droit, dans le ciel des idées, qu’en fait dans la tête des citoyens qui ont bien voulu nous allouer quelques précieuses secondes de discours dans l’agora-mobile.
Donc, nous disons : « Il faut écrire des poèmes ! » Pourquoi cela ? Qu’ont les poèmes de si extraordinaire ? Et quelles propriétés devraient-ils cultiver pour exacerber encore le pouvoir que nous leur prêtons ? C’est à ces questions que répond Agir non agir, essai dans lequel je propose à la poésie qui vient de croître dans l’espace ouvert par les sept dimensions suivantes : qu’elle soit sauvage, totale, tendue, intéressante, pensante, collective et rituelle.
Par « sauvage », j’entends le fait que le poème ne réponde pas aux plans de l’esprit. Il est un corps, autrement dit une articulation mouvante (mais stable : automobile) d’éléments hétérogènes. Cette propriété ne rapproche pas le poème de l’animal d’une manière seulement métaphorique : car dans sa différence et son refus de la synthèse de l’esprit, le poème lui oppose une résistance. Quoique le fruit d’un artisanat humain, le poème (et sans doute l’art en général) réplique à l’humain la présence de son irréductible corps. Alors tout poème est-il sauvage, doit-il être sauvage ?, demandez-vous. Le poème, soulignons-le, ne doit rien. Mais sans doute en effet certains poèmes sont-ils plus sauvages que d’autres : comparons les Suppôts et Suppliciations d’Artaud et les poèmes de Voltaire. Ce n’est d’ailleurs pas seulement une question de modernité : les sonnets de du Bellay me semblent bien plus sauvages que le vomi bâclé des épigones du jour. Car l’important pour moi, c’est bien ceci : est-ce que le poème illustre une décision du poète (et vomir-comme répond à une telle décision), ou est-ce qu’il vit de son corps propre (et il peut bien vivre tenu par les attelles d’un système de rimes) ? À quoi sert-elle, cette « sauvagerie » ? D’abord, notons que c’est déjà quelque chose (d’absolument, infiniment et malheureusement modeste, mais tout de même quelque chose) de soustraire un morceau du réel aux décisions de la rationalité calculante dont la tendance fâcheuse est de transformer tout ce qui est en synthèse comptable, et de détruire l’inassimilable. Le tableau Excel est d’abord devant le poème comme une poule face à un couteau (ou plutôt, le contraire) — cette mise en déroute me semble à elle seule justifier l’existence du poème. Mais je mentirais si je n’avouais pas que je confie en réalité à sa « sauvagerie » un rôle beaucoup plus ambitieux, au succès moins garanti : qu’elle incarne la sauvagerie en général, au moment de l’extinction massive des espèces. C’est-à-dire qu’elle porte et soigne, aussi infime soit-elle, la flamme du sauvage dans un monde qui s’en débarrasse. Que le poème soit une petite arche de Noé. Bien sûr, cela prête à sourire : c’est qu’il manque encore des médiations explicatives. La présentation des six autres dimensions est là pour les fournir.
D’abord, et c’est ce qui signe l’ampleur et le caractère inédit du problème, ce ne sont pas seulement les individus qui disparaissent, mais le tout comme tout — c’est-à-dire la nature, entendue comme système « vivant » (ce que Lovelock nomme Gaïa). Par « totale » (c’est la deuxième dimension), je désigne donc non le poème singulier mais le livre de poèmes, dont l’organisation, systémique comme thématique, doit permettre de figurer le tout qu’est la nature.
La tâche (celle du poème de sauver l’être sauvage comme celle du livre de figurer la nature) paraît encore très nettement utopique. Mais cela ne doit pas nous décourager et c’est pourquoi j’en appelle — c’est la troisième dimension — à une poésie « tendue » dans son effort, fût-il irréalisable. Ce n’est pas très original de le dire, mais la quête d’un idéal même seulement régulateur induit des effets politiques réels. Que la démocratie effective soit hors d’atteinte (ou pour un peuple de dieux), comme l’avait explicitement noté Rousseau, n’a pas empêché les Révolutionnaires ses lecteurs de chercher à mettre en place, et finalement de nous offrir, une République réelle qui, quoique éloignée de la perfection, vaut infiniment mieux que l’Ancien Régime des privilèges.
Cette tension du poème, et du livre de poèmes, vers l’idéal, a toutes les chances de se solder par un simple échec, c’est entendu. Mais cet échec, si le poème parvient à l’incarner dans son drame, peut acquérir une nouvelle vertu : elle le rend « intéressant » — c’est la quatrième dimension. Que le poème, autrement dit, soit un drame et que quelque chose d’important s’y joue, que les enjeux qui le travaillent soient cruciaux et qu’ils y soient mis en scène de façon captivante. Pour une pièce de langage, le drame en question implique au minimum, me semble-t-il, la lutte effective d’une puissance (humaine) d’énonciation et d’une puissance (inhumaine, animale peut-être) de désénonciation.
Cette lutte, qui définit le sens comme l’enjeu, toujours fragile, jamais définitif, d’une réception qui se fait moins enregistrement que véritable expérience, est en outre la condition pragmatique élémentaire d’une lecture concentrée et continuée : si le poème ne nous intéresse pas, s’il nous tombe des mains, tous ses autres offices sont rendus impossibles. Notamment celui de penser et de faire penser — c’est la cinquième dimension — « sans concepts » : comme sut le faire l’épopée guerrière, au point de renouveler l’imaginaire politique de sociétés anciennes plongées dans des crises apparemment insurmontables.
Si en effet, pour aller vite, Athènes sort de l’Iliade (comme l’a démontré en détail Florence Goyet) ou, pour le dire autrement, si la littérature sait, sous le régime de l’épopée, tirer d’une crise politique radicale les ressources pour modeler un imaginaire social à même de la surmonter, elle ne peut malgré tout le faire que dans des œuvres qui sont collectives et populaires. On ne peut décider a priori cette dernière propriété, mais la première des deux est de notre ressort : on peut s’efforcer de se coordonner dans des ouvrages collectifs (c’est la sixième dimension), dans lesquels nous mettons en commun nos forces pour penser à plusieurs le problème qui nous arrive à tous.
Collectif, le poème a alors une chance d’avoir moins pour enjeu l’expression de ce qui compte pour l’un, que la mise en rapport avec ce qui vaut pour tous. C’est-à-dire de servir de médium par lequel se définit et se touche un sacré : une source de valeur suffisamment importante pour que nous soyons prêts à consentir des sacrifices en son nom. C’est singulièrement ce qui nous manque pour sortir de la catastrophe écologique. Cette dimension, la plus éloignée de la poésie des cent cinquante dernières années mais la plus cruciale du dispositif que j’appelle de mes vœux, est ce qui dans le poème relève du « rituel ». Si nous ne sommes pas dans une société sans rituels (qu’on pense au baccalauréat, au mariage, aux soldes), la poésie en semble singulièrement dépourvue. Or non seulement cela n’a pas toujours été le cas, mais le poème se trouve justement être ce qui nous reste de la parole chamanique, et de la promesse d’une puissance performative de la parole. Il nous faut maintenant trouver comment la réactiver.
La poésie du futur doit donc être archaïque. Je ne me suis démarqué de la position fondationnelle de Jean-Claude, sur la nature de tous temps écologique du poème, que pour mieux l’appuyer, dans un détour à l’issue duquel le fondationnel lui-même est fondé, mais par la pragmatique.
J.-Cl. P. : Je brosserais d’abord volontiers le décor. Oui, il importe plus que jamais, autant que faire se peut, de « sauver l’être sauvage » (je reprends la formule de Pierre), au moment où sa destruction est entrée dans sa phase terminale. De ce point de vue, l’entreprise de La Sauvagerie est mille fois justifiée. Elle est, au sens étymologique comme au sens propre, digne d’admiration : à la fois belle surprise (dans le champ poétique) et digne d’éloge en son projet comme en sa réalisation.
Ladite destruction du sauvage n’est toutefois pas à confondre avec la déconstruction de la notion (celle, tout spécialement de wilderness) opérée par les sciences humaines. Cette déconstruction peut au contraire aller dans le sens d’une défense de la Nature. Dans le chapitre 2 de son livre Par-delà nature et culture, intitulé « Le sauvage et le domestique », Philippe Descola souligne ainsi que pour les peuples de chasseurs-cueilleurs l’opposition du sauvage et du domestique doit être relativisée : pour les Aborigènes d’Australie par exemple, c’est la « totalité de l’environnement » qui est « habitée comme une demeure spacieuse et familière »9. L’écoumène et l’érème forment un continuum.
Cependant, si la notion de « sauvage » doit être relativisée, si la forêt primaire elle-même est « par-delà nature et culture », il ne s’ensuit pas que la catégorie d’« être sauvage » doive être partout abandonnée10. La thèse, métaphysique (ontologique et poétologique), que je défends est au contraire que si la notion de Nature est sans cesse, dans l’histoire des idées, construite et reconstruite, il y a cependant dans la réalité naturelle (dans sa « donnéité » indéductible) quelque chose d’irréductible (de non déconstructible et de non reproductible, contrairement à ce dont rêve le projet transhumaniste). On peut appeler ça un alogon, quelque chose qui échappe absolument à la prise du concept, au Logos. Ou encore on parlera (je reprends ici des formules de Christian Prigent venues de Bataille) d’un réel « impossible » et d’une « différence non-logique ». Cet irréductible, cet « hors Logos », procède ontologiquement de ce que j’appelle, avec Renaud Barbaras, l’« archi-mouvement » de la Nature. Nous sommes de celle-ci pleinement partie prenante, malgré l’« archi-événement » du langage qui n’aura cessé de nous en éloigner. Et la poésie (au sens large, c’est-à-dire comme art en général) est comme le conservatoire actif, vivant, de cette appartenance première ; elle est une zone de résistance (une ZAD) à l’effacement de cet « archi-mouvement ». C’est en ce sens qu’elle a partie liée avec la défense du « sauvage ». Avant d’être déontologique (de déterminer ce qu’éventuellement devrait être et faire le poème), l’affaire est donc ontologique : l’affinité de la poésie avec la part « sauvage » de la Nature est constitutive de son être.
À cela s’ajoute une dimension historique. Avec la Modernité, le « pacte pastoral » (celui qui fait l’amitié ancestrale de la poésie et de la Nature) est de plus en plus mis à mal sous l’effet d’une domination toujours plus totalitaire du Logos sur les formes de vie. En réaction à cette domination, l’art moderne a entrepris de se « réensauvager », de transgresser les limites de l’écoumène pour retrouver quelque chose comme un érème. Deux exemples : le Fauvisme en peinture et le Sacre du printemps de Stravinsky.
Concernant le poème, cela passe par un recours accentué à l’obscurité. Faire du poème un « animal sauvage », comme dit Pierre Vinclair, cela requiert qu’on l’emmène se perdre dans la selva oscura, là où nulle balise sémantique ne peut plus éclairer son chemin. « La sauvagerie d’un vers tient à son refus de se clore dans une proposition logique », à sa façon de « pousser le sens hors de ses gonds11 ». Sans doute ce recours à l’obscurcissement du sens, cet hermétisme, n’est-il pas l’apanage de la modernité poétique. Le seul nom de Lycophron (je pense à la retraduction qu’en a proposé Pascal Quignard12) suffirait ici à montrer l’antiquité d’un tel type d’écriture. Toutefois, ce penchant à l’obscurité, non seulement est devenu un trait particulièrement accentué de la poésie moderne, mais celle-ci l’a hautement revendiqué (sans toujours en bien saisir les tenants et aboutissants).
Et si l’on veut encore remonter dans le temps et aborder à l’immémorial, on pourra alors invoquer, comme le fait Pierre Vinclair, le chamanisme du poème. Présent sous la forme des « incantations anent »13, chez les Achuar, ces « horticulteurs de la haute Amazonie14 » dont parle Philippe Descola, le chamanisme est aussi une référence majeure de la poésie moderne — il suffit ici de penser à Artaud et à la manière dont il aura été marqué par son voyage au pays des Tarahumaras. Dans l’état chamanique, note Pierre Vinclair, « l’attention à la fois flottante et aiguë » du poète le rend apte à « entendre les assonances plutôt que les références faites aux choses, [à] voir dans un mot son anagramme ou dans une expression sa conformité ou son écart à un schème métrique, plutôt que sa signification15 ». Au fond, la langue du poème tend à devenir ce que les Futuristes russes appelaient une langue « za-oum », une langue d’« outre-entendement ». On comprend dès lors qu’elle puisse paraître « forêt obscure » et « sauvage » au regard des usages ordinaires du langage. Commentant la démarche poétique de Vélimir Khlebnikov, Jean-Claude Lanne, un de ses traducteurs en français, note que le vers cherche chez ce poète russe à se souvenir de sa parenté avec l’univers. Et il ajoute : « le russe dit mieux cette identité profonde par les deux vocables “stikh” (le vers) et “stikhia” (la force élémentaire qui travers le monde)16 ». Ce que je traduirais volontiers ainsi : la sauvagerie « za-oum » du vers (du poème) est sa façon de faire entendre en lui, à rebours des médiations sans fin du Logos de la raison calculante qui cherchent à en étouffer la respiration, l’« archi-mouvement » de la Phusis (des Éléments).
Que faire quand nous sommes au bord du gouffre ? J’avoue être ici bien démuni et, relisant les dernières pages de mon essai, je ne peux qu’en constater la tonalité résolument funèbre. Les modalités du poème que je passe en revue (stabat mater, chant du cygne, thrène, chants d’extrême onction athée) paraissent toutes relever de la rubrique « soins palliatifs ».
Deux facteurs nourrissent ce pessimisme : le peu (le sempiternel peu) que peut la poésie d’une part, plus aggravé que jamais peut-être (mais ce diagnostic mérite sans doute d’être aujourd’hui corrigé), et, dans l’ordre « poéthique », la réduction du temps aux deux seules dimensions du présent et du passé, du fait, sinon de l’abolition du futur, du moins de sa brusque contraction à cet avenir immédiat que l’urgence du dérèglement climatique nous impose.
Depuis toujours, j’ai voulu voir en la poésie (en son Idée comme en sa réalité textuelle) le vecteur d’une promesse parente de celle, émancipatoire, du marxisme : celle d’une habitation poétique de la terre. Tant qu’était tenable l’idée d’un « tunnel de l’époque », d’un « interrègne » qui ne serait pas éternel, tant qu’existait pour elle un horizon, cette promesse pouvait continuer à donner crédit à l’action poétique. Elle pouvait faire fonction d’Idéal régulateur et inciter à voir dans le poème une force (aussi faible soit-elle) capable de contribuer, en renouvelant nos imaginaires, à l’invention de formes de vie alternatives.
Et pour mieux soutenir cette perspective, je pensais nécessaire d’élargir la poésie à la littérature tout entière et même à l’art en général. À cette fusée, j’ajoutais même le renfort d’un étage (ou plutôt d’un sous-sol), considérant qu’en cette affaire d’action poétique essentielle était la « poétique du dehors » mise en œuvre ici et là (à Notre-Dame-des-Landes par exemple) par ce que j’appelle le « poétariat ».
Je crains que cette construction ne soit plus désormais que château en Espagne, utopie au mauvais sens du mot. Si seuls n’existent plus pour nous qu’un passé et qu’un présent (le futur proche n’étant de ce dernier qu’une annexe), quelle action poétique alors demeure possible qui soit capable de renverser la vapeur ?
Il serait facile de dénigrer tout ce qui relève de la tentation du repli. Au plan individuel, faire retraite n’est cependant pas sans vertu : dans la « mélancolie des vaincus », il peut y avoir une forme de critique et même le ressort d’une tonalité joyeuse (« léopardienne »). Au plan collectif, comme soustraction au système dominant, comme forme d’exode immanent, se retirer « dans la vie profonde » peut avoir valeur d’une forme de résistance. Toute une frange de la jeunesse recourt aujourd’hui à cette pratique (je renvoie ici aux analyses de Toni Negri et Michael Hardt).
Si la poésie peut avoir malgré tout quelque efficace, c’est dès maintenant, au présent, en contribuant à « aménager » ces temps de la fin qui sont déjà les nôtres dans le sens d’une réorientation de nos formes de vie. Peut-elle aider à retrouver ce « pacte pastoral » dont nos existences sont devenues très oublieuses ? On aimerait le croire. En tout cas, elle a, mieux que bien d’autres « disciplines », le pedigree pour le faire : elle peut ainsi contribuer, dans l’ordre « poéthique », à ce que Stéphane Bouquet appelle « une intensification charnelle du présent », « communiste » en ce sens qu’elle serait « accessible à tous ». Elle peut aussi insuffler à nos existences, par ses « chants », par le sens de la beauté qui lui est propre, une énergie tonale qui puisse un tant soit peu contre-effectuer la « solastalgie » (la douleur du réconfort perdu) et la misère, la désespérance, qu’impliquent les temps de la fin. Écrivant cela, je suis bien conscient cependant de ne guère dépasser ces « soins palliatifs » que j’évoquais en commençant de répondre à cette deuxième partie de votre question.
Du fait de sa relative brièveté (souvent), de sa vitesse de réaction aux mutations du temps, la forme de l’essai peut paraître en effet plus efficace que le traité philosophique cheminant lentement vers quelque fondation ou structure architectonique. Il faudrait toutefois distinguer ici l’essai journalistique (son « bavardage ») et l’essai, littéraire et/ou philosophique, capable de longue résonance dans la pensée et la sensibilité parce qu’il n’a pas perdu l’oreille pour cette dimension « musaïque » si essentielle à la poésie. Deux modèles ici ont beaucoup compté pour moi : celui des Petites œuvres morales de Leopardi et l’écriture fragmentaire de Nietzsche dans Le Gai Savoir.
Au-delà de la question propre de l’essai, les œuvres qui me retiennent sont celles, « totales », où s’entrelacent la narration, la réflexion et le chant. Le nom de Proust est évidemment de ceux qu’on ne peut pas ici ne pas citer. Dans cet ordre d’idées, parmi les contemporains, je ferai une place toute particulière à Pierre Michon. Mais si la prose est le médium souvent privilégié d’un tel thyrse, rien n’exclut que le vers puisse parvenir à cet entrelacement. C’est en tout cas ce dont La Sauvagerie, livre lui aussi total, administre une preuve que je trouve pour ma part magistrale.
*
G. A.-B. : Il me semble que nous touchons là au cœur — difficile et battant — de la question : celle de la possibilité d’une « sauvagerie » du poème comprise comme promesse d’une réconciliation entre l’homme et sa part de nature irréductible ou, pour reprendre votre terme, Jean-Claude, « indéconstructible ». Vous le rappelez, les mises en question philosophiques (ou anthropologiques) de l’unité logologique du concept de Nature ne doivent pas être entendues comme révocation de l’idée d’un « être sauvage » : que, comme le suggère notamment Philippe Descola, le grand partage philosophique entre Nature et Culture puisse et doive être en partie révoqué, voilà qui ne signifie pas la disparition ou la dissipation de la Nature « elle-même », mais qui indique seulement la nécessité d’une réévaluation du lieu de la nature en nous et hors de nous.
Il y aurait donc en nous « nature », une « vie à travers nous » selon l’expression de Baptiste Morizot, une « sauvagerie » indéfectible à quoi nous devons une attention qui ne peut sans doute être que poétique (c’est-à-dire, pour prendre le terme selon son acception la plus large, « inventive »17). D’où l’injonction par vous évoquée, Jean-Claude, d’une obscurité sans hermétisme — i.e. non réductible à l’appel d’une herméneutique — qui permette de soustraire le poème à l’horizon limité de notre humanité culturelle.
Pierre Vinclair, vous le montrez d’ailleurs en pratique dans La Sauvagerie, et en théorie, si j’ose dire, dans votre Agir non agir : le poème doit trouver les voies d’un rapprochement non « seulement métaphorique » avec l’animal, dont vous définissez la teneur par sa force de « résistance » corporelle. Le poème, dites-vous, doit vivre « de son corps propre », ce qui suppose entre autres choses la dramatisation à lui immanente de « la lutte effective d’une puissance (humaine) d’énonciation et d’une puissance (inhumaine, animale peut-être) de désénonciation ». Le poème sauvage ne saurait donc pas prétendre à quelque « pure » sauvagerie, à l’animalité simple du cri ou du rugissement, mais plutôt se chercher au point où s’éveille la limite entre parole et silence, entre nature et culture — limite toujours mouvante, donc, sans cesse rejouée et relancée.
J’en viens à ma question : la sauvagerie du poème serait-elle donc moins à comprendre comme un « retour » à la nature, que comme l’attention inquiète (et peut-être, comme vous le dites, Pierre, sans cesse menacée par la possibilité de l’échec), depuis les procédures « séparées » de l’artefact linguistique, à ce qui lui résiste, à ce qui lui échappe ?
Je précise : comment rejoindre la nature « en poème », si ce n’est plus par les voies d’une représentation mimétique supposant la délimitation stricte, désormais révoquée par les travaux d’un Descola, entre Nature (réel extérieur) et Culture (artefact réfléchissant) ? Doit-on accepter de ne dire la nature qu’au travers de la dramatisation d’un échec, par quoi le poème manifesterait négativement ce qu’il ne peut pas dire, ou peut-on encore rêver d’un écho, supposant que dans la parole humaine résonne encore quelque texture d’un chant ?
Ce qui suscite une ultime interrogation, réagissant à vos dernières remarques, Jean-Claude : vous dites que « les œuvres qui [vous] retiennent sont celles, “totales”, où s’entrelacent la narration, la réflexion et le chant », comme celles de Proust, Michon, ou Vinclair. Mais cette « totalité » qui répèterait dans une analogie au moins principielle la totalité naturelle, n’est-elle pas toujours menacée de « détotalisation » ou de fragmentation (deux qualités qu’on peut encore dire « naturelles », d’ailleurs) : Proust inachève l’écriture de la Recherche, Michon écrit selon la règle du « minuscule », Vinclair réfléchit, en la détotalisant donc relativement, l’entreprise de La Sauvagerie (Nature ?) par Agir non agir (Culture ?) ?
P. V. : Il ne faut pas traiter Descola en métaphysicien : son entreprise, révolutionnaire dans un champ intellectuel fondé sur le concept-fétiche (si j’ose dire) de culture, ne peut pas être comprise comme relevant de l’ontologie. Non seulement parce qu’elle est explicitement méta-ontologique (il s’agit de comparer des ontologies entre elles) mais parce que son propos est d’abord politique : s’il souligne la dimension « culturelle » de la « nature », c’est pour contester la rhétorique de la culture qui sert en réalité notre volonté de puissance. Qui l’imaginerait expliquer par exemple aux Achuars que leur vision du monde n’est qu’une construction parmi d’autres, qui gagnerait à se relativiser au contact de la nôtre ? Son propos, c’est la démotivation ontologique de l’Occident. Or, on peut dans le même but adopter la stratégie complémentaire — celle d’un Gary Snyder, par exemple — et retourner le stigmate, en revendiquant moins la valeur culturelle du sauvage dénigré, que la valeur de la sauvagerie même. Dire qu’il n’y a pas de sauvage en soi (que tout est « culturel »), en effet, ou dire que le sauvage en soi est la plus grande valeur, revient au même, d’un point de vue pragmatique : il s’agit dans tous les cas de formuler des discours à même de protéger ces êtres que nous appelons (à tort ou à raison) sauvages.
Parler de la sauvagerie du poème, en revanche, ne relève pas d’une approche seulement pragmatique : il s’agit bien de pointer l’essence de quelque chose. Mais cette essence ne saurait relever de la « pure » sauvagerie, comme vous dites. Il s’agit nécessairement d’une sauvagerie seconde, ou d’une sauvagerie malheureuse. Jean-Claude propose une caractérisation très précise, très juste, dans Pastoral, du rapport de la parole humaine à la nature dont elle est issue, qu’elle nie, mais qu’elle voudrait rejoindre : « Redevable à la Nature, comme tout homme, de son existence […], le poète lui doit en outre sa parole […] », écrit-il p. 27). Or « la conscience poétique est une conscience malheureuse qui aspire à une réconciliation avec la Nature, quand le langage, en sa négativité, signifie pour l’homme la séparation d’avec cette même Nature. Cette réconciliation est donc loin d’aller de soi : l’idylle pastorale est une affaire “problématique” […] » (p. 27-28, c’est lui qui souligne). La « sauvagerie pure » ou première est par définition inaccessible au poète, puisque son instrument langagier est l’opérateur de la mise à distance de la nature lui-même. L’enjeu du poème est donc nécessairement de retrouver une sauvagerie seconde, ou, pour reprendre le titre de Descola, qui se situât par-delà Nature et Culture.
Pas de simple cri dans le poème. Il peut bien le singer, ou tenter l’onomatopée — mais faute de pouvoir sortir de son imaginaire social par le bas (par son en-deçà), ce ne sera jamais qu’une posture dans le magasin de la culture. Il faut sortir par le haut (par l’au-delà). Or ce n’est pas là vaine revendication, je ne prends pas mes désirs pour des réalités : qu’on ne puisse pas sortir par le bas est un fait, qu’on puisse sortir par le haut est aussi un fait. Nous avons en effet au cœur du Naturalisme même (pour reprendre la caractérisation par Descola de l’Occident), une poche de sauvagerie dialectique qui en est la respiration et lui est sans doute consubstantielle. C’est l’art. L’art est précisément la manière dont l’esprit humain travaille à s’envoyer en l’air, c’est-à-dire à mobiliser sa propre culture pour la dépasser dans la sauvagerie. Que les artistes les plus cultivés et les plus virtuoses soient les fondateurs de mouvements tels que le fauvisme ou le primitivisme n’est pas un hasard : l’art est le tour par lequel la Culture retrouve la Nature, ou (avec les catégories de Descola) la manière dont le Naturalisme retrouve dans sa propre ontologie un tunnel vers l’être. L’art est sauvagerie. C’est la raison pour laquelle j’oppose franchement, dans Agir non agir l’art et la littérature, cette dernière entendue comme une pratique relevant de la simple culture. D’un côté l’effort sauvage qui s’arrache à la culture, de l’autre l’illustration de son répertoire formel ou thématique. Sur les sites des maisons d’édition, on lit souvent : assurez-vous que votre manuscrit correspond bien à la ligne de ce que nous publions. Voilà la littérature : complaire au cahier des charges d’un genre (par exemple en composant une intrigue comme il faut dans laquelle des « personnages » sont doués de « psychologie »), faire du style (c’est-à-dire chercher à acquérir des propriétés phénotypiques valorisées), imiter des manières. Kant ne disait pas autre chose, avec ses théories du « génie » (par lequel la nature donne ses règles à l’art et impose ses révolutions artistiques au monde de la culture) et du « sublime », qui correspond au sentiment que provoque en nous la nature « brute » ou « sauvage » [rohen Natur]. Et ce n’est pas le défaut d’art, dans un poème, qui fait remonter celle-ci : le recours à l’onomatopée (chez les disciples d’Artaud, par exemple) ne fait que connoter le sauvage, mais ce qu’il performe, c’est l’imitation (dans cet exemple, d’Artaud). Au contraire, un art titanesque, qui maitrise toutes les techniques (comme celui de Picasso, par exemple), peut retrouver dans un langage (culturellement construit, mais poussé à la limite et relevé ou « sursumé ») le corps sauvage de l’être. La spontanéité d’un solo de free jazz ne se gagne qu’au prix de longues études de solfège. Le débutant ne sait comment souffler dans l’anche.
J.-Cl. P. : Le poème aimerait sans doute pouvoir « rejoindre » la nature « sauvage » (ou le réel « non-logique »), mais niet, la « sauvagerie » obtenue n’est jamais que seconde. Thèse déceptive où je crois pouvoir discerner la transposition, dans le champ poétique, du postulat philosophique d’une clôture de la représentation : affirmer, à la façon kantienne, qu’on ne peut en sortir pour atteindre la chose en soi, c’est récuser à la fois le réalisme naïf du sens commun et la posture mystique (son illusion d’un accès extatique à quelque chose comme une réalité ultime ou primordiale). D’où en effet la conscience malheureuse du poète, quand il fait le constat qu’il est lui aussi (lui le supposé mage) condamné, quoi qu’il fasse (cri ou glossolalie), à demeurer prisonnier du langage, de sa finitude propre.
De cette aporie, on ne peut, dit Pierre Vinclair, que « sortir par le haut » et non par le bas (celui du cri). Et d’évoquer alors une « sauvagerie dialectique » inhérente à la culture elle-même. J’acquiesce volontiers, mais pense pourtant que ce « par le haut » peut n’être pas contradictoire avec un « en bas » matérialiste.
Réfléchissant au matérialisme de Ponge18 (à ce que j’appelais son « matérialisme de la différence », un matérialisme « à la limite »), je m’étais naguère arrêté à la formule célèbre où il écrit (dans Méthodes) que « le monde muet est notre seule patrie ». En d’autres termes, nous habitons bien la matière (la materia de Lucrèce, la Nature), mais elle ne parle pas, le Logos étant l’apanage de l’homme et de lui seul. D’où un hiatus que rien ne peut venir combler. Ponge, bien que méfiant à l’égard de toute ontologie (« le souci ontologique est un souci vicieux »), ajoutait cependant que les poètes sont « les ambassadeurs du monde muet » en ce qu’ils « s’enfoncent dans la nuit du logos, — jusqu’à ce qu’enfin ils retrouvent au niveau des racines, où se confondent les choses et les formulations ». Je ne suis pas sûr de pouvoir être tout à fait d’accord aujourd’hui (malgré les majuscules — ou à cause d’elles) avec cette idée de « racines ». Mais que le poète soit celui qui se porte aux limites du sens (du Logos) et qu’il soit, du monde sans Logos (du monde « sauvage »), l’ambassadeur, voilà qui me convient. J’y vois la confirmation que Ponge n’est pas seulement du côté d’une poétique « négative » (qui constate sans fin l’impuissance du langage à rejoindre le réel), mais aussi du côté d’une poétique de l’affirmation – et la célébration est en effet chez lui essentielle, selon un tropisme qui, au-delà de son cas propre, vaut pour le poète en général. En outre, dans cette idée d’« ambassadeur du monde muet » (c’est-à-dire non humain), je vois une parenté possible avec ce que j’énonce sous la rubrique d’un « pacte pastoral ».
Aller plus loin et « rêver d’un écho » tel que la parole humaine ne serait pas tout à fait seule au monde ? L’hypothèse, sous réserve d’une redéfinition de la notion de langage, me semble soutenable, dès lors qu’on veut bien, quittant le cadre d’une ontologie sourcilleuse quant aux interdits relatifs à la chose en soi, écouter ce qu’une « zoopoétique » pourrait nous enseigner. La différence abyssale, le hiatus ne sont plus alors de mise (demeure toutefois la question de l’articulation des deux approches). C’est au contraire la dimension de continuité entre l’« archi-mouvement » de la Nature et l’« archi-événement » du langage qu’il faut prendre en compte. Car si le monde est « muet », s’il ne parle pas, s’il est radicalement dépourvu de sens, néanmoins il n’est pas silencieux. De ce continuum (un terme, au passage, cher à Philippe Descola) atteste parmi bien d’autres phénomènes le lien du chant humain au chant des oiseaux. Plus largement, la musique humaine, si elle ne s’y réduit pas, procède génétiquement des sons du biotope. Et ce procès peut d’autant plus facilement être étendu au plan proprement linguistique qu’on accorde crédit à la thèse de Rousseau quant à l’origine du langage19. En d’autres termes, la culture est encore nature, en porte toujours l’indélébile empreinte.
Mais inversement, si High is Low, Low is High. La nature est déjà culture. « L’art, écrivaient Deleuze et Guattari dans Mille plateaux, n’attend pas l’homme pour commencer ». Ils s’attachent à montrer comment, de par les qualités expressives, constructives (presque au sens propre) de son chant, l’oiseau se révèle être un « artiste complet », à la fois peintre et musicien, lorsqu’il dispose des feuilles au sol pour construire la scène où il va se mettre à chanter sa ritournelle, comme le Scenopoïetes dentirostris, cet « oiseau des forêts pluvieuses d’Australie ». L’intérêt majeur de leur théorie de la ritournelle, cependant, est de montrer que celle-ci ne vise pas seulement à produire une « territorialisation ». Elle est aussi synonyme d’« ouverture déterritorialisante », lorsque, connectant les agencements du chant au Cosmos, elle prend la forme de cet appel mystérieux des forces de la nature qui « arrache l’habitant au territoire » et voit par exemple les pinsons se lancer « dans un voyage irrésistible » et se rassembler « soudainement par millions ». Il y a donc une ambivalence de la ritournelle, qui est l’équivoque même du « Natal » : elle est à la fois chant du territoire et chant du monde. « La nature est comme l’art », elle conjugue « la Maison et l’Univers, le Heimlich et l’Unheimlich, le territoire et la déterritorialisation, les composés mélodiques finis et le grand plan de composition infini, la petite et la grande ritournelle »20. Cosmique, cette « ouverture déterritorialisante » déjà repérable dans le monde animal vaut a fortiori pour l’œuvre d’art humaine : chez Proust, notent Deleuze et Guattari, si « tout commence par des ritournelles », « tout se termine à l’infini dans la grande Ritournelle, la phrase du septuor en perpétuelle métamorphose, le chant des univers, le monde d’avant l’homme ou d’après »21.
Il y aurait lieu, sans doute, de s’attarder sur la métaphysique sous-jacente à la théorie de la ritournelle avancée par Deleuze et Guattari et sur cette idée pour le moins problématique de chant du monde (de « chant des univers ») à laquelle ils semblent aboutir. Je me contenterai ici pour ma part d’y voir un point d’appui en faveur de la thèse d’une « sauvagerie seconde » du chant poétique. Loin d’être confronté à un monde simplement « muet », le poème est mis en présence d’une part « chantante » pré-verbale qui le fait partie prenante du monde naturel. Lui aussi est « animal » — ou plutôt « animiste », comme dit Marielle Macé. Et il l’est parce que, s’arrachant au bavardage, il est en mesure (c’est tout le travail de l’art) de faire entendre en son chant propre une vibration « musaïque » qui nous rappelle que notre langage n’est pas né de rien, qu’il a son origine (insituable) dans le grand tohu-bohu de la Nature, dans sa respiration cosmique, même si cette origine, fût-elle fantasmée (ce fut la Muse des mythologies antiques), est à jamais hors d’atteinte.
Enfin, par livre « total » (l’adjectif est peut-être mal choisi), je n’entends pas un livre clos sur lui-même, Système enfermant la totalité supposée achevée du savoir, selon le modèle hégéliano-kojévien, et pas davantage ce Livre mallarméen où l’entièreté du monde viendrait se résumer et le tout de la littérature se récapituler. Cela supposerait une philosophie de l’identité (du réel et du rationnel) à laquelle je n’adhère pas, plus enclin que je suis à suivre Nietzsche invitant à « émietter l’univers » et à « perdre le respect du tout ».
Ce qui m’importe, c’est qu’on n’écarte a priori du poème aucun registre (narration, fiction, réflexion, chant…), ni aucun ton ni aucune modalité (tragique, comique, lyrique, ironique…). Sur ce point, Barthes me semble avoir dit l’essentiel dans son cours sur La Préparation du roman. Il y a selon lui une dialectique du Livre et de l’Album et « c’est finalement l’Album qui est le plus fort, c’est lui qui reste »22. L’ambition du Livre toutefois n’est pas, dans l’Album, totalement supprimée. Elle est plutôt « dépassée » (au sens hégélien : « sursumée », aufgehobt). J’aime les livres ambitieux qui sont des livres sur tous les sujets, qui abordent une question sous tous les angles possibles. Ce me semble être le cas de La Sauvagerie, livre assez éloigné du modèle minimaliste qui a longtemps prévalu pour la poésie française des dernières décennies.