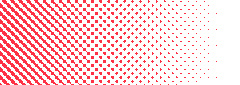Croisements non carrefours. Des anthropologues en prise avec le poétique
1À 19 ans, l’un des pionniers de l’anthropologie nord‑américaine aujourd’hui assez oublié — contemporain du « père fondateur » Lewis H. Morgan (1818‑1881) qui a contribué à en effacer la mémoire —, Ephraim George Squier (1821‑1888) envoie ses premiers vers au Literary Pearl (Charlton, État de New York), puis au Ladies’s Cabinet Magazine (Albany) dans l’espoir explicite de se faire un nom. Son poème autobiographique, « What’s In a Name ? » — référence directe à Shakespeare et à une réplique de Juliette contre la tyrannie des noms de famille1, rêve d'une renommée qui ne soit pas usurpée et qui puisse « triompher du destin » que le nom impose2.
Is there a man above all others great ?
‘Tis he who burst the fetters of low estate,
And strongly struggling, triumphs over fate!
But is there one who meanly creeps the earth,
And though with honors crown’d, yet without worth,
Mark ye the man — he boasts a lofty birth.
2Quelques mois plus tard, Squier lance The Poet’s Magazine : A Repository of Original and Selected Poetry qui ne survivra pas à ses deux premiers numéros. Abandonnant alors la poésie, il se tourne vers le journalisme avant de s’investir pleinement dans l’archéologie et l’anthropologie au sein desquelles il se fera, enfin, « un nom » par les fouilles et les enquêtes conduites sur les « gloomy ruins » des vallées de l’Ohio et du Mississipi à la recherche des mythiques « Mound Builders », le peuple originel commun aux groupes autochtones de l’est des États‑Unis, puis dans plusieurs zones de l’Amérique centrale et méridionale (du Mexique au Pérou, en passant par le Nicaragua et le Honduras). La poésie se retire de l’horizon des chemins de la renommée, ce qui n’empêche pas Squier de continuer d’écrire des vers dans ses carnets privés durant encore quelques années3.
3Née un siècle et demi plus tard (1943) et de l’autre côté de l’Atlantique, à Athènes, Margarita Xanthakou écrit, après quelques essais de jeunesse, ses premiers poèmes en français à la fin des années 1970 tout en conduisant des recherches d’anthropologie des affects et des troubles psychiques dans l’espace hellénique. Progressivement, à partir du milieu des années 2000, ses publications scientifiques s’accompagnent d’une écriture de poèmes de plus en plus régulière. Trois recueils de « prose poétique » sont ainsi publiés sous son nom chez une éditrice de poésie contemporaine, Laurence Mauguin : Souvenir du soleil (2009), Un sursis de tristesse (2012) et Sur ce bout de terre osseux (2015)4, auxquels l’on pourrait associer, comme une amorce hybride5, ses Mémoires grecques (1993) qui composent un mode de restitution des contes de tradition orale et de l’expérience du terrain fondé sur le fragment et selon le degré de brillance des éclats du souvenir — et non sur la chronologie qui conduirait une narration ou sur l’élucidation d’un problème qui construirait une analyse.
4La mise en miroir de ces deux modalités du rapport que peuvent avoir des anthropologues à la poésie — ou à l’idée qu’ils s’en font — révèle l’aporie à laquelle ce dossier s’est trouvé confronté quand il s’est agi de donner de la consistance au fil directeur qui guidait son élaboration. Nous avions pris acte du fait que, tandis que les rapports entre anthropologie et littérature en étaient arrivés à un stade d’exploration qui en faisait presque un champ à part entière, les relations entre poésie et anthropologie restaient moins bien documentées. Elles ne se donnaient généralement à penser que dans une asymétrie commode préservant le confort des compétences à l’intérieur de leurs frontières ordinaires. D’un côté, une anthropologie des pratiques poétiques et des traditions orales6 ; de l’autre, une poésie d’emblée située au-delà de l’anthropologie, c’est-à-dire quand cette dernière échoue à rendre compte du sensible. Il y a trente ans un dossier important (occupant l’espace de trois numéros) de la revue fondée par Stanley Diamond, Dialectical Anthropology, et intitulé « Poetry and Anthropology », avait lui aussi reconduit, quoique d’une manière un peu différente, ce partage des compétences en faisant assumer aux auteurs sollicités de façon séparée leur double casquette de poète et d’anthropologue. L’on peut en effet y lire, entre autres, des poèmes de Paul Friedrich suivis d’un commentaire de James Redfield, puis une brève étude de Paul Friedrich sur la musicalité de la langue poétique, ou encore des poèmes de Dell Hymes, précédé d’une réflexion générale du même Hymes qui reconduisait la séparation fondamentale entre les deux « domaines », réaffirmée par le geste même qui cherchait à les rapprocher : « Poetry is a continuation of anthropology by other means », écrit ainsi Dell Hymes à propos des Totems (1982) de Stanley Diamond7.
5Notre dossier prétendait, au contraire, s’inscrire dans l’espace d’intersections véritables entre poésie et anthropologie, ce qui comprenait, principalement, la longue tradition des écritures poétiques chez les anthropologues, l’usage de l’anthropologie fait par les poètes, mais aussi les relations intellectuelles qui ont pu s’établir entre les uns et les autres. Or chacune de ces entrées présente des caractéristiques propres, obéit à une généalogie singulière et recouvre des problématiques qui ne s’informent pas nécessairement les unes les autres. La confrontation d’études de cas prises dans chacun de ces registres n’avait que peu de sens et interdisait, dès le départ, toute montée en généralité. Il fallait donc restreindre l’enquête à un territoire plus limité, ce que nous avons fait en décidant de nous concentrer sur des anthropologues engagés dans un rapport actif, vivant, concret à la poésie — objet dont l’étroitesse relative (la grande majorité des anthropologues n’écrivent pas de poésie et n'en parlent même pas) laissait supposer sinon une homogénéité, du moins la possibilité d’une approche systématique et le repérage de quelques régularités.
6Nous espérions ainsi tendre un fil entre Ephraim G. Squier et Margarita Xanthakou, soit entre des commencements poétiques avortés qui ouvrent sur une carrière d’anthropologue et une vie conduite dans l’anthropologie et où la ligne parallèle de l’écriture poétique grossit et envahit même le texte anthropologique8. Ces cas ne sont pas isolés. Avec d’autres, dont certains font l’objet d’articles de cette livraison, ils actualisent deux configurations bien connues et dont le pouvoir d’identification lisse sans doute un peu trop les aspérités de chaque situation. D’une part, l’on retrouve le motif de l’aspiration littéraire déçue et rabattue dans la pratique d’une science, l’anthropologie, qui maintient le désir initial d'écriture et d'expression sous assistance narrative et descriptive (Squier), et qui peut aussi trouver à être pleinement assouvi dans la restitution — la traduction — de la poésie des autres. Pour ces chercheurs, l’anthropologie est « the next best thing to poetry » comme le disait Stanley Diamond9 qui, après avoir abandonné la seconde au profit de la première, revient à sa vocation poétique d'enfance en même temps qu'il fonde le département d'anthropologie de la New School — une institution qui, vingt ans plus tard, le consacrera officiellement « Poet in the University » en même temps que « Distinguished Professor of Anthropology and Humanities ».
7D’autre part, s’impose avec la même force l’image de l’ethnographe qui, ayant épuisé les limites de la description ordinaire pour rendre compte de l’expérience éprouvée, remet entre les mains d’autres instances évocatrices (la Littérature, la Poésie) la charge de restituer l’épaisseur du sensible et du vécu car elles n’ont pas à transiger avec les contraintes (méthodologiques, déontologiques, etc.) qui pèsent sur la science.
8Mais le fil ne tient pas. Et en premier lieu parce que les pôles entre lesquels il est tendu manquent de consistance. Les façons dont la poésie est première, ou dernière, sont extrêmement disparates et vont de la lecture passionnée à la publication précoce, en passant par la copie, l’écriture privée, la participation aux activités d’un groupe, l’animation d’une revue ou d’un réseau, etc. De même, l’entrée en anthropologie et la manière dont celle-ci est ensuite pratiquée présentent des facettes très différentes et ne correspondent pas toujours à l'infléchissement d'une vocation littéraire ; c’est d’ailleurs l’une des propriétés de la discipline qui continue de cultiver un certain goût pour les parcours atypiques et pour la diversité des modes d’attention aux différences. En second lieu, la lecture polarisante (qu’induisait, au fond, la formulation « poésie et anthropologie ») contribue à cristalliser les deux termes autour de présupposés qui fixent leurs différences et leurs ressemblances. À l’anthropologie revenaient ainsi la démarche et l’aridité scientifiques, l’exigence de la précision, la logique analytique et l’arraisonnement du divers ; à la poésie, la toute-puissance expressive, le privilège de la fulgurance et l’intranquillité fondamentale face aux représentations. Pour autant, ces réductionnismes aisément repérables ne peuvent être balayés simplement. Car ils sont partagés et alimentés par une large partie des acteurs eux-mêmes. La poésie reste pour beaucoup le signifiant commode de ce que voudrait — et à quoi ne parvient pas — l’anthropologie, sans qu’il soit nécessaire de déterminer avec précision en quoi consiste « l’obscur objet du désir » qui peut être le fantasme de la traduction intégrale, de la restitution vive de l’expérience vécue, ou de la mise en présence du réel absent.
9Entre le discours des auteurs, qui durcit et polarise artificiellement les pratiques, et une collection de situations qui ne forment en aucun cas système, quel parti prendre ? Faut‑il en conclure que les croisements observés relèvent simplement de l’aléatoire ? Qu’il n’y a que des cas particuliers, et des configurations accidentelles qui font que, parfois, l’anthropologue est ou a été aussi poète ? Ce dossier fait le pari inverse. Tout en récusant la possibilité de subsumer la variété des cas sous un mode d’articulation unique, les articles réunis ici montrent le caractère essentiel du lien entre poésie et anthropologie pour chacun des personnages considérés — Bronislaw Malinowski, Michel Leiris, Edward Sapir, Ruth Benedict, Margaret Mead, Roger Bastide, Georges Condominas, Tina Jolas. Chacun d’entre eux élabore pour lui-même et au contact d’autres individus une formule d’association entre poésie et anthropologie qui lui est propre mais qu’il pense ou vit comme partageable, et qui peut être, mais n’est pas nécessairement, partagée. On éprouve ainsi, en même temps, sa pratique personnelle et le pattern de celle‑ci, une singularité idiosyncratique et sa puissance d'extension et de généralisation. Il s’agit peut-être là d’un trait non propre mais souligné chez les intellectuels qui ont investi des savoirs ou des discours à forte réflexivité ajoutée10. Comme les anthropologues ; comme les poètes.
Luttes de la base et du sommet
10Revenons aux deux « pôles » initialement envisagés. L’alternative, schématisée à l’extrême dans les parcours, eux-mêmes plus complexes, d’Ephraim G. Squier et Margarita Xanthakou, entre des débuts poétiques abandonnés au profit de l’anthropologie et une vie d’écriture scientifique qui prend de plus en plus en compte ce que peut la poésie, dessine les contours d’une question qui apparaît le plus souvent en filigrane, mais parfois aussi de façon très explicite, dans les propos et les écrits de plusieurs des figures qui sont ici évoquées. La sensibilité poétique — manifestée par la lecture, la traduction ou l’écriture de poèmes — constitue-t-elle l’humus idéal où prend racine le regard anthropologique ? S’y élaborent en effet le premier décillement et la grave inquiétude — moteur de toute recherche — fécondée par la quête des ressemblances et des différences en quoi consiste fondamentalement le geste poétique comme le rappelle ici‑même Marielle Macé. Ou faut-il penser au contraire que l’expression poétique est requise par la « matière » anthropologique et l’épreuve d’un rapport au réel radicalement différent que la restitution scientifique appauvrit ? La poésie impose‑t‑elle son exigence à qui se sent tenu par un « idéal de saisie de la totalité de l’expérience humaine » selon l’expression d’Éléonore Devevey ? Qui, de l’anthropologie ou de la poésie, forme la base — ou le sommet — de l’autre ?
11 Dire que l’anthropologie est la meilleure chose à faire, après la poésie (S. Diamond), ou que la poésie est la continuation de l’anthropologie par d’autres moyens (D. Hymes), est une façon commode de répondre à ces questions mais ces formules sont plus suggestives qu'elles ne sont éclairantes. Et elles aplatissent les pratiques discursives et les modes d'écriture en les rabattant sur un face-à-face qui néglige les effets de simultanéité, de récursivité, comme les contradictions. De sorte qu'on trouvera dans les articles ci-dessous à la fois la prégnance de ce modèle pour les acteurs — il est très efficace pour se mettre en ordre de façon rétrospective — et les éléments factuels qui en dénoncent le caractère artificiel.
12 Pourquoi artificiel ? C’est que dans les deux cas — le modèle « Squier » de la vocation poétique avortée ou le modèle « Xanthakou » de la poésie envahissant l’anthropologie — , on passe de l'une à l'autre en raison d'un sentiment d'échec et selon une logique de substitution, ou à partir de l’impression d’un manque. Or les études de cas de notre dossier mettent en évidence deux choses. D'une part, elles invitent à distinguer l'alternance de la substitution : pour la plupart des anthropologues que nous considérons, poésie et anthropologie ne s'opposent pas sur le mode du « ceci tuera cela » ; elles cohabitent et s'imprègnent l'une l'autre. D'autre part, les contributions ici réunies montrent à l'œuvre des sensibilités qui, sans toujours se réaliser directement par l'écriture de poèmes, accordent à la poésie un rôle central dans la conception et l'analyse du terrain ethnographique. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de considérer la poésie comme une forme d'écriture, éventuellement concurrente de l'écriture ethnologique, mais comme une disposition ou comme une catégorie d'appréhension du réel. C'est à la fois une nécessité et une difficulté. Une nécessité car, historiquement, l'ethnologie (et les ethnologues) relève(nt) d'une époque où la poésie excède le poème11, où la notion de poésie subsiste toujours en bonne part quand celle de littérature est discréditée (c'est un point de jonction majeur entre les savants et les avant-gardes12) — et ce serait trahir cette réalité que de vouloir restreindre la poésie au vers. Une difficulté car évidemment, la notion est dès lors menacée de dissolution : comment distinguer une conception vague de la poésie — qui peut même tomber dans le piège de la projection à la façon dont les réalités exotiques peuvent paraître « poétiques » à un œil étranger13 — d'un rapport réfléchi, intense, productif à la poésie ? Comment distinguer les recours faibles à la poésie — la poésie comme autre nom de l'ineffable — des recours forts, qui informent, voire programment l'enquête ethnographique ? Une telle interrogation ne connaît pas de réponse in abstracto. C'est précisément pour cette raison qu'il fallait en passer par des études de cas.
13De la poésie comme base et origine de l'aventure ethnologique, l’on peut trouver plusieurs motifs non exclusifs les uns des autres. D'abord, l’entrée en écriture par la poésie (le modèle « Squier ») : on retrouve ce phénomène chez Ruth Benedict — dont le rapport à la poésie, précoce et intense, a été bien étudié par Richard Handler dans un article important de 1986, que nous traduisons ici —, chez Margaret Mead — qui évoque dans ses poèmes les cultures non-occidentales sur un ton élégiaque qui, comme le montre Phillip Schweighauser, contraste fortement avec le vitalisme primitiviste de ses contemporains — ou chez Bronislaw Malinowski — dont le travail anthropologique viendra combler une « pulsion de création » que ses poèmes de jeunesse ne parvenaient pas à assouvir, ainsi que le souligne Amalia Dragani. Ensuite, le motif de la soupe poétique primordiale (modèle « Leiris ») que l’on trouve donc chez Michel Leiris, immergé dans le bain surréaliste ou chez Edward Sapir aspiré par la New Poetry (Ezra Pound notamment). La poésie est un idéal premier moins comme forme d'écriture que comme vie ou type de vie ; elle est associée à un accomplissement existentiel plus qu'à un genre. À sa suite, l'anthropologie est elle aussi envisagée comme une pratique et une aventure ; l'une comme l'autre forgent le caractère et promettent des scénarios existentiels — « vie poétique » chez Leiris, vigueur et virtuosité de l'humaniste accompli pour Sapir. Ce qui distingue ce motif du suivant (même si la séparation n’est pas forcément franche), c’est le sentiment de la « bifurcation » (comme Vincent Debaene l'a montré à propos de Leiris14), et d’une autre vie à envisager ou envisageable (l’autre carrière rêvée par Sapir toute sa vie, dont témoigne l'article déjà mentionné de Richard Handler). Mais bifurquer n’est pas choisir. C’est plutôt accentuer un registre, le positionner en tant que clef sur la portée mélodique de l’existence, réservant à un autre les liens d’accompagnement, d’écho, de réponse ou de fuite. Ainsi, l'anthropologie et la poésie ne se substituent pas nécessairement l'une à l'autre, mais peuvent donc alterner ou cohabiter, à l'exemple de ce qu'on observe chez Sapir et chez Leiris (dont le rapport à la poésie sur le long cours est ici étudié par Vincent Debaene). Plutôt que « formes d'écriture » concurrentes, poésie et anthropologie doivent alors être envisagées comme parties de petits écosystèmes idiosyncratiques, chacune jouant tour à tour vis-à-vis de l'autre le rôle de refuge ou de relance. Enfin, — dernier motif de cette petite typologie qui n’en est pas une — le ressort poétique continu (modèle « Jolas ») : ce qui caractérise ce motif, c'est la forte continuité entre poésie et anthropologie. C’est déjà le cas, en un sens, chez Benedict qui conçoit pratique poétique et pratique anthropologique comme répondant aux mêmes aspirations et qui (comme Sapir d'ailleurs, mais sans le tragique du choix de vie) tâche de convertir des arguments poétiques (la « dureté » de Pound) en concepts anthropologiques. C'est le cas plus encore chez Tina Jolas, figure méconnue de la discipline ethnologique mise à l'honneur ici par Nicolas Adell, à partir d'une reconstitution de son parcours et de ses échanges avec André du Bouchet, René Char et Yvonne Verdier. Pour elle, ce n’est pas qu’il n’y a pas de rupture, mais simplement la poésie est au début et à la fin de tout; elle précède et englobe une pratique ethnographique qui ne prend sens que par rapport à elle.
14De l’anthropologie comme base ou ressource de la poésie, le modèle absolu est fourni par la field ou ethnographic poetry, contemporaine du poetic turn de l'ethnologie américaine15. Dans ce cas (et à la différence de ce qu'on observait chez les élèves de Franz Boas — Ruth Benedict, Edward Sapir, Margaret Mead —, qui n'évoquaient que très rarement leurs enquêtes et leurs objets dans leurs vers), la matière anthropologique et l’expérience du terrain font l’objet de mise en poèmes et d’expression poétique, souvent au nom des limites de la description ethnographique classique. Les représentants les plus engagés dans cette voie étaient ceux-là mêmes qui figuraient dans le dossier spécial de Dialectical Anthropology : Denis Teddlock, Stanley Diamond, David Price, Gary Snyder — et tous pourraient reprendre à leur compte la formule de Dell Hymes à propos des poèmes de Stanley Diamond : « La poésie, c'est la continuation de l'anthropologie par d'autres moyens. » Leur reconnaissance institutionnelle va d’ailleurs de pair avec une conceptualisation de la poésie comme « méthode ethnographique »: ils usent de la poésie
comme d'un moyen immédiat pour saisir intuitivement et de manière empathique les sujets natifs en même temps que leur propre historicité, faisant ainsi émerger des aspects inconscients et révélateurs mieux que la prose ne le permet16.
15De telles entreprises sont assez étrangères à la tradition française — aux traditions françaises, faudrait-il dire, que l'on regarde du côté de l'anthropologie et de son héritage théorique et sociologique, ou du côté d'une poésie qui, au xxe siècle, ne se fonde guère sur un idéal expressif de restitution de l'expérience individuelle et se tient à bonne distance des réalités concrètes et quotidiennes (on peut certes évoquer l'huître ou la pomme de terre, mais pas le jukebox).
16Cela dit, à défaut de réalisations, on trouve chez certains ethnologues français l'expression d'un tel désir de poésie qui pallierait l'incapacité du discours savant à embrasser et saisir la complexité de l'expérience ethnographique. C'est ici que viendraient se ranger les appels, au fond assez communs, à la poésie comme au-delà de l’anthropologie. C’est ainsi que Georges Bataille avait lu Tristes tropiques, par exemple. Considérant l'ouvrage comme une coda en supplément du travail savant de Claude Lévi‑Strauss, il y voyait la preuve que, une fois parvenu à ses fins descriptives et explicatives, l’ethnologue doit s’incliner devant le poète et lui laisser la place afin — comme il le disait déjà à propos de L’Île de Pâques d’Alfred Métraux — de « donne[r] la dimension poétique de ce dont [il] parle, qui l’éclaire de manière à rendre sensible un élément souverain, que ne subordonne aucun calcul17 ». Seule une « ouverture poétique », continuait Bataille, permet d’atteindre « la dimension de l’homme », ce « domaine inaccessible à la science proprement dite18 ». Mais c’est aussi le terrain théoriquement le plus glissant, car on a tôt fait de faire de la poésie l’autre de la science, en un face-à-face stérile voire idéologiquement dangereux. Bien qu'il ne s’agisse pas encore d’ethnologie au sens moderne, on peut ici évoquer les très nombreuses critiques dirigées au long du xxe siècle contre la sociologie durkheimienne et ses matériaux ethnographiques, « accumulation d’observations patientes, où les mœurs des sauvages, des Botocudos et des Iroquois tiennent la plus grande place19 ». Souvent fondées sur de vagues références à l’intuition bergsonienne, ces critiques ne se contentent pas de raidir le rapport entre savant et poète en les opposant comme l’athée au croyant ; elles se teintent parfois d’un irrationalisme suspect qui glorifie les esprits supérieurs dont la sagacité et les traits de génie surpassent les avancées laborieuses de la science. C’est ce qu’avait bien perçu Marcel Mauss à la lecture de Le Mythe et l’Homme de Roger Caillois : dans « cette espèce de philosophie politique que vous essayez d’en sortir au nom de la poésie », il reconnaissait « un déraillement général », une « espèce d’irrationalisme absolu » et « l’influence de Heidegger, bergsonien attardé dans l’hitlérisme, légitimant l’hitlérisme entiché d’irrationalisme20 ». Plusieurs trajectoires individuelles résonnent avec l'avertissement de Mauss et lui donnent rétrospectivement des allures prémonitoires : celle de Henri Massis (1886‑1970), l’une des deux figures cachées sous le pseudonyme d’Agathon qui signe en 1911 L’Esprit de la Nouvelle Sorbonne, virulent pamphlet ciblant en particulier Lévy‑Bruhl et Durkheim au nom des « chefs-d'œuvre » de la « culture classique française » — Massis qui rejoindrait bientôt l'Action française, rédigerait un Manifeste des intellectuels français pour la défense de l’Occident (1927), avant de devenir pétainiste et collaborateur — ; celle de Ramon Fernandez (1894‑1944) qui, en 1935, mettait en scène le face-à-face du sociologue et du poète, insistant sur la supériorité du second, avant de glisser progressivement du socialisme au fascisme et finalement à la collaboration ; celle de Jules Monnerot (1909‑1995), d’abord marxiste et proche des surréalistes, puis anti-durkheimien fervent, auteur de Les Faits sociaux ne sont pas des choses (1945), ralliant finalement l’extrême‑droite et appelant dans ses derniers écrits à un « patriotisme de civilisation21 ».
17Il n'est évidemment pas question d'assimiler toutes les critiques de la science sociale à de telles dérives de même qu'il serait très réducteur de voir, dans ces polarisations ethnologie / poésie, un facteur à lui seul déterminant de ces différents parcours individuels. Il reste que les similitudes sont troublantes et signalent que la dénonciation du projet anthropologique assortie d’une idéalisation de la poésie s'inscrit parfois dans une dynamique idéologique plus large dont le fascisme est un point d'arrivée possible. Ici encore, donc, la patience et la nuance sont de règle et ce sont les cas particuliers qui doivent imposer à l'analyse ses critères si l'on ne veut pas replier les unes sur les autres les grandes oppositions entre intuition et raison, foi et savoir, poésie et logique, empathie et abstraction, etc. On pense en particulier à l'articulation entre ethnologie, poésie et spiritualité — sur laquelle se greffe le vaste dossier des rapports entre anthropologie et mission — qui est singulièrement complexe et riche, et mérite mieux qu'un face-à-face entre science et mystique. Il suffit de penser aux très nombreuses relectures du travail de Maurice Leenhardt qui, s’il ne parle jamais de poésie à ce propos, traduit les mythes et légendes canaques et s’émerveille de la place accordée à la parole dans les représentations indigènes en même temps que de l’expressivité esthétique qui imprègne la vie quotidienne22. Il croit pouvoir y lire une « synthèse de l’intelligence et de l’affectivité » et une « contrepartie » (selon deux formules de James Clifford23), qui font pièce aux tendances rationalistes et analytiques d’une société occidentale sécularisée : « Ah certes, ils ne pratiquent point l’art pour l’art, les artistes de la Grand Terre !24 ».
18Dans ce dossier, Stefania Capone s'attache par exemple au cas de Roger Bastide — protestant comme Leenhardt qui fut pour lui une influence majeure —, auteur de poèmes en prose dans sa jeunesse, lecteur passionné de Barrès et de la poésie spiritualiste de l'entre-deux-guerres (particulièrement de Pierre‑Jean Jouve) et qui, devenu ethnologue se propose de considérer « la poésie comme méthode sociologique » afin d'accéder à une meilleure compréhension des phénomènes religieux et particulièrement de la mystique du candomblé. La poésie ici ne correspond pas à une pratique d'écriture, mais nomme un idéal de compréhension sympathique seul apte à saisir le phénomène mystique, au seuil duquel — si l’on en croit Bastide — s'arrêtent les approches rationalistes durkheimiennes. Ce sentiment d'une insuffisance, on le retrouve bien sûr ailleurs, sous des formes plus ou moins élaborées. C’est Jolas qui rend compte à Char de son terrain à Minot, puis dans la Creuse, pour alimenter son imagination poétique et dépasser la pauvre science qui tombe toujours dans « l’ornière des résultats ». C'est Pierre Clastres qui, soucieux d'éviter une forme d'aplatissement, choisit de donner sa réflexion sur la parole prophétique guarani à une revue de poésie, L'Éphémère, plutôt qu'à une revue d'anthropologie et l'accompagne d'une traduction de la « prière méditante d'un Indien », « tragique dans le silence matinal d'une forêt »25. C'est Alfred Métraux qui, revenant à la nuit tombée d’une séance vaudou dans un quartier populaire de Port‑au‑Prince en compagnie de Leiris, rêve d'un « moyen de rendre compte exactement de ce que [sont] ces rues [...] et de l’aspect de leurs maisons ». Et Leiris d’expliquer qu’un tel souci « n’était pas seulement un souci de spécialiste avide de précision, mais un souci d’ordre proprement poétique : ne pas se contenter de décrire les choses mais, les ayant saisies dans toute leur réalité singulière, les faire vivre sous les yeux de celui qui vous lit ». Et de conclure que Métraux n’était pas seulement « un observateur scrupuleux », mais
ce que j’appelle un poète […] non point tellement quelqu'un qui écrit des poèmes, mais quelqu’un qui voudrait parvenir à une absolue saisie de ce en quoi il vit et à rompre son isolement par la communication de cette saisie26.
19 C'est sans doute Georges Condominas — dont l'œuvre singulière fait ici l'objet de l'attention soutenue d'Éléonore Devevey — qui illustre le mieux cette fertilisation de l’anthropologie par la poésie. Difficile dans son cas de dire si la poésie est base ou sommet : il évoque certes une vocation artistique initiale (mais quel adolescent un peu lecteur et un peu sensible ne s'est pas projeté poète ou écrivain ?) et présente sa carrière d'ethnologue comme un choix fortuit ; pourtant, tout montre que son travail d'ethnologue n'a pas été un pis-aller faute d'œuvre mais plutôt une réponse à un souci poétique constant (aiguisé par la lecture des poètes, d'Henri Michaux particulièrement, véritable compagnon de terrain) et ce qu'Eléonore Devevey nomme un « crédit fervent donné à la parole, à la fois comme fait humain par excellence et comme médium d’expériences esthétiques ». La poésie non comme œuvre mais comme forme de réceptivité qui « brouille le partage jugé par lui trop net entre réception et création ». Son cas illustre exemplairement l'une des propositions essentielles de Marielle Macé dans l'entretien qu'elle nous accorde et qui invite à penser l'interface réelle entre poésie et sciences sociales en combinant deux mouvements: d'une part, en désessentialisant la poésie au profit de certains poètes ou de certains poèmes ou même de certains aspects de tel ou tel poème; d'autre part, en reconnaissant des vertus proprement intellectuelles à la poésie, en tant que travail sur les différences, la variation et les seuils.
Traduction, transaction, translation
20 Les exemples de Condominas et Clastres conduisent à envisager, enfin, un dernier aspect des rapports entre anthropologie et poésie, à savoir ce que Jerome Rothenberg a baptisé l’ethnopoétique27, qu'illustrent les treize numéros de la fascinante revue Alcheringa Ethnopoetics qu'il a d'abord codirigée avec Dennis Tedlock de 1970 à 1976, avant de fonder la revue New Wilderness Letter (1976-1984) tandis que Tedlock restait seul à la direction d'Alcheringa28. Ce n’est plus l'ethnographic poetry, qui visait à faire des poèmes ou de la prose poétique à partir de matériaux de terrain. Là, il s’agit de rendre la poésie des Autres dans une forme équivalente chez Nous29. Ici encore, une telle tentative n'a pas de véritable équivalent français, en tout cas pas à une telle échelle. Mais les préoccupations des acteurs d'Alcheringa se retrouvent chez plusieurs ethnologues éminents, à commencer donc par Condominas qui noue un lien intime et profond avec la poésie orale mnong (et tout particulièrement avec le chant intitulé « Le Déluge » dont l'aventure, depuis la première audition sur le terrain jusqu'à la traduction et la publication, dure plus de trente ans).
21 Mais son exemple invite à renverser quelque peu la perspective. En considérant l'ethnopoétique comme un courant, ou un épisode de l’histoire de l’anthropologie, on se place dans la position fausse de l'historien qui, après coup, se penche sur l'évolution des savoirs et des institutions, identifie des moments et des types. Or ce qui est premier pour les ethnographes concernés — et inutile ici de considérer les écoles ou les traditions nationales —, ce n'est ni un choix de méthode, ni un choix d'objet, mais le saisissement lors de la découverte de la poésie des autres, et ils sont nombreux à rapporter une telle expérience de la poésie en acte comme le moment suprême (à la fois unique et totalisateur) du terrain ethnographique, qui constitue non seulement une voie d'entrée privilégiée pour comprendre la société étudiée mais qui est, de plus, vécue et éprouvée comme une expérience elle-même poétique. Car c'est devant la poésie des autres, lorsqu'on la voit, l'entend, et qu'on en perçoit les effets que — de façon privilégiée — la poésie excède le poème et « se dilate aux dimensions de la situation » (pour reprendre une formule d'Eléonore Devevey). La poésie devient alors le nom de ce qui rapproche et de ce qui éloigne à la fois ; elle est un pont tendu par-delà la différence — puisqu'elle s'éprouve — en même temps que le rappel d'une opacité indépassable — puisqu'elle confronte avec ce qui est absolument propre à une collectivité, à une terre, à un monde30.
22 Deux voies s'ouvrent alors, que notre dossier indique sans les explorer, et qui sont deux modes particuliers d’actualisation des rapports entre anthropologie et poésie. La première est bien sûr la figure du traducteur — entendu non pas ici dans un sens large et maximaliste, qui fait de la traduction un modèle épistémologique pour une ethnologie conçue comme « traduction culturelle31 » —, mais traducteur au sens concret, en lutte avec les mots, à l'œuvre entre les mondes. Ici, la tâche de l'ethnologue se confond très profondément avec celle du poète traducteur confronté à cette « idée partout répandue et partout contredite : la poésie serait l'intraduisible même »32, idée dont Michel Deguy montre que, loin d'indiquer ses limites, elle fait de la traduction l'horizon même de la poésie. Comme le poète selon Deguy, l'ethnologue — c'est un axiome premier de sa discipline et de sa pratique, et avant d'être un axiome, une conviction impensée et irréfragable, de celles qui font les vocations — « ne rêve pas de l'unité de la langue avant Babel car c'est au commencement qu'il y a Babel, au commencement qu'il y a la différence » : pour lui, « la multitude est le fait premier et [...] c'est à cette multitude qu'il faut être fidèle33. » Si les rencontres avec la poésie des autres sont si marquantes pour les ethnographes de terrain et si elles sont elles-mêmes vécues comme des « moments poétiques », c'est qu'elles révèlent la profonde communauté de l'ethnologie et de la traduction poétique comme expérience de l'autre dans le même et du même dans l'autre. Elles définissent la tâche de l'ethnologue comme la quête ou plutôt l'invention d'« un "même" qui se conserverait dans le mouvement ; un "même" qui ne peut être, lui, déterminé à part, c'est-à-dire en aucune langue » : « Le même est précisément ce qui ne peut être isolé, circonscrit. Il est ce qui transite. Le même est entre ; et il n'y a pas d'entre langues34. » C'est à une telle tentative qu'on peut rapporter l'entreprise ethnopoétique de Rothenberg, Tedlock ou Hymes — si l'on veut bien la considérer sérieusement et non simplement comme l'écume primitiviste et new age d'une avant-garde new-yorkaise des années 197035. Il ne s'agit pas, en traduisant, de montrer au monde d'ici la beauté et la dignité de ces objets venus d'ailleurs, ni même d'élever la traduction des poèmes des autres au rang de poésie elle-même, mais bien de retrouver une identité fondamentale entre pratique ethnographique et traduction poétique. À défaut d'équivalent de la revue Alcheringa, on peut trouver dans la tradition française des indices qui pointent en direction d'une telle identité, à commencer par le recueil La Planche de vivre, anthologie de poèmes venus « de temps et de pays divers », traduits et proposés en édition bilingue, et seul ouvrage cosigné par l'ethnologue Tina Jolas et le poète René Char36.
23Le second motif qui actualise les rapports réels et concrets entre poésie et ethnographie est le prolongement du motif de la traduction. Il surgit lorsque la poésie devient un espace de transaction et le poème une « monnaie d'échange », si l'on veut, qui équilibre les rapports toujours asymétriques entre l'ethnographe et les indigènes. Dans ce cas, c'est l'ethnographe qui, à la demande — explicite ou non — de ces informateurs, offre, en contre-don pour la collecte de mythes et légendes indigènes, un poème qui lui appartient en propre. Voici comment Christine Laurière, s'appuyant sur le récit d'Henri Lavachery, compagnon d'Alfred Métraux sur l'île de Pâques en 1934, reconstitue la scène :
Après plus de dix semaines d’enquête, Métraux sent que le vent tourne, il est de plus en plus alarmé face au manque d’entrain, à la lassitude affichée ostensiblement par Tepano. Soucieux de le ménager, il le prend au mot et décide de raconter un mythe célèbre de son pays. Inspiré, Métraux choisit l’Odyssée et se met à narrer le périple et les aventures d’Ulysse, puni par les dieux à errer sans fin et à subir leur courroux. Les veillées ont lieu au camp d’Hanga Hoonu, sous la grande tente qui fait office tout à la fois de magasin, de salle à manger et de bureau. Elles réunissent une petite dizaine de personnes, y compris Lavachery et Métraux. Captivés par le récit de Métraux, tous ont le visage tendu vers lui ; « Tepano seul ne regarde pas le conteur ; il a le front plissé, penché vers la terre, comme si le récit était présenté à sa critique. Métraux, poursuit Lavachery, raconte les voyages d’Ulysse avec un sens, je dirai “ethnographique”, de son auditoire. » Ulysse est ainsi devenu, pour les besoins de la prononciation, Ulite, et il est ariki, c’est-à-dire noble. Il ne retrouve plus son île et vogue sur son canot d’une terre à l’autre. Habilement, l’ethnographe ménage ses effets en ne racontant qu’un épisode par soirée pour maintenir l’attention de son auditoire, qui va crescendo. Il instille des éléments polynésiens dans la trame du récit afin de le rendre compréhensible : Circé est devenue la Tatané Tirté, qui change les compagnons d’Ulite en cochons. Cette aventure et celle du Cyclope ravissent les indigènes qui, à leur tour, propagent dans le village les fortunes et infortunes d’Ulite. Tout le monde à Hanga Roa finit par connaître le personnage d’Homère, et un petit garçon sera même baptisé Ulite37.
24L'épisode est d'une grande richesse, et son analyse pourrait ajouter un chapitre polynésien à la déjà très vaste Bibliothèque de Circé, selon la belle formule de Marc Escola et Sophie Rabau38. Mais il importe d'abord de saisir qu'il ne s'agit nullement d'un hapax. C'est au contraire une situation générique dont on pourrait recenser les illustrations39. On trouve un épisode très semblable dans la relation de Condominas, L'Exotique est quotidien, épisode que rapporte ici Eléonore Devevey — sauf que la logique de l'échange se poursuit un pas plus loin, puisque l’ethnologue ne se contente pas de livrer à son informateur une épopée de son pays (l’épisode des sirènes de l’Odyssée) en « cherch[ant] à transposer l’histoire, pour la mouler dans un contexte mnong40 »: il lui est même donné de la voir adaptée et récitée à la veillée :
Et Kroong-Gros-Nombril de répéter les aventures de Paang Yoo Ulit ! Oh, ce n’était pas tout à fait ce que je lui avais raconté moi-même. Mais mon récit renaissait, magnifiquement transfiguré. Baap Can et les siens s’étaient rapprochés. Dieu, que c’était beau !... Sur les maigres éléments, secs, sans vie, hésitants, hachés, alourdis d’explications, que je lui avais livrés quelques instants auparavant, Kroong, par la magie de sa puissance poétique, nous restituait, avec une aisance et une vérité extraordinaires, l’épopée de l’astucieux Mtao böh yoo Böh süp [le roi des temps anciens]. On aurait juré une noo pröö, apprise au cours de plusieurs soirées où il aurait entendu quelques vieux kuang la répéter. C’était si beau, si vrai, que, surpris par cette histoire sublime que j’entendais pour la première fois, j’en oubliai de noter la transcription magistrale que Kroong faisait du conte squelettique que je lui avais si piteusement servi.
Pétrissant de la boue, il en a fait de l’or.
Qui sait si, plus tard, quelque ethnologue, revenant dans ces parages, ne sera pas intrigué par une belle légende qui s’apparente curieusement à celle de l’astucieux roi d’Ithaque !41
25À la lecture de ces lignes, on comprend que l’image de la poésie comme « monnaie d’échange » est insuffisante : ce qui est en jeu ici est une expérience non pas partagée, mais réciproque, d’une langue et d’un contexte qui éprouvent leurs propres limites pour accueillir le récit de l’autre :
Le schème de l’hospitalité est celui de se priver pour être comme. Traduire, c’est se traduire vers, au-devant de l’arrivant. Jusqu’où sa langue peut-elle sortir de soi au-devant de l’autre en vue de la rencontre, avec des échanges, c’est la question, expérience de la limite42.
26La poésie échangée ne relève donc pas seulement d’une transaction permettant de corriger un rapport de force déséquilibré. À défaut de symétriser l’ethnologie elle-même, l’Ulite pascuan et le Paang Yoo Ulit mnong ouvrent la possibilité d’une communauté fondée non sur l’identité (l’exorbitant going native) mais sur la désappartenance consentie, sur l’arrachement réciproque au soi ; ils expriment un effort non pour faire entendre la langue de l’autre dans sa propre langue, mais pour « inventer dans sa propre langue un rapport d’étrangeté analogue à celui qui était produit par l’œuvre à traduire »43.
Conclusion : attention, croisements
27« Poésie des carrefours » est la belle expression que Michel Leiris avait forgée pour qualifier à la fois son émerveillement devant la beauté immédiate des métissages culturels aux Antilles — qu’il fréquente à la fin des années 1940 en compagnie d’Alfred Métraux — et la présence, là-bas, du poétique au ras du sol, imprégnant les rues, les boutiques, le quotidien44. Poésie de la rencontre — entre civilisations, mais aussi entre artistes et intellectuels — et poésie de la différence s’amalgamaient dans ces « carrefours » qui, comme l’a bien souligné Anna Lesne dans un article récent45, recelaient une polysémie assumée et fonctionnaient comme un concept, ou à tout le moins une grille de lecture desserrant les îles de leur isolement, de leur uniformité et de leur immobilisme supposés. Mais le terme a, aujourd’hui, perdu de sa plasticité. Il s’est replié sur son nœud organisateur et topographique, ordonnant des pôles et livrant les directions à prendre par des indications : « Pour la Poésie, continuez tout droit », « À gauche, l’Action », « Tournez à droite, et c’est l’Ethnologie », etc. Cette dimension n’est pas absente chez Leiris mais c'est l’intérêt pour le nœud qui le guide, la façon dont son ami Aimé Césaire, par exemple, parvient à faire que les registres se fondent les uns dans les autres en évitant les écueils de l’exclusion (si je vais vers la Poésie, je ne vais pas vers l’Action) et de la coexistence suspecte46. Comme si, lieu centripète plus que centrifuge, le carrefour devait idéalement exercer sa force d’attraction, tirer à lui les pôles indiqués pour les replier les uns sur les autres, et révéler dans cette opération leur asymétrie puisque que la coïncidence des contraires est, pour Leiris, le signe même de la « grande poésie » forcément « totale47 ».
28 Nous avons pris ici le parti d’un degré zéro du carrefour, quand il ne stabilise pas encore durablement l’organisation de l’espace, quand la manière de la rencontre, les directions, les chemins ne sont pas encore fixés par une signalisation réglée, des panneaux indicateurs, ou un tracé conventionnel. Tout juste un fait de croisement donc, entre des lignes poétiques et des lignes ethnologiques qui peuvent se couper en divers endroits selon les situations, conduire à des bifurcations de ceux qui les empruntent, permettre en suivant une ligne de croiser l’autre à plusieurs reprises. Mais le provisoire et l’incertain règnent sur l’organisation territoriale que creusent nos intersections. Et pour une raison principale : il n’y a pas d’espace préexistant stabilisé sur lequel tirer les azimuts et faire les tracés. L’espace — de l’organisation des savoirs, des modes d’élucidation du réel — surgit, à chaque fois neuf et à chaque fois recommencé, de quelques croisements premiers.
29Encore fallait-il que les cheminements de l’ethnographique et du poétique se croisent de façon assez répétée pour qu’on pût les situer sur un même plan ou qu’on pût imaginer pour eux un plan commun né de ces rencontres multipliées. Ce plan est fait d’un point de vue singulier qu’ont en partage la poésie et l’anthropologie et qui est, dans les mots de Michel Deguy, celui de la perspective « très ailleurs très près48 ». C’est un trait qui permet du reste de signaler une propriété de la fécondation de l’anthropologie par la poésie. Cette dernière semble en effet constituer un levier efficace pour maintenir constant, c’est‑à‑dire y compris au sein de sa propre société, un regard appliqué à débusquer les séries de différences et de ressemblances essentielles et à créer un effet de transparence qui corrige le chaos ou l’ordre trop réglé des apparences. « L’acte d’attention » qu’est le poème — comme le qualifiait David H. Lawrence — encourage chez l’anthropologue qui y est sensible un déchiffrement nouveau du monde le plus immédiat, celui peuplé par les « natives of the near kind » selon la belle expression de Dennis Tedlock49.
30Il pourra ainsi estranger le proche (« découvrir un nouveau monde à l’intérieur du monde connu » à l’instar de la mission de la poésie, poursuit Lawrence50) ou au contraire abolir la fracture née d’une distance lue comme irrémédiable (altérité imprenable qui vous sidère par sa beauté ou sa détresse, par sa beauté et sa détresse) pour établir le plan neuf d’unité sur lequel les individus peuvent se nuancer les uns par rapport aux autres grâce à de nouveaux descripteurs et, en général, grâce à l’attention prêtée à la langue. Cela ne consistera pas prioritairement en l’élaboration de nouvelles métaphores faussement destinées à faire entendre chez nous la voix de ceux qui n’ont, par ce geste, qu’été déplacés d’un autre monde à un monde parallèle au nôtre, c’est‑à‑dire à jamais disjoint. Il s'agira au contraire de ménager, et par les mots d’abord, des voies d’accès concrètes et immédiates qui permettront de passer de la sidération à la considération, selon la formule de Marielle Macé51, d’une poésie comme marque d’une indépassable altérité au poème d’intervention, d’une anthropologie fascinée à une anthropologie à symétrie tendancielle.
31Mais il ne s’agira pas non plus, d'exotiser le semblable, et par souci de signaler les écarts là où l’on n’identifiait auparavant que du même, d’éloigner, par d’autres jeux de langage, les atomes qui composent les collectifs de nature diverse que nous formons pour n’en faire que des îles, reliées seulement par quelques ponts constitués d’intentions, de stratégies et d’intérêts bien compris. Aussi l’on souhaiterait pour finir que ces réflexions sur anthropologie et poésie soient l'occasion de repenser l’anthropologie du proche. Nous voudrions suggérer, à l’encontre d’une certaine tradition historiographique, que celle-ci n’est pas seulement, ni même principalement, l’héritière des travaux des folkloristes retamisés par « la science », ni une démarche de repli pour des anthropologues du lointain que la décolonisation aurait condamnés à résidence forcée. L'anthropologie du proche est d’abord le fait d’anthropologues en prise avec le poétique, c’est-à-dire d’une attention aux différences et aux ressemblances maintenue par une pratique du poème, acte premier d’attention52. Et l’on veut croire que c’est aussi le recul poétique qui alimente cette capacité d’estrangement qui, peut‑être, forme le noyau de l’opération de dédoublement qui qualifie l’anthropologie en son cœur (ici / là‑bas, nous / eux, le même / l’autre, etc.)53 et que l’anthropologie du proche a dû reconstruire car son enquête ne se situait pas immédiatement entre les mondes. Par cet effort supplémentaire qui lui incombe, elle révèle donc l'origine poétique de cette opération de dédoublement qui est au cœur de toute entreprise ethnologique, et dévoile que le faux dualisme du couple poésie / anthropologie recouvre en réalité la diversité des manifestations d'un impératif plus fondamental : il faut être deux.